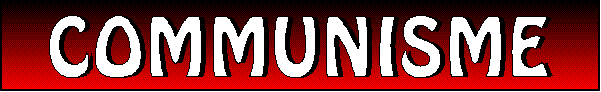
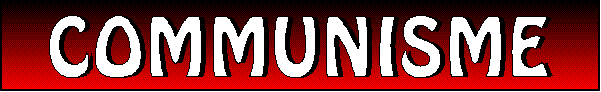
Nous n'avons pas pour habitude de nous appesantir sur l'analyse des contradictions que le partage du monde engendre au sein de la bourgeoisie. C'est d'ailleurs un reproche qui nous est fréquemment adressé: nous manquerions de subtilité et de richesse d'analyse. Nous pensons, quant à nous, que le développement du capitalisme mondial a polarisé l'ensemble de la société à tel point que toute analyse, pour être rigoureuse, doit précisément se centrer sur la contradiction essentielle; nous pensons que la catastrophe de la société bourgeoise mondiale est d'une amplitude telle que c'est la survie de l'espèce humaine elle-même qui est en jeu et que noyer cette contradiction dans des dizaines d'autres, moins importantes, comme le font presque tous les écrits à la mode aujourd'hui, est une irresponsabilité grave vis-à-vis de l'enjeu actuel. Autrement dit, pour nous, une analyse qui ne prend pas pour axe central l'antagonisme entre la vie et la mort de cette société, entre l'intensification de la catastrophe actuelle et sa destruction révolutionnaire, entre la bourgeoisie et le prolétariat, entre la persistance du capitalisme et le communisme, ne constitue rien d'autre qu'une sorte de marécage idéologique dans lequel l'analyse et le lecteur sont irrémédiablement engloutis. C'est bien évidemment dans ce marécage que la bourgeoisie aimerait nous confiner et, pour ce faire, rien de plus utile que les dits «moyens de communication», spécialisés dans l'interprétation isolée des faits et toujours prêts à réduire un événement à ce qu'il a de particulier, dissimulant ainsi systématiquement les causes communes de la catastrophe actuelle.
En réalité, si dans tous nos travaux nous nous concentrons sur la contradiction fondamentale, au risque d'être traités de simplistes par ceux qui nous critiquent, c'est du fait de notre conception révolutionnaire, de notre compréhension globale de la société et de notre analyse de la période actuelle; il s'agit donc d'une décision délibérée, une option de lutte, d'agitation et de dénonciation de la globalité de la société actuelle. Il est certain que d'autres militants avant nous, tout en se centrant sur l'axe bourgeoisie/prolétariat, capitalisme ou révolution, ont accordé une importance beaucoup plus grande à d'autres analyses et, en particulier, aux contradictions entre les fractions bourgeoises. Nous ne considérons pas que cela soit inutile, loin de là. Si nous nous y attardons rarement c'est pour trois raisons essentielles.
Premièrement, parce que, comme nous l'avons déjà signalé et comme d'autres militants révolutionnaires l'avaient prévu il y a plus d'un siècle et demi déjà, toutes les contradictions sociales se sont simplifiées et se sont concentrées dans la polarisation centrale de la société.
Deuxièmement, parce qu'il s'agit d'une option militante que nous avons adoptée résolument, à contre-courant de l'idéologie particulariste dominante.
Troisièmement, parce qu'au vu de l'absence généralisée d'analyse véritablement classiste dans le monde, notre priorité ne peut être que de nous focaliser sur la contradiction centrale.
Encore une fois, cela ne signifie pas que les contradictions interbourgeoises, les contradictions entre fractions du capital à l'échelle régionale et internationale ne nous intéressent pas, c'est simplement que nous les considérons moins importantes que la contradiction entre le système capitaliste et la nécessaire révolution sociale.
Cela dit, lorsque nous analysons les contradictions interbourgeoises, nos textes se singularisent par le fait de systématiquement mettre en évidence que toutes les contradictions sont le produit de la contradiction principale. Nos articles parlent des différentes fractions bourgeoises, mais au lieu d'y faire référence de façon autonome, en fonction par exemple de leurs différentes formes d'accumulation (bourgeoisie agraire, bourgeoisie industrielle, bourgeoisie bancaire, bourgeoisie commerciale,...), nous y référons en les définissant directement sous la forme qu'elles revêtent dans l'affrontement à notre classe (parti de l'ordre, parti social-démocrate ou fasciste et anti-fasciste ou droite et gauche,...) ce qui, évidemment, situe ces contradictions interbourgeoises à leur véritable place, une place tout à fait secondaire par rapport à la contradiction fondamentale. Substantiellement, il s'agit d'analyser les diverses tactiques utilisées par le capital pour maintenir sa domination sur notre classe.
Dans ce numéro de Communisme, nous entrerons cependant un peu plus en détail dans l'examen des contradictions interbourgeoises. Etant donné qu'il s'agit d'analyser le comportement et les tactiques utilisées par les différentes fractions du capital pour constituer différentes forces dans la lutte pour le partage du monde, nous tenterons de mettre en évidence les critères qui guident ces fractions et ce, bien sûr, sans perdre de vue le cadre général de la tendance constante du capital à la généralisation de la guerre impérialiste. Ceci nous conduira à exprimer, plus concrètement que ce que nous l'avons fait précédemment, les tendances générales du capital: centripètes, alliances et unifications et centrifuges, ruptures et guerres. Simultanément l'analyse du capitalisme mondial et de la concurrence, l'examen de la valeur s'accumulant et guerroyant contre toute autre unité de valorisation, s'atomisant et s'attirant, nous mènera à distinguer des fractions du capital mondial plus générales et plus précises que les fractions classiques rangées selon le type de secteur économique: fractions libre-échangistes et fractions protectionnistes (1). La tendance générale du capital (produit de la concurrence internationale et de la loi de la valeur à l'échelle de la planète) est de liquider les secteurs et fractions qui ne sont pas à même de le concurrencer; c'est l'application sans restriction de la loi de la valeur à l'échelle internationale. Cependant, cette tendance se voit toujours contrecarrée par les intérêts de ces mêmes secteurs et fractions que cette dynamique conduit à la ruine. Ceux-ci s'unifient dès lors également pour défendre leurs intérêts dans la lutte pour s'emparer des forces productives et des marchés de la planète. Cette analyse des mécanismes du capital, que nous avons déjà exprimée dans d'autres textes, permet non seulement de mieux comprendre les alliances et les guerres, les changements de tactiques et de discours des militaires, des syndicalistes, des journalistes et des politiciens, mais aussi de saisir ce qu'il y a derrière ces polarisations présentées au public comme la gauche et la droite, le fascisme et l'anti-fascisme, les «pays capitalistes» et les «pays socialistes», les «mondialistes» et les «écologistes», les friedmaniens et les keynésiens, les «atlantistes» et les «yougoslaves»,...
Ces structurations bourgeoises organisées à différents niveaux nous obligent à faire un éclaircissement concernant l'Etat. Pour nous, l'Etat est toujours synonyme de concentration de capital en force de domination et de reproduction élargie de la société bourgeoise. Mais le capital, dont l'essence est la concurrence, est en même temps lutte de capitaux et alliance de fractions bourgeoises, lutte de capitaux qui s'affrontent, qui obéissent au processus d'attraction des atomes de valeur et alliance de fractions bourgeoises qui tendent à s'organiser en forces spécifiques, en Etats particuliers -des Etats qui ne coïncident pas avec les pays, et que ces alliances cherchent même à redéfinir au cours de leurs batailles. Cependant, comme concrétisation de la force du capital mondial et en même temps comme concentration de forces particulières contre d'autres capitaux, la structuration en force au sein d'un pays avec sa propre armée et ses propres structures gouvernementales et de contrôle représente un niveau important de la centralisation en force. Il n'est pas une fraction bourgeoise d'un ou plusieurs espaces productifs qui ne se batte pour diriger chacune de ces concrétisations de l'Etat général du capital, pour contrôler le pouvoir de ces Etats «nationaux» (2), ce qui conduit à parler de pays, de parcelles de ces pays qui s'autonomisent, d'Etats à différents niveaux de définition, de guerre, de redéfinition de frontières, d'autonomies et de nouveaux pays.
Mais de là à affirmer, comme on l'entend tous les jours, que «la France bombarde la Yougoslavie», ou que «les Serbes attaquent les Kosovars», ou que «les Etats-Unis ont déclaré la guerre à l'Irak», c'est évidemment associer les exploités aux exploiteurs, ce qui favorise de fait les intérêts de ces derniers et représente objectivement un point de vue bourgeois (même si celui qui utilise ces expressions n'en a pas conscience). C'est pour cela que les médias parlent sans cesse de pays en guerre les uns contre les autres. Ils reproduisent ainsi l'idéologie dominante et aident à affirmer la communauté nationale assurant l'exploitation et l'utilisation des dominés comme chair à canon dans les guerres. Nous nous efforçons de ne jamais nous exprimer de la sorte. C'est pourquoi, au lieu de parler de pays, nous parlerons de tel ou tel Etat, de l'Etat de tel ou tel pays (entendez par là l'Etat dans tel ou tel pays) pour insister sur le fait qu'il s'agit de la force organisée des exploiteurs; une force organisée qui vise tout autant à maintenir l'exploitation dans telle ou telle région du monde qu'à affirmer leur intérêt particulier en tant que fraction bourgeoise spécifique face à d'autres. Cette façon de parler est sans doute parfois pesante (cf. les USA: l'Etat des Etats-Unis?!), mais il est évident aussi que le langage n'est pas fait pour exprimer notre point de vue de classe, et bien plutôt celui de notre ennemi. Nous nous excusons donc de la lourdeur de certains de nos textes et nous accueillerons avec joie toute proposition intéressante à ce sujet, mais nous estimons indispensable ce souci de précision terminologique dans le cadre d'une analyse des fractions bourgeoises, analyse qui nous semble bien plus claire que tout ce que nous rencontrons généralement.
Le premier texte de cette revue montrera que, contrairement aux analyses «marxistes» qui se perdent dans les méandres des contradictions interbourgeoises et finissent par se soumettre à celles-ci, notre analyse, même lorsqu'elle se concentre sur ces contradictions, ne perd jamais de vue l'axe central communisme-capitalisme. Nous verrons ainsi que les contradictions entre fractions impérialistes sont déterminées en dernière instance par la façon d'affronter le prolétariat, et, dans le cas particulier de la guerre en Yougoslavie, par la capacité de mener le prolétariat à la guerre. Nous verrons, par exemple, que la poursuite de la guerre dans les Balkans supposait une intervention terrestre ayant comme corollaire des niveaux de mobilisation du prolétariat bien supérieurs à ceux atteints jusque-là.
Dans le second texte, sans jamais oublier la contradiction fondamentale, nous verrons comment les tentatives de généralisation de la guerre vinrent se heurter à l'apathie générale du prolétariat international, voire même à une importante résistance contre la guerre, particulièrement dans la zone de conflit. Nous verrons que la désertion, la démobilisation, l'action directe contre la guerre dans les différentes régions auxquelles nous nous référons dans le texte ont représenté un frein important à l'escalade guerrière, toutes ces actions de lutte constituant également un appel exemplaire de nos frères de classe dans cette région, une invitation à ce que l'on s'affronte partout à la bourgeoisie. Nous constaterons pour terminer que si, pour le moment, le capitalisme parvient plus ou moins à maintenir l'immonde ordre bourgeois international et la relative paix sociale qui le caractérise, dès qu'il assume ses immanents besoins bellicistes, toutes les contradictions sociales s'intensifient et la réémergence du prolétariat devient évidente, quels que soient les efforts faits par la bourgeoisie pour l'occulter. Cette réémergence, qui s'est de façon embryonnaire exprimée en ex-Yougoslavie désigne, malgré ses limites, le chemin de l'opposition à la guerre: l'action directe contre sa propre bourgeoisie, c'est-à-dire, la révolution mondiale.
Chaque atome de valeur, chaque particule constituant le capital (de la valeur se valorisant) est en guerre permanente, en perpétuelle compétition avec tous les autres atomes du capital. Cette tendance centrifuge s'accompagne, dans son développement, d'autres tendances qui la contrecarrent: ainsi pour une particule de capital, la seule façon de se valoriser, c'est de se joindre à d'autres particules, de s'unifier à d'autre capitaux afin d'affronter dans les meilleures conditions possibles cette guerre qui est dans sa nature: la concurrence.Unification et désintégration sont deux tendances contradictoires qui se reproduisent au sein d'une même unité, et ce dans tous les aspects du développement capitaliste, depuis ses atomes de valeur jusqu'aux différentes institutions étatiques et supra-étatiques (alliances internationales, marchés communs,...), en passant par les sociétés anonymes, les groupes financiers, les cartels, les trusts,... Contrairement à ce que prétendent les apologues du capital, il n'y a jamais d'équilibre parfait; le capital est toujours déséquilibre, instabilité, rupture, séparation en capitaux multiples... même s'il est aussi concentration, centralisation, unification... La prédominance de tendances unificatrices ne peut être que passagère car ce qui détermine un regroupement demeure la recherche de l'optimisation des chances dans l'affrontement au concurrent; et tôt ou tard, une nouvelle confrontation se produit, une nouvelle lutte pour les moyens de production s'engage, une lutte pour des matières premières, pour des marchés ou pour le contrôle de la force de travail éclate. Enfin, tôt ou tard, le capital, qui n'est autre chose que des capitaux qui s'affrontent, des capitaux concurrents, tôt ou tard donc, le capital aboutit à une «nouvelle» guerre.
Face aux crises et à l'unique perspective capitaliste qu'elles offrent, la guerre et sa généralisation, les fractions bourgeoises se voient contraintes de forger des unions plus stables (1), des constellations qui se fortifient les unes face aux autres. Les forces hégémoniques, celles qui peuvent représenter les intérêts fondamentaux du capital, doivent imposer un ordre à leurs différentes fractions afin d'obtenir la convergence nécessaire qui donnera force à leur constellation, ou, si on préfère, à l'association des différentes structures étatiques ou des forces armées, dans l'affrontement aux autres constellations. Cette unification des structures étatiques ne se fait pas, comme le prétend l'idéologie bourgeoise, par pays. L'irrégularité des pays et des frontières qui les séparent constitue elle-même un témoignage historique de la lutte que se sont livrées les fractions internationales du capital, y compris à l'intérieur de chaque pays. Lorsque des pays se consolident, c'est de manière toute relative parce que la plupart du temps, le pays continuera à se transformer en fonction des différentes guerres et paix qui s'y dérouleront. Y compris au sein de chaque pays, il est toujours possible que surgissent des fractions autonomistes ou indépendantistes ou que se développent de nouvelles «guerres civiles», opposant des fractions libre-échangistes à des fractions protectionnistes (2).
La période actuelle est, pour le capital mondial, une période de clôture de son cycle d'expansion, cycle dans lequel les perpétuelles convulsions provoquées par la dévalorisation générale du capital se manifestent de façon de plus en plus puissante. A plus d'un an de la fin de la guerre dans les Balkans, les objectifs de celle-ci sont toujours soigneusement dissimulés. C'est pourquoi, il nous a semblé important de réunir dans ce texte différents matériaux permettant de révéler les clés de cette guerre, ce qui nous donnera en même temps la possibilité de mieux comprendre les limites historiques du système social actuel ainsi que les conditions et les rapports de forces qui se dressent sur le chemin de son abolition.
La relative paix sociale internationale qui règne aujourd'hui permet une augmentation des bénéfices que la bourgeoisie engrange au prix d'une dégradation importante du niveau de vie du prolétariat. Mais, bien souvent, lorsqu'il s'agit d'envoyer le prolétariat défendre, au prix de sa vie, les intérêts d'une fraction bourgeoise, cette paix révèle toute sa fragilité. En effet et, contrairement à ce qui se produisit lors de la «seconde guerre mondiale», la bourgeoisie internationale n'a pas réussi à produire une idéologie aux racines suffisamment profondes pour conduire le prolétariat au massacre que signifie une guerre généralisée. Les contradictions intercapitalistes ont éclaté et se sont développées sans parvenir à forger deux constellations cohérentes et claires, capables de susciter une adhésion idéologique internationale massive. C'est pourquoi, les guerres qui ont éclaté ces dernières années, malgré les tentatives de généralisation, principalement sous la direction idéologique et militaire des Etats-Unis, ne sont même pas parvenues à atteindre leurs objectifs officiels déclarés qui étaient de liquider tel ou tel dictateur, ce qui, par ailleurs, leur convenait parfaitement la plupart du temps.
Malgré les massacres qu'elles provoquent, les guerres ne parviennent pas à atteindre le niveau de généralisation réclamé par les instances les plus militaristes. Dans chacun des conflits qui se sont produits, les organisations du capital (FMI, OTAN, Banque Mondiale,...) ont réussi à imposer leurs objectifs généraux, unifiant autour d'elles les différents Etats qui les composent, neutralisant l'action des autres Etats capables de s'allier avec les Etats attaqués. La neutralisation des fractions qui cherchent centralement à soutenir ces Etats attaqués est évidente. Ainsi par exemple, les Etats de Yougoslavie et d'Irak furent totalement coupés du soutien de la Russie lors des guerres dont ils furent l'objet.
Mais cette unification, cette centralisation des Etats autour des institutions mondiales du capital demeure invariablement dans l'incapacité d'imposer un intérêt global à l'ensemble des fractions qui la composent.
Non seulement les intérêts particuliers (politiques, économiques, idéologiques) de chaque fraction continueront de s'affronter, mais l'unification qui s'opère s'accompagnera toujours d'une exacerbation des intérêts concurrents de chaque fraction capitaliste. Les conflits militaires qui surgissent participent également de l'intensification de la concurrence intercapitaliste et de son développement vers la généralisation de la guerre.
Les véritables causes de la guerre sont toujours cachées à l'opinion publique. La guerre dans les Balkans a été présentée comme le résultat de conflits interethniques, conflits de nations, de religions,... donnant ainsi un panorama confus et chaotique impossible à comprendre.
Nous analyserons quant à nous cette guerre comme le produit authentique du développement des contradictions propres au capital, en montrant par la même occasion que les choses sont plus simples que ce qu'on nous raconte. Ainsi nous verrons que tous ces conflits interethniques ont surgi et ont été encouragés dans le but principal de polariser le prolétariat selon les intérêts spécifiques de chaque fraction du capital. C'est pour cette raison que ces conflits semblent générer une situation d'atomisation et de désintégration extrême qui, sans une analyse de classe, rend confuses et incompréhensible les raisons de la guerre dans les Balkans.
Nous commencerons ce texte par l'analyse des différentes contradictions
interbourgeoises qui menèrent à la guerre, pour analyser
ensuite les oscillations concernant les interventions de l'OTAN et les
tendances à l'extension de la guerre en Europe.
L'objectif de la production capitaliste est l'accumulation de survaleur. La valorisation du capital engendre un processus qui lui est contradictoire et inséparable: la dévalorisation. En même temps que le capital se valorise, les marchandises se dévalorisent: les moyens de production perdent rapidement leur valeur face à d'autres qui surgissent avec moins de valeur incorporée; et n'étant plus compétitifs face à ces derniers, ils sont simplement détruits car ils sont désormais inutiles à la production capitaliste. Les moyens de consommation qui ne peuvent réaliser leur valeur sont détruits et la force de travail, cette marchandise qui diffère de toutes les autres par la différence qui existe entre sa propre valeur et la valeur qu'elle crée, la force de travail donc est elle-même détruite par les maladies, le chômage, etc.
La destruction des forces productives atteint son apogée lors des guerres capitalistes, guerres qui se produisent après la fin du cycle d'expansion, lorsqu'on se dirige vers une situation d'enlisement, de stagnation. Les destructions massives provoquées par les guerres permettent d'ouvrir un autre cycle infernal d'expansion et de stagnation, qui donnent lieu à de nouvelles guerres. Les guerres, même si chaque fraction bourgeoise les mène pour s'approprier et détruire les forces productives de l'autre fraction, concrétisent cette nécessité impérieuse du capital de détruire pour construire et recommencer un nouveau cycle d'expansion.
Aujourd'hui comme hier, le capitalisme détruit les marchandises. Derrière ce qu'on appelle pompeusement la mondialisation, la globalisation, le libéralisme, se cache la destruction de tout ce qui entrave la valorisation. Sans cette destruction, le capital ne peut continuer son processus d'accumulation. Mais si, dans certains espaces productifs, cette dévalorisation se développe sans créer des stagnations, des crises et des guerres, dans d'autre régions, comme en Europe de l'Est, elle impose, depuis des années, d'importants niveaux de stagnation, de crise et de destruction massive de marchandises. En effet, dans ces pays, on ne peut plus augmenter la plus-value absolue comme on le faisait avant pour rester compétitif sur le marché mondial et compenser ainsi le retard technologique.
Il s'agit en réalité d'effacer les manifestations embarrassantes d'un espace productif qui n'a pu évoluer selon les diktats de la loi de la valeur internationale: la protection juridique génère des conditions fictives de rentabilité qui ne peuvent se maintenir à long terme. Arrivée à un certain point, la loi de la valeur impose l'élimination des fractions bourgeoises qui vivaient principalement grâce à ces protections étatiques, protections qui avaient progressivement éloigné ces fractions des révolutions des forces productives qui s'opéraient à l'échelle mondiale.
Derrière la «lutte pour la démocratie», consigne centrale de la bourgeoisie ces dernières années dans la région, se cache l'exigence de la dévalorisation générale de la force de travail et des moyens de production non compétitifs, ainsi que la mobilisation du prolétariat au service d'intérêts qui ne sont pas le siens.
La fin de ce qu'on a trompeusement appelé «communisme» (3) dans les pays de l'Europe de l'Est fut en réalité une réorganisation générale du capitalisme qui produisit le démantèlement et la désorganisation du marché interne, le désordre et la désintégration des intérêts bourgeois, l'effritement de l'activité productive, la diminution vertigineuse de la croissance et des conditions d'existence du prolétariat ainsi que l'augmentation pressante de l'inflation. On estime que le PIB de l'ex-URSS, exception faite des pays baltes, n'atteint que 55% de celui de 1989 et que les investissements ont chuté à un cinquième du niveau atteint en 1990. 40% des produits industriels s'échangent sur le mode du troc.
L'échec de la politique de gestion du capital dans ces régions et la dévalorisation généralisée à laquelle elles sont confrontées détermine une exacerbation des différentes contradictions. Il y a d'une part, au niveau international, la lutte des différentes fractions du capital (Etats nationaux, consortiums financiers, industriels,...) pour le contrôle productif de la zone et la puissante lutte des institutions internationales de la bourgeoisie pour s'affirmer comme les garantes de la paix capitaliste, et, au niveau régional, la réémergence de différentes contradictions régionales, nationalistes, ethniques,... qui expriment différents intérêts capitalistes spécifiques. Mais d'autre part, il y a également le prolétariat qui a commencé à se manifester comme force, rappelant par là-même le potentiel avec lequel il pourrait dangereusement remettre en question la paix sociale dominant le monde actuellement.
La bourgeoisie a structuré son ordre social sur des bases puissantes, mais aussi -dialectiquement- extrêmement fragiles. Aujourd'hui, le pouvoir de la bourgeoisie se maintient tant qu'il n'y a pas de guerre. Toute tendance à la guerre -une tendance inévitable- met en évidence les limites de la paix sociale actuelle. De la même façon, chaque rupture de la paix sociale en un espace économique donné peut se généraliser et rapidement faire voler l'ordre social en éclats, non seulement dans la région mais également sur le plan international. C'est pour cela que les institutions internationales de l'ordre bourgeois ne peuvent permettre la généralisation de la désorganisation économique et sociale qui se produit dans le dit bloc de l'Est. Il est impératif de contrôler ce qui se joue dans cette partie de l'Europe. Les mouvements sociaux qui éclatent en réponse aux crises réveillent les terreurs de voir la paix sociale rompue et de se trouver confrontés à la résurgence d'une perspective prolétarienne généralisée à toute l'Europe.
Bien avant la chute du mur de Berlin, les différents chefs d'Etat voyaient clairement que la situation socio-économique des pays de l'Est était extrêmement explosive, que la réponse prolétarienne pouvait être fatale au capital et qu'il était nécessaire de parler de liberté, de démocratie, pour faire passer les mesures antiprolétariennes que le capital devait imposer dans ces espaces productifs. Au niveau international, la crainte d'une généralisation des luttes qui se déroulaient toujours plus près de l'Europe occidentale (Pologne, Roumanie,... et Yougoslavie) posa la nécessité de l'édification de murs (véritables cordons sanitaires) bien plus puissants que celui de Berlin, contre la lutte prolétarienne. Il fallait dès lors raffiner quelque peu les idéologies bourgeoises susceptibles de contenir la réaction prolétarienne et sa généralisation et les rendre compatibles avec les nécessités présentes du capital: concentrer la plus-value aux mains des secteurs les plus compétitifs. Pour ce faire, la lutte pour l'idéal démocratique contre le «communisme» s'est révélée de la plus haute importance; grâce à elle, on parvint à opposer les exigences libre-échangistes d'accumulation capitaliste aux recettes protectionnistes qui avaient jusque-là caractérisé les pays de l'Est. «Cette zone de l'Europe doit acquérir une homogénéité dans la démocratie et dans l'économie de marché afin de prospérer, de s'ouvrir et de s'intégrer à l'Europe», déclara le secrétaire d'Etat aux Affaires Extérieures roumain Mihai-Razvan Ungureanu. Il ajoute encore: «La Roumanie a accompli en trois ans quelques-uns des objectifs les plus pressants pour sa pleine intégration à l'OTAN et à l'Union Européenne. Le premier de ceux-ci était la stabilité interne et le renforcement des institutions. L'échec des révoltes minières de cet hiver fut une épreuve du feu qui a clôturé une période de turbulences au cours de laquelle différentes forces antiréformistes mettaient en doute la légitimité des institutions» (El Pais, 28/04/1999).
S'exprimant à un niveau plus global, Prodi, président de la Commission Européenne, se déclara contre le protectionnisme, mettant en garde sur le fait que celui-ci pouvait avoir «des conséquences dans les économies communautaires».
Les deux tendances propres au développement du capital, protectionnisme et libre-échangisme, se présentent donc sous de nouveaux accoutrements: démocratie, libre-échange, mondialisation, fonds monétaire d'un côté, et de l'autre anti-néo-libéralisme, anti-libre-échangisme. Ces tendances, à travers leurs multiples affrontements et à travers la défense de leurs intérêts de fraction, préparent objectivement et essentiellement la canalisation du prolétariat dans la défense d'intérêts qui ne sont pas les siens et sa destruction comme classe potentiellement destructrice du capital. Il ne fait aucun doute que l'idéal démocratique, érigé en but à atteindre pour les pays de l'Europe de l'Est, s'est révélé un des mythes les plus puissants face à l'échec de ces idéologies bourgeoises antérieures que le capital mondial avait convenu d'appeler cyniquement «socialistes» ou «communistes». Le capitalisme du modèle stalinien avait démontré son véritable visage antiprolétarien non seulement dans les pays de l'Est mais également sur le plan international. Le mythe du paradis «socialiste», basé sur l'étatisation juridique du capital en Russie, à Cuba et ailleurs, perdait de sa force; la mystification qu'exerçaient les différents partis staliniens, maoïstes, castristes, trotskistes ou populaires également. Dans chaque lutte prolétarienne, on brûlait et on démolissait tout symbole rappelant les vieux chefs staliniens. Mais c'est pourtant des cendres de ces sphinxs staliniens que renaîtra le «nouveau» mythe de la «lutte pour la démocratie». Disons plus exactement que les vieux mythes reprendront vigueur. Toujours est-il que ce furent les chefs d'Etat «communistes» eux-mêmes qui, les premiers, exprimèrent la nécessité de parler de démocratie, de démocratisation, pour faire accepter les mesures d'austérité qui s'imposaient et contenir la lutte prolétarienne (4).
Mais, comme nous le verrons plus loin, cette idéologie de la «démocratie à gagner» dévoila rapidement son vrai visage: augmentation de la misère, mort causée par le travail (tant sur le lieu de travail que faute de travail), par les guerres,... en deux mots, la réalité d'un capitalisme qui entre dans une phase de crise généralisée. Face à cela, les défenseurs nostalgiques du projet bourgeois stalinien s'insurgèrent contre ce qu'ils nomment «capitalisme»; s'attirant ainsi les bons échos des secteurs antimondialisation, antilibéralisme, partisans d'une «troisième voie» ou d'une «économie humaine», autrement dit, toute la faune des partisans d'un capitalisme «à visage humain». Et de désigner l'OTAN, le FMI, la Banque Mondiale comme responsables de tous les maux de la terre, alors qu'en réalité ces institutions ne font qu'exprimer les déterminations de la loi de la valeur au niveau international. Cette idéologie social-démocrate crée l'illusion d'un capital sans contradiction, d'un paradis démocratique qui, dans la pratique sociale, est là pour donner cohésion à la prosaïque réalité du capital, qui, pour le prolétariat, ne peut être autre chose qu'un enfer (5).
Protectionnistes contre partisans du libre-échange, capitalisme sauvage contre capitalisme «à visage humain», démocratie contre dictature ou fascisme,... ce sont là quelques-unes des nombreuses polarisations que le capitalisme génère pour maintenir son système d'exploitation intact, pour nous utiliser comme chair à canon dans ses guerres impérialistes; c'est là quelques-unes des nombreuses polarisations que le prolétariat devra affronter dans sa marche pour imposer ce qui réellement le définit comme classe opposée à tout l'ordre social: la révolution contre le capitalisme.
Dans un langage moins politicien cela signifie: des licenciements massifs, la diminution des subsides à la consommation ouvrière, des services et des programmes sociaux (éducation, santé publique,...), l'inflation, ainsi que l'augmentation des prix des marchandises de consommation ouvrière, la réduction des salaires, la fermeture des usines, le chômage (6),... Ces ajustements produisirent des situations explosives, tant pour le niveau de vie des prolétaires de ces régions (on estime que le taux de pauvreté est passé de 19% en 1979 à 60% en 1988) que dans les relations entre les différentes fractions du capital. En 1971, le PIB était, en Serbie, de 5.400 dollars par habitant, en 1997 il est tombé à 1.000 dollars par habitant. Le poids de la dette externe est énorme, la capacité de paiement limitée. En 1980, la dette atteint les 20 milliards de dollars et les intérêts 4 milliards de dollars par an. Vu la situation, les exigences du FMI sont imposées. Le financement de la dette par l'ensemble des républiques et provinces de la Fédération Yougoslave créera d'énormes conflits interbourgeois. Cela participera également de l'exacerbation des contradictions et des discussions entre les dites «régions riches», qui refusent de «financer» les «régions pauvres», et ces dernières qui dénoncent un échange inégal: leurs produits sont achetés à bas prix, ce qui permet d'enrichir les autres régions (7). La fermeture des usines et autres centres de production est brutale.
Dans ce contexte de décomposition du développement capitaliste en Yougoslavie, différentes maffias voient le jour, qui se renforcent grâce au trafic de drogue, d'armes et à la prostitution et qui s'emparent d'espaces que le vide productif a laissés. «Le Kosovo est devenu la plaque tournante internationale d'une grande variété de trafics: cigarettes, voitures volées, drogue, armes, êtres humains, prostitution» (Groupe de Recherche et Information sur la paix et la sécurité, Bilan de la Guerre du Kosovo). Aujourd'hui, on estime que ces activités représentent la moitié du PIB.
La lutte de chaque fraction du capital pour intégrer le prolétariat à la défense de ses intérêts spécifiques est intense et multiforme: «musulmane», «slovène», «kosovare»,... chaque fraction prétend incarner au mieux, au travers de ses nationalismes, intégrismes, parlementarismes et autres revendications démocratiques, les intérêts de ses ressortissants; chaque fraction affirme offrir à «ses» prolétaires une perspective productive, une société plus humaine, être le sauveur face au chaos. A ce stade deux idéologies retiennent notre attention: l'idéologie anti-FMI et l'idéologie nationaliste (8).
Aujourd'hui comme hier, il est très à la mode de revendiquer une politique contre le FMI. Ici, il convient de signaler la différence existant entre la lutte du prolétariat qui s'affronte au FMI et qui ne peut le faire qu'en s'affrontant au capitalisme dans son ensemble et les caquetages bourgeois anti-FMI déterminés par des intérêts de fractions protectionnistes qui prétendent, toutes sans exception, transformer le prolétariat en wagon de queue de leurs intérêts fractionnels. Lorsqu'une fraction bourgeoise affirme nous défendre contre l'ogre FMI, elle ne cherche qu'à diluer la véritable contradiction prolétariat-capitalisme et à nous utiliser comme base d'appui pour ses négociations, ce qui, évidemment, n'exclut pas qu'elles finissent toujours par se mettre d'accord et adopter des politique communes contre nous (9). Ainsi se structure une idéologie selon laquelle l'ennemi n'est plus le capital mais le FMI. Et on affirme, comme ne cesse de le faire Le Monde Diplomatique, véritable centre d'élaboration théorique de ce courant idéologique: «Une économie qui va à l'encontre du libre-échangisme et qui veille à l'intérêt des citoyens est possible». En deux mots, ce qu'on nous vend c'est un capitalisme sans les contradictions qui lui sont inhérentes: crise, destruction massive de marchandises, guerres, sous-développement, armées,... Un capitalisme à caractère «humain». Malheureusement, ce règne des cieux, n'est pas seulement une construction idéologique de laboratoire, un conte de fées auquel même les gosses ne croient pas, c'est un moyen de canaliser et d'endormir la rage que provoquent inévitablement les politiques économiques appliquées au nom du libéralisme et du FMI. En effet, le mensonge se transforme en véritable démobilisation lorsqu'il prend corps dans notre classe et parvient à la conduire dans les voies sans issue, lorsque le prolétariat abandonne ses intérêts pour s'identifier, par exemple, à la pseudo-lutte des antilibéraux, anti-FMI ou de ceux qui se réclament pompeusement de «la troisième voie».
En Yougoslavie, comme dans n'importe quel autre espace capitaliste, c'est la même rengaine, ce qui, évidemment, n'empêche pas Milosevic, le FMI, l'Union Européenne et les autres représentants de l'Etat mondial du capital de s'asseoir côte à côte pour convenir ensemble des mesures qu'ils considèrent nécessaires pour restructurer l'économie, et qui entrent en contradiction directe avec les besoins les plus élémentaires des travailleurs. En Yougoslavie, en Pologne -lors de la dite thérapie de choc- comme hier en Bulgarie, en Roumanie, en Albanie (10) ou aujourd'hui en Colombie ou en Equateur pour ne citer que quelques exemples, éclatent des réponses ouvrières que les médias appellent «des mouvements sociaux spontanés contre la mondialisation».
En Yougoslavie, comme nous l'avons déjà montré dans d'autres articles (11) et comme nous le verrons plus loin, les réponses prolétariennes seront puissantes et obligeront le FMI, en accord avec les autres fractions bourgeoises, à reculer. Ces réponses prolétariennes bloqueront complètement les plans d'austérité. Une fois de plus, la bourgeoisie, qui craint toujours de perdre sa bourse face à un prolétariat en lutte, s'unifia et fut capable de reculer sur ce qu'elle présenta comme indispensable, inéluctable pour éviter la décomposition de sa paix sociale.
Rapidement, l'opinion publique oublia que, dans les années '80 le prolétariat avait lutté et renforcé son unité comme classe, dépassant les idéologies qui le divisaient; rapidement, elle oublia que les travailleurs «croates», «serbes», avaient occupé ensemble le parlement fédéral. Elle oublia aussi que c'était ce même prolétariat qui, par sa lutte, avait bloqué le paquet de mesures antiprolétariennes que la bourgeoisie voulait imposer; et que, en 1991, plus de 100.000 prolétaires «serbes» avaient occupé la rue, manifestant contre l'Etat aux cris de A bas Milosevic! et A bas la guerre!.
Objectivement, la lutte du prolétariat s'affrontait alors à toutes les fractions bourgeoises qui imposaient l'austérité et s'affirmait, de cette manière, en lutte contre le capital mondial. Plus tard, deux types d'idéologies s'imposèrent:
- l'une soutenait que c'était le FMI, la Banque Mondiale et les neo-libéraux qui créaient le chaos et la crise: «Il est encore moins évident que les politiques de privatisation sauvage en cours aient des retombées positives sur la population et favorisent une stabilisation de la région... Les démocrates adoptent des recettes libérales qui creusent le chômage et l'insécurité» (Catherine Samary, journaliste et analyste pour le journal Le Monde Diplomatique, spécialiste des pays balkaniques);
- l'autre défendait les mesures antiprotectionnistes et la solution démocratique comme seule issue possible.
Les premières réactions prolétariennes une fois canalisées, l'inévitable restructuration économique s'imposa, exacerbant les luttes entre fractions bourgeoises, tant sur le plan national qu'international. Les Etats européens, et particulièrement l'Etat allemand, participèrent activement aux affrontements interbourgeois, appuyant et armant les séparatistes en Croatie et en Slovénie. Le Vatican défendit également ses intérêts spécifiques, historiquement liés à ceux des nationalistes croates (13). En 1991, Javier Pereza Pellón, envoyé spécial du journal El Independiente dans la zone de conflit informait de l'existence d'un intense trafic d'avions qui, de France et de Belgique, atterrissaient à Zagreb, chargés d'un abondant armement et d'une armée séparatiste de 40.000 hommes munis d'«uniformes allemands, casques français, armes nord-américaines ou soviétiques et bombes britanniques». Les milices serbes, bosniaques et kosovares ne firent que perfectionner ce que développent les autres fractions internationales du capital: «Si tu veux te protéger, sauver ta peau, enrôles-toi dans ma milice». La restructuration économique, qui nous est partout présentée de façon si positive, comprend une phase armée! L'oeuvre pacificatrice des Nation-Unies, fournissant armes et entraînement aux Croates, ne fut pas non plus étrangère à cette escalade militariste, un rôle que même le journal allemand Der Spiegel du mois de décembre 1997 a dénoncé.
Concernant le séparatisme bosniaque, le panorama est identique. L'Union Européenne appuya et reconnut le nouvel Etat bosniaque, et prit position pour l'intervention directe. Simultanément, l'Etat britannique et les Etats-Unis, appuyés par le Vatican, annoncèrent la nécessité d'une intervention militaire directe. Peu de temps après, l'OTAN intervint en Bosnie. Au même moment, les médias lançaient une campagne d'intoxication dans laquelle ils dénonçaient sans ménagement les crimes qu'aurait commis l'Etat serbe. Cette campagne exacerba les contradictions idéologiques interethniques qui, progressivement, tant idéologiquement que physiquement, écrasèrent le prolétariat. Le conflit «interethnique» atteint son apogée avec la formation de l'UCK (Armée de libération du Kosovo) qui revendiquait la constitution d'un Etat autonome. «Si l'OTAN laisse les Serbes sans tanks ni canons, nous nous occuperons de laisser le Kosovo sans Serbes», déclarait un militant de l'UCK.
Comme nous le montrerons plus loin, les différentes puissances internationales participèrent activement à ce que les médias, d'un commun accord, dénommèrent «conflit interethnique». Voyons maintenant quelques exemples de la propagande destinée à substituer l'idéologie nationaliste, serbe, croate, albanaise,... à la vieille idéologie autogestionnaire (parée de vernis socialiste) et d'unité nationale yougoslave.
Si dans les paragraphes qui suivent nous nous référons principalement à ces éléments idéologiques de domination du prolétariat, il ne faut pas pour autant perdre de vue que ce qui détermine les changements d'idéologie, leur importance relative, demeurent les nécessités capitalistes de restructuration économique, la lutte entre les fractions bourgeoises et leurs besoins de transformer la guerre sociale en guerre interbourgeoise afin d'embrigader le prolétariat au service des différentes fractions nationalistes et de le détruire comme classe autonome. Dans les écoles, les discours sur la révolution d'octobre, l'apologie de Tito, l'athéisme, l'harmonie et le respect des différents peuples qui formaient la République Yougoslave... ont été remplacés par des expressions telles:
- «Nous sommes l'unique peuple juste et bon et pourtant l'injustice s'acharne contre notre innocente nation serbe. Tous les cinquante ans une épée apparaît au dessus de nous et un génocide la précède», dixit un jeune serbe réfugié en Croatie.
- «Avec les Serbes, la paix n'existe pas», dit un jeune croate.
Et tandis que dans les écoles de Bosnie-Herzégovine les cours d'histoire parlent d'«une dictature communiste qui imposait son pouvoir par la violence et la répression... ce premier Etat totalitaire eut rapidement des partisans fascistes et nazis...», aux petits Croates on explique que «la Yougoslavie, suivant le modèle soviétique, se transforma en un Etat centralisé de type communiste qui avait hérité de la domination des Serbes; l'expression ethnique des nations non serbes n'était pas autorisée; il était difficile pour les Croates d'accéder aux postes de direction car on les accusait constamment d'être des ennemis du peuple, autrefois coupables des crimes perpétués par les Oustachis; la participation des Croates à la lutte de libération nationale était délibérément passée sous silence.»
La bourgeoisie n'a cessé d'attiser l'idéologie nationaliste
et les luttes interethniques contre le processus d'unification réelle
que le prolétariat avait développé en luttant contre
la dégradation de ses conditions de vie. Tandis que le prolétariat
luttait contre l'augmentation du taux d'exploitation que la bourgeoisie
mondiale tentait de lui imposer, les nationalistes cherchaient à
l'entraîner dans le camp de la répartition interbourgeoise
de la plus-value. «Viens avec moi, ton salut sera assuré»,
«les
Bosniaques, les Serbes s'emparent de ton travail»,
«c'est
nous qui finançons les autres régions»,
«si
nous nous libérons, notre situation s'améliorera»,
disent les «Slovènes»; «nous leurs vendons
des produits bon marché, c'est comme cela qu'ils nous exploitent»,
disent les «Kosovars», etc.
Aujourd'hui comme hier, les Balkans représentent une zone au rôle politique important: constituer l'espace socio-économique européen où se manifestent les premières contradictions aiguës du capital, l'endroit où les différentes alliances et contradictions bourgeoises se dessinent, d'abord chaotiques, difficiles à aborder vu leurs multiples manifestations, pour ensuite être canalisées en polarisations plus appropriées à leur généralisation future.
Et en effet, les Balkans sont à nouveau le terrain sur lequel la bourgeoisie mesure ses forces, ses contradictions, ses capacités et les conditions qui la poussent à généraliser la guerre. Encore une fois, les différentes fractions du capital se disputent et s'arment afin de se présenter comme la fraction capable d'imposer une solution qui garantisse l'ordre social. Elles défendent toutes leurs intérêts particuliers et utilisent pour cela différentes idéologies guerrières afin de transformer le prolétariat en chair à canon de leurs guerres concurrentielles.
Mais, en même temps, dans les Balkans actuellement, ce que les fractions bourgeoises jaugent, c'est la capacité des différents Etats à consolider des constellations capables de mener une guerre généralisée et de triompher. Ces luttes interbourgeoises sont le résultat, tantôt direct et tantôt indirect, de la concurrence entre de puissants intérêts stratégiques concernant les moyens de production et la répartition des marchés. Voyons brièvement ce que cache à ce sujet la région des Balkans.
D'un coté, le nord industriel de ce que fut la Fédération Yougoslave possède d'importantes réserves de minerais (plomb, zinc, nickel, lignite), cruciales pour les industries capitalistes. De l'autre, les Balkans, en général, représentent un immense intérêt stratégique en tant que zone de passage vers l'Europe Occidentale, du pétrole, du gaz et des grandes réserves de minéraux situés dans la région du golfe Persique ou de la Mer Caspienne.
On estime que les champs de pétrole du Kazakhstan, les réserves de l'Azerbaïdjan et le gaz du Turkmenistan constituent une réserve stratégique aussi importante que celle du golfe persique. De plus, par ses réserves en minerais, la Sibérie est devenue un pôle d'attraction important de l'accumulation capitaliste. Cette région est le second producteur mondial d'or; ses gisements de pétrole et de gaz et ses énormes sources hydro-énergétiques l'ont transformée en important pôle fournisseur d'énergie. Son potentiel productif, fait naître d'importantes contradictions entre les différents impérialismes et est à la source de multiples guerres. Azerbaïdjan, Turkmenistan, Ouzbekistan et Kazakhstan concentrent un énorme potentiel de production pétrolière. Le sous-sol du Kazakhstan contient un quart des réserves mondiales de pétrole, ce qui fait de la Mer Caspienne un pôle de transit de l'or noir. Ce potentiel énergétique a déterminé l'émergence d'intérêts compétitifs démesurés entre industries capitalistes et entre Etats nationaux: «Présentes depuis 1990, les grandes compagnies occidentales s'y livrent une 'guerre sans merci'. Chevron a déjà investi dix milliards de dollars dans ce pays. Quant à Agip (Italie) et British Gas, ils s'opposent à un consortium russe pour le contrôle d'une gigantesque source de gaz kazakh. (...) Pour emporter les contrats, tous les coups sont permis» (Le Monde Diplomatique). De son côté l'Etat allemand lutte pour la conquête d'une voie directe qui lui permette d'obtenir en termes très compétitifs le pétrole du Moyen Orient, de la Mer Caspienne et du Kazakhstan. Bakou est un centre pétrolier de grande importance pour l'Allemagne. «En ce qui concerne les matières premières, notre attitude doit être l'attaque» a déclaré F.W. Christians, Président du conseil d'administration de la Deutsche Bank. Les Etats-Unis luttent également pour imposer les intérêts énergétiques que la rentabilité leur dicte en fonction de nécessités de leur espace productif.
La Loi D'Amato, signée par Clinton en 1996 «punit les entreprises nord-américaines qui investissent dans l'industrie du gaz ou du pétrole de trois pays: Iran, Irak et Libye», principaux fournisseurs de l'Europe et du Japon. «Tout contrat par lequel l'Iran tente de développer son secteur énergétique sera considéré comme une menace directe pour la sécurité nationale des Etats-Unis», dira encore le sénateur D'Amato. Et, peu après, Robert Dole, chef du Parti Républicain, ajoutera: «[La guerre du Golfe fut] un symbole de la préoccupation nord-américaine pour la sécurité des réserves de pétrole et de gaz. Les frontières de cette préoccupation avancent de plus en plus vers le nord et comprennent le Caucase, la Sibérie et le Kazakhstan». Ce potentiel énergétique suppose un important contrôle des routes que prennent le pétrole et le gaz et, dans ce contexte, les espaces productifs de Turquie et des Balkans sont de la plus haute importance car ils constituent les lieux de passage obligés vers l'Est et le Moyen Orient. Selon la revue française Défense nationale, les conflits entre les Etats européens et les Etats-Unis sont énormes à ce niveau: «Maîtres du pétrole du Moyen Orient, les nord-américains s'efforcent de contrôler également, au détriment des européens, celui de la Mer Caspienne».
Par leur proximité territoriale avec cette région riche en matières premières et particulièrement en pétrole, les Balkans constituent une zone stratégique. Son espace géographique doit être inclut dans toute politique de transport du pétrole et du gaz, surtout en direction de l'Allemagne. Avec le nouveau canal reliant le Rhin au Danube, ce dernier est devenu un moyen de navigation stratégique offrant une voie de communication permanente entre les mers du nord (la Mer du Nord et la Mer Baltique) et les mers du sud de l'Europe, (la Mer Méditerranée et la Mer Noire). La construction de ce canal fournira à l'Etat allemand une voie directe et compétitive par laquelle transporter le pétrole du Moyen Orient, de la mer Caspienne et du Kazakhstan, si toutefois il parvient à contrôler ce fleuve qui traverse la Serbie. L'embargo militaire a permis au Pentagone de s'approprier le contrôle de la navigation sur le Danube, non seulement en Serbie mais également en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie.
Les intérêts des différents consortiums de l'industrie d'armement furent également déterminants. En effet, l'industrie militaire des Etats-Unis et d'Allemagne a obtenu de très gros contrats dans les Balkans à partir des années '80. Par ailleurs, des mortiers et des avions de chasse MIG ont été envoyés par les agences d'aide de l'ONU et de l'OTAN aux armées musulmanes de Croatie (selon Defense & Foreign Affairs Strategic Policy, de novembre 1992). De la même façon, et comme la Maison Blanche l'a officiellement reconnu, malgré l'embargo sur les armes décrété par l'ONU, la CIA a continué à envoyer des armes aux armées musulmanes de Bosnie. Les intérêts des groupes financiers ont également joué un rôle important: différentes banques nationales se sont disputé les marchés de l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, sur presque tout le territoire de ce qui fut la Yougoslavie, le mark allemand est la monnaie officielle.
Voyons maintenant d'autres aspects contradictoires qui ont opposé diverses structures étatiques en lutte pour le contrôle de l'explosive région des Balkans.
Ainsi, aujourd'hui, dans les industries clés de la production d'armes, par exemple, différents Etats, différentes associations d'Etats, des groupes industriels,... s'affrontent de façon permanente. Depuis 1994, de gigantesques fusions se sont produites entre les grands groupes mondiaux de l'industrie d'armement aux Etats-Unis: Lockeheed-Martin-Loral; Northrop-Gutman-Westinghouse; Raytheom-E Systems.
Ces fusions ont entraîné des réactions de la part des industriels «européens»: «L'Europe n'a pas une minute à perdre face aux fusions gigantesques qui s'opèrent aux Etats-Unis. Nous n'accepterons pas que l'industrie aérospatiale et défensive allemande soient réduites à des fonctions secondaires ou qu'elles gravitent à la périphérie d'éventuels pôles de défense français» (Werner Heinzmann, principal industriel allemand du secteur de la production d'armes).
En 1999, le groupe britannique GEC-Marconi (électronique militaire, radars pour transports aériens, systèmes électroniques de guerre) fusionne avec British Aerospacial (BAE). Un industriel français déclare: «Tous les schémas de restructuration de l'électronique et de l'aéronautique militaire sont d'un seul coup bouleversés; (...) ce mariage ferait définitivement exploser le projet de société intégrée aéronautique civile et militaire, lancé en décembre 1997 par les gouvernements et industriel français, allemands et britanniques» (Dossier Armements dans «Solidarité Internationale», publication du Parti des Travailleurs de Belgique). Dasa, entreprise d'origine allemande, ressent également que ce processus de fusion l'exclut et l'affaiblit. L'un de ses dirigeants déclare: «Ce n'est pas une fusion européenne, elle rendra probablement plus difficile le processus d'intégration européenne». L'entreprise Aérospatiale Française réagit également et annonce sa privatisation en vue d'intégrer Matra-Lagardère. Selon le Financial Times du 16 février 1999, le groupe français est devenu ainsi le cinquième groupe mondial. Le gouvernement des Etats-Unis n'accepte pas l'unification de ses concurrents européens... mais, par la suite, il fixe le type de fusions qui seront dorénavant acceptées. Selon le journal français Le Monde: «Des fusions avec des industriels des pays «amis» seraient désormais acceptées par le Pentagone. Le Royaume-Uni figure en tête de ces pays amis».
En 1991, un tiers du commerce entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale passait par l'Allemagne et l'Etat allemand devint le principal investisseur étranger en Europe de l'Est. Des sociétés d'origine allemande se sont installées en Slovénie, où elles contrôlent 70% du commerce et en Croatie, où elles contrôlent 40% du commerce.
A ces intérêts économiques s'ajoutent les juteuses affaires de trafic d'armes. Déjà en janvier 1991, l'Etat allemand envoyait des missiles type Armbrust et des instructeurs de la Bundeswher en Slovénie pour y former des milices armées. Plus tard, il établit un pont aérien et naval qu'il compléta par l'envoi massif d'armes qui arrivaient en Croatie par la route. Un expert britannique soulignait: «Sans l'appui des services secrets allemands, une grande partie de ce trafic d'armes sur le territoire de l'ex-Yougoslavie serait absolument impossible» (Poker Menteur, Michel Collon, p.61). On estime qu'entre avril 1992 et avril 1994, l'Etat allemand a exporté pour 320 millions de dollars de matériel militaire vers la Croatie et pour 6 millions de dollars vers la Bosnie. «Selon plusieurs sources des services de renseignements occidentaux, le BND (Bundes Nachrichten Dienst, service de l'Intelligence allemand) s'installe de façon très active dans les pays de l'ex-bloc de l'Est», dixit Mickael Opperskaiski, expert en services secrets. Kohl insista lors d'un sommet européen au Luxembourg pour que soit reconnue l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Le Vatican et l'Etat allemand furent les deux premiers Etats à reconnaître l'indépendance de la Croatie et ensuite de la Slovénie, une impulsion déterminante sur le chemin de la déstabilisation de la Yougoslavie et de la guerre nationale et internationale. Plus tard, l'ensemble des Etats de l'Union Européenne reconnurent l'indépendance de ces deux «nouveaux Etats», ce qui représenta, en retour, une grande victoire militariste pour l'Etat allemand (14). Comme l'affirmait Lord Carrington, cette reconnaissance constitua une déclaration de guerre contre l'ancienne unité nationale: «La reconnaissance fut une erreur tragique qui se révéla être le point de départ de la guerre civile». C'est un peu comme si demain, la Russie reconnaissait l'Etat basque indépendant que réclament l'ETA et d'autres forces nationalistes.
«Avec l'indépendance, la Slovénie et la Croatie perdent leurs marchés et leurs sources de matière première. Notre maison est préparée à intervenir et à les aider», déclare alors la Deutsche Bank. Avec l'indépendance de la Slovénie, l'Etat allemand consolidait son contrôle sur la zone des Balkans; mais cette consolidation engendra de nouvelles contradictions: «il se joue une guerre d'influence sur les nouvelles économies de marché d'Europe de l'Est. Les Etats-Unis et l'Allemagne s'affrontent [...]; derrière ces querelles se trouve la théorie selon laquelle celui qui rédige les lois obtient les contrats. La Pologne, la Hongrie, La République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie et la Lituanie développent un système d'entreprises et de banques très proche des traditions allemandes. Avec des banques exerçant des fonctions universelles [...]. De 1990 à 1995, les Etats-Unis auraient investi plus de quatre millions de dollars pour imposer leur marque dans les lois et les règlements de l'Europe de l'Est. L'Allemagne aurait dépensé huit millions de marks pour atteindre le même objectif. Certains européens craignent que l'enthousiasme allemand n'aspire à rétablir les vieilles sphères d'influence [...]. La République Tchèque, la Lituanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie et la Croatie ont déjà lié leur monnaie au mark» (Wall Street Journal).
L'Etat allemand, avec Kohl à sa tête, a été une force active de contrôle et de direction dans le démembrement des économies d'Europe de l'Est. Schröder et son ministre de l'extérieur, l'écologiste Fischer, n'ont fait que continuer cette ligne et, comme nous le verrons plus loin, leurs intérêts spécifiques, plus liés à l'Union Européenne, les placèrent plus d'une fois en contradiction avec l'OTAN. Leur défense d'une solution dans laquelle l'ONU ou l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) établirait une «force internationale de paix» était cohérente avec les intérêts que l'Etat allemand manifestait pour l'unification européenne. Une fois le conflit terminé, cet Etat élabora un «pacte de stabilité pour les Balkans», approuvé par l'Union Européenne, dans lequel les problèmes de frontières, de minorités ethniques, de réfugiés, de coopération économique,... étaient réglés par la «communauté internationale» et les pays de la région sous les auspices de l'OSCE. Selon l'Etat allemand, ces pays devaient intégrer le processus d'extension de l'Union Européenne. La fortification de l'Union sous la direction de l'Etat allemand attribua à ce dernier un poids important dans le rapport de force vis-à-vis de ses concurrents.
La reconnaissance de ces nouveaux Etats par l'Union Européenne fut considérée par l'Etat britannique comme une soumission à un fait accompli qui fortifiait l'Etat allemand. Tony Blair continua la politique de ses prédécesseurs, ce qui le conduit à apporter son soutien inconditionnel à la politique des Etats-Unis et de l'OTAN. C'est pourquoi il est considéré comme «l'allié le plus 'va-t-en- guerre'» et n'hésite pas à affirmer: «la question n'est plus de savoir quand on interviendra sur le terrain au Kosovo, mais comment et avec quels moyens» (déclaration recueillie par Daniel Coulon, Le Soir, 22/4/99).
Lorsque la Russie est à son apogée, son armée rivalise avec celle de l'OTAN et on dit même qu'elle la surpasse d'un point de vue quantitatif tant sur le plan des armes conventionnelles que sur celui des armes nucléaires. Au début des années '80, l'armée russe compte 4 à 5,3 millions de soldats et d'officiers alors que les Etats-Unis n'en ont que 2,2 millions. Actuellement, on estime le nombre de soldats et officiers russes à 900.000!
Alors que, au début des années '80, les dépenses militaires atteignaient le chiffre de 250 à 300 milliards de dollars, en l'an 2000 elles sont tombées à 6 milliards. Entre 1991 et 1997, la production militaire a chuté de 80% «Plus de 70% des armes russes sont très vieilles et dans un avenir très proche, il faudra les remplacer, pour notre propre sécurité» dit M.Golz, commentateur militaire pour l'hebdomadaire Itogy.
Après l'échec de l'Afghanistan et de la première guerre tchètchène, l'armée russe a subi un processus de démantèlement et de désorganisation violent: plus de 60% des jeunes appelés à «servir la patrie» ont déserté. Les conditions matérielles et idéologiques de cette armée sont également désastreuses: les soldats ne reçoivent pas leur paie pendant plusieurs mois, les salaires des hauts fonctionnaires se situent sous le minimum vital, les corps spéciaux se décomposent (15) et face à l'impossibilité d'obtenir de quoi vivre, ils commencent à vendre leurs services aux différentes maffias; et bien souvent, ils se retrouvent en conflit (parfois armé) contre d'autres forces de l'Etat.
Les contradictions entre le président et le parlement, principalement contrôlé par les nostalgiques de l'époque stalinienne et les nationalistes, ont également de lourdes conséquences. Un des points culminants de ces contradictions fut le bombardement de l'immeuble du parlement (en octobre 1993) ou, comme nous le verrons plus loin, la proposition de destitution de Yeltsin de la part du parlement.
Cette situation de graves difficultés économiques, sociales, politiques et militaires empêche l'Etat russe d'appuyer son allié historique: l'Etat serbe. Les cris poussés par le parlement, la réprobation de l'intervention de l'OTAN et les menaces spectaculaires émises par ses chefs suprêmes, n'étaient que de la poudre aux yeux car l'Etat russe était incapable de s'affronter réellement aux ennemis de l'Etat serbe et aux intérêts de certaines fractions bourgeoises qui, dans ce pays aussi, poussent dans le sens de l'Occident et des recettes fond-monétaristes. A ce propos, Erik Derijcke, ministre belge des Relations Extérieures déclare: «Je pense que la Russie attache plus d'importance à ses relations avec les Etats-Unis, d'une part, et avec le Fonds Monétaire International ainsi qu'avec l'Union Européenne, qu'à son soutien traditionnel à la Serbie». «Les bonnes relations de la Russie avec le FMI et l'Occident sont d'un intérêt national vital. En revanche, la sympathie envers les frères slaves ne l'est pas...» (Moscow Times).
Plus de 10 milliards de dollars seront accordés à l'Etat russe par le FMI. C'est le prêt le plus important après celui accordé à l'Etat du Mexique pour résorber la crise de la bourse en 1996. Plus tard, lorsque l'explosion sera imminente dans les Balkans, Primakov, le premier ministre russe obtiendra une nouvelle «aide» de 4,5 milliards de dollars pour la restructuration de la dette externe de la Russie.
Les déclarations belliqueuses de Yeltsin menaçant d'intervenir directement dans le conflit («ne pas pousser la Russie à une action militaire sinon il y aura sûrement une guerre européenne, peut-être mondiale») ne sont que du bluff; au même moment, la «maison blanche» russe rassure la Maison Blanche nord-américaine: la Russie n'interviendra jamais militairement dans la crise du Kosovo. Hypocrisie, double discours,... sans doute, mais ce qui caractérise la diplomatie bourgeoise n'explique pas entièrement cette façon de procéder. Les contradictions flagrantes de l'Etat en Russie sont a chercher dans la situation réelle qu'il doit affronter: différentes institutions bourgeoises (parti «communiste», nationalistes, le parlement, ainsi que certains secteurs de l'armée russe) revendiquent une Russie puissante, capable d'affronter les USA et de soutenir les frères serbes,... en même temps, les dirigeants des appareils centraux de l'Etat sont conscients de leur faiblesse stratégique et ne peuvent aller plus loin que ce double discours pour tenter de les apaiser.
Ce rôle le pousse à fortifier les institutions internationales (OTAN, FMI, et OMC), à se placer et à assumer la fonction de garant idéologique et militaire des intérêts généraux du capital, et ce, bien que cela puisse entrer en contradiction avec les intérêts particuliers de telle ou telle fraction dominante aux Etats-Unis.
Il n'y a pas que les intérêts économiques de l'espace productif des Etats-Unis, énergétique ou autres, qui soient vitaux pour la structuration de cet Etat; les intérêts qui dépassent le cadre du pays le sont également. Ces intérêts déterminent la force de la politique internationale de l'Etat nord-américain, la nécessité de constituer et de fortifier les appareils internationaux qui s'unifient et s'associent à d'autres Etats pour imposer des politiques économiques libérales, c'est-à-dire des politiques qui expriment le mieux le fonctionnement de la loi de la valeur au niveau international. Mais, encore une fois, le développement de cette unification peut exacerber d'autres conflits interbourgeois, y compris au sein d'alliances qui paraissent aujourd'hui stables.
«La politique étrangère américaine doit se donner pour but de convaincre d'éventuels rivaux qu'ils n'ont pas besoin de jouer un plus grand rôle. (Notre statut de superpuissance unique) doit être perpétué par un comportement constructif et une force militaire suffisante pour dissuader n'importe quelle nation ou groupe de nations de défier la suprématie des Etats-Unis. Ceux-ci doivent tenir compte avec intérêt des nations industrielles avancées pour les décourager de défier le leadership américain ou de chercher à mettre en cause l'ordre économique et politique établi... L'ordre international est en définitive garanti par les Etats-Unis et ceux-ci doivent se mettre en situation d'agir indépendamment quand une action collective ne peut être mise sur pied». «Nous devons agir en vue d'empêcher l'émergence d'un système de sécurité exclusivement européen qui pourrait déstabiliser l'OTAN. En Extrême Orient, il faut rester attentif aux risques de déstabilisation qui viendraient d'un rôle accru de nos alliés, en particulier du Japon» (Rapport Wolfowitz, 1992).
Rand Corporation -importante institution d'analyse des Etats-Unis qui collabore étroitement avec le Département de la Défense- présente cette nécessité de maintenir l'ordre comme si c'était un coût économique: «Sans la Pax Americana, le capitalisme va à sa perte. La stabilisation du système international est donc une affaire ruineuse. Une puissance hégémonique contrainte d'accorder une telle importance à la sécurité militaire doit détourner des capitaux et la créativité du secteur civil».
Comme on le voit, les intérêts politiques, la lutte des USA pour se consolider comme Etat hégémonique, la paix nord-américaine comme synonyme de pérennité du capitalisme sont présentés comme des niveaux séparés, désintéressés, et même autonomes du terrain économique; comme le prix à payer pour le maintien de l'ordre mondial. Mais en réalité, c'est l'économique qui détermine l'importance vitale de toute action politico-militaire et la nécessité de se consolider comme puissance face à ses concurrents. De plus, le commerce des armes, loin d'être un «coût», est un secteur économique clé qui dynamise l'accumulation capitaliste dans ce pays et dans le monde entier.
Il était impératif d'adapter la politique internationale à la nécessité de maintenir sous contrôle les situations conflictuelles qui surgissaient sans discontinuer de la lutte de classes et de la désorganisation capitaliste dans les zones d'Europe de l'Est. Comme l'affirmaient les principaux représentants des Etats des pays de l'Est, on craignait que la crise économique ne détermine le ressurgissement de réponses prolétariennes qui pouvaient non seulement coûter cher aux Etats dits «communistes» mais aussi, vu la possibilité d'extension de ces conflits, aux Etats du reste de l'Europe. Les luttes en Pologne, Roumanie ou Albanie matérialisaient déjà ces appréhensions du capital international.
L'OTAN, comme institution mondiale du capital, ne pouvait échapper à ses responsabilités: elle devait adapter sa politique militaire au contrôle de cette zone potentiellement conflictuelle. Dès 1991, lors de la conférence de Rome, sont fixées les nouvelles tâches que l'OTAN va devoir assumer face à l'instabilité sociale qui s'annonce et, si les problèmes intercapitalistes sont évidents, c'est la compréhension du danger prolétarien qui sera déterminante: «Les risques auxquels est exposée la sécurité des Alliés tiennent probablement moins à l'éventualité d'une agression calculée contre le territoire des Alliés qu'aux conséquences négatives d'instabilités qui pourraient découler des graves difficultés économiques, sociales et politiques que connaissent de nombreux pays d'Europe centrale et orientale».
La clarté avec laquelle l'OTAN parvient à exprimer les deux tendances qui surgissent du développement de la crise capitaliste dans cette zone, la guerre et la révolution, est étonnante. A partir de l'analyse des rapports de forces, elle délimite la politique de son intervention pour prévenir et gérer les conflits qui surgiront inévitablement. Son objectif: éviter à tout prix une situation qui mette en péril la paix sociale actuelle, une désorganisation du système productif. Ainsi l'OTAN assume de façon organisatrice et militaire les besoins actuels de la bourgeoisie: maintenir la paix sociale et, pour ce faire, prévenir, diriger et contrecarrer les situations potentiellement conflictuelles.
Mais cette prétention, qui est celle d'assurer un développement pacifique au processus d'accumulation du capital, vient achopper aux conditions sociales créées par la valorisation du capital. La lutte contre la diminution du taux de profit ne peut être menée qu'en déchargeant tout le poids de la réorganisation sur le prolétariat. Les conflits interbourgeois s'intensifient et la capacité de les diriger s'amenuise; la désorganisation de la production augmente, créant les conditions d'une nouvelle émergence du prolétariat.
Actuellement l'OTAN peut se présenter comme une force capable de diriger centralement les processus guerriers du capital, capable de les arrêter si c'est nécessaire, d'imposer la paix bourgeoise contre le prolétariat,... mais tôt ou tard il lui faudra affronter une intensification des rapports de forces qui, toute consciente et organisée qu'elle soit, lui rappellera que l'anarchie du capital, sa dévalorisation généralisée et les conflits qu'il génère ne peuvent être planifiés. Tandis que l'OTAN se fortifie et s'impose comme gendarme international de l'ordre capitaliste, ses limites et sa fragilité aussi se manifestent. Limites et fragilité qui transparaissent lorsqu'il s'agit d'imposer «son» ordre au sein des fractions bourgeoises et de conduire le prolétariat vers la généralisation d'une guerre. Chaque pas que fait l'OTAN dans ses alliances, dans ses interventions, dans ce qu'on appelle «la force de coordination» de tous les contingents qui la composent, chacun de ces pas fait surgir des contradictions, des possibilités d'expulsion ou d'attraction d'autres fractions, d'intensification des contradictions entre capitaux et, par là, le risque de voir émerger d'autres constellations impérialistes en contradiction avec les intérêts qu'elle défend.
D'autre part, l'OTAN ne pourra jamais contrôler le choc violent produit par la contradiction entre la valorisation et la dévalorisation du capital, entre les forces productives et les rapports de production: autrement dit, elle ne pourra empêcher le surgissement d'une nouvelle vague, beaucoup plus puissante, de luttes révolutionnaires au niveau mondial. Cette perspective est inévitable, l'OTAN ne peut que la postposer. Aujourd'hui déjà la fragilité de la paix sociale est évidente: les idéologies censées conduire le prolétariat à la guerre généralisée et en faire la chair à canon des intérêts capitalistes n'ont pas l'impact voulu. La généralisation de la guerre capitaliste entraîne la perspective d'une ruine totale de la paix sociale dont le capitalisme a besoin pour exploiter et accumuler.
La force de l'OTAN engendre ses propres faiblesses: aujourd'hui elle peut postposer les besoins destructifs du capital mais pas les éviter. Ces besoins transforment la force de l'OTAN en faiblesse stratégique, face à des nécessités guerrières qui ressurgiront évidemment avec plus de puissance et de façon encore plus incontrôlable. La conscience bourgeoise a ses limites, sa volonté de contrôler la catastrophe contenue dans le capitalisme aussi.
L'OTAN n'exigeait pas seulement le privilège de diriger et d'obtenir la liberté pleine et entière de circuler et de s'installer sur «l'ensemble du territoire de la Fédération Yougoslave, espace aérien et eaux territoriales compris», elle voulait également «utiliser les aéroports, les routes, les voies ferrées et les ports, sans payer de charge, de droit, d'impôt, de péage ou de rente». L'OTAN exigeait «l'immunité de juridiction civile, administrative et pénale... [ainsi que le droit] d'augmenter ou de modifier selon sa volonté, les infrastructures de tout le territoire de la Fédération Yougoslave, comme les ponts, les tunnels, les bâtiments et les systèmes d'utilité publique».
Il est clair que l'Etat serbe ne pouvait accepter cette exigence, qu'il s'agissait là d'une véritable déclaration de guerre. C'est de cette manière que l'OTAN, consciente de ce fait et gardant pour objectif sa propre domination militaire, provoqua l'éclatement de la guerre. «Il n'y a jamais eu de négociations... il s'agissait d'imposer une sorte de protectorat international sur le Kosovo, qui n'avait plus rien à voir avec l'autonomie de la province... Il était question d'envoyer au Kosovo une force internationale de 28.000 hommes, dont la mission, nous disait-on, aurait été de 'désarmer l'armée de l'UCK'... le déploiement de troupes de l'OTAN au Kosovo était la véritable objectif de la réunion de Rambouillet... le véritable enjeu était d'implanter une base de l'OTAN au Kosovo» (Branko Brankovic, ambassadeur de la République Fédérale de Yougoslavie aux Nations Unies).
L'OTAN, par le biais de son secrétaire général, J.Solana (hier secrétaire général de l'OTAN, Solana est aujourd'hui responsable de la politique extérieure et de la défense de l'Union Européenne), fit tout ce qui était en son pouvoir pour que la présence militaire internationale en Yougoslavie soit acceptée. Avant le déclenchement de la guerre, elle avait déjà négocié avec l'Etat russe, lui concédant un niveau d'autonomie dans le partage du commandement militaire, et elle avait également obtenu l'approbation des autres Etats, ne faisant pas partie de l'OTAN, quant à son intervention militaire. Rambouillet devait couronner la présence militaire internationale en territoire yougoslave. «Le grand argument visant le gouvernement de Milosevic s'appuyait sur le fait que neuf ans de répression et une année d'hostilité militaire ne lui avait pas suffit pour étouffer la rébellion de la province. Et qu'en conséquence, si d'un coté la présence militaire internationale protégerait les revendications autonomistes des Kosovars, de l'autre, elle constituerait l'unique garantie permanente que ces revendications ne mettent pas en danger l'intégrité territoriale du pays» (El Pais, 01/03/1999).
Pour que l'OTAN puisse se fortifier comme institution étatique du capitalisme mondial, il fallait que l'ordre social règne dans les Balkans. Afin de défendre leurs intérêts impérialistes, tant économiques que politiques et militaires, pour imposer leur logique libéraliste dans ces espaces productifs, et principalement pour imposer le contrôle capitaliste sur le prolétariat qui, déjà en Albanie (18) émergeait comme force désorganisatrice de l'Etat capitaliste, certaines fractions bourgeoises exigèrent l'occupation du territoire yougoslave par l'OTAN.
Il ne s'agissait pas d'un choix parmi d'autres mais d'une nécessité
stratégique qui mettait en jeu la viabilité même de
cette alliance: «Il n'est pas exagéré de dire que
si l'OTAN ne parvenait pas à s'imposer cela signifierait la fin
de l'organisation atlantique comme alliance crédible, et la fin
du leadership mondial des Etats-Unis. Les conséquences seraient
dévastatrices pour la stabilité mondiale» (Zhigniew
Brzezinski, ex-assesseur des affaires de la sécurité nationale
du président des Etats-Unis).
L'OTAN se libéra donc de la tutelle de l'ONU et attaqua sans le consentement du Conseil de Sécurité, précisément conçu pour assurer la paix mondiale. Ainsi on peut voir quelles seront les méthodes futures: lorsqu'il s'agit d'assumer les nécessités guerrières du capital, d'imposer l'ordre, aucune institution ou formalisation juridico-démocratique ne peut empêcher l'action décidée de ceux qui assument les tâches fondamentales du capital. Mais ceci n'est pas neuf. Nixon a envahi l'Indochine sans l'autorisation du congrès nord-américain, Reagan a fait de même en Amérique Centrale et Clinton a bombardé l'Irak sans consulter les «institutions démocratiquement élues par les citoyens américains». Les véritables nécessités démocratiques du capital (faire la guerre), ne peuvent être réfrénées par les institutions formelles de cette démocratie; institutions qui, comme lors de coups d'Etat, sont suspendues simplement parce qu'elles sont totalement secondaires par rapport à l'essence démocratico-terroriste du capital. Mais cela non plus n'est pas nouveau. Toute l'histoire du capitalisme montre que lorsque l'action de certaines fractions de la bourgeoisie fut nécessaire, celles-ci agirent sans l'aval des «institutions démocratiquement élues». Ce qui est «nouveau», ce qui «change» ne se situe donc pas dans les «transgressions» que commettraient ces institutions, mais dans le cynisme avec lequel le besoin du capital est annoncé et perçu et dans la volonté de donner un cadre légal qui légitimise tout type de transgression.
De Chomsky à Debray en passant par tous les autres personnages du monde du spectacle, tous s'insurgent contre la «dégradation de la démocratie»... alors qu'en fait, c'est l'existence même de cette démocratie qui requiert l'utilisation des armes et le terrorisme d'Etat. Ces messieurs prétendent défendre des solutions pacifiques, «humanitaires», mais il suffit de regarder dans l'histoire: lorsque le passage aux armes s'impose comme seule solution contre un prolétariat qui émerge comme force sociale, ces pacifistes «humanistes» n'hésitent pas un seul instant à recourir à la répression ouverte, ou, tout au moins, à la soutenir. Ainsi aujourd'hui, les écologistes, avec leurs discours en défense de l'environnement, ne voient aucun problème à s'impliquer directement dans la guerre. Ces messieurs (19) sont tout-à-fait conscients du fait que les désastres écologiques engendrés par les bombardements (non seulement en Yougoslavie mais dans toute l'Europe) seront énormes, et sans se cacher, ouvertement ils les appuient. L'écologiste J.Fischer, Ministre des Relations Extérieures allemandes, en accord avec ses homologues des autres pays, a activement participé aux décisions politiques qui donnèrent le feu vert au lâcher des bombes assassines de l'OTAN (20). Et il ne resta plus aux autres écologistes, à tous ceux qui croient en leur noble cause et pour lesquels c'est au sein des parlements qu'il faut résoudre les choses, que les larmes et les déclarations d'impuissances. Ainsi, rien ne fut plus facile que d'aggraver le grand désastre écologique qu'engendrent toujours les bombes: destruction directe ou indirecte (par exemple, via les nuages toxiques) de la faune et de la flore, pollution des rivières, dévastation écologique de la Mer Méditerranée, et leurs cortèges de cancers, naissances difformes, etc. Aujourd'hui comme hier, colombes de la paix et faucons guerriers ne font qu'un, choisissant leur masque selon les circonstances.
Et ces Etats qui, aujourd'hui enhardis par le manque de réaction prolétarienne, font la guerre au nom des «droits humains au Kosovo» sont ceux-là même qui réduisent à néant «leurs» Noirs aux USA, ou «leurs» Arabes en Europe; ce sont eux qui dans leur course effrénée au profit jettent à la rue des masses de travailleurs, les privant des moyens les plus élémentaires de survie tout en soumettant ceux qu'ils peuvent encore exploiter à une intensification si monstrueuse du travail qu'elle provoque une augmentation du stress et tout un tas de maladies et de calamités crées et/ou aggravées par le travail producteur de plus-value.
Autre aspect important de cette «nouvelle» idéologie avec laquelle on déclare la guerre: «la guerre propre», avec zéro mort, sans pertes dans les armées qui attaquent. Mis à part le cynisme complet qui consiste à parler d'«accidents», de «pertes collatérales», mise à part la destruction écologique que le capital effectue quotidiennement en temps dit de paix, la base fondamentale de cette idéologie s'enracine dans la nécessité de maintenir le contrôle bourgeois sur le prolétariat, la peur de ramener des soldats morts et d'ainsi exacerber des contradictions qui pourraient pousser le prolétariat à se révolter, à se constituer en force destructrice de la société actuelle. Comme on le verra dans le texte qui suit, les différentes manifestations qui éclatèrent contre la guerre, bien qu'encore faibles et limitées rappellent à la bourgeoisie que sa paix sociale est fragile et qu'elle ne résiste pas à la guerre, que le fantôme d'un prolétariat combatif peut facilement évoluer vers une situation de réémergence révolutionnaire.
La version officielle de l'OTAN consistant à défendre qu'il s'agit d'une intervention contre «l'extermination ethnique au Kosovo», s'est imposée dictatorialement, et tous ceux qui dénonçaient la terreur vécue par le prolétariat en Serbie et au Kosovo furent persécutés ou censurés. On réprima même les timides descriptions ou critiques de l'intégrisme démocratique de l'OTAN faites par certains journalistes. La majorité des ministres de l'Union Européenne appuyèrent sans honte l'offensive de l'OTAN, seuls les ministres grec et italien s'y opposèrent tandis que les ministres irlandais, autrichien, suédois et finlandais se déclaraient neutres. Koffi Annan, le secrétaire de l'ONU se fit fort de confirmer son accord avec les bombes assassines: «Il est des moments où l'usage de la force peut être légitime pour la poursuite de la paix».
Comme on le sait, après les premiers bombardements, la population soi-disant défendue entame un exode massif (800.000 personnes) tandis que les fabricants de l'opinion publique parlent de «désastre humanitaire». Non sans difficulté ni cynisme, l'OTAN, par la voix de J.Solana, tente de nier sa responsabilité dans la catastrophe et l'exode, affirmant que ceux-ci ne sont pas le produit de l'intervention militaire mais d'une stratégie de nettoyage ethnique dirigée par Milosevic: «Si nous n'avions pas attaqué, la situation aujourd'hui serait identique, sinon pire».
Le rapport des enquêtes réalisées entre décembre 1998 à mars 1999 par les 1.300 observateurs de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) qui devaient vérifier les atrocités commises par les «Serbes» contre «le peuple du Kosovo» fut déclaré «confidentiel». Jacques Proud'homme, conseiller, membre du contingent français de la mission de l'OSCE, soutient que durant les mois qui ont précédé la guerre, ses collègues et lui-même n'ont rien constaté qui puisse être assimilé à des exactions systématiques, tels des assassinats collectifs ou individuels, l'incendie de résidences, des déportations,... dans la région de Pec, où leur mission circulait librement. Si ce témoignage confirmait la globalité du rapport de l'OSCE, cela signifierait que le dit «désastre humanitaire» est le produit exclusif de l'intervention de l'OTAN.
Ce qui ne fait en tout cas aucun doute et qui s'est vérifié dans les faits, c'est que le terrorisme d'Etat s'est généralisé avec l'intervention de l'OTAN et que cette dernière a aggravé les massacres qu'elle prétendait combattre. La répression des milices serbes était sélective, l'intervention de l'OTAN généralisa cette répression et la seule alternative pour le prolétariat fut la fuite. C'est ainsi que commença un exode massif.
Le 26 mars, l'OTAN reconnait ce qu'elle appelle «des effets collatéraux»: la mort de centaines de civils, la destruction d'hôpitaux, de moyens de transport et d'infrastructures utilisés par la population civile. Plus tard, se produiront d'autres «accidents collatéraux» qui s'ajouteront à la liste des «objectifs non militaires» détruits: ponts, dépôts de combustible en zones industrielles, raffineries de pétrole, quartiers ouvriers, systèmes d'approvisionnement en eau, électricité, pétrole,... L'idéologie d'une guerre contre Milosevic qui n'attaquerait pas le peuple serbe commence alors à s'effriter; les promesses d'une guerre rapide et propre ne résistent pas à la dure réalité. L'escalade guerrière s'intensifie et l'intervention terrestre se dessine de plus en plus comme la seule perspective capable de réaliser les objectifs initiaux de l'OTAN. Tandis que se dévoile peu à peu le véritable et immonde visage de l'intervention de l'OTAN - et par voie de conséquence l'essence de toute guerre impérialiste: une guerre contre le prolétariat - quelques ripostes prolétariennes à la guerre commencent à se manifester, exprimant l'existence de brèches importantes dans les fronts militaires, comme nous le verrons dans l'article suivant.
Comme nous le disions, la guerre fut déclarée avec la promesse de ne pas impliquer de soldats US dans des affrontements terrestres, mais l'Etat yougoslave ne céda pas devant les attaques aériennes; son attitude et son opposition aux exigences de l'OTAN devenant de plus en plus intransigeantes. Du coup, les différents chefs d'Etat de l'OTAN se virent confrontés à une vérité que les grands chefs militaires avaient annoncée dès le départ: une campagne aérienne ne peut atteindre les objectifs prévus si elle n'est pas accompagnée ou suivie d'une offensive terrestre: «Les militaires américains anglais et français font tous remarquer que des bombardements n'ont jamais suffi, à eux seuls, à remporter une guerre, encore moins à conclure une guerre civile» (déclaration de Mr. Védrine, co-président de la conférence de Rambouillet).
C'est sans conteste l'appareil militaire qui défendit le plus clairement cette voie. Mi-mai, dans un message envoyé à Clinton, les militaires du Pentagone affirment que la guerre contre la Yougoslavie va mal et que la seule manière d'assurer la victoire dépend de l'envoi de forces terrestres qui puissent agir dès le début du mois d'août. Ils critiquent la Maison Blanche qu'ils tiennent pour responsable de l'enlisement militaire. Le général Powell, chef d'Etat-major pendant la guerre du Golfe, affirme: «J'aurais présenté mes objections à une campagne qui non seulement n'incluait pas de troupes terrestres mais qui, dès le début, écarta la menace de l'utilisation de ces force terrestres».
Le Général Morillon, chef de la FORPRONU en Bosnie déclare: «Croire que l'on peut faire la guerre sans pertes humaines est une illusion. La théorie américaine du «zéro mort» est le meilleur moyen d'être totalement désarmé». Cette détermination claire ne sera pas uniquement défendue par des chefs militaires, le social-démocrate chef des escadrons de la mort de l'Etat espagnol, Felipe Gonzales en personne, défendra l'intervention «avec forces de terre si nécessaire».
Le président Clinton qui redoute tant une intervention terrestre «parce que c'est dangereux pour la vie des soldats américains», commence alors, avec l'appui de Tony Blair à étudier les possibilités d'une intervention terrestre et à mobiliser les réservistes. Fin mai 1999, plus de 30.000 réservistes sont mobilisés aux Etats-Unis. Pendant ce temps, Solana reste intransigeant et exclut toute négociation avec Milosevic: «Il n'y a pas de place pour une négociation ou un compromis avec Milosevic; nous avons indiqué nos exigences et ces conditions seront remplies dans leur totalité».
Les Etats-Unis insistent sur l'exécution des conditions exigées. L'OTAN veut être le noyau central des unités internationales qui protègeront les réfugiés. Le parti républicain propose alors de doubler le budget extraordinaire sollicité par Clinton pour la guerre et critique d'une part la position de Madeleine Albright, secrétaire d'Etat, qui désire vendre une guerre rapide et, d'autre part, «l'irresponsabilité» du président qui s'est lié les mains en promettant de ne jamais envoyer de troupes terrestres combattre les yougoslaves.
Le Général Klaus Naumann, chef du comité militaire de l'OTAN déclare: «A ce jour, dans l'histoire militaire, nous n'avons jamais vu d'opération qui se termine avec succès en utilisant exclusivement la force aérienne». Le président espagnol Aznar refuse de soumettre au Congrès quelle que décision que ce soit concernant la guerre, et refuse de s'engager à attendre une autorisation préalable du parlement avant de décider d'un éventuel envoi de troupes espagnoles pour participer à une intervention terrestre.
C'est à cette période que se tient le sommet commémorant le cinquantième anniversaire de l'OTAN. Clinton et Blair s'y rendent et confirment qu'ils ouvrent la voie à l'étude d'une possible escalade avec envoi de troupes d'infanterie. Blair déclare au parlement britannique que l'OTAN ne doit pas renoncer à la possibilité d'envoyer des troupes terrestres. Solana et le général nord-américain Wesley Clark, commandant militaire en Europe, déclarent qu'ils sont en train d'étudier la possibilité d'une éventuelle campagne terrestre contre la Yougoslavie. Robert Hunter, ex-ambassadeur des Etats-Unis à l'OTAN, dit: «Nous ne sommes pas en train de gagner, parce qu'il y a une claire disproportion entre les objectifs de l'OTAN et ses méthodes». Clark exprime ses frustrations face aux limitations imposées à la campagne par la nécessité d'un consensus politique entre les 19 membres de l'OTAN. Mais, au moment même où on reconnait que de cette façon on ne peut pas gagner la guerre, on déclare publiquement qu'on détruira au moins les forces productives de l'adversaire, révélant ainsi une partie des objectifs de la guerre. Ainsi, en mai fleurissent les premiers bilans de la guerre: soixante-six jours de destruction triomphale et implacable en ont fini avec les noyaux industriels importants du pays, entraînant des dégâts économiques supérieurs à ceux causés dans le pays par la dite seconde guerre mondiale et laissant sans emploi plus de 600.000 personnes (José Vidal-Beneyton, El Pais, 28/05/99). De plus, on affirme avoir détruit les infrastructures approvisionnant Belgrade et la majeure partie du territoire serbe en eau et en électricité.
L'Institut de Recherche et de Sondage nord-américain sonne l'alarme: la popularité de Clinton chute ainsi que le soutien à la participation nord-américaine à la guerre; les gens s'inquiètent des possibles pertes en vies américaines dans les Balkans, en particulier si une offensive terrestre est déclarée. La bourgeoisie craint manifestement de se retrouver dans une situation similaire à celle de la guerre du Vietnam. De nombreuses personnalités d'Etat affirment être dans l'impossibilité de recruter des hommes pour aller défendre des intérêts qu'ils comprennent à peine.
A cette période, le Sénat de Etats-Unis repousse une motion autorisant Clinton à «employer la force nécessaire et autres moyens, en accord avec les alliés, pour atteindre les objectifs des Etats-Unis et de l'OTAN». Les Chambres exigent du président qu'il demande l'autorisation au Congrès pour toute escalade militaire supposant l'envoi de troupes terrestres. On commence même à critiquer les attaques aériennes: 17 membres de la chambre des représentants présentent une dénonciation contre Clinton, arguant que l'attaque aérienne viole l'acte des pouvoirs de guerre de 1973 selon lequel c'est au Congrès qu'il revient de déclarer la guerre ou de voter en faveur d'une action militaire.
Par ailleurs, si l'Etat albanais a inconditionnellement appuyé l'OTAN, ses territoires du nord, très montagneux ne facilitent pas une campagne terrestre, ce qui rend l'utilisation des territoires grec et macédonien indispensable. Mais ces Etats se trouvent dans une situation inconfortable et hésitent à donner leur feu vert aux plans militaristes de l'OTAN. En effet, depuis le début de la guerre, surtout en Grèce, différentes manifestations se sont déroulées qui ont poussé les gouvernants à refuser de céder leur territoire pour des opérations militaires. Simultanément, les Etats allemands et italiens refusent d'envoyer des troupes d'infanterie. Comme on le verra plus loin, à ce moment-là, l'Etat allemand prétend diriger, via l'Union Européenne, les négociations visant à mettre un terme au conflit. Le premier ministre italien M. D'Alema propose alors à l'OTAN un cessez-le-feu pratiquement inconditionnel, sans attendre l'approbation d'un accord de paix par le Conseil de l'ONU et sans exiger comme préalable le retrait des troupes serbes du Kosovo. Ce cessez-le-feu se concrétiserait à partir du moment où on aurait trouvé un accord avec la Russie et la Chine sur une résolution encore en préparation à présenter au Conseil de Sécurité, une proposition que la Grèce considère urgente. En Russie, l'opposition stalinienne et nationaliste, majoritaire à la Douma, dénonce ce qu'elle appelle «la trahison des frères yougoslaves» et critique férocement «le caractère pro-américain» de la présidence. Les conflits entre les fractions bourgeoises s'intensifient. En Chine, après le bombardement de l'ambassade de ce même Etat à Belgrade, les manifestations contre l'OTAN et les Etats-Unis se radicalisent. Ces manifestations, tolérées et même stimulées par l'Etat chinois dans un premier temps, se transforment peu à peu en actions combatives que l'Etat ne parvient plus à contrôler. Confrontée à une telle situation, la présidence américaine recule et affirme que les alliés n'ont pas trouvé d'accord concernant la campagne terrestre et que celle-ci pourrait provoquer des divisions au sein de l'OTAN. On accepte que la force internationale pour le Kosovo, tout en restant sous la direction de l'OTAN, puisse agir sous «le parapluie» de l'ONU et inclure une importante présence russe et ukrainienne, et, dans le même temps, on se déclare disposé à faire «une pause» dans les bombardements si les Serbes commencent à se retirer du Kosovo. L'heure des négociations est ouverte. En mai, le G-8, groupe comprenant les 7 pays «les plus industrialisés» et la Russie, parvient à un accord dont les bases sont le «déploiement au Kosovo d'une présence internationale efficace, civile et de sécurité» sous l'égide de l'ONU et la réduction de 5 à 2 des conditions clés exigées par l'Alliance pour cesser les bombardements: retrait des troupes de Milosevic et déploiement d'une force internationale sur les lieux. On considère que «les 3 autres [conditions] (l'arrêt des tueries, le retour des réfugiés et un cadre politique à long terme) sont contenues dans les deux premières».
Le G-8 reconnait également le Kosovo comme partie de la Yougoslavie et demande le désarmement des guérilleros de l'UCK. Un plan de reconstruction pour les Balkans est ensuite approuvé qui ouvre la possibilité, pour ces Etats, de devenir membres de l'Union Européenne. Les consignes sont: démocratisation et droits de l'homme, reconstruction économique, développement, coopération et sécurité. Le gouvernement yougoslave approuve cet accord. Fin mai, une délégation russe est envoyée à Belgrade pour négocier la fin de la guerre. Ensuite, une délégation de l'Union Européenne, présidée alors par la Finlande, obtient finalement de l'Etat yougoslave qu'il réduise ses exigences et de Milosevic qu'il retire totalement ses forces militaires, policières et paramilitaires du Kosovo. Est accepté également le déploiement sur ce territoire d'une force internationale à laquelle participeront les troupes russes mais dont le noyau essentiel sera intégré par l'OTAN.
Ainsi se termine un conflit dont les possibilités d'extension, sur le plan terrestre, furent importantes mais auquel les protagonistes principaux décidèrent de mettre un terme, de peur qu'une guerre sur terre n'engendre une remise en question de la paix sociale internationale. Dans cette décision, on peut remarquer une grande clarté, une grande conscience de la part de la bourgeoisie. Même les limites de la sociologie et de l'économie politique semblent avoir été dépassées: le prolétariat est vu, par les secteurs les plus lucides de la bourgeoisie, non plus comme les ouvriers, les simples travailleurs, mais comme potentiel de rupture qu'il ne faut à aucun prix réveiller.
La bourgeoisie peut bien utiliser tout son arsenal militaire, idéologique,
politique et économique pour maintenir le contrôle sur notre
classe, elle n'arrivera pas à éliminer les déterminations
matérielles qui la poussent vers la guerre. La seule chose qu'elle
puisse faire c'est postposer, une fois de plus, cette alternative qui,
de toute façon, se représentera tôt ou tard avec plus
de force. La guerre, qui est principalement dirigée contre notre
classe, pousse celle-ci à lutter, à opposer la révolution
à la guerre bourgeoise. Il y aura sans doute toujours des secteurs
bourgeois capables de comprendre ce danger, mais jamais ils ne pourront
l'éviter.
a) La consolidation d'une idéologie qui permette de canaliser la lutte prolétarienne et son dévoiement en luttes interfractions.
b) La réorganisation des constellations capitalistes, c'est-à-dire la convergence et la centralisation de certaines fractions du capital en forces internationales pour s'affronter dans de meilleures conditions aux autres fractions.
Lors de la dite guerre froide, l'idéologie dominante prêchait la lutte contre ce que la bourgeoisie mondiale appelait, d'un commun accord, «le communisme», ou, de l'autre côté, «l'impérialisme capitaliste». Grâce à ces idéologies, le prolétariat fut mobilisé et utilisé comme chair à canon dans les différentes guerres interbourgeoises qui éclatèrent sur les cinq continents, et y compris au sein de chaque pays. Avec la chute du mur de Berlin, ces idéologies se sont modernisées, quoique dans certains cas on se limite à repeindre d'une autre couleur de vieilles idéologies des siècles passés. Ainsi, sont remis au goût du jour des idéologies telles la lutte humanitaire, «le combat pour la civilisation», «pour la démocratie», «contre le fascisme», «contre la barbarie», «contre le non-respect de droits de l'homme»,... pendant que les staliniens de vieille souche, rejoints par d'autres personnages de la gauche bourgeoise, réclament avec nostalgie le retour à la bonne «époque» du «communisme», dénonçant ce qu'ils appellent «la mondialisation» et glorifiant un passé soi-disant favorable à la classe ouvrière.
Les guerres, qui n'ont jamais cessé, se transforment ainsi en «guerres humanitaires», et la guerre au Kosovo va servir de laboratoire aux différentes fractions du capital. En effet, les Etats capitalistes pourrons y mesurer et y confronter la force et les limites que ces idéologies exercent sur les milieux prolétariens. Sur le terrain, on compare l'efficacité mobilisatrice des différentes idéologies, leur capacité à obtenir la mobilisation populaire.
L'expédition aérienne en Yougoslavie est le prélude à l'extension de la guerre, c'est au cours de cette campagne que se noueront les différentes alliances dans la perspective de futurs affrontements. En fait, l'analyse de ces intérêts contradictoires n'entre pas dans les «modèles» généralement utilisés. Ainsi, d'habitude, le terme bloc est employé pour désigner l'association des forces impérialistes qui s'affrontent. Nous préférons le terme constellation à celui de bloc qui induit une notion trop figée et statique du processus contradictoire d'unification. La dialectique qui anime les alliances bourgeoises menant à la guerre ne résiste pas aux concepts immuables: chaque alliance de capitaux se réalise contre d'autres et, par conséquent, attire et repousse. Comme nous l'avons toujours dit, ce processus d'unification attise les contradictions. Par exemple, lors de la dite seconde guerre mondiale, des groupes de capitaux et d'Etats nationaux sont passés d'un camp à l'autre, et même au sein de chaque Etat on vit d'importants affrontements armés entre fractions: l'Etat russe s'allia à l'Etat nazi pour ensuite passer dans le camp «allié», l'Etat français, sous le gouvernement de Vichy, collabora activement avec le gouvernement nazi pour passer ensuite, lui aussi, dans le camp des «Alliés». L'unification autour de l'intervention de l'OTAN dans les Balkans ouvre la voie à d'autres contradictions et à la possible constitution d'autres polarisations dans le conflit. Mais si les processus d'unification se font sur base de contradictions d'intérêts, ces derniers en retour consolident un centre à travers lequel s'unifient des capitaux, et une fraction impose l'ordre -son ordre et l'ordre bourgeois général- aux autres fractions. Le phénomène qui se rapproche le plus près de cette dialectique d'attraction/répulsion est celui de la constellation. Dans les constellations existe un noyau qui attire et repousse en permanence mais qui génère aussi de nouveaux noyaux, qui, à leur tour, créent d'autres constellations. Ce concept permet de mieux capter que derrière les unions, des noyaux sont en gestation qui opposeront une constellation à une autre. Ainsi, on peut comprendre comment dans le processus même de la guerre, des capitaux individuels de sociétés, de consortiums, de groupes militaires, nationaux, étatiques,... passent d'une constellation à une autre selon leurs intérêts spécifiques qui ne sont jamais fixés définitivement. Par exemple, on a vu récemment comment l'Etat allemand a ressurgi comme noyau potentiel d'attraction et de contradiction.
Nous allons maintenant voir le double processus qui est en cours: consolidation des institutions étatiques internationales devant assumer les nécessités globales du capital, et développement, au sein même de ces institutions, d'intérêts contradictoires qui poussent à d'autres alliances.
«Les Etats-Unis étant le seul pays ayant des intérêts globaux, ils sont le leader naturel de la communauté internationale» (J.Perry, ex-secrétaire de la défense du président Clinton). Pour défendre ces principes, «avant nous ne disposions pas de théorie [...]. Le concept stratégique est la codification de l'expérience, y compris celle du Kosovo [...] sur la façon dont se font les missions d'interposition et de pacification, grâce à de grandes coalitions politiques qui fonctionnent par consensus, sans voter. Une des fonctions principales du secrétaire général est d'agir comme catalyseur de ce consensus» déclara K.Annan, secrétaire général de l'ONU, qui défend également «la nouvelle pensée» sur «le droit d'ingérence». Ces citations sont on ne peut plus claires. Elles révèlent que le gendarme mondial a pour fonction de maintenir l'ordre social face à un capitalisme qui entraîne une intensification de tous les conflits locaux et tend à la généralisation de la guerre. Encore une fois, le continent européen ressurgit comme champ géopolitique sur lequel les affrontements militaires tendent à se mondialiser. La guerre en Yougoslavie pose la nécessité de garantir la paix sociale face aux possibilités de guerre et de révolution que pourrait ouvrir la situation socio-économique actuelle.
L'OTAN joue donc le rôle de garant international. Elle doit être présente partout où son action est nécessaire, elle doit être prête à agir rapidement. Pour cela, il faut un mode de fonctionnement plus agile qui lui permette d'aller plus loin et d'agir plus rapidement que ne le permet la démocratie consultative. En fait, il s'agit de briser la limite du cadre parlementaire, des institutions où les oppositions entre fractions bourgeoises régissent les actions à mener. Les tâches centrales du capital ne peuvent être suspendues à des consultations démocratiques permettant de connaître l'opinion des différentes oppositions, elles doivent être assumées par les forces les plus aptes à les prendre en charge, celles capables de limiter le poids de l'acceptation de la décision unanime.
Lors du sommet de commémoration du cinquantième anniversaire de l'OTAN, cette nouvelle conception fut analysée et on tenta de lui donner un cadre légal. Ce sommet affirma haut et fort les nouveaux objectifs que l'intervention dans les Balkans imposait à l'OTAN comme institution garante de la paix: «Défense des droits de l'homme et maintien de la paix, même si elle doit intervenir dans des pays tiers». «Le Kosovo est le premier exemple de la mission dont s'est doté l'OTAN pour le XXIème siècle: défendre ses intérêts et valeurs dedans et hors des frontières, avec ou sans l'approbation explicite de l'ONU [...], dans l'idée claire de construire une force militaire plus puissante et plus flexible» (El Pais, 26/04/99).
Dans Le nouveau concept stratégique de l'Alliance, document approuvé lors du sommet de l'OTAN, sous le chapitre Menaces et risques en matière de sécurité, on peut lire: «Parmi ces risques on trouve l'incertitude et l'instabilité dans la région euro-atlantique et autour de cette région, ainsi que la possibilité de crises régionales à la périphérie du territoire de l'Alliance qui pourrait évoluer rapidement. Certains pays, dans ou autour de la région euro-atlantique affrontent de graves difficultés économiques, sociales et politiques. Les rivalités ethniques et religieuses, les disputes territoriales, l'insuffisance ou l'échec des efforts réformistes, les violations des droits de l'homme et la dissolution des Etats peuvent produire l'instabilité locale et régionale. Les tensions résultantes peuvent provoquer des crises qui affectent la stabilité euro-atlantique, souffrance humaine et conflits armés. Ces conflits pourraient avoir des répercussions sur la sécurité de l'Alliance et ils pourraient également affecter la sécurité d'autres Etats. [...]. Les intérêts de sécurité de l'organisation peuvent se voir affectés par d'autres dangers, au cadre plus large, tels les actes de terrorisme, sabotage et crime organisé, et les problèmes d'approvisionnement en ressources vitales. Le mouvement incontrôlé de groupes très nombreux de population surtout comme conséquence de conflits armés peut également poser des problèmes de sécurité et de stabilité qui portent atteinte à l'Alliance». Dans la quatrième partie du document on ajoute que: «La présence de forces conventionnelles et nucléaires des Etats-Unis en Europe est vitale pour la sécurité européenne qui est inséparablement liée à la sécurité nord-américaine». Concrètement, l'OTAN tente de formaliser le saut qualitatif que constitue l'assumation des tâches de police mondiale, prévoyant le surgissement et l'intensification des deux processus inévitables auquel conduit le développement du capital: la guerre et le risque de réponse prolétarienne, la révolution.
Comme nous l'avons vu, au travers de ces tentatives, la bourgeoisie tente d'affronter les contradictions inévitables de son système social: son équilibre social se maintient grâce aux fils fragiles d'une paix sociale que la guerre peut détruire. C'est pourquoi, elle avance sa perspective d'intervention terrestre pour ensuite se rétracter. Mais, il est clair que ce retrait ne lui permettra jamais d'éviter ni la guerre vers laquelle tend le capital, ni le choc certain que la guerre produit entre révolution et contre-révolution. D'autre part, nous voyons que les préparatifs d'une guerre généralisée continuent. Ces préparatifs sont non seulement politiques mais aussi militaires: le budget militaire des USA a été augmenté à 112 milliards de dollars pour 1999. Pour l'an 2000 il aura atteint 274 milliards de dollars et en 2005, 331 milliards de dollars. La rubrique privilégiée de l'augmentation budgétaire sera la «protection des forces», c'est-à-dire, la capacité d'envoyer vers d'autres territoires des troupes et du matériel militaires. Le Pentagone est également gâté: il recevra des crédits afin de perfectionner ses infrastructures militaires dans l'espace, ce qui lui permettra d'améliorer son pouvoir de communication et d'information.
L'OTAN prévoit d'incorporer trois Etats des pays de l'est (Pologne, Hongrie et République Tchèque) et organise un forum auquel ces Etats participent en compagnie du GCM (Groupe de Contact Méditerranéen): Egypte, Israël, Jordanie, Maroc, Mauritanie et Tunisie. «La campagne militaire des alliés au Kosovo tendait à prouver aux Etats-Unis que l'OTAN pouvait élargir son rôle en Europe, tout en maintenant son unité. A Washington, on s'est félicité de cela» (El Pais, 28/04/99).
Autrement dit, la puissance capitaliste qui sera la plus apte à gérer le chaos que provoquent les capitaux en guerre, celle qui démontrera que son développement est synonyme de développement général ce qui est précisément la raison pour laquelle, elle est la fraction la plus apte à contrôler son ennemi historique- imposera sa force et sa direction au sein des institutions mondiales du capital, affirmant ainsi son hégémonie internationale.
Aujourd'hui, ce rôle est assumé par l'OTAN et le FMI, la Banque Mondiale et les Etats-Unis; mais, à son tour, la contradiction entre ces institutions et d'autres forces capitalistes annoncent de violentes polarisations. Derrière la défense d'un Etat européen, que ce soit au nom de la «lutte contre la mondialisation imposée par les Etats-Unis à travers ses institutions internationales» ou au nom de «l'Europe sociale», ce qui se joue c'est la possibilité que surgisse une autre constellation d'Etats opposée à celle qui domine aujourd'hui. La construction de l'Identité Européenne de Sécurité et de Défense (IESD) provoque des contradictions avec les Etats-Unis: «les USA voient un intérêt stratégique dans une Europe forte. Les Etats-Unis ont besoin d'amis et de membres pour affronter ensemble les problèmes [...]. Le processus d'intégration européenne a donné la stabilité à l'Europe [...] mais il faut s'assurer que la relation transatlantique se renforce» (déclaration de la Délégation de Washington). Pour le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, le sommet européen de Cologne, en juin 1999, présente des contradictions graves avec les accords du sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Washington en mars de la même année. «Les conclusions de Cologne suggéraient une division des tâches entre l'OTAN et l'Union Européenne, de façon que l'OTAN était confinée à la défense territoriale et l'Union Européenne se chargeait de la gestion de la crise. Les USA ne désirent pas voir limiter le champ d'action de l'OTAN [...]; il faut institutionnaliser les liens pour que la conclusion du sommet européen d'Helsinki et la réunion ministérielle de l'OTAN se renforcent et ne se contredisent pas entre elles. Ainsi, il est d'une grande importance de considérer la position de la Turquie sans laquelle 'il est impossible de réaliser des opérations dans certaines zones'. La guerre du Kosovo 'montra un grave déphasage dans les capacités' des USA et de l'Europe». Cohen, le secrétaire de la Défense des USA, souligne également les contradictions existant entre son Etat et l'Union Européenne: «L'Alliance célèbre les tentatives croissantes de l'Union Européenne pour affirmer une politique de défense propre, pour autant qu'elles soient compatibles avec l'OTAN» (El País, 3/12/99). Le successeur de Solana à l'OTAN, George Robertson, défend quant à lui que la préoccupation la plus immédiate de l'Alliance reste de rétablir la loi et l'ordre: «Le Kosovo a subi quarante années de politiques économiques communistes désastreuses [...]; les consignes de l'heure doivent être la reconstruction et la démocratisation au Kosovo».
Voyons donc, comment le rôle de gendarme mondial de l'OTAN coïncide avec les intérêts et les projets des autres Etats.
Pendant le conflit, l'Etat allemand s'est efforcé d'impulser la collaboration de l'Etat russe avec les forces internationales dont l'OTAN constituait le noyau dur, et qui devaient assurer le contrôle de la zone. Selon la diplomatie allemande, le contrôle international de ce territoire devait compter avec la participation de l'Etat russe qui «pourrait jouer un rôle comme partie de la solution politique», dit Ischinger, secrétaire d'Etat. La solution du conflit, selon les représentants de l'Etat allemand, devait passer par une «force internationale avec une étiquette distincte de celle 'OTAN' même si celle-ci était, de fait, le 'noyau dur'». Kissinger affirme pour sa part: «L'OTAN joue sa crédibilité comme gendarme de l'Europe».
«[...] Ce n'est pas l'Europe qui intervient et bombarde, mais l'OTAN. Ce ne sont pas les armées d'une défense européenne commune qui se manifestent, mais celles d'une organisation dénommée Atlantique à forte domination nord-américaine. [...] A côté de cette conception de l'Europe et de l'Alliance Atlantique il y en a une autre, plus rebelle. C'est celle de tous les pays qui se résignent provisoirement à l'inexistence d'une défense commune et à la nécessité, en cas de guerre, de recourir aux force nord-américaines pour guider et diriger les opérations. Mais ces pays, parmi lesquels la France aimerait assurer le leadership, cherchent une occasion de faire entendre leur voix [...]; on ne peut laisser ni l'OTAN ni l'ONU en dehors des accords et projets de règlement. Les américains et leurs alliés anglo-saxons se sont montrés réticents. Ils voient dans ces initiatives, trop exclusivement européennes, une dissolution de leur autorité» (El Pais, Jean Daniel, 28/4/99). «La condition de compagnons de voyage soumis annule la possibilité de toute identité européenne de sécurité et de défense, aggrave durement l'économie de nos pays, [...] affaiblit l'euro et consacre notre infériorité militaire. L'Union Européenne a-t-elle définitivement renoncé à avoir un système de satellites d'information du type de celui des USA dont l'accès nous est interdit? Pour cela, l'Europe, au lieu d'aider Clinton, devrait approfondir la proposition de Milutinovic d'une présence internationale au Kosovo dont, maintenant seulement, nous savons qu'elle aurait pu ouvrir la voie à Rambouillet» (El Pais). Ces voies qui réunissent autant d'éléments de la gauche que de la droite participent activement à la consolidation bourgeoise qui nous entraîne vers la guerre. Du Monde Diplomatique aux chefs d'Etat européens en passant par les bourgeois pseudo-communistes d'autrefois, tous affirment qu'il s'agit de consolider une force impérialiste capable de s'opposer aux intérêts militaires «hégémoniques» et «impérialistes» des Etats-Unis. Pour ce faire, ils en sont réduits à hisser le drapeau de la démocratie ou celui du «communisme» selon leur credo. A côté des déclarations de ces colombes de la paix, il faut mettre les propositions des chefs de l'armée, non pas que ces derniers aient des programmes ou des objectifs différents, mais parce qu'ils ont l'avantage d'affirmer explicitement ce que la défense de l'Europe implique: «L'engagement d'une armée suppose que tout homme soit prêt, pour la défense de notre pays et de nos citoyens, à prendre une arme et risquer sa vie, y compris à l'extérieur de l'Allemagne... Les soldats allemands doivent être préparés pour des opérations en dehors de l'Allemagne, ce n'est plus une option très lointaine» (Klaus Naumann, inspecteur de l'armée).
La belligérance n'est rien d'autre que la concrétisation de toute propension à nous conduire à défendre une fraction bourgeoise contre une autre au nom de la paix, de la démocratie, de la défense d'un pays, d'un Etat, d'un continent, d'une ethnie ou autre idéologie. Et aujourd'hui les Etats évaluent leurs forces relatives, leurs possibilités d'alliances pour défendre leurs intérêts spécifiques de fraction face à d'autres fractions du capital; la concurrence que se livrent ces fractions de la bourgeoisie tend irrémédiablement à la guerre.
Les critiques qui dénonçaient l'impuissance des Etats de l'Union Européenne acquirent de plus en plus de poids à mesure que le conflit se généralisait. Les défenseurs du développement d'une entité européenne exigeaient une préparation militaire, politique,... pour assurer leurs intérêts et intervenir militairement au cas où le conflit affecterait leurs intérêts. «Les intérêts vitaux de l'Europe doivent être défendus par les Européens eux-mêmes». Mais le terrain militaire ne peut être dissocié du terrain économique. L'Union Européenne, qui prétend diriger la reconstruction des Balkans, s'affrontera aux Etats-Unis qui ne veulent pas être en reste sur ce point et veulent assurer leur présence et leur permanence dans la région. L'Etat allemand propose de limiter le rôle de l'OTAN aux aspects de sécurité. Tout ceci sera source de conflit, un conflit portant sur la distribution des rôles de protagonistes et de dirigeants de la paix sociale. Le 27 mai, est convoquée à Bonn, une réunion à laquelle participent les représentants des Etats de l'Union Européenne, les USA, l'OSCE, le Conseil de l'Europe et les différents Etats des Balkans, y compris ce qui reste de l'Etat yougoslave, afin d'élaborer un plan de reconstruction de la région des Balkans. A cette conférence, les intérêts des Etats allemand et nord-américain s'affrontent. Ces derniers veulent inclure la zone dans la communauté euro-atlantique et asseoir une présence quasiment permanente dans les Balkans. L'Etat allemand, quant à lui, propose le contraire («Le rôle et les objectifs de l'OTAN doivent se limiter au champ de la politique de sécurité») et veut que ce soit l'Union Européenne qui se charge d'organiser la police et les force de l'ordre nécessaires, type garde civile, à mesure que se retireront les militaires. Il propose également aide et reconstruction économiques et désire conduire, via un pacte de stabilisation pour la région et sous les auspices de l'OSCE, le processus de reconstruction des Balkans. Le chef de la diplomatie allemande, l'écologiste J.Fischer défend: «Une voie qui pacifie la région de façon durable, par la création de certaines conditions préalables stables pour la démocratie, l'économie de marché et la coopération régionale». Il s'agit d'une «intégration à long terme de tous les Etats du sud-est de l'Europe dans l'Europe de la modernité». La fortification de l'Etat allemand passe par le leadership de l'Union Européenne. Tous deux doivent diriger la reconstruction d'après-guerre dans les Balkans. Une déclaration, approuvée par les quinze pays de l'Union Européenne, détaille les carences actuelles de la défense européenne: «[Il faut] renforcer les bases industrielles et technologiques de défense et la restructuration de l'industrie européenne de défense».
«Les Quinze [Etats de l'U.E., ndr] multiplient leurs déclarations pour renforcer leur collaboration diplomatique et militaire. Il y eut par exemple l'initiative franco-britannique, en décembre: l'Union, selon les deux pays, doit avoir une capacité autonome d'action appuyée sur des forces militaires crédibles y compris quand l'OTAN, comme telle, n'est pas engagée. Aujourd'hui, l'Allemagne pousse dans le même sens. Même les Verts du gouvernement Schröder ont ravalé leur credo pacifiste pour soutenir la première intervention militaire extérieure de leurs troupes depuis la fin du nazisme. Et même les Etats neutres -l'Irlande, la Suède, la Finlande et l'Autriche- participent activement aux concertations des Quinze en marge de l'action de l'OTAN» (André Riche, Le Soir, 15/04/99).
Le secrétaire général de l'OTAN, le britannique Robertson, affirme qu'il faut «renforcer les capacités des forces militaires alliées, en particulier celles des alliés européens [...]. Ce que nous avons en ce moment est un tigre de papier en termes militaires européens, et nous devons le transformer en forces réelles sur le terrain [...]. [Les pays de l'U.E. disposent de] deux millions de soldats sur le papier, comme démontré lorsqu'il fut si difficile de mobiliser 2% du total, c'est-à-dire 40.000, au Kosovo». En décembre 1999, les Etats européens sont confrontés au projet des Etats-Unis de ressusciter la guerre des étoiles: prolifération de missiles et antimissiles qui couvriront le territoire nord-américain. L'élargissement de la zone ne se ferait que dans un deuxième temps, ce qui, évidemment, marginalise les Etats de l'espace européen quant à cette couverture.
Le contraste entre ses discours guerriers (pointer les missiles sur
les pays de l'OTAN, provoquer une nouvelle guerre européenne) et
son intérêt évident de négocier avec les institutions
étatiques des alliés fait apparaître l'Etat russe comme
totalement incohérent. Mais au-delà des contradictions réelles
existant entre les fractions bourgeoises «communistes», nationalistes
et «fondmonétaristes», il s'agit, en réalité,
d'un jeu politiciste, spectaculaire dont le but est de chercher à
établir un meilleur rapport de forces dans le partage des concessions
que les organisations mondiales doivent octroyer à l'Etat russe.
Par ailleurs, comme la campagne tchètchène l'a mis en évidence,
l'opposition à la politique des chefs de gouvernements et l'hostilité
à l'égard de l'OTAN ne sont pas des idéologies pouvant
encadrer adéquatement le prolétariat et le mener au massacre.
L'Etat russe n'est pas en condition d'assumer une véritable guerre
à long terme et, dans ce pays, depuis 1917, décomposition
de l'armée rime avec révolution sociale. C'est pourquoi il
sera, par excellence, l'Etat de la conciliation, celui qui peut sortir
la guerre de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Rien de plus logique
donc que de l'associer aux différentes conférences visant
à mettre un terme à la guerre: il est le seul à détenir
la solution qui permettra à tout le monde de sauver les apparences,
il est le seul à pouvoir triompher là où les bombes
ont échoué, c'est-à-dire dans la difficile mission
de convaincre les dirigeants serbes d'abandonner leur position intransigeante.
Putin, comme on le sait, tentera de résoudre la crise aiguë
de l'armée russe: dès le début de son mandat de président,
tous les postes du budget de l'armée russe seront augmentés
de 50%.
La situation actuelle du capitalisme et les mesures qu'impose la bourgeoisie pour contrecarrer la dévalorisation du capital, loin d'éliminer les contradictions, les intensifient. Les attaques frontales contre le prolétariat exacerbent la contradiction principale. La tendance à éliminer les fractions bourgeoises qui vivent principalement grâce au protectionnisme rend les contradictions interfractions de plus en plus fortes et intensifie simultanément les luttes pour le contrôle des marchés et des forces productives au niveau mondial. La redistribution de la plus-value extorquée au prolétariat en faveur des secteurs les plus compétitifs de la bourgeoisie intensifie également toutes les contradictions. Tout cela détermine l'apparition de diverses guerres, pour l'instant localisées, qui manifestent la nécessité vitale de détruire les forces productives (principalement la force de travail) et d'asseoir les bases d'une polarisation capable de mener le prolétariat à la guerre. La guerre dans les Balkans fut un moment important de la généralisation de la guerre capitaliste. Elle mit en évidence les contradictions explosives existant entre les politiques libre-échangistes et protectionnistes qui mènent à la guerre, et les contradictions potentiellement explosives existant entre les différents Etats et les structurations de ceux-ci en institutions internationales du capital. Ceci nous montre les bases fondamentales des constellations qui se préparent pour la généralisation de la guerre même si elles continuent d'être, de par leur nature, instables et changeantes.
Dans notre analyse de la guerre dans les Balkans, nous avons posé les différentes raisons de l'arrêt de cette guerre. D'une part, nous avons constaté l'incapacité de mener une intervention terrestre -vu que cette perspective menaçait l'unité de l'OTAN- qui, on l'a vu, semblait être l'unique perspective de victoire possible. Cette situation a montré que les conditions pour la constitution de deux constellations en guerre n'étaient pas encore réunies, que le pas qualitatif nécessaire pour une guerre généralisée n'était pas encore franchi. D'autre part, nous avons mis en avant que l'arrêt de la guerre fut conditionné par les limites bourgeoises au contrôle du prolétariat lorsqu'il s'agit de donner un saut qualitatif à l'escalade guerrière; si ce contrôle peut être maintenu en temps de paix, la guerre risque de faire voler la paix sociale en éclats et de provoquer une réponse prolétarienne puissante. Cette réalité montre clairement que les polarisations actuelles sont insuffisantes pour mener le prolétariat à la guerre généralisée. Mais, en même temps, la guerre dans les Balkans confirme que le capitalisme se dirige universellement vers la guerre, que la guerre bourgeoise généralisée est l'incontournable perspective de ce système social. Face à cette solution bourgeoise, le prolétariat ne peut qu'opposer la guerre révolutionnaire. Le prolétariat international seul peut se soulever contre la catastrophe actuelle du monde capitaliste sur base de l'action directe, c'est-à-dire en affrontant «ses propres bourgeois», «son propre Etat», le capital mondial partout, sur toute la planète.
Textes de référence
Contre la mythologie justifiant la libération nationale
Le Communiste, numéros 15, 16 et 20
Thèses et contre-thèses pour expliquer et combattre l'idéologie de la libération nationale.Mémoire ouvrière: les causes des guerres impérialistes
Le Communiste, numéro 6.L'armée et la politique militaire des USA
Le Communiste, numéros 12 et 13.
Première partie: connaître les gendarmes de l'ordre mondial. Deuxième partie: les changements «stratégiques» dans l'armée nord-américaine.Capital: totalité et guerre impérialiste
Communisme, numéro 33.
Le capital est une totalité mondiale. Sa contradiction essentielle réside dans le fait que pour accroître la valeur, pour se valoriser donc, il se soumet lui-même à des crises permanentes de dévalorisation. Le processus de valorisation (dévalorisation du capital) se développe sur base principalement de la destruction de son ennemi, le prolétariat, mais également sur base de l'élimination des concurrents. Telle est l'essence -hier, aujourd'hui et demain- des différentes guerres capitalistes.Editorial: contre la guerre et la paix de ce monde de merde!
Communisme, numéro 32.
A un moment où le capital en pleine euphorie veut croire à la fin du communisme et chante une invisible harmonie universelle, nous relevons la barbarie, la crise, la guerre contenue dans le capitalisme et nous y opposons la révolution prolétarienne.De la guerre en Yougoslavie: guerre impérialiste contre le prolétariat mondial
Communisme, numéro 39.
On présente ici le cadre général de la restructuration de l'Etat en Yougoslavie et de la lutte de classe dans cette région. On y décrit l'exacerbation des contradictions de classes et des contradictions interbourgeoises, nationales et internationales, avant que ne s'impose la guerre impérialiste.Mutineries à Banja Luka (ex-Yougoslavie). Septembre 1993.
Communisme, numéro 39.Situation actuelle de la restructuration capitaliste en Russie
Communisme, numéro 44.
Nous allons maintenant aborder la lutte que le prolétariat a menée contre la dictature de l'économie dans la région des Balkans et le développement de la guerre à l'encontre de cette lutte. Nous analyserons également l'idéologie qui s'efforce de camoufler aux yeux des prolétaires les véritables raisons de cette guerre et nous soulignerons quelques éléments de la réaction prolétarienne face à cette dernière.Les rivalités ethniques ou religieuses ne peuvent à elles seules expliquer le processus qui a abouti à l'intervention militaire de l'OTAN dans les Balkans et, plus particulièrement, à la dernière vague de bombardements contre la Yougoslavie et le Kosovo. L'analyse des différentes contradictions bourgeoises ne suffit pas non plus pour saisir pleinement cette dynamique guerrière. Il faut en effet prendre également en considération non seulement le fait que la destruction d'une partie du capital qui ne parvient plus à se valoriser ne constitue qu'un moment de la guerre, une résolution provisoire de la dévalorisation générale, mais surtout que, bien souvent, la guerre est un moyen efficace de soumettre les prolétaires aux intérêts de la bourgeoisie et de leur faire accepter la pérennité de l'ordre capitaliste (1).
Toute guerre est avant tout une guerre contre le prolétariat. C'est en fait le moment le plus élevé de la négation du prolétariat et de son projet social, le communisme. Lorsque les prolétaires sont obligés (de gré ou de force) d'abandonner leur vie déjà misérable en temps de paix, pour intégrer une armée en guerre, lorsqu'ils sont forcés de se transformer en assassins directs d'autres prolétaires et en chair à canon au service des intérêts d'un camp bourgeois, ils quittent leur terrain de classe, ils abandonnent la défense intransigeante de leurs propres intérêts. Un des plus hauts degrés de civilisation bourgeoise est alors atteint: le prolétaire, oublieux de ce qu'il est vraiment, un exploité, endosse l'uniforme, empoigne une arme et part au front en beuglant d'immondes chants patriotiques. Jamais cette société suintant la misère à un pôle et accumulant la richesse à l'autre, n'est aussi forte que lorsqu'elle parvient à envoyer un ouvrier tuer ses semblables au nom de la patrie, de dieu, du «socialisme»... ou, comme c'est le cas depuis la dite seconde guerre mondiale, pour défendre la démocratie et les droits de l'homme.
La guerre au Kosovo ne fait pas exception à la règle. La nécessité de nier le prolétariat et son projet historique, le besoin impérieux de transformer la lutte sociale qui s'est développée dans les Balkans ces dernières années en guerre interimpérialiste ont été les objectifs centraux de «l'intervention» de l'OTAN et ce, indépendamment de la conscience qu'ait pu en avoir tel ou tel protagoniste.
La nécessité d'écraser un prolétariat actif
qui n'acceptait pas facilement les diktats de l'économie explique
en grande partie la guerre dans les Balkans.
Toujours dans la péninsule des Balkans, l'Albanie constitue un autre foyer d'inquiétude. C'est à l'unisson que la «communauté internationale», c'est-à-dire la bourgeoisie réunie sous ses diverses appellations (ONU, UEO, OTAN...), s'est épouvantée de l'attaque de l'Etat en Albanie par des prolétaires en armes (3). La bourgeoisie mondiale dut intervenir promptement pour pallier à l'incapacité de sa fraction locale d'imposer l'ordre social. Sous couvert d'humanitaire une «opération Alba» fut montée avec diverses troupes régionales épaulées par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne afin de mettre un terme au processus de dissolution de l'Etat enclenché en Albanie. Le désarmement des prolétaires insurgés en échange de nourriture et d'argent constituait la première étape d'une stabilisation sociale que toutes les fractions bourgeoises, malgré la concurrence mortelle qu'elles se livrent entre elles, désiraient ardemment. Tout comme en Roumanie, la situation est aujourd'hui loin d'être apaisée bien que l'action prolétarienne et les luttes semblent avoir maintenant cédé le pas à la loi de la jungle du capitalisme. Les investisseurs ne se bousculent toujours pas aux portes du pays et évitent soigneusement de faire des affaires tant que les prolétaires n'ont pas, en premier lieu, restitué les armes qu'ils avaient pillées dans les casernes de l'armée nationale et, dans un second temps, repris le chemin du travail.
Quant au troisième foyer de tension, l'ex-Yougoslavie, elle a constitué pendant plus de dix ans un pôle d'instabilité sociale chronique où grèves, manifestations, occupations, sabotages... composaient le pain quotidien de l'ouvrier. A la mort de Tito, en 1980, la bourgeoisie locale avec l'aide du FMI tenta vainement de rendre l'espace économique yougoslave plus compétitif. Des plans d'austérité se succédèrent à une cadence exceptionnelle provoquant dans le chef des ouvriers un refus toujours plus profond de ces nouvelles conditions d'exploitation. La guerre parvint à mettre un terme à ces conflits, consommant ce que la division par ethnies avait commencé, elle poussa les prolétaires -qui hier faisaient grèves ensemble- à se détester et à s'entre-tuer parce qu'on les déclarait subitement «Serbes», «Bosniaques», «Croates», «Musulmans» ou «Chrétiens». Pourtant, l'imposition de cette effroyable boucherie ne se fit pas sans mal et, à certains endroits, les ouvriers continuèrent à résister à la dissolution de notre classe dans les camps bourgeois rivaux. Sarajevo, Vukovar et d'autres villes furent anéanties par toutes les armées présentes sur le terrain. Le prolétariat devait être écrasé et disparaître de la scène. La bourgeoisie mondiale au travers de l'OTAN, de l'UEO (Union de l'Europe Occidentale) et de l'ONU compléta ce processus de dissolution de notre classe en intervenant militairement pour définir des réserves «ethniquement pures» où les prolétaires furent entassés dans des conditions où leur survie dépendait directement de leur passivité et de leur soumission à l'ordre social existant. Gamelle contre paix sociale, telle est la devise des «hommes en bleu». Alors que ces prolétaires vivaient et luttaient ensemble dans cette région du monde depuis des générations, l'intervention des casques bleus au nom de la démocratie et des droits de l'homme a permis à la bourgeoisie de terroriser notre classe pour la soumettre à ses besoins de valorisation et la remettre au travail dans des conditions encore plus effroyables que celles qui régnait avant le déclenchement de la guerre (4).
Dix ans de conflits sociaux ont ainsi été transformés en dix autres années de guerre sanglante.
Finalement le Kosovo ne représenta que le énième épisode de ce sanglant carnage où les leçons tirées de la guerre en Bosnie devaient être systématiquement appliquées. L'expulsion de centaines de milliers de prolétaires désignés comme «Albanais» devait participer au redécoupage de la région en entités déclarées «homogènes», ne regroupant que des «Serbes» ou des «Albanais». Les prolétaires furent ici aussi obligés d'abandonner leur intérêt commun pour se fondre dans la communauté nationale et enfiler l'uniforme aux couleurs de la «Grande Serbie» ou de la «Grande Albanie». Avec un prolétariat détruit par dix années de guerre, ce nouveau partage ne devait plus être qu'une formalité, une opération de routine. Et pourtant, alors que l'hystérie de l'Union sacrée battait son plein, des mutineries ont à nouveau éclaté dans l'armée yougoslave (5). Laisser se développer les mutineries n'apporterait rien de bon et était intimement en contradiction avec le motif de l'intervention des troupes de l'OTAN dans les Balkans (c'est-à-dire imposer définitivement la paix sociale). Comme le signalait une des résolutions émise en plein bombardement par le G-8 lors de sa réunion à Peterberg le 6 mai 1999, l'intervention de l'OTAN s'inscrivait pleinement dans une: «approche globale du développement économique et la stabilisation de la région.»
La déstabilisation de la région, c'est ce que reprochait l'OTAN au gouvernement Milosevic qui avait trouvé plus commode de se débarrasser du trop plein de bouches à nourrir en obligeant à émigrer chez les voisins/concurrents. La République de Macédoine comme l'Albanie n'auraient jamais pu supporter pareil flux migratoire, sans même parler de la Grèce, le pôle d'accumulation le plus important de la région (6). La stabilité de la région était menacée, le risque d'une exacerbation des conflits sociaux dans un avenir proche obligeait la bourgeoisie à imposer son intérêt général: il fallait résoudre les problèmes internes à la Serbie d'une façon différente de celle envisagée par le gouvernement Milosevic. En fait, ce n'est pas «l'épuration ethnique» -plus prosaïquement le massacre de milliers de prolétaires- qui était reprochée au gouvernement de Belgrade (cela les Etats-Unis l'avaient bien accepté pendant 10 ans), mais bien le facteur supplémentaire de déstabilisation sociale que cette politique «Grand Serbe» impliquait. C'était un risque que la bourgeoisie mondiale ne pouvait pas courir dans une situation sociale aussi dégradée que celle des Balkans. Milosevic devait céder la place à un gouvernement plus conciliant et plus à même de se plier aux intérêts généraux de la bourgeoisie, quitte à ne pas résoudre les contradictions qui minaient la Serbie, tel cet encombrant million de réfugiés résultant des guerres perdues en ex-Yougoslavie et dont la bourgeoisie locale ne savait quoi faire. Les envoyer coloniser le Kosovo débarrassé des «Albanais», voilà la solution que Milosevic avait trouvée pour éviter que la situation ne lui saute à la figure.
L'intervention de l'OTAN avait non seulement pour but de se débarrasser
de Milosevic, le «déstabilisateur», mais également
de couvrir la région d'une série de bases militaires devant
servir de points d'appui pour de futures opérations humanitaires
répondant aux désordres sociaux qui n'allaient pas manquer
de surgir dans la zone au cours des années suivantes.
C'est William Cohen, secrétaire américain à la défense, qui joue la première scène de cette manipulation en annonçant à la chaîne américaine CBS: «Nous avons vu la disparition d'environ 100.000 hommes en âge de service militaire... Ils peuvent avoir été assassinés.» Quelques jours plus tard, les esprits étant suffisamment échauffés, le doute peut laisser place à l'affirmation. Le secrétaire d'Etat «pour les crimes de guerre» [sic!] annonce d'un air tragique (quel bon comédien!) que «225.000 Albanais âgés de 14 et 59 ans ont disparu.» Chaque mot étant pesé, disséqué, analysé, «disparus» doit être compris comme «tués». En faisant monter la tension crescendo, d'autres sources militaires américaines tablent, elles, sur le chiffre encore plus impressionnant de «400.000 victimes». Le mot «génocide» apparait et se généralise. Les comparaisons vont bon train, les Kosovars d'aujourd'hui ressemblent à s'y méprendre aux Juifs d'hier. «Serbe» devient synonyme de «nazi». L'intoxication enfle au même rythme que s'accroissent les préparatifs militaires des Alliés. Plus le chiffre des «disparus», «massacrés», «torturés», «déplacés» grossit et plus le dispositif militaire dans la région se renforce. Les avions, les bateaux, les hommes de troupes, les chars, les hélicoptères... se déploient pratiquement à la même vitesse que les flots de mensonges déversés par les experts en communication du Pentagone. Pour mettre fin au massacre il n'y a pas d'autre solution que d'abattre ce «monstre sanguinaire qu'est Slobodan Milosevic». «Pour sauver les Kosovars assassinés sur les bords des routes ou expulsés de force de leur maison, il faut que les Etats-Unis envoient leurs 'boys' mettre de l'ordre puisque les Européens sont incapables d'arrêter ce génocide.» Les experts en communication ont réussi à «communiquer».
Les opérations humanitaires cachent de moins en moins les intentions guerrières des Etats qui les mettent sur pied.
Bien sûr, nous avons déjà mis en exergue dans différents articles la fonction répressive des opérations humanitaires, leur caractère contre-révolutionnaire. Nous avons également relevé combien les capitalistes avaient conscience de l'intérêt de l'humanitaire pour contrer la révolution. Claude Bébéar, patron du groupe Axa en France ne déclarait-il pas il y a peu que l'aide humanitaire devait servir à empêcher la révolution? De même, à propos des soulèvements en Albanie, un responsable européen de la Défense en Europe occidentale n'a pas hésité à affirmer: «Et pour contraindre les insurgés à rendre leurs kalachnikovs? Nous disposons de moyens de pression largement suffisants. Par exemple: la restitution des armes volées contre la fourniture de nourriture».Bref, cela fait longtemps que les opérations humanitaires servent de couvertures aux différents Etats pour réprimer le prolétariat tout en menant leurs propres guerres inter-impérialistes, mais jusqu'ici cela se faisait avec une certaine discrétion.
Aujourd'hui, il semble que l'Etat n'ait même plus besoin de cacher ses motivations guerrières et de s'encombrer de ces organisations dites 'non gouvernementales' pour organiser des convois humanitaires. Ainsi, en Macédoine, ce sont carrément les forces de police, les forces du Ministère de l'intérieur et les services de renseignement qui ont récemment eux-mêmes composé une mission humanitaire, sans la médiation d'une quelconque ONG, sans la présence du moindre des Kouchner pour justifier leur guerre.
C'est ce dont témoigne le court extrait d'un article publié dans Le Monde du 12 mars 2001, et que nous reproduisons ci-dessous:
«Il fut tout d'abord question d'un convoi humanitaire qui, selon les autorités macédoniennes, avait été pris sous le feu des 'terroristes' de l'Armée de libération nationale albanaise, dans les montagnes à la frontière du Kosovo. Dans la soirée du jeudi 8 mars, cette 'mission humanitaire', organisée par le gouvernement de Skopje, avait en effet mal tourné: elle avait été prise dans une embuscade qui avait provoqué la mort d'un jeune policier de l'escorte. Le convoi était censé apporter de l'aide humanitaire aux populations civiles déshéritées des villages de Gusince et de Brest... En fait d'humanitaire, le convoi était essentiellement formé de policiers macédoniens (plusieurs dizaines) et conduit par le vice-ministre de l'intérieur, l'Albanais Refet Elmazi, le secrétaire d'Etat pour les affaires intérieures, Ljube Boskovski, et un haut responsable du service des renseignements... Ils avaient fait le voyage de Skopje, distant d'une cinquantaine de kilomètres, pour installer des postes de police dans ces deux villages reculés...»
Un exemple illustrera à la perfection comment l'intoxication médiatique a été systématiquement menée par l'OTAN. Le Daily Mirror britannique a relaté (relayé le lendemain par un grand nombre de chaînes télévisuelles) l'établissement d'un camp de concentration dans les mines de Trepca où les «serbes avaient bâti des fours inspirés d'Auschwitz» pour brûler et enfouir des milliers de corps. D'après des témoins «dignes de foi», un grand nombre de camions y aurait pénétré le 4 juin avec des milliers de personnes pour ne plus jamais en ressortir. Après le passage des enquêteurs du TPI, aidés par une équipe de spéléologues français, force fut de constater qu'ils n'avaient «absolument rien trouvé». Pourtant, l'OTAN continue officiellement à parler de «centaines de milliers de morts». Un rapport publié fin 1999 par le secrétariat d'Etat américain continue à se référer au chiffre symbolique de «10.000 morts».
Bien que réels, les massacres organisés par les forces militaires serbes ont été très fortement exagérés dans le but évident de fabriquer une opinion publique, de la préparer à accepter «la nécessité humanitaire de ces bombardements».
«La puissance aérienne n'a pas contribué à la solution du problème humanitaire au Kosovo, ce qui était pourtant l'un des principaux objectifs énoncés par les dirigeants alliés au début de la campagne. Il est même hautement probable que les expulsions massives et les violences dont les Kosovars ont été les victimes ont été exacerbées par la volonté de l'OTAN de recourir exclusivement à des frappes aériennes de longue durée.» (9)
Un mois plus tôt, le chef d'état-major général, le Général H. Shelton, et le secrétaire à la Défense William Cohen déclaraient conjointement devant le Sénat américain: «... nous savions que l'utilisation de la force militaire ne pourrait stopper l'attaque de Milosevic contre les civils kosovars...» Décidément, la falsification, l'escroquerie, la mystification, la tromperie constituent le véritable fond de commerce de tous ces politiciens, militaires et journalistes qui connaissaient les enjeux réels de ce conflit et ont tout fait pour nous le vendre comme une «guerre humanitaire».
Au lendemain de la guerre, l'acteur William Cohen, secrétaire américain à la Défense, se transformait en représentant de commerce pour vanter l'efficacité de l'armement made in USA. De conférence de presse en interview, ce bonimenteur déclara que les frappes aériennes de l'OTAN avaient réussi à détruire plus de 50% de l'artillerie et un tiers des véhicules blindés de l'armée yougoslave. Le général Shelton essaya de lui ravir la vedette en affirmant que ce matraquage aérien avait réussi à atteindre des «résultats fabuleux», détruisant 120 tanks, 220 véhicules blindés de transport de troupes et plus de 450 pièces d'artilleries ennemies. Ce bilan représentait pour le secteur militaro-industriel et pour l'US Air Force, dont les appareils composaient 80% des avions ayant participé à ces opérations, une «incontestable victoire». Devant le Congrès, le général Wesley Clark déclara même que l'armée yougoslave avait été quasiment anéantie et ne pouvait plus constituer une menace sérieuse dans la région puisque plus de «75% de son armement lourd avait été pulvérisé».
Le problème, c'est que tous ces blindés, véhicules et canons détruits avaient curieusement disparus du champ de bataille lorsque les Alliés occupèrent le Kosovo. Le 15 mai 2000, cette histoire à dormir debout explosait comme une baudruche dans laquelle on aurait trop soufflé. Contradictions et rivalités au sein de l'OTAN provoquèrent des fuites dont l'hebdomadaire américain Newsweek se fit l'écho: les chiffres étaient faux!
Dommages collatéraux?
Si les objectifs militaires ont été relativement épargnés par les bombardements, il n'en va pas de même des quartiers ouvriers qui eux ont régulièrement été éventrés, faisant des centaines de victimes baptisées dans le langage des guerriers humanitaires de «dommages collatéraux». Malgré le discours nauséabond de l'OTAN qui affirmait ne vouloir s'en prendre qu'aux militaires, la guerre bourgeoise, est toujours une guerre contre le prolétariat. Sous les gravats calcinés se cachaient non pas les «méchants» partisans de Milosevic, mais des prolétaires. Et c'est en toute connaissance de cause que ces bombardements ont été effectués sur des cibles non militaires. Comme le déclarait déjà le 14 février 1941 l'état-major allié: «la terreur est à l'ordre du jour (...) le bombardement doit maintenant être centré sur le moral de la population civile ennemie et en particulier, des ouvriers industriels.» (Official History of II World War, volume I, p.323). Hier comme aujourd'hui, la bourgeoisie se plaît à affirmer le contraire de ce qu'elle fait: la liberté c'est l'esclavage, la paix c'est la guerre, les frappes chirurgicales c'est le massacre organisé de milliers de prolétaires.5 avril 1999 - Des bombes tuent 17 personnes dans un quartier résidentiel d'Aleksinac.
7 avril 1999 - Dans un quartier à très forte densité de population un raid est mené contre un objectif non militaire; la centrale de chauffage de Belgrade. Est-ce une erreur? Certainement pas: L'International Herald Tribune du 13/10/99 interview un responsable américain qui affirme qu'une «population frigorifiée et affamée est davantage susceptible de renverser M.Milosevic». Quel cynisme!
12 avril 1999 - Un train de passagers est attaqué par des avions à Grdelica: 10 morts au moins.
14 avril 1999 - Un convoi de réfugiés soi-disant pris pour une colonne militaire blindée est attaqué sur la route de Prizren-Djakovica: 74 morts.
27 avril 1999 - Des missiles s'abattent sur Surdulica: 20 morts et de nombreux blessés.
1er mai 1999 - A Luzane, un bus est foudroyé en traversant un pont. Tous les occupants sont tués: 40 morts.
7 mai 1999 - Alors que les pompiers éteignent l'incendie qui ravage l'ambassade de Chine à Belgrade suite à un bombardement de «haute précision», des bombes à fragmentation sont larguées sur le marché et l'hôpital de Nis: au moins 14 tués.
19 et 21 mai - A deux reprises la prison d'Istok au Kosovo est la cible des avions de l'OTAN. Les prisonniers qui ont échappé au carnage sont abattus par la police yougoslave. Division du travail qui se chiffrera officiellement à 100 morts!
30 mai 1999 - Jour de marché à Varvarin, les forces alliées attaquent un pont: 11 morts.
31 mai 1999 - Le sanatorium de Surdulica, cible «hautement stratégique» est atteint par des tirs: 20 morts. Novi Pazar est de nouveau l'objectif d'attaques aériennes: 23 personnes tuées.
Le 10 juin 1999 c'est la fin de la campagne aérienne. On aurait pu croire que le nombre de morts allait s'arrêter là. Eh bien non, de 11 à 20.000 engins britanniques et américains ont été dispersés dans la campagne yougoslaves provoquant chaque jour le décès ou la blessure de 4 à 6 personnes. Voilà à quoi ressemble leur «guerre propre», la «guerre humanitaire» menée par l'OTAN en Yougoslavie.
Cette guerre permet de confirmer une chose: même si elle utilise des armes sophistiquées et extrêmement coûteuses (tels les avions de reconnaissance sans pilote et les satellites capables de lire une plaque minéralogique), une armée bourgeoise ne peut sortir victorieuse d'un conflit si elle n'occupe pas le terrain. Une guerre menée à «5.000 mètres» d'altitude ne parviendra jamais à écraser un adversaire qui se contentera de se mettre à l'abri en attendant que l'orage passe. Pour gagner cette guerre, il fallait impérativement déployer des hommes sur les routes, dans les forêts, sur les collines, dans les montagnes, dans les villes, sur un terrain terriblement accidenté propice à la guerre d'embuscade, de coup de main, à la guérilla... bref une guerre qu'évitent systématiquement les armées modernes parce que, en fin de compte, elles n'en sortent que très rarement victorieuses. Malgré la surpuissance des moyens mis en oeuvre, le danger d'intervenir sur place comportait un facteur que redoutent toutes les armées bourgeoises: l'enlisement. Voilà pourquoi le Pentagone a voulu éviter à ses troupes toute intervention terrestre et promotionner la théorie d'une guerre victorieuse grâce à l'utilisation quasi exclusive de l'armée de l'air.
La peur de l'enlisement, la crainte de devoir faire face à une guérilla, la hantise de voir des centaines de corps être quotidiennement rapatriés aux Etats-Unis, l'appréhension que cette guerre, qui devait être «courte, humanitaire, propre et hi-tech», devienne un véritable bourbier, comme ce fut le cas pour l'armée russe en Tchétchénie, détermine chaque décision stratégique, c'est pourquoi il n'y aura pas d'intervention terrestre. Le bourbier balkanique pourrait faire remonter à la surface le pire des cauchemars qui, aujourd'hui encore, hante la bourgeoisie américaine: sa guerre perdue au Vietnam. Voilà l'explication des circonstances et des limites dans lesquelles cette guerre fut menée par l'armée nord-américaine. Et il ne pouvait en être autrement, comme l'a prouvé l'enlisement de la Wehrmacht allemande durant la seconde guerre mondiale dans cette région montagneuse.
Malgré le déploiement de force et de technologie, sans même parler des tonnes de propagande déversée sur l'efficacité de la guerre aérienne, ce conflit a démontré une fois encore les limites de cette armée si puissante. Son incapacité à assumer ses propres morts en dit long sur la réelle cohésion sociale qui existe non seulement en son sein mais aussi à l'arrière, aux Etats-Unis. Régulièrement dans cette revue nous parlons de ce que la bourgeoisie tente systématiquement d'occulter dans le pays de «l'oncle Sam»: l'effroyable misère qui y règne. Accumulation de richesse rime avec dénuement extrême, bidon-villisation de villes entières, violence urbaine, drogue, prisons surpeuplées, travailleurs sous anxiolytiques permanents, etc. Tous ces facteurs ont certainement participé à la décision prise par la Maison Blanche de ne pas provoquer d'intervention terrestre des troupes américaines au Kosovo. Comme le confirmait le porte-parole de l'OTAN, Jamie Shea, lors d'une de ses conférences de presse quotidiennes:
«L'option aérienne vise à préserver autant que possible la vie des pilotes, car la perte ou la capture de quelques-uns d'entre eux pourrait avoir des effets néfastes sur le soutien de l'opinion publique à l'opération.»
Toute intervention terrestre comportait un risque d'enlisement pour les troupes américaines, un «nouveau Vietnam» comme le souligne le général anglais commandant les troupes des Nations-Unies en Bosnie: «Nous avons tous vu les Serbes quittant le Kosovo fièrement, leurs drapeaux flottant. Nous n'avions clairement pas fait les dommages prétendus. Si nous avions mené une campagne terrestre en croyant que nous avions fait les dommages que nous prétendions, je pense que nous aurions eu une très mauvaise surprise.»
Echec militaire, peur de l'enlisement, crainte d'une intervention terrestre,
faiblesses réelles de l'armée nord-américaine malgré
le battage médiatique sur la «technologie», contradictions
d'intérêts entre puissances impérialistes au sein de
l'OTAN... sont autant de facteurs qui expliquent pourquoi cette guerre
devait être courte et se dérouler exclusivement dans les airs.
Derrière le matraquage médiatique, derrière l'étalage
de techniques guerrières, une chose essentielle a manqué
pour transformer ce conflit en prémisse d'une destruction généralisée:
la participation massive et active des prolétaires. Leur mobilisation
dans la défense d'un camp sous le drapeau des «droits de l'homme
et du citoyen» ou «au nom de l'ingérence humanitaire»
n'a pas fait véritablement recette. C'est la passivité la
plus complète qui a prévalu. Nulle part, une véritable
mobilisation «pour aller casser du serbe génocidaire»
ou pour «défendre les frères slaves» ne vit véritablement
le jour. La bourgeoisie ne parvint pas à mobiliser les prolétaires
dans un camp ou dans un autre, or c'était là la condition
indispensable à la transformation de ce conflit en boucherie généralisée.
En conséquence, la bourgeoisie se vit dans l'obligation de mettre
un terme à la guerre et, par son intervention au Kosovo, étouffa
toute vélléité de lutte dans les Balkans pour occulter
les réactions de notre classe contre cette guerre.
L'insoumission et la désertion dans la capitale sont monnaie courante depuis le milieu des années '90. Dès lors, ce n'est pas un hasard si la politique guerrière que mène le gouvernement Milosevic depuis une décade consiste à faire appel à un grand nombre de mercenaires étrangers, de milices nationalistes enragées voire d'anciens gangsters devenus des «seigneurs de guerre» comme le défunt Arkan et sa milice, «les Tigres». Ne trouvant plus de soldats pour le Kosovo, c'est au sein de cette IIIème armée que les gestionnaires locaux du capital seront obligés de puiser pour faire leur guerre. Mais cette politique n'était pas sans risque. Lors des précédents conflits, des mutineries avaient déjà touché les troupes originaires de cette région. L'état-major, coincé par ce fâcheux précédent, ne pouvait pourtant pas faire autrement tellement les autres unités étaient gangrenées par le défaitisme.
Le rapatriement de corps de soldats tués au combat est souvent le signal du déclenchement de la contestation. Ainsi à Krusevac le 14 mai, arrivent en provenance du front 7 cadavres dont les autorités militaires refusent de divulguer les noms. Rapidement, les parents des conscrits manifestent devant la mairie exigeant de savoir de qui il s'agit. A Prokuplje, le même scénario se reproduit le 19 mai, où l'arrivée de 11 soldats tués au Kosovo provoque directement une émeute. Dans d'autres villes, comme à Cacak, les manifestations contre la guerre sont quotidiennes. La réponse des autorités est rapide et violente parce que le rapport de force le permet encore. On arrête les meneurs et d'imposantes forces de l'ordre quadrillent la ville pour empêcher tout rassemblement. A Raska et à Prokuplje une répression préventive est déclenchée en vue d'éviter toute poursuite de la contestation.
Le 17 mai, deux mille manifestants dont un grand nombre de soldats, exigent des autorités municipales et militaires de Krusevac la publication du nombre exact d'hommes tués au combat, ainsi que leurs noms. Le maire, Miloje Mihajlovic, membre du parti socialiste serbe (celui de Milosevic) est violemment bousculé lorsqu'il annonce qu'il ne peut pas satisfaire leur demande. La protestation s'en prend dès lors aux mass medias, et les locaux de la télévision locale sont systématiquement cassés malgré la présence d'un important dispositif policier. Le même jour, un millier de personnes se réunissent à Aleksandrovac pour s'opposer au départ de réservistes vers le Kosovo. Le maire de la ville, entouré de ses gardes du corps, tente vainement de calmer la situation mais n'y arrive pas. Les manifestants ivres de colère le jettent par terre et le rouent de coups. Il est sauvé du lynchage par une unité de police militaire qui le cache dans les toilettes d'un magasin avant de le conduire à l'hôpital de Nis dans un état grave.
Le lendemain de ces incidents, le 18 mai, 5000 manifestants, pour la majorité des femmes, envahissent à nouveau la ville de Krusevac. Les fenêtres des bâtiments militaires et de la municipalité sont prises pour cible: des pierres, des oeufs, des boulons les font voler en éclats. Les prolétaires envahissent et saccagent les locaux de la télévision locale. Durant la nuit, les premiers signes de réaction de notre classe contre la guerre apparaissent parmi les troupes du front. Plus de mille réservistes d'Aleksandrovac et de Krusevac désertent le front du Kosovo, généralisant ainsi le mouvement qui se développe dans les villes.
«Nous nous sommes arrangés pour rentrer à la maison. Il y a eu pas mal de problèmes sur la route. Ils ont même utilisé des autopompes pour nous empêcher de rentrer chez nous. Ils ont exigé que nous déposions nos armes. Nous avons refusé d'obéir. Ca ne suffisait pas d'être tués par les bombes, maintenant ils frappent nos familles. Je ne retournerai pas là-bas. C'est pas une guerre c'est du délire, c'est aussi difficile de survivre que de ne pas devenir fou. Je veux garder l'esprit sain. Je ne veux tuer personne et je ne veux pas être tué...» Un déserteur à Alternative Information Network.
Les déserteurs font route durant la nuit vers ces deux villes. Au petit matin, la plupart des réservistes campent dans des villages environnants, à deux pas de chez eux, les forces de répression les ayant empêchés d'aller plus loin. Pourtant à l'aube, 400 d'entre eux arrivent à se faufiler à travers les mailles du filet et pénètrent à Aleksandrovac où, avec d'autres, ils défilent «les armes en bandoulière». Le commandement militaire de la région intervient à la télévision et les accusent de «saper le moral des troupes» et de «collaborer avec l'ennemi». Les prolétaires se foutent de ce que racontent ces vieilles badernes qui, au même titre que ces satanés avions qui depuis des jours et des jours bombardent leurs femmes, leurs enfants, leurs parents..., constituent leurs véritables ennemis.
Le prolétariat ne reconnaît qu'une seule guerre, la sienne! Celle qui oppose les prolétaires du monde entier aux bourgeois quels que soient leurs uniformes; yougoslave, croate, américain ou français. Qu'il est admirable ce manque de patriotisme dont font preuve ces mutins qui, les armes à la main, affirment que leurs intérêts sont tout à fait opposés à ceux de l'Etat! L'intérêt du prolétariat n'est pas d'aller tuer d'autres prolétaires au Kosovo ou de se faire descendre pour que la bourgeoisie serbe continue à en tirer des bénéfices. Notre intérêt est de mettre fin à toutes les guerres fratricides, à toutes les guerres qui opposent des prolétaires à d'autres prolétaires, notre intérêt est de retourner nos armes contre «notre propre» bourgeoisie, en vue de transformer ce carnage en guerre sociale contre la dictature du capital. Quand ces assassins étoilés affirment que ces actions de rébellion «sapent le moral des troupes», ils donnent en fait la véritable direction à suivre pour arrêter ce carnage: généraliser les mutineries à d'autres unités et empêcher du même coup la possibilité d'une répression ouverte contre les soulèvements.
Mercredi 19 mai, le général en chef de la IIIème armée yougoslave vient parlementer avec les mutins qui campent aux abords de Krusevac. Nebojsa Pavkovic leur offre un compromis: leur absence du front sera considérée comme une simple permission de quelques jours s'ils daignent rejoindre le front. Les déserteurs refusent aussi sec et demandent la fin de la guerre. Le jour même, la population de Krusevac empêche le départ des bus qui emmènent les réservistes vers le front. Un seul bus parvient à sortir de la ville sous bonne escorte et rejoint le Kosovo. Mais des fissures apparaissent parmi les mutins établis dans les environs de la ville. Le lendemain quelques centaines d'entre-eux acceptent l'offre du général et remettent leurs armes aux autorités militaires. La réaction à l'affaiblissement du mouvement proviendra d'un autre groupe de réservistes établi lui aussi depuis plus de 2 mois dans les environs de Krusevac. Un noyau décidé de plus de 300 hommes en armes s'infiltre en ville et manifeste son refus d'être envoyé se faire tuer au Kosovo.
Le samedi 22 mai, les 300 réservistes qui occupent maintenant Krusevac sont rejoints par le reste des déserteurs qui avaient fui le front le 18 mai. Ils refusent non seulement la proposition du général Pavkovic, mais aussi d'être envoyés au front. C'est encore à Krusevac que l'opposition à la guerre connaît un nouveau rebondissement: le dimanche 23 mai 1999, plusieurs milliers d'habitants exigent le retour de tous les soldats du Kosovo. Dès 7 heures du matin, les déserteurs occupent la ville. Plus de 2.000 manifestants se réunissent dont beaucoup portent l'uniforme de l'armée yougoslave. Pêle-mêle se trouvent là des réservistes qui refusent de partir au Kosovo, des déserteurs et des parents de soldats, ainsi que d'autres prolétaires. Tous manifestent ensemble contre la poursuite de la boucherie. Les autorités locales tentent de faire face à ce nouveau mécontentement qui fissure un peu plus l'union sacrée et décident d'interdire dorénavant tout rassemblement.
Lorsque la manifestation rejoint les déserteurs qui contrôlent certains points de la ville, serment est fait par les hommes en âge d'être (r)appelés sous les drapeaux de ne répondre à aucune convocation. Pendant la manifestation, des slogans sont scandés avec détermination: «Nous voulons le retour de nos fils», «Nous ne voulons plus retourner au Kosovo», «Nous voulons la paix», «Vous ne nous aurez plus jamais». Un certain nombre d'officiers présents en ville tentent d'intervenir pour calmer la situation. Un général essaye de haranguer les manifestants en leur rappelant que «la patrie est en danger» et que «tous doivent accepter leur devoir», tous doivent accepter «l'envoi de leurs fils au front». Il se fait rouer de coups, lui et ses gardes du corps. Ensanglanté, il reprend la parole et accepte la revendication des mutins pour sauver sa peau tout en leur conseillant maintenant de se disperser et de rentrer chez eux. Les manifestants s'y refusent et certains d'entre eux appellent à des rassemblements quotidiens tant que la guerre durera. D'autres manifestants se rendent au quartier général «pour avoir une explication» avec les officiers qui s'y cachent. Ces derniers terrorisés par les incidents du matin, tentent de les recevoir le plus cordialement possible et leur expliquent qu'il n'a jamais été question de les renvoyer au Kosovo. Seul «les volontaires» y seront envoyés. Quelques coups fusent et les officiers se font traiter de «menteurs» et de «bandits».
Malgré la détermination des déserteurs, les troupes toujours plus nombreuses qui quadrillent la ville restent fidèles au gouvernement. Les déserteurs, tout comme les autres prolétaires qui manifestent, ne tentent pas sérieusement de les gagner à leur cause. La situation semble bloquée. Le rapport de force ne parvient toujours pas à changer de camp et ce malgré l'arrivée de deux bonnes nouvelles: des déserteurs annoncent que des «unités spéciales» sont bloquées dans les montagnes de Kopoanik et qu'un autre millier de déserteurs arrive directement du Kosovo. Krusevac devient le centre de la contestation. Instinctivement, déserteurs, mutins, prolétaires en armes sentent que le changement du rapport de force à cet endroit-là est la clé pour l'extension du mouvement. D'autres déserteurs venant d'Aleksandrovac tentent de faire la jonction avec ceux de Krusevac, poussés par le besoin de s'unir pour être plus forts. Mais ils sont freinés par des troupes restées fidèles au gouvernement. Ici non plus, nous n'avons aucune information permettant d'affirmer que de sérieuses tentatives de défaitisme aient été faites à leur endroit pour miner leur capacité de répression et faire basculer le rapport de force en faveur de la lutte prolétarienne. Isolés, les mutins décident alors de rebrousser chemin et organisent avec d'autres prolétaires (plus d'un millier) une manifestation contre la guerre à Aleksandrovac. D'autres manifestations éclatent au même moment à Raska, Prokuplje et Cacak où la police réagit très brutalement et tabasse un grand nombre de participants.
Parallèlement, le commandement militaire met la pression et ordonne le rappel général de tous les réservistes de la région, interdisant en même temps à leurs parents de les accompagner vers les casernes qui doivent servir de point de regroupement. Ce que craint particulièrement l'armée, c'est la répétition des actes d'insubordination qui commencent à se multiplier devant toutes les casernes du pays: des parents, des amis accompagnent systématiquement les réservistes et, là tout explose. Les mères s'enchaînent à leur enfant ne voulant pas «qu'il meure pour rien», des hommes s'en prennent aux officiers et, de cris en insultes, l'enrôlement des réservistes se transforme systématiquement en manifestation d'opposition à leur départ. Ces manifestations secouent maintenant toutes les villes de la région. Certains réservistes y participent avec leurs armes et l'état-major craint par-dessus tout que les manifestations, pour l'instant pacifiques, ne se transforment en affrontements violents avec les forces de répression.
Pressé par une situation périlleuse pour lui, le gouvernement de Belgrade propose un arrangement: les déserteurs ont jusqu'au 25 mai pour remettre leurs armes aux autorités militaires et rejoindre leurs unités. A ces conditions, le gouvernement annonce qu'il «oubliera» leur désertion, sinon, ce sera la cour martiale et le poteau d'exécution. Au même moment, d'importantes forces de l'ordre sont massées à Krusevac. La répression commence à sévir et 6 personnes sont condamnées à verser entre 250 et 750 dollars pour avoir participé à une réunion illégale contre la guerre. La police empêche dorénavant toute manifestation dans le sud industriel de la Serbie: Krusevac, Aleksandrovac, Prokuplje et Raska sont quadrillées. Malgré ce déploiement impressionnant de force policière, aucun réserviste ne part pour le front et les armes ne sont toujours pas restituées. Les prolétaires non seulement cachent les réfractaires mais continuent à empêcher tout départ de réservistes au Kosovo.
Alors que les bombes de l'OTAN pleuvent sur la majorité des villes yougoslaves, la contestation fait tache d'huile et gagne d'autres régions. A Podgorica (capitale du Monténégro) comme à Krusevac, des réservistes ayant quitté le front arrivent en ville et, avec des parents de soldats, manifestent pour exiger «le retour de leurs enfants». L'armée, le gouvernement, comme les autorités locales sont dans l'incapacité réelle de faire barrage à l'extension du refus de la guerre. La bourgeoisie hésite à réprimer parce qu'elle ne sait pas très bien ce qui sortira de l'affrontement. Cela fait maintenant plus de 10 ans que le pays est en guerre, que les sacrifices imposés se suivent et se ressemblent. Cela fait maintenant plus d'une décennie qu'on annonce régulièrement aux familles la mort de leur fils, de leur mari ou de leur père, «tombés héroïquement au champ d'honneur». Même pour ceux qui ont cru au mirage nationaliste, la situation est devenue insupportable. L'opposition gouvernementale se sent elle aussi complètement dépassée par ce mouvement qui commence à s'étendre. Ainsi, Zoran Djindjinc le chef de l'Alliance Démocratique qui regroupe une grande partie de l'opposition gouvernementale déclare: «Ce n'est pas l'opposition qui a organisé ces manifestations qui, d'ailleurs n'ont pas d'objectifs politiques... Aujourd'hui, Milosevic ne peut calmer ces gens que s'il les satisfait. Et il ne peut les satisfaire que s'il arrête la guerre, leur rend leurs enfants ou leur trouve du travail. (...) En fait ce sont les victimes de sa politique qui sont descendues dans les rues. Ce que nous attendions depuis dix ans.»
Même si pour l'instant cette opposition gouvernementale affirme un antagonisme évident avec le mouvement de refus à la poursuite de la guerre, elle compte bien sur le ras-le-bol des prolétaires pour se remettre en selle et se présenter à eux comme alternative au gouvernement actuel. Et Djindjinc d'ajouter qu'il a très bien compris ce qui est en jeu: «... l'opposition n'a pas non plus gagné en popularité pour l'instant, mais nous avons plus de chance pour l'avenir car nous n'avons pas participé à la guerre.»
La relève se met en place. C'est avec la carte de l'opposition que la bourgeoisie espère écraser le mouvement de révolte prolétarienne.
Malgré l'important dispositif policier qui quadrille désormais la région, les prolétaires continuent de refuser de partir au front et de remettre leurs armes. Le général commandant les troupes serbes au Kosovo s'est lui-même déplacé pour tenter d'endiguer le mécontentement des réservistes. Des promesses sont faites pour qu'ils rendent les armes en leur possession. L'Etat ne peut tolérer de se voir dépossédé du monopole de la violence. L'armée exige que tous les mobilisés soient immédiatement envoyés au front, ce à quoi de jeunes conscrits répondent: pourquoi cette mobilisation épargne-t-elle «les riches ou certains privilégiés»? En Vojvodine plusieurs condamnations sont prononcées par les tribunaux contre ceux qui s'opposent à la guerre.
La situation reste périlleuse pour le gouvernement Milosevic. Une issue doit être rapidement trouvée pour sortir de cette impasse. D'un côté, les bombardements aériens n'ont réussi ni à détruire l'armée serbe ni à la forcer à quitter le Kosovo, par contre les mutineries risquent de la disloquer en faisant surgir le spectre du communisme dans cette région. Un scénario du type «Guerre du Golfe» est en train de prendre corps. Cette situation (la menace explicite de troubles sociaux graves) détermine la bourgeoisie à mettre fin à cette guerre.
Le 7 juin, les généraux yougoslaves Marjanovic et Stefanovic rencontrent secrètement à Kumanovo, en Macédoine, le général britannique Michaël Jackson. Depuis des semaines, au travers de son allié russe, le gouvernement yougoslave tente de prendre contact avec les Alliés pour sortir de la crise qui menace de le balayer. En deux jours de négociations, un accord «militaro-technique» est signé alors que les mutineries dans l'armée serbe ne sont toujours pas éteintes et que des manifestations se déroulent dans un grand nombre de villes du pays. Cet accord prévoit le retrait immédiat des troupes serbes du Kosovo et l'occupation de cette province par un contingent de la KFOR. Alors que 3 jours sont prévus pour évacuer, l'armée serbe abandonne le terrain en une seule journée. Le 10 juin 1999, l'OTAN arrête les bombardements sur la République Fédérale Yougoslave. La tension redescend d'un cran. Les troupes yougoslaves sont plus ou moins démobilisées, ce qui disloque toute perspective de poursuite et/ou d'extension des mutineries du mois de mai.
Alors qu'un autre objectif déclaré des frappes aériennes
de l'OTAN était de se débarrasser de Slobodan Milosevic,
celui-ci tout comme Saddam Hussein en 1991, une fois la guerre terminée
(10), reste solidement accroché au pouvoir avec le consentement
plus ou moins tacite de ses ennemis d'hier pour réprimer toute tentative
du prolétariat de remettre en cause l'ordre social existant. Aux
yeux de l'OTAN, il est préférable d'avoir à Belgrade
un Slobodan et à Bagdad un Saddam plutôt qu'une révolution
sociale. Malgré les disputes, la famille capitaliste reste unie
contre toute menace qui tenterait de remettre son règne en cause.
La guerre généralisée ne parvient toujours pas à être imposée socialement. C'est une énorme limite à la réalité capitaliste aujourd'hui. Une telle guerre est en effet indispensable à la survie du capital qui, sans cette dévalorisation massive des moyens de production surabondants (surabondants relativement aux possibilités actuelles de valorisation du capital), est absolument incapable de relancer un nouveau cycle d'accumulation. La bourgeoisie a sans doute la force aujourd'hui de lancer des guerres locales sans que, c'est vrai, le prolétariat ne puisse réagir et les stopper, mais ces guerres locales ne suffisent plus.
La défense des «droits de l'homme», le droit d'«ingérence humanitaire», la diabolisation de l'ennemi... sont des réalités idéologiques totalement insuffisantes pour mobiliser massivement les prolétaires dans la guerre. L'apathie avec laquelle le prolétariat répond à ces appels à la mobilisation impérialiste n'est certes pas un gage révolutionnaire, mais cette attitude constitue néanmoins un frein important dans la mesure où les fractions les plus conscientes de la bourgeoisie craignent les conséquences que pourraient avoir cette guerre généralisée dont le système social a pourtant tellement besoin.
L'obstination avec laquelle la bourgeoisie cherche à prolonger internationalement un conflit local, et l'enlisement qui s'ensuit, provoquent immédiatement des réactions au sein de notre classe. Que ce soit au Soudan, en Irak ou récemment en Yougoslavie, la prolongation des guerres locales entreprises ces dernières années sous le pavillon de l'ONU a entraîné presque systématiquement le prolétariat à sortir de son apathie et à reprendre son chemin de classe. L'insurrection prolétarienne en Irak en constitua assurément l'exemple le plus frappant.
Le spectre d'une situation révolutionnaire consécutive au déclenchement d'une guerre généralisée continue a gêner les plans guerriers de la bourgeoisie. La guerre technologique que cherchent à nous vendre les moyens de désinformation publique n'atteint pas ses objectifs et, bien que l'option d'une guerre traditionnelle présente les risques évoqués plus haut, il est fort probable qu'on retourne aux formes traditionnelles de la guerre, comme cela s'est passé en Iran/Irak ou plus récemment au Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. Mais comme on l'a vu, la grande terreur de la bourgeoisie internationale est de s'enferrer dans une guerre massive qui ferait ressurgir le fantôme du prolétariat révolutionnaire et qui verrait se transformer l'imbécile mansuétude actuelle de ses esclaves salariés en un nouvel octobre 1917, en dehors et contre toute alternative pacifiste et social-démocrate.
Sans préjuger du poids des déterminations plus immédiates qui peuvent mener telle ou telle association de requins impérialistes à se lancer tête baissée dans une guerre de conquête pouvant conduire à une généralisation plus ou moins importante, nous pensons néanmoins que la peur de tout perdre face au resurgissement de la révolution influence plus qu'on ne le croit les actuelles et provisoires hésitations bourgeoises à s'engager dans une guerre de plus grande envergure et surtout plus impliquante socialement.
Ceci étant dit, et malgré toutes les limites que nous voyons aujourd'hui dans l'action que mène la bourgeoisie en direction de la guerre généralisée, il faut bien reconnaître que le prolétariat pour sa part, est encore incapable d'affirmer ses objectifs propres. Ce serait faire preuve d'un triomphalisme déplacé que de prétendre le contraire. Malgré les résistances qu'il oppose à la guerre et que nous avons décrites dans ce texte à propos de la guerre en Yougoslavie, il faut bien admettre qu'il se trouve lui aussi dans une situation difficile, où l'absence de structures et d'associations prolétariennes, l'absence d'une presse de classe massive, le manque d'internationalisme, l'isolement des noyaux communistes, pèsent de tout leur poids sur les mouvements de lutte qui se déclenchent épisodiquement.
Une conséquence dramatique de cette réalité est que, lorsqu'il s'insurge contre la guerre comme en Irak, ou lorsqu'il affronte les armes à la main une situation de survie catastrophique comme en Albanie, le prolétariat demeure encore et toujours terriblement isolé. Face à cette situation d'isolement, la bourgeoisie n'éprouve aucune difficulté à circonscrire l'incendie social et à offrir l'une ou l'autre alternative aux prolétaires insurgés, dans le but de leur faire quitter leur terrain de classe.
Plus que jamais, l'organisation en force des exploités, l'organisation du prolétariat en un parti international, est indispensable au développement d'une réponse classiste à la guerre. Le seul moyen d'empêcher la spirale militariste qu'impose le capital, la seule façon de s'opposer aux guerres que la bourgeoisie développe un peu partout dans le monde, est de lutter et de s'organiser collectivement pour la destruction définitive de cette immonde société.
Et d'ajouter: «Les forces de maintien de la paix de l'ONU, accusés à diverses reprises d'avoir provoqué des troubles dans des zones où elles se sont déployées, sont maintenant l'objet de critiques assassines de la part de leur propre organisation. Dans une étude récente, ayant trait aux répercussions des conflits armés sur les enfants et mineurs d'âge, il a été démontré qu'au Mozambique, en Angola, en Somalie, au Cambodge, en Bosnie et en Croatie, 'l'arrivée des soldats du maintien de la paix fut liée à une rapide augmentation de la prostitution infantile'... Depuis la signature du traité de paix de 1992, les soldats de l'Opération des Nations-Unies au Mozambique (ONUMOZ), ont recruté des fillettes entre 12 et 18 ans, afin qu'elles leur servent de prostituées».
Le rapport reconnaît encore qu'au Cambodge, l'arrivée des missions de paix de l'ONU, ainsi que de groupes d'employés de différentes institutions internationales, est directement liée à l'augmentation vertigineuse de la prostitution à Phnom Penh. Entre 1991 et 1993, le nombre de prostituées serait passé de 6.000 à 20.000. De son côté, l'UNICEF témoigne de viols répétés de fillettes, perpétrés par les Casques Bleus, révélant aussi l'existence d'agressions sexuelles à l'encontre de gamines mutilées, telles ces petites filles sans jambes, violées à plusieurs reprises, durant des orgies collectives par ces dévoués protecteurs de la paix. Même l'organisation de la «Protection de l'Enfance» des Nations-Unies s'est vue obligée d'admettre l'implication directe de ses agents dans des viols, dans la prostitution de femmes et d'enfants et dans l'application systématique de «tortures sexuelles», dixit la rédactrice du rapport de l'ONU, Graça Machel (qui a donné son nom au rapport: «Rapport Machel»). Mais, comme le souligne El Pais, «Ni l'ONU, ni l'UNICEF, n'ont fourni de précision sur le nombre de soldats impliqués ou sur leur nationalité».
Au vu de ces joyeusetés charitables et humanitaires, on comprend pourquoi les informations concernant les abus sexuels perpétrés par le directeur européen de l'UNICEF sur des mineurs d'âge soit totalement passées à la trappe.
Tout aussi dérisoire est l'information nous apprenant que l'ex-ministre des Relations Extérieures de l'Equateur et «ex-chef des Droits de l'Homme de l'ONU a été accusé d'exploitation abusive de sa femme de ménage» (El Pais du 19 mars 1997), parce qu'il la payait une misère et lui refusait tous soins médicaux: preuve supplémentaire du fait que jamais les droits de l'homme ne se sont opposés à l'exploitation! Au contraire, l'égalité face à la Loi assure («donne force de loi à») cette exploitation!
Et qui s'émeut encore de cette pratique, entrée complètement dans la norme, que sont les viols systématiques de prisonniers et prisonnières dans les geôles du monde entier? Pour preuve, ce rapport passé inaperçu, publié aux Etats-Unis par Human Rights Watch, qui dénonçait: «Les prisonnières sont violées par voie vaginale, anale et orale. Les gardiens de prisons utilisent la force physique, les menaces, les privilèges,... Aliments, tabacs, drogues s'emploient habituellement comme monnaie d'échange, ainsi que la régulation des visites des enfants et de la famille». Et bien que la généralisation d'un tel procédé ait été constaté dans les 11 pénitenciers où s'effectuèrent les recherches, au beau milieu de ce paradis des droits humains que sont les Etats-Unis, cela ne gène en rien le sommeil des honorables et respectables citoyens de ce monde sans âme.
Ils ont continué à dormir, même lorsqu'ont été découvertes les tortures infligées par les Casques Bleus italiens, dans plusieurs pays africains (1) et lorsque furent dévoilées les monstruosités racistes et assassines des flics canadiens en mission de paix.
Mais revenons-en plutôt aux viols humanitaires perpétrés par ces fameux Casques Bleus. Eduardo Haro Tecglen, dans sa célèbre rubrique «Visto/Oído», du journal El Pais, commentait ainsi la norme qu'impose ces valeureux pacifistes, encensés par les médias du monde entier: «L'homme de 'Hora Cero' considère comme une tentation, la scène où la belle jeune fille s'offre pour une bouchée de pain. C'est une transaction normale, une représentation économique. Un soldat a sexuellement faim et un excès de pain, une jeune fille a faim de pain et un sexe disponible; quoi de plus normal que d'en revenir au troc primitif? De toutes façons, cette question de soldats et de femmes violées est éternelle; dans les lointaines guerres des temps passés, dans celles qui se déroulent actuellement et dans celles qui restent à venir».
Oui, vous avez bien lu. La barbarie de la guerre est normale, les viols, le terrorisme généralisé font partie intégrante et sont inhérents à toutes guerres, depuis des temps immémoriaux et ont existé dans toutes les sociétés de classes. Mais, dans la phase où le capital se trouve actuellement et grâce aux énormes progrès que nous apporte cette société de développement permanent et catastrophique, la guerre est devenue bien plus normale qu'auparavant, et la «normalité» des «abus sexuels» qu'elle génère s'avère être également «plus normale» qu'avant! (Comme dirait l'autre, tous les citoyens sont égaux, mais certains sont plus «égaux» que d'autres). Quoi qu'il en soit, des Nations-Unies aux repaires humanitaristes et pacifistes, tous s'accordent pour reconnaître que, sur ce plan-là, les guerres modernes vont beaucoup plus loin que celles du passé.
Ils peuvent être fiers ceux qui défendent le progrès, le développement, la modernité! Allez-y, continuez à appuyer le capitalisme progressiste et humanitaire! «Et, comme le dénonce le rapport Machel, -enchaîne l'article d'El Pais du 5 décembre 1996-, la guerre moderne cause chaque fois plus de ravages dans la vie des femmes et des enfants et dans les services de santé et d'éducation, qui constituent une part essentielle de la survie et du développement de la famille et de la communauté».
Et Haro d'ajouter: «Et il y a des questions bien plus graves dans ce rapport: les fillettes livrées à la prostitution par les humanitaires pacificateurs, les gamines blessées aux jambes qui furent violées,...».
La réponse est simple: la dénonciation elle-même, quel que soit le camp impérialiste duquel elle émane et quelle que soit la fraction bourgeoise mise en accusation fait partie, elle aussi, de la guerre. Il y a dénonciation ou non, en fonction des intérêts en jeu. La tragédie humaine qu'occasionnent les guerres est relevée ou pas selon les intérêts des parties belligérantes; on en parle ou on la passe sous silence en fonction des nécessités économico-militaires des camps en présence. L'important, ce n'est pas la tragédie humaine, l'important, c'est comment gagner la guerre à tout prix, et la dénonciation humanitaire n'est qu'un autre pan de cette guerre impérialiste. Et Haro de s'interroger: «Quelle est la raison de la publication de ce rapport aujourd'hui, alors qu'il traite de faits qui se sont déroulés il y a déjà quelques années? Et pourquoi est-ce l'UNICEF qui le divulgue, lui, pourtant si proche de l'ONU et des casques bleus? Je suspecte là une manoeuvre faisant partie de la campagne des Etats-Unis à l'encontre de Butros-Gali». Normalement, l'opinion publique ne devrait pas être mise au courant de ce type de «détails», somme toute habituels de la logique humanitaire, mais lorsque l'on se décide à «informer» (bien qu'il soit audacieux d'appeler cela de l'«information»), c'est parce qu'il y a d'autres intérêts en jeu, bien plus sonnants et trébuchants que ces menus «détails».
Vous souvenez-vous de ce jour où les écrans de télévision du monde entier ont soudain été envahis d'images d'enfants décharnés et sous-alimentés, aux ventres ballonnés, petits squelettes moribonds? Vous souvenez-vous que la situation qui régnait en Somalie à l'époque nous était présentée, avec force image, comme ayant atteint un niveau de gravité jusque là inconnu? Vous souvenez-vous qu'ensuite nous avons tous été appelés à venir en aide à ces enfants affamés en achetant du riz qui devait être ensuite expédié en Somalie?
Et bien sachez que cela coïncidait exactement avec la mission humanitaire des Marines américains en Somalie et qu'il fut difficile de cacher que des «scélérats» dressaient des barricades contre cette aide pourtant si désintéressée. Et quand ces «sauvages» atteignirent un niveau d'ignorance tel qu'ils se mirent à affronter, les armes à la main, ces Marines aux vertus humanitaires, alors, comme par enchantement, ces horribles images d'enfants décharnés, de ventres ballonnés, de morts-vivants, disparurent de nos écrans aussi soudainement qu'elles étaient apparues,... Et à nouveau, nous eûmes droit aux superbes beautés publicitaires, aux parties de football endiablées, aux pubs pour lessives qui lavent plus blanc que blanc. Qui peut dormir tranquille? Qui peut croire que ces ventres ballonnés aient disparu de la planète? Qui peut croire que les agents de l'humanitaire aient réussi à rassasier tant d'affamés (2)?
Ensuite, ce fut au tour des enfants décharnés d'Ethiopie d'occuper les écrans de télévision, puis vinrent ceux du Rwanda, du Burundi, du Zaïre, de Tanzanie, d'Irak, de Slovaquie, de Croatie, du Kosovo,... mais, eux aussi, apparaissaient et disparaissaient au rythme frénétique des intérêts impérialistes contradictoires et des publicités commerciales.
Ainsi, la participation des commandos et parachutistes belges et français, à la direction et à l'organisation des massacres et génocides (ou «holocaustes»! ou «crimes contre l'humanité», comme aiment les dénommer les grands de ce monde, quand cela remplit leurs escarcelles!), perpétués ces dernières années en Afrique et ailleurs, est parfois partiellement révélée au public. On a même vu le Pape se prêter au jeu cynique des remords et des aveux publics, reconnaissant textuellement (dans son discours au nouvel ambassadeur du Rwanda au Vatican) la «participation de certains prêtres dans les tueries» du Rwanda. Mieux encore, on parvint finalement à un consensus international dénonçant la participation du régime de Mobutu et de ses alliés impérialistes de toujours, Paris et Bruxelles, à tous ces massacres. Mais pas besoin d'être voyante extra-lucide, ou spécialiste ès politique internationale, pour se rendre compte que si toutes ces hyènes se sont soudain mises à pleurnicher en public sur le sort des Noirs exterminés, c'est simplement parce qu'il y avait plein de fric en jeu.
C'est que déjà, à l'horizon, se profilait une série d'accords entre les grandes multinationales, concentrées au Canada et aux Etats-Unis et certaines autres factions bourgeoises d'Afrique, telle la fraction Kabila qui signa alors d'importants marchés (les bourses du monde entier enregistrèrent une subite montée des actions de ces compagnies!). Des pressions s'exercèrent, dès lors, sur le reste des fractions bourgeoises pour qu'elles acceptent les réaménagements généraux que le taux de profit dictait en Afrique. Et du jour au lendemain, Mobutu, historique «ami de l'occident», à qui on avait permis tant de massacres, tomba en disgrâce et l'on se «rendit compte», tout à coup, qu'en réalité Mobutu ne représentait pas le modèle démocratique qu'on avait toujours présenté. Et une fois les remaniements impérialistes indispensables dûment réalisés, on s'empressa d'oublier les millions de morts que cela avait coûté.
Et si, la publicité, le foot, Diana, et autres modes qui envahissent quotidiennement les écrans de télévision, ne suffisent pas à nous faire oublier, on n'hésite pas à nous reparler des chambres à gaz, des juifs exterminés par les nazis,... Face à ce matraquage médiatique, le spectateur n'a plus qu'à se prosterner, car, face au massacre perpétré par les nazis, tout autre massacre ne peut apparaître que comme un écart, une déviation de la norme,... Face à l'horreur nazie, tout le reste ne peut être réduit qu'à une question de «détails». Une fois que la bourgeoisie mondiale a donné sa propre définition du mal absolu, tout autre mal ne peut être qu'un détail, comme le furent Hiroshima, Nagasaki, Dresde, ou les nombreux camps de concentration des alliés avant, pendant et après la guerre. Les bourgeoisies et puissances triomphantes, de la dite deuxième guerre mondiale, ont redéfini ce génocide de telle sorte que toute comparaison avec un autre génocide constitue un péché. L'antifascisme, idéologie suprême de l'ordre mondial, utilise l'ensemble des appareils de l'Etat mondial afin d'empêcher quelque comparaison que ce soit. Avec la participation des trotskistes, du Mossad, des staliniens, des complices de Vichy... une gigantesque campagne antifasciste s'est développée qui s'ingénie à amalgamer toute critique de l'antifascisme à une position fasciste. Cela permet de persécuter et d'acculer les révolutionnaires qui, depuis toujours, ont dénoncé le fascisme et l'antifascisme comme étant les deux mâchoires du régime bourgeois; cela permet d'accuser de complicité avec l'extrême-droite, tous ceux qui ne se résignent pas à accepter le mythe créé au nom d'un mal absolu incarné par les nazis et leurs «chambres à gaz»... cela permet enfin, au nom de la lutte contre le fascisme, de réduire au rang de futilité tout massacre actuel ou passé et quiconque ose comparer le massacre des juifs, durant la deuxième guerre, au massacre des indiens d'Amérique, ou au génocide esclavagiste perpétré sur le continent africain par les colonisateurs européens, se voit aussitôt traité de révisionniste. Et à mesure que les exigences commerciales l'exigent, les contours du massacre du continent africain s'estompent pour ne plus apparaître que comme une chose triviale et de deuxième ordre. On en revient au consensus généralisé, on ne parle plus des massacres dans lesquels étaient impliqués les para-commandos et les parachutistes des fameuses démocraties européennes ou les prêtres assassins; «il faut que l'économie fonctionne», on annonce de nouveaux gouvernements, des accords nationaux, des accords de coopération, de nouvelles visites ministérielles, de nouveaux investissements,... et on martèle qu'«il faut être réaliste!».
Non seulement, ils sont capables de nous faire le coup des secours humanitaires en fonction de leurs actions militaires, de leurs positions dans la guerre, suivant leurs actions anti-émeutes, leurs actions et intérêts boursiers et de tout faire disparaître quand cela les arrange, mais en plus, ils nous considèrent comme des débiles mentaux et nous font croire à n'importe quel bobard, aussi énorme soit-il. Ainsi, par exemple, il y a quatre ans, on parlait de plus d'un million d'êtres humains se trouvant dans une famine terrible, on disait que les réfugiés rwandais et burundais ayant survécus aux massacres organisés, crevaient littéralement de faim, on annonçait la plus grande tragédie humanitaire de tous les temps.
Ensuite, comme par enchantement, plus rien, plus aucune référence à ce million de personnes agonisantes. Et, pire encore, à qui continuait à se préoccuper de la question, on répondait, qu'en réalité, «on ne savait rien de ces personnes», précisant encore qu'«on en avait perdu la trace». Avec un aplomb sans nom, radios, télévisions, journaux, sans oublier internet, déclarèrent alors qu'effectivement, ce million de personnes était introuvable, qu'on n'avait pas la moindre idée de l'endroit où elles se trouvaient et tentèrent par tous les moyens de minimiser l'affaire,... ils auraient été, en réalité, moins nombreux qu'annoncé précédemment,... tout au plus 300.000 ou 400.000 personnes.
Ainsi, d'un côté, on nous fait croire que grâce aux satellites et autres moyens de contrôle que possèdent les grands de ce monde, c'est désormais un jeu d'enfant de déchiffrer, depuis l'espace, une plaque d'immatriculation, d'identifier le profil d'un quidam ou de lire une carte d'identité et de l'autre côté, on nous explique, sur ce ton sérieux qu'on utilise lorsqu'on cite les chiffres d'un ou deux millions de morts (c'est une approximation tellement absurde et cynique!), qu'un million de réfugiés se sont envolés en fumée, et aucune puissance impérialiste, aucun service secret, n'est capable de localiser ne fut-ce qu'un seul d'entre eux! Et les satellites, alors? Ils sont en panne? Ou c'est nous qui sommes débiles?
Des mois plus tard, alors qu'on ne parlait presque plus des morts du Rwanda et du Burundi, une «commissaire» européenne en mission dans la zone dénonça le fait que les réfugiés continuaient à mourir comme des mouches dans la région, affirma qu'il était faux de prétendre qu'on ignorait où se trouvaient ces réfugiés, que, sur ce territoire, des centaines de milliers de personnes crevaient de faim et que le silence généralisé à leur égard constituait un véritable scandale,... Mais peu de temps après, ces révélations tombèrent dans l'oubli et on n'entendit jamais plus parler de cette fameuse «commissaire» scandalisée.
Une fois de plus, on constate la puissance des moyens de désinformation publique, alternant rumeur ou silence, leur capacité à faire et défaire l'événement et le «non-événement», mais aussi leur capacité à déterminer la réalité même. Dans la mesure où il est rentable et sert les objectifs de telles ou telles campagnes militaires et/ou de mobilisation de l'opinion publique, le faux est un moment décisif du monde actuel. Le faux et le vrai, l'information et l'occultation, le mensonge et la campagne de désinformation constituent différents moments et processus de la réalité sur laquelle ils ont à la fois une incidence et un rôle, consolidant une fraction bourgeoise contre une autre.
On constate aussi la valeur des campagnes humanitaires menées par les différentes puissances et répercutées par leurs «ONG» et leur presse.
Frère, prolétaire, militant, camarade, sans doute n'avons nous pas la force aujourd'hui d'imposer la violence révolutionnaire contre l'humanitarisme d'où qu'il vienne, Casques Bleus, curés et autres bienfaiteurs de même acabit,... mais, au moins, quand ils viennent te parler d'«humanisme», de collectes, quand ils conseillent d'acheter quelques grains de riz à envoyer, quand ils t'invitent à soutenir telle ou telle action humanitaire, n'hésite pas: crache-leur au visage!
Les luttes qui se sont déroulées dans plusieurs pays d'Amérique Latine depuis la fin de l'été 1999, ont sans doute été trop importantes pour qu'on les passe complètement sous silence, mais la presse s'est dès lors ingéniée à les dévoyer, à les catégoriser, à les parcelliser. Face à cette escroquerie, nous aimerions rappeler ici quelques-uns de ces événements et souligner leur importance d'un point de vue social:
* la grève générale et les affrontements de prolétaires (des «paysans et indigènes» pour la presse) avec les forces de police dans différentes villes au Paraguay;
* les barricades, la remise en question généralisée du pouvoir et l'appropriation de centres importants de l'Etat bourgeois par le prolétariat en Equateur (un soulèvement d'«indigènes» selon les médias de droite; un «geste héroïque des indigènes équatoriens» selon la presse de gauche et anarchoïde);
* la radicalisation des luttes et les occupations de terres par les prolétaires au Brésil (des «paysans sans terre», dixit la presse);
* la persévérance des escrache (1) réalisés par les prolétaires contre les bourreaux et les assassins principalement en Argentine (appelés «parents de disparus» et «partisans des Droits de l'Homme» par la télévision et tant d'autres médias);
* l'utilisation de la dynamite par les prolétaires des mines au Chili pour défendre leurs intérêts (les médias regretteront que «les mineurs détruisent leurs propres mines»);
* les importantes manifestations prolétariennes avec affrontements de rue au Costa Rica (des «manifestants» dira la presse), les affrontements permanents entre prolétaires et gardiens de l'ordre au Mexique (des «étudiants» selon la TV, les journaux, la radio et internet);
* la révolte prolétarienne généralisée en Bolivie (les médias n'en ont quasiment pas parlé!), etc.
N'ayant ni les moyens ni les possibilités de réunir, dans une revue comme la nôtre, les éléments nécessaires à une information adéquate sur chacun de ces événements, nous nous contenterons de souligner quelques aspects de cette lutte que le prolétariat mène contre le capitalisme et l'Etat, ici en Amérique Latine. Nous voudrions signaler quelques éléments particulièrement positifs pour notre classe et qui pour cette raison, sont systématiquement mis de côté par l'ensemble de la presse. Comme on le lira, il s'agit de combats et d'affrontements aux forces de l'ordre et, contrairement au mythe de leur toute-puissance, un mythe que tentent de nous faire gober leurs scribes et leurs journalistes, on verra que face à un prolétariat déterminé et décidé à lutter, ces troupes mercenaires sont faibles et lâches, minées par leurs contradictions internes, et qu'on peut aisément leur filer la raclée. Ce qui réaffirme l'heureuse perspective de leur destruction généralisée à l'échelle planétaire.
En janvier 2000 lorsque les prolétaires de l'intérieur du pays marchent sur Quito, et radicalisent ainsi également le mouvement qui préexistait dans cette ville, c'est l'ensemble des luttes qui avaient secoué l'Equateur durant toute l'année précédente qui prend soudainement une vigueur nouvelle. Le gouvernement démocrate populaire de Mahuad tente de freiner les protestations en dépêchant la répression et en brisant les manifestations par la force. Au début, cette attaque prend les manifestants par surprise, certains sont blessés, d'autres faits prisonniers et, dans un premier temps, la dispersion et la désorientation prédominent. Mais à la violence d'en haut le prolétariat agricole et urbain répondra par la violence d'en bas: plutôt que de s'étioler, les manifestations vont se développer de façon toujours plus organisées et se fortifier. La violence de classe est ouvertement assumée. Tandis que le prolétariat s'empare des puits de pétrole, paralyse l'oléoduc transéquatorien, coupe la distribution de combustible et empêche toute exportation de brut, des dizaines de milliers de manifestants s'affrontent aux piquets militaires, coupent les routes, contrôlent les accès des villages et des villes et occupent la rue dans diverses cités du pays. Si certains ont pu prétendre un temps que la colère du prolétariat était dirigée contre le président et le pouvoir exécutif, la radicalisation des manifestations est maintenant telle qu'il est impossible de ne pas reconnaître publiquement que c'est l'Etat dans sa totalité qui est remis en question.
Les manifestations sont interdites, les troupes de choc sont déployées dans la rue et l'état de siège est décrété. Mais les manifestations sont de plus en plus puissantes et le prolétariat remet ouvertement en question le pouvoir de l'Etat dans son ensemble. Totalement dépassé par les événements, le président Mahuad joue alors la carte de la carotte: quelques ministres sont rendus responsables de la situation, on les démissionne et on en nomme d'autres, plus progressistes... Mais tout cela ne sert à rien, la lutte prolétarienne se poursuit et s'intensifie. Comprenant le danger, la bourgeoisie décide de sacrifier son président. Même l'armée et les syndicats s'efforcent de calmer le jeu. Invoquant la «lutte contre la corruption», le FUT (Front Unitaire des Travailleurs) déclare qu'il faut punir la corruption et former un Gouvernement de Salut National. De leur côté, la Centrale des Travailleurs de Petro Ecuador, la Coordination des Mouvements Sociaux et la Confédération des Nationalités Indigènes d'Equateur (CONAIE) qui, entre autres revendications, exigent la destitution du président, sont complètement débordées par une guerre sociale qui n'arrête pas de se développer malgré tous leurs efforts pour l'en empêcher: les manifestants clament haut et fort qu'ils ne luttent pas pour un changement de président et réaffirment la lutte contre l'Etat dans son ensemble. L'appareil policier se décompose, la discipline est rompue, la désorganisation est générale, les prolétaires contrôlent la rue même si l'armée, contrairement à la police, parvient à garder dans un premier temps une relative unité de corps. Celle-ci pourtant sera de courte durée. Très vite, les contradictions internes à l'armée vont également éclater, et des corps entiers vont participer aux manifestations aux côtés des prolétaires, prenant même parfois une part décisive à l'assaut de bâtiments qu'organise le mouvement.
Aucune force répressive n'est désormais capable de freiner le mouvement insurrectionnel, les quelques policiers qui s'y essayent sont totalement débordés et reculent devant cette avalanche humaine de plusieurs milliers de prolétaires de tous sexes, de tous âges, de toutes catégories (qu'ils soient «indigènes» ou pas, quoi qu'en disent ces fumiers de journalistes, indécrottables commis du capital et de l'Etat!) qui parviennent à s'emparer de plusieurs édifices publics: à Quito, ils prennent le Palais du Gouvernement, le Parlement, la Cour Suprême de Justice, la Contraloria (l'Office du contrôle des contributions), les Ministères, la Banque Centrale, etc. Et, ce faisant, ils lancent des appels à agir de même dans toutes les villes, déjà paralysées par le mouvement. Le président devient une simple figure décorative qui, bien qu'elle continue à s'agiter et à hurler quelle «ne renoncera pas», est destituée dans les faits par le mouvement lui même. L'attaque réelle des manifestants contre les trois pouvoirs de l'Etat (exécutif, législatif et judiciaire) s'accompagne de l'exigence de leur destitution, ce qui représente déjà, sans nul doute, une certaine formalisation juridique extrême de l'intransigeante lutte du prolétariat pour imposer son pouvoir contre l'Etat.
Le 23 janvier, dans les rues, malgré la présence de gauchistes et autres réformistes qui, mêlés aux insurgés, continuent à «chercher des solutions au mouvement», on fête la victoire de l'insurrection. Comme à l'accoutumée, les fabricants de l'information falsifient tout et parlent de coup d'Etat militaire appuyé par les indigènes, incitant ainsi accessoirement au racisme anti-indigène.
Une Junte de Salut National est formée par un triumvirat constitué de militaires, de leaders indigènes officiels et d'un membre en vogue de la Cour Suprême. Cette junte, par un discours de gauche, tente de rétablir l'ordre (2).
Pour contrer la continuité du mouvement et la perte de confiance totale du prolétariat envers l'Etat, un véritable front unique de salut national est mis sur pied, composé des syndicats, des partis et de ce qui reste des forces répressives. Ce front appelle à cesser le mouvement et appuie la Junte de Salut National. Le Président de la CONAIE, Antonio Vargas, déclare que «le peuple équatorien a triomphé, que la Junte de Salut National ne décevra pas le pays et... que l'unité avec les Forces Armées est une nouvelle expérience pour l'Amérique Latine». Mais confronté à un manque de crédibilité généralisée, cette Junte ne vivra que quelques heures. Dans les faits, et malgré tous les efforts des réorganisateurs de l'Etat capitaliste, parmi lesquels les journalistes qui taisent, désinforment, tergiversent, etc., le pouvoir est dans la rue. Profitant de l'absence de nouvelles initiatives et directives au sein du prolétariat, et prenant appui sur les consignes appelant les prolétaires à rentrer chez eux, on déclare (par la bouche du Général Carlos Mendoza au nom du commandement militaire) que le «pouvoir» du président destitué passe aux mains du vice-président Gustavo Noboa, qui, comme chacun des protagonistes le sait, imposera la même politique économique que son prédécesseur. Le prolétariat continue à refuser explicitement ces «solutions». Dans la rue, les consignes appellent à rejeter toute tentative émanant ouvertement de l'Etat. Face à ce sentiment généralisé (qui pousse à la permanence de la révolution), le Front de Salut National, des secteurs militaires aux syndicats en passant par les partis, accorde son soutien à Noboa et multiplie les appels à cesser le mouvement, parlant, de façon très timorée (ils ont peur de leur propre mensonge!), de «triomphe». Par la bouche de son président Antonio Vargas, la CONAIE, organisation indigéniste qui comme nous l'avons vu se voulait l'interlocuteur représentant officiellement le mouvement, appuie la «solution» convenue avec les partis, l'armée et les syndicats (l'indigénisme agit contre l'unification et la lutte prolétarienne!). Simultanément, pour tenter de se donner une certaine crédibilité, la CONAIE évoque également «la trahison de Mendoza».
Les appareils de l'Etat bourgeois se réunifient et, pour ce faire, on coopte des prolétaires indigènes inconséquents. Dans la rue, le mécontentement et la désorientation sont généralisés, le sentiment d'une nouvelle tromperie est total et le choc que représente les déclarations de ces chefs vendus est tellement violent qu'il parvient à disloquer au moins provisoirement le mouvement. La presse dira, satisfaite (du devoir d'ordre accompli!), que «les indigènes retournent à leurs terres, à leurs maisons».
Après deux semaines de luttes ouvertes contre l'Etat, ce retour a évidemment un goût amer. Cependant rien ne sera plus comme avant. Désormais, maintenir le prolétariat soumis ne sera plus chose aussi aisée, lui qui a senti de façon tangible qu'il pouvait affronter l'Etat et le mettre en pièces; et malgré tous leurs efforts, les fabricants de l'opinion publique auront du mal à effacer de la conscience des prolétaires le souvenir de la force qu'ils viennent d'expérimenter.
Passons maintenant à «d'autres» (pas si différentes!) situations et expériences récentes du prolétariat en Amérique latine.
En Bolivie, l'effervescence est grande depuis plusieurs mois, les réunions et discussions vont bon train un peu partout, des tracts quotidiennement imprimés et, depuis le dernier trimestre '99, les manifestations prolétariennes sont de plus en plus fortes. A La Paz, des groupes de femmes et de parents de membres des forces répressives se joignent aux protestations. Lorsque les flics sont envoyés pour réprimer leurs parents, ils refusent et passent du côté des manifestants. A Cochabamba et dans d'autres villes, les protestations prolétariennes tournent autour du problème de l'eau et de son coût prohibitif imposé par le gouvernement et l'entreprise des Eaux de Tunari. Constatant que le prolétariat ne se soumet pas de bon gré aux ordres de Banzer, le gouvernement généralise la répression et déclare l'état de siège. Mais, ici aussi, le mouvement se durcit et répond à la violence du capital par la violence du prolétariat: les manifestants passent à l'offensive et parviennent à s'emparer de plusieurs bâtiments publics, brisant dans les faits, l'ordre que l'Etat tente d'imposer par la force. Nous n'avons pas d'autres détails sur ce mouvement, mais à Cochabamba, l'échec de l'état de siège est tel (dans le contexte d'un état de siège, ce sont les forces répressives qui empêchent toute circulation, à Cochabamba c'est la révolte qui empêchera la circulation des militaires!) que le gouvernement finit par le faire lever et décide d'octroyer d'importantes concessions sur la question de l'eau potable.
Pour terminer, disons deux mots encore sur des événements survenus au Mexique. Il est vrai que, après des mois de lutte intense Mexico, les flics de l'Etat démocratique mexicain ont obtenu une importante victoire contre les grévistes et les occupants de l'UNAM (Université Autonome de Mexico) qu'ils ont fini par déloger violemment et cela malgré l'énorme détermination démontrée par des milliers de prolétaires venus porter secours aux encerclés. Mais la lutte a continué et les flics ne sont pas parvenus à imposer leur terreur partout. Ainsi dans la petite ville de Francisco Madero, les forces répressives mexicaines, avec la brutalité qui les caractérise, avaient violemment vidé une école rurale occupée et fait 165 prisonniers parmi les prolétaires qui avaient pris position dans ce local. Comme de bien entendu, les prolétaires avaient été frappés et brutalisés. Mais le prolétariat de cette ville ne s'est pas laissé faire et a réagi de façon coordonnée et organisée, en décidant de chasser à coups de bâton la plus grande partie des flics postés là. Dès huit heures du matin, le dimanche 20 février, désireux de libérer leurs camarades et de donner une leçon aux flics, les habitants de Francisco Madero (hommes, femmes,... vieillards et enfants) munis de gourdins, de bâtons et de piques, passent à l'attaque. Ils occupent toutes les issues de la ville afin qu'aucun flic ne puisse s'échapper, ils les encerclent, les désarment, leur ôtent leurs vêtements et font un énorme feu de joie dans lequel ils brûlent les uniformes, les bottes, les équipements, les gilets pare-balles, etc. Les flics seront retenus en otages pendant plusieurs heures. Plus tard, les policiers vêtus de leur seul caleçon et les officiers tout nus, sont attachés les uns aux autres et obligés de marcher en file indienne, les mains sur la nuque, jusqu'à la place centrale (à 5 km de là). Tous les véhicules de la police municipale, des camionnettes Chevrolet pour la plupart, sont également incendiés. Arrivés sur la place centrale, les prolétaires demandent des comptes aux flics. Ceux-ci, morts de peurs, implorent leur pardon, mais les insultes de la masse continuent à pleuvoir. Quelques prolétaires n'hésitent pas à dire qu'il faudrait transformer la place centrale en échafaud et en finir avec eux, tandis que d'autres proposent purement et simplement: brûlons-les! Les consignes du mouvement sont «s'il n'y a pas de solution -la libération des 165 prisonniers- il y aura crémation !» ou encore «qu'on libère les détenus ou nous brûlerons ces serviles défenseurs de l'ordre».
Ici encore nous n'avons pas d'autres détails sur ce qui s'est passé ensuite, mais une chose est certaine: face à la détermination prolétarienne, l'Etat de Mexico eut tôt fait d'oublier toute formalité juridique et légale et, laissant tomber les procès qu'il avait menacé d'entamer, libéra en hâte les prisonniers. C'est ainsi que les 165 prolétaires que les forces de l'ordre avaient incarcérés furent libérés. Les flics, couchés à plat ventre et surveillés par des groupes de militants organisés, au visage caché, brandissant des massues et des pieux, seront gardés jusqu'à la tombée de la nuit. Ils ne seront relâchés que lorsque les prisonniers auront rejoint leur famille et que la fête battra son plein.
Les faits parlent d'eux-mêmes et démontrent que seule la force peut répondre avec succès à la terreur de l'Etat démocratique, que seule l'unification dans le combat contre l'ordre légal permet au prolétariat d'imposer ses intérêts et de défendre les siens. Et si par hasard, quelqu'un ose vous dire le contraire, vous connaissez maintenant la consigne: brulez-le!