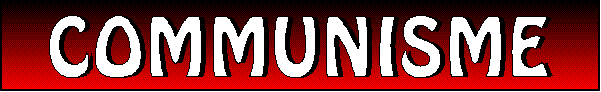
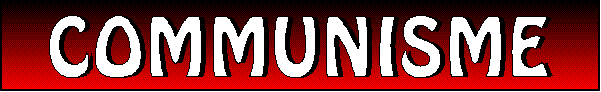
La mystification démocratique consiste à faire croire qu'une conduite de l'Etat "plus humaine" ou basée sur "une meilleure répartition des richesses"... pourrait faire l'impasse sur les misères et les matraques intrinsèques aux exigences de la loi de la valeur. Or, tant qu'il s'agira de gérer le capitalisme et non de le combattre, l'incontournable logique du profit et de l'argent, via son agent contemporain, la bourgeoisie, continuera à dicter d'une main de fer la brutalité des mesures à prendre à l'encontre du prolétariat. Des mesures pour l'exploiter toujours plus, des lois pour le frapper s'il se révolte.
Qu'elle assure son règne dans ce que l'opinion publique nomme "république socialiste", "démocratie parlementaire" ou "dictature éclairée" (1), l'économie capitaliste est indissociable de l'exploitation, de la guerre, de la misère, des coups, du sang.
Evidemment, les blessures par lesquelles suppurent les souffrances du prolétariat, il faut les cacher, les minimiser, les estomper. Et c'est là qu'intervient cette multitude de salauds d'intellectuels de gauche ou de droite, ces progressistes de carrière, "lumières" de la bonne conscience bourgeoise, Don Quichotte de la réforme, Soeur Teresa des consciences... véritables distributeurs d'aspirines pour les fractures ouvertes du prolétariat. Tels de vulgaires sparadraps, ils tentent de recouvrir les plaies béantes, ils s'y collent, se mêlent au sang comme ils s'engluent dans nos drapeaux, jusqu'à se confondre avec notre chair et empêcher qu'on les repère et les arrache. Ils dissimulent la misère en la pleurant et interdisent tout en même temps que nos colères s'attaquent à la racine du mal, au Capital comme totalité. La mission de ces infirmiers de la conscience est de donner une explication de la misère qui la rende plus tolérable, c'est-à-dire acceptable; et pour rendre la non-vie de l'esclave salarié plus supportable, quoi de mieux que de la relativiser, de la comparer à d'autres situations d'oppression, quoi de plus efficace que de la mettre en relief avec le pire?
Les discours des emplâtres réformistes se rassemblent tous autour d'un même point: ils ont systématiquement un moindre mal à défendre. On devrait s'estimer heureux de n'avoir "que" le couteau sur la gorge pour nous inciter à aller bosser chaque matin. D'autres y vont un fusil dans le dos ou une matraque électrique sur la tempe. Et ça, c'est mille fois pire, n'est-il pas? (voir encadré) Ces fractions capitalistes n'ont qu'un moins pire à faire valoir face à notre haine de toute exploitation.
Les matraques électriques auxquelles nous faisons allusion ont fait l'objet d'un rapport d'Amnesty International qui serait désopilant s'il n'était pas tragique. Cette organisation, démontrant une fois encore son total dévouement à la défense de l'Etat, du capitalisme, de la démocratie, des droits,... dénonce l'utilisation des matraques électriques dans les régimes qu'elle qualifie de "dictatoriaux". Par contre, elle avalise tout à fait leur fabrication et leur utilisation contre des prolétaires dans le cadre des régimes dits "démocratiques" quand "ces armes sont effectivement destinées à maintenir l'ordre public" et qu'elles sont aux mains de policiers ayant reçu "une formation pour apprendre à les utiliser..." (Cf. Le Monde Diplomatique - avril 1997). Pour Amnesty International, les chocs électriques des matraques de la démocratie honorent et défendent le monde des droits et devoirs marchands, un monde où les classes n'existent pas. C'est sans doute cette permanence avec laquelle Amnesty International "oublie" l'existence du prolétariat qui lui a valu, depuis bien longtemps déjà, d'être rebaptisé "Amnésie Internationale".
Hier et aujourd'hui.
Avant-hier déjà, en France, ils nous appelaient à défendre la République face au péril réactionnaire, infiniment plus nuisible aux intérêts du prolétariat, disaient-ils. Depuis, la République a écrasé la Commune de Paris, haché des tonnes de chair à canon sur les champs de bataille, déporté des milliers de prolétaires juifs sous Vichy, massacré des milliers de prolétaires algériens à Paris et à Alger sous De Gaulle, vendu des tonnes de lots de sang contaminés par la grâce de Mitterrand,... Mais on continue à nous vendre l'idéal républicain comme le moins mauvais des systèmes et à écraser sous ces arguments tous ceux qui en subissent chaque jour les conséquences. Dans la même absurde logique et avec les mêmes arguments, d'autres partisans du moindre mal encouragent aujourd'hui à barrer la route au racisme de la droite en soutenant le Parti Socialiste... celui-là même qui a (entre autre) organisé avec tellement d'humanité les charters d'expulsés au début des années quatre-vingt dix. La constance des arguments politiciens n'a d'égal que la permanence avec laquelle des masses d'idiots s'y soumettent. Pour les élections de mai 1997 en France, l'inénarrable Daniel Cohn-Bendit ne déclare-t-il pas encore et toujours: "Si la droite gagne, cela rendra la France plus malade. Si la gauche gagne, ce ne sera pas le paradis, mais ce sera quand même mieux" (Libération - 23/5/1997).
Il y a quelques années encore, pour vendre son propre mode de gestion du salariat aux prolétaires d'Allemagne de l'ouest qui critiquaient le capitalisme à l'occidentale, le stalinisme "sauce DDR" reprenait lui aussi l'argument du moindre mal et utilisait le discours pacifiste (la paix avec l'Est plutôt que la guerre en Europe) pour obtenir un soutien au "socialisme réel". Les adeptes du stalinisme à l'ouest avaient trouvé un fort joli slogan pour défendre ce sordide calcul: "mieux vaut rouge que mort". C'est ce que doivent penser à coup sûr tous ceux qui, de Varsovie à Berlin-est en passant par Budapest, se sont un jour révoltés contre ce capitalisme aux couleurs du socialisme (2) et qui croupissent maintenant six pieds sous terre.
Les Fronts de Libération Nationale, un peu partout dans le monde, ont eux aussi fait l'objet d'un soutien ainsi argumenté: "un moindre mal en attendant la 'révolution'", nous chantaient les tiers-mondistes. Depuis, l'Algérie du FLN a actualisé avec succès l'héritage tortionnaire des anciens colons français, les routes du Cambodge khmer sont rouges du sang qu'a fait couler Pol Pot, et la Palestine elle-même -objet de tant d'espoirs auprès des trotskystes et maoïstes du monde entier- n'était pas "libérée" d'un mois que sa police torturait déjà. Le moindre mal des polices Nationalement Libérées a vite fait ses preuves. Quant à la "révolution"...
Face à l'impossibilité de nous vendre le monde de la guerre de tous contre tous sous l'emballage d'un paradis terrestre, la plupart des justifications centrales de l'ennemi réformiste tournent autour de ce fameux moindre mal:
Surtout qu'à chaque tour de carrousel, les nouveaux maîtres nous assurent que cela ne peut pas être pire qu'avant, que leur politique, faite de progrès, barrera la route à la réaction, à toute menace de ces autres politiques qui sont tellement "plus préjudiciables pour nos libertés".
De moindre mal en moindre mal, les innombrables petites merdes progressistes que compte cette société conduisent ainsi les prolétaires de crise en crise, de guerre en guerre, de reconstruction en reconstruction, etc., repoussant toujours à plus tard "l'idéal social" pour lequel ils prétendent se battre.
En période révolutionnaire, c'est de cette manière que les assauts du prolétariat sont brisés. Derniers remparts du système, les fractions les plus radicales de la bourgeoisie -les forces social-démocrates, les gauchistes, les centristes,...- cherchent à anéantir les objectifs des forces révolutionnaires en les réduisant à des revendications "raisonnables", "réalistes"... L'idéologie du moindre mal brise ainsi l'élan du prolétariat, l'appelant à renoncer aux objectifs généraux et révolutionnaires qu'il s'est fixé, sous le même éternel prétexte qu'il risque de tout perdre s'il ne se contente pas de ce qu'il a déjà "conquis".
En Allemagne, c'est Rosa Luxembourg qui prétendait, contre les gauches communistes révolutionnaires: "Il vaut mieux le pire des partis ouvriers que pas de parti du tout." Après avoir défendu sur cette base l'union avec le SPD, puis avec l'USPD, puis avec tout ce qu'il y avait de favorable au syndicalisme et au parlementarisme au sein du KPD, cette politique a conduit, sous la direction ultérieure de Lévi, au stalinisme, à la démobilisation du prolétariat... et au fascisme. L'idéologie du "moins pire des partis ouvriers", qui représentait alors l'attachement sacré à la tradition de la IIème Internationale, à son réformisme, à son culte des masses domestiquées, a clairement contribué à déposséder le prolétariat de ses objectifs révolutionnaires.
Combattre l'idéologie du moindre mal, c'est dénoncer toutes ces insurrections qui ont été détournées vers le cul-de-sac des réformes pour "un moindre mal", une impasse où sont embusqués les défenseurs du capital, en attente du moment où ils pourront porter le coup fatal. Grâce à l'idéologie du moindre mal combien d'anciens révolutionnaires ont-ils fini par participer au gouvernement pour y gérer les réformes? (...) Combien de guerres, de renoncements, de sacrifices au nom de ce "moindre mal" qui, en dernière instance, a systématiquement donné lieu au pire de tous les maux: la défaite de la révolution et la survie de ce cataclysme permanent qu'est le capitalisme?(Extrait de "Le mythe du socialisme cubain" - Communisme No.45)
Aujourd'hui aussi, -et alors que nous sommes bien loin de vivre une époque révolutionnaire-, il suffit que le prolétariat cherche à casser un tant soit peu le cadre de la valse droite-gauche, partis du gouvernement-partis de l'opposition,... il suffit qu'il rejette les religions de gauche comme de droite et qu'il affirme très élémentairement que le pire, entre deux maux, c'est précisément d'en choisir un, bref qu'il réaffirme -même timidement- la perspective révolutionnaire de destruction de tout Etat, en refusant le parlementarisme, le syndicalisme ou toute autre forme d'adaptation proposée sur le marché des "moins pire", pour que tous les curés du monde lui tombent dessus.
Prendre position dans la guerre que se livrent les moindre mal respectifs ne pose pas trop de problème, surtout si le cadre de discussion reste celui de l'alternance. Argumenter républicain contre monarchiste, "démocratie ouvrière" contre "démocratie parlementaire", gauche contre droite, c'est admissible. Le point de vue bourgeois a bien compris que la subversion intervient exactement au moment où on sort de ce cadre, où on le détruit. Et c'est pourquoi, c'est précisément ce cadre que s'acharnent à défendre les staliniens, les syndicalistes, les gauchistes, les progressistes et toutes les forces de la réforme.
Ce qui est inacceptable pour toutes les fractions de la bourgeoisie, c'est de dénoncer l'Etat -tous les Etats- comme l'ennemi du prolétariat, et donc de rappeler que le frère de gauche et la bonne soeur de droite font partie de la même famille marchande; ce qui est intolérable pour l'intellectuel bourgeois, c'est de dénoncer l'idéologie antifasciste comme le pire produit du fascisme, d'affirmer que stalinisme et fascisme sont des frères ennemis nécessaires à la domination universelle de la démocratie, de soutenir que le social-démocrate Noske à formé les Corps Francs qui lui ont permis, à lui comme à Hitler ensuite, de massacrer des milliers de prolétaires.
Définir le capitalisme sous toutes ses formes comme le système à abattre est évidemment quelque chose d'insupportable pour la bourgeoisie. Et elle le montre bien.
Dès que le spectre du communisme manifeste sa présence en dénonçant l'ensemble de ses ennemis, le capital lâche ses anticorps. Blancs ou rouges, ses globules opportunistes se pressent autour du germe révolutionnaire et c'est à qui criera le plus fort à l'aventurisme politique, à l'utopie ou à la réaction, pour couvrir les mots d'ordre prolétariens. La contre-révolution s'exprime alors. A droite, on amalgame les révolutionnaires au passé sanglant du rival de gauche (Staline, Pol Pot,...); à gauche, on complète l'anticommunisme viscéral de toute cette clique de bourgeois terrorisés, par l'assimilation des positions anticapitalistes au fascisme, au nazisme, bref au passé monstrueux du rival de droite (3).
Faut-il vraiment mettre des références sur toutes ces habituelles pratiques de flics, toujours actuelles, et qui n'ont comme unique objectif que de salir la révolution? Est-il vraiment nécessaire de mettre des noms sur les salauds de gauche ou de droite qui, dans toutes les régions du monde et à toutes les époques, ont défendu leur fond de commerce idéologique de cette manière? Est-il indispensable de rappeler les noms et les pratiques de tous ces Louis Blanc de l'histoire, socialistes en paroles et anticommunards en acte? Faut-il ressusciter les Jean Jaurès et les Jean Grave, les Bernstein et les Kautsky, les Largo Caballero et les Abad de Santillan ou ressortir les cadavres des placards de 1968: Régis Debray, Alain Geismar, Serge July, etc. etc.?
Et bien oui! Il est sans doute nécessaire, encore et toujours, de rappeler que les ennemis du prolétariat utilisent aujourd'hui les mêmes armes qu'hier, les mêmes vieux clous rouillés, toujours utiles parce qu'ils blessent plus cruellement. Et quand des prolétaires crient leur dégoût des syndicats en France ou qu'ils balancent quelques tomates sur la gueule des socialistes en Belgique, c'est toute l'intelligentsia démocratique, de gauche comme de droite, qui crie au poujadisme. Face à une situation ou les forces du progrès et de la réaction sont simplement et élémentairement mis dans le même sac, les journalistes de la démocratie -des éditorialistes de L'Express aux scribouillards trotskystes en passant par les historiens "anarchistes"- se précipitent aux devants de la scène et, dans la dialectique de concierge qui leur est propre, s'empressent d'affirmer qu'il ne faut pas jeter tous les politiciens dans le même sac et que la plus haute expression du civisme consiste à soutenir les moins mauvais.
Et dans la pratique, voilà que l'historien libertaire Alexandre Skirda défend la magistrature de gauche en France, que les maoïstes du Parti du Travail de Belgique demandent de remplacer la gendarmerie par une police démocratique et ouvrière, que les antifascistes "grande gueule" genre Charlie Hebdo pleurnichent avec des flics pour disposer d'une vraie police républicaine et que le leader de l'Organisation Socialiste Libertaire en Suisse devient conseiller du ministre stalinien de la Police et de le Justice du très démocratique canton de Vaud... sans parler des "guérilleros" argentins, uruguayens, salvadoriens,... devenus hommes d'Etat!
Face au danger de poujadisme et de fascisme, quoi de mieux pour ces cafards que le moindre mal que constitue la collaboration ouverte avec l'Etat?
Et dans l'enthousiasme de cette chasse aux sorcières moderne, on ressort de vieux textes qu'on dénature allègrement et que l'on taxe d'antisémites ou de révisionnistes parce qu'ils dénoncent et Auschwitz et le grand alibi qu'Auschwitz a fournit aux officiers français, aux hauts fonctionnaires anglais, aux ministres et autres banquiers "va-t-en-guerre" du camp bourgeois dit Allié. Edifiant!
Non contentes d'avoir pu laver idéologiquement la France patriotique du sang des prolétaires qu'elle avait sur les mains, ces serpillières de l'Etat républicain (5) n'hésitent pas à s'attaquer maintenant aux quelques fractions révolutionnaires qui seules ont eu le courage de défendre à l'époque le mot d'ordre historique du prolétariat -à bas toutes les guerres!-, mot d'ordre pour lequel la plupart de nos camarades ont été tantôt fusillés par l'appareil républicain français, tantôt assassinés dans les camps fascistes allemands, quand ils n'ont pas disparu dans les goulags staliniens.
Mais l'odieuse défense du camp antifasciste ne s'arrête pas à la destruction de la mémoire de nos camarades. La défense de l'antifascisme, c'est la responsabilité politique de toutes les guerres qui ont été menées depuis par les Vainqueurs. Car c'est bel et bien le camp antifasciste qui, après la "Victoire" a lâché la bombe sur Hiroshima, mené les guerres d'Indochine ou de Corée, commis les massacres au Vietnam, les tortures et assassinats en Algérie, ou plus récemment encore la guerre d'Afghanistan ou du Golfe, les débarquements meurtriers en Somalie ou au Rwanda, etc.
Est-elle glauque et lugubre la gloriole politique que les fantoches de l'antifascisme peuvent tirer aujourd'hui de leur défense d'un camp capitaliste contre un autre! Et qu'est-ce qu'ils sont retors et compliqués les détours de la "dialectique" auxquels ils recourent pour tenter de se justifier face aux massacres commis par le camp qu'ils ont choisi de défendre!
Pour nous comme pour nos camarades, il n'y a bien sûr qu'une et une seule même sale guerre capitaliste, résultant de l'éternel besoin du Capital de relancer un nouveau cycle de valorisation par la dévalorisation brutale d'un maximum de marchandises, ce qui se traduit pour les prolétaires par d'immenses pertes humaines. Que Napoléon, Hitler, Nixon, Churchill, Staline ou le pape en soient les acteurs et que chacune de ces fripouilles justifie le massacre par des intentions philosophiques, politiques ou religieuses distinctes ne change rien au fait que c'est le Capital qui dicte la guerre, le Capital comme système. Un système qui exige impérativement, derrière toute considération politique, la destruction d'un maximum de marchandises-forces de travail.
La perplexité des intellectuels face à cette simple généralisation n'a d'égal que la terreur qu'inspire à la bourgeoisie un niveau d'abstraction où toute proposition de participation à une guerre impérialiste, quelle qu'elle soit, est recadrée dans son champ naturel, celui de la lutte de classe: bourgeoisie contre prolétariat, guerre contre révolution. Un champ où la bourgeoisie défendra la nécessité de se battre contre le camp adverse. Un champ où notre classe dénoncera, quant à elle, la guerre comme une situation où la concurrence capitaliste qui a mené deux ou plusieurs camps bourgeois à la guerre, constitue très précisément le cadre de destruction du prolétariat.
L'idéologie dominante a horreur de ce niveau d'abstraction parce qu'il nivelle toutes les intentions des protagonistes guerriers -leurs haines mutuelles, leurs désaccords idéologiques, leurs projets politiques respectifs- à ce qu'elles alimentent objectivement: la consolidation d'un système qui, pour maintenir le règne de la marchandise et l'exploitation de l'homme par l'homme, se ressource dans des destructions massives (6).
Le cadre de la lutte de classe clairement établi, il devient évident que seule la bourgeoisie trouve un intérêt dans la guerre. Non seulement comme fraction impérialiste parce qu'elle espère en sortir vainqueur et renforcer ainsi ses positions face aux autres concurrents capitalistes, mais en plus et surtout, comme classe dans sa globalité parce que, qu'elle que soit le concurrent vainqueur, la destruction massive de capitaux accumulés sous formes de forces productives relancera un cycle de valorisation permettant de résoudre la crise et d'assurer la pérennité de la domination sur le prolétariat. Quels que soient les drapeaux derrière lesquels on enverra le prolétariat au front, ce qui compte pour le Capital c'est que la bataille ait lieu. On se battra "pour la patrie", "pour le socialisme", "pour la paix" ou "contre l'impérialisme ennemi",... Les chants de ralliement à la guerre seront d'autant plus variés que leur dénominateur est commun... justifier la participation à la guerre.
Quant au prolétariat, s'il subit la guerre en tant que masse de prolétaires excédentaires, il la hait et la combat par ailleurs, en tant que classe révolutionnaire. "A bas toutes les guerres", "l'ennemi est dans notre propre pays, c'est notre propre bourgeoisie", "défaitisme révolutionnaire", "retournez les fusils contre les officiers", "transformation de la guerre impérialiste en guerre révolutionnaire",... autant de mots d'ordres qui chercheront à définir la révolution communiste comme le seul dépassement humain possible d'une société basée sur l'imbécile liberté qu'a chaque parcelle de capital de mener la guerre à son voisin.
Pour casser cette opposition -guerre ou révolution-, l'arme du moindre mal servira ici encore et justifiera la participation ("critique", "momentanée", "tactique",...) à la défense nationale. L'acharnement avec lequel la bourgeoisie cherchera à convaincre les prolétaires d'adhérer à la guerre -un acharnement basé le plus souvent sur l'obligation terroriste d'aller au front sous peine de mort-, trouvera des prolongements idéologiques dans la définition de moindre mal guerriers. D'innombrables fractions bourgeoises, de gauche comme de droite, d'extrême-gauche comme d'extrême-droite, viennent ainsi régulièrement, et sous des prétextes théoriques les plus divers, dévier les colères prolétariennes du domaine de la lutte de classe vers celui de l'union nationale. L'ennemi de classe cherche ainsi à désarticuler l'alternative "guerre ou révolution". Suppliant d'adhérer aujourd'hui à la guerre, il promet mieux pour demain, un "mieux" qui s'habillera, selon ceux à qui il s'adresse, d'une "démocratie parlementaire", "ouvrière", "populaire", "socialiste", "antifasciste", voire "révolutionnaire"...
Hier, aujourd'hui, demain, tant que ce système nécessitera des idéologues pour le justifier, il existera toujours quelque vendeur d'idées, quelque "épicier de la pensée" comme disait Marx pour défendre tel ou tel aspect du mode d'exploitation en place. Et dans cette perspective, l'idéologie du moindre mal semble avoir encore de beaux jours devant elle. Quoi de plus séduisant en effet pour ceux qui tentent de briser l'élan anticapitaliste que l'utilisation d'un quelconque beau parleur sublimant les colères et insatisfactions formulées par les "mécontents" en les recadrant vers un ennemi bien restreint, bien identifiable: le dictateur stalinien, monarchiste, fasciste ou républicain, ou seulement les "dix familles les plus riches", ou telle ou telle fraction de la bourgeoisie,... Peu importe finalement ceux qui sont touchés, l'important pour le Capital est que le mouvement ait été canalisé vers quelques uns seulement des exploiteurs. Dans tous ces cas, le résultat est le même: l'élan prolétarien est cassé net, le moindre mal de l'ordre marchand peut continuer à régner.
Heurtons-les donc encore une fois! Et avec une "vieillerie" s'il-vous-plait! Réaffirmons notre haine de tout ce qui produit et reproduit le quotidien de la terreur capitaliste, quelle que soit sa forme de gestion. Voici donc en avant-première d'une "Mémoire ouvrière" que nous vous proposerons dans un prochain numéro (Le Mouvement Anarchiste (1912-1913), publication du Club Anarchiste Communiste), quelques lignes extraites du texte "Face à la République", un texte qui se verrait à coup sûr affublé de l'adjectif "poujadiste" ou "révisionniste" s'il avait été écrit aujourd'hui! Laissons donc nos camarades affirmer bien fort avec nous, et à l'encontre ici de la République, qu'il n'existe pas de moindre mal sous le capitalisme.
Quelle que soit sa couleur, de gauche ou de droite, fasciste ou antifasciste, "ouvrière" ou "démocratique",...
"Ce que nous reprochons (à la République), ce ne sont pas quelques abus superficiels, quelques canailleries inutiles et qu'elle pourrait s'éviter. (...) Le plus atroce, le plus tragique, à qui regarde de près, c'est le travail normal quotidien de l'ignoble institution. Chaque jour, son armée, sa police opèrent leurs infâmes besognes, chaque jour ses juges exercent leur exécrable métier, chaque jour dans ses prisons, dans ses bagnes, on torture ignoblement des êtres humains. Chaque jour aussi des hommes meurent de faim, ou des maladies de la misère, ou brisés par des labeurs exténuants; chaque jour des milliers d'hommes sont grugés, exploités, spoliés par les bandits capitalistes dont l'Etat républicain avec tout son appareil de puissance -machine à tromper, machine à tuer, machine à torturer- est le très fidèle gardien, et l'on se demanderait pourquoi nous la détestons."
Ainsi, il y a peu est apparu au grand jour que Georges Marchais, ex-secrétaire général historique du Parti "Communiste" Français, avait effectué du travail volontaire en Allemagne nazie; plus récemment François Mitterrand (alors président de la République) reconnaissait avoir collaboré avec le régime nazi qui régnait en France durant l'occupation et avoir même été l'ami intime et le collaborateur des plus sinistres personnages de la police française qui travaillaient pour les nazis... Et on pourrait continuer ainsi car la liste est longue.
En 1996, une dépêche de l'agence EFE à Rome, révélait que dans les archives du Parti "Communiste" Italien se trouvaient deux lettres écrites par Winston Churchill -présenté en général comme une des plus grandes figures mondiales de l'antifascisme- à Benito Mussolini. Ce courrier, toujours selon l'agence EFE, aurait été saisi lors de la détention du Duce. Dans ces lettres, le chef de file de l'antifascisme mondial félicite une des plus grandes figures du fascisme contemporain pour sa campagne d'Ethiopie, et pour l'appui accordé par le gouvernement italien à Franco. Cela n'a rien d'étonnant pour nous, mais l'agence EFE semble elle fort surprise de cette nouvelle: "...deux lettres dans lesquelles Churchill donnait au Duce son approbation pour la campagne d'Ethiopie et plus insolite encore, sa bénédiction à l'appui italien pour Franco." Cela vaut peut-être la peine de rappeler que publiquement les antifascistes se sont toujours présentés comme des opposants au gigantesque massacre organisé par les fascistes en Ethiopie, ainsi que comme partisans de la république espagnole contre Franco. Cela vaut la peine également de se souvenir que seule une poignée de groupes révolutionnaires dans le monde s'opposaient de la même manière à l'antifascisme et au fascisme, qu'ils considéraient comme les deux mâchoires d'une même tenaille en permanente collaboration contre l'insurrection prolétarienne dans tout le processus de révolution et contre-révolution en Espagne.
Du matin au soir, à la radio, à la télé, dans la bouche des sociologues, des journalistes ou des syndicalistes se succèdent toutes sortes d'explications temporisatrices utilisant le piège du moindre mal:
Toujours est-il que c'est à l'aide de cette logique vulgaire mais efficace que les administrateurs du Capital font passer leurs mesures.
Et, c'est en acceptant cette logique mortifiante de "bon sens commun" et de soumission quotidienne à l'Etat que, de moindre mal en moindre mal, les prolétaires se retrouvent un beau jour un fusil à la main dans une quelconque tranchée nationale avec pour mission de tirer sur le frère de classe qui se terre dans la tranchée d'en face... Et c'est cette même logique de concessions successives qui conduira le prolétaire à appuyer sur la gâchette car, après tout, mieux vaut le doute existentiel après l'assassinat sur commande que la certitude d'être fusillé pour insoumission. Et puis un jour, à force de calculer, de louvoyer entre mal et moindre mal, c'est sa propre vie qu'il mettra dans la balance: mieux vaut crever tout de suite en se tirant une balle dans la tête, que de continuer à vivre l'enfer de la guerre.
Il n'y a aucune fracture entre l'acceptation d'une taxe, d'un nouveau licenciement, d'une énième diminution de salaire, d'une "dernière" humiliation... et l'estimation finale sur le "mieux" ou le "moins bien" que constitue le suicide, cette ultime négation de nos désirs.
Chaque concession opérée au nom du moindre mal, aussi infime et quotidienne soit-elle, est un pas de plus sur le terrain glissant qui mène à notre défaite. Se résigner régulièrement sur la route du "ça aurait pu être pire" est une petite mort au quotidien qui se situe sur le terrain de l'ennemi de classe. Accepter le terrain du moindre mal, c'est accepter le terrain du Capital. Consentir à la logique du moindre mal, c'est donner les premiers coups de pelle préparant notre propre tombe.
|
|
"L'atmosphère à Gjirokaster est folle. La révolte populaire se transforme en anarchie totale, il n'y a plus de police, plus d'Etat, plus de règle. La ville s'enthousiasme, s'épanouit, se prend au jeu de la rébellion"... (Le Monde - 11/3/1997)
"Avoir une arme, c'est un plaisir"... une "incontestable ivresse que provoque chez les combattants l'anarchie"... "Les pillages se multiplient, opérés par des hordes de miséreux ou par des bandits. Personne ne se cache, et il y a parfois un air de fête populaire." (Le Monde - 16-17/3/1997)
Il ne faut pas croire qu'il serait possible de faire une chronologie qui ne soit pas directement une analyse, une prise de position par rapport aux événements. Une chronologie neutre, que les partisans du libre arbitre appelleraient "objective", cela n'existe pas. Il est clair que tout ce que laissent transparaître les médias est d'emblée un parti pris (le choix des événements relatés, les mots qui sont mis sur ce qui se passe,...) et exprime, en l'occurrence, le point de vue bourgeois, un point de vue qui ne peut que nier le fait qu'il y a eu en Albanie (en tout cas dans un premier temps) affrontement classe contre classe en dehors et contre tout règlement démocratique. Ce qui est objectif, c'est que tout regard posé sur les événements dépend du point de vue où l'on se place, soit le point de vue de la bourgeoisie défendant son Etat et son système mercantile,... soit le point de vue du prolétariat dont la lutte est destruction du capitalisme et affirmation du communisme (1).
Alors que toute la presse bourgeoise s'indignait d'encore assister à des moyens de lutte aussi "barbares" comportant attaques de banques, incendies des commissariats, des municipalités, des tribunaux, pillages des dépôts de vivres et d'armes que sont les casernes, prises d'assaut des prisons et libération des prisonniers,... de notre côté, c'est avec une certaine exaltation que nous apprenions que le mouvement de lutte en Albanie rompait avec les sempiternelles manifestations mises en place par les oppositions du monde entier (en Albanie: les ex-staliniens rebaptisés socialistes) et se réappropriait les moyens de lutte de toujours des prolétaires contre l'Etat.
Au lendemain du 9 mars 1997, date à laquelle Gjirokaster est gagnée par la révolte, le journal Le Monde s'étonne de ce que l'atmosphère y soit à l'enthousiasme, que les pillages donnent un air de fête aux rues, que le fait de porter une arme procure une certaine joie de vivre, que la ville semble s'épanouir alors que l'anarchie y est totale, sans plus de police, sans plus d'Etat... Parce qu'imbu de leur idéal démocratique, positionnés du côté de la classe dominante, les journalistes ne peuvent comprendre que de tels mouvements libèrent tout à coup des générations et des générations de privations, de sacrifices, d'assassinats, d'emprisonnements,... durant lesquelles l'on a courbé l'échine et encaissé tous les coups,... Oui, c'est jouissif d'enfin briser les chaînes, de se réapproprier tout ce dont on nous fait rêver mais qu'on ne peut jamais toucher parce que c'est cadenassé derrière les barrières de l'argent, les barreaux des prisons,... Oui, c'est festif de ne plus avoir peur et de se retrouver forts et unis dans la rue contre la propriété privée et l'Etat, contre tout cet ordre qui nous fait crever -cet ordre qui ne crevera que lorsque la liesse de ces prolétaires en armes qui ont enfin retrouvé la voie de la lutte sera partagée par les prolétaires du monde entier.
Ces sociétés d'épargne proposant des taux d'intérêts faramineux (de 35 à 100 % par mois) ont attiré jusqu'aux fonds de tiroir des coins les plus reculés d'Albanie. Afin d'investir chez Sude, Populi, Xhaferri, Vefa, Kamberi ou autre, de déposer chaque mois un peu plus d'argent à ces guichets installés à la hâte dans les rues, les Albanais ont vendu tout ce qu'ils pouvaient. Appartements, voitures, troupeaux, terres,... ont été liquidés. Mais les montants payés aux premiers déposants ne provenant que de l'apport croissant de nouveaux dépôts, l'effondrement de ces sociétés d'épargne (qui viennent tôt ou tard à cours de dépôts) était inévitable. Des centaines de milliers d'épargnants s'en sont retrouvés complètement dépouillés. 70 à 80 % des foyers albanais ont été touchés. Et bien sûr, ce furent les plus pauvres qui furent comme toujours les plus touchés.
La ferveur à investir dans les pyramides financières exprime la persistance du mythe qui prétend qu'à l'occident l'argent est facile, qu'il suffit de s'endormir sur ses rentes pour se réveiller riche le lendemain...
Jusqu'en 1990-91, la nécessité de défendre le mythe de l'existence d'une Albanie socialiste avait gardé les frontières fermées aux seuls échanges/investissements avec les pays de l'Est. Puis, comme en Russie et dans les autres pays de l'Est, le mythe du socialisme comme paramètre fondamental du maintien de la paix sociale ayant fait son temps, on parla de libéralisation du système, de la fin des restrictions, de la possibilité pour chacun de s'enrichir,... A Berlin on fait tomber le mur, en Albanie on déserte les 700.000 bunkers qu'Enver Hoxha (2) avait fait construire dans la crainte d'une agression étrangère.
Comme en Russie (3) et dans tous les pays de l'Est, le largage des mesures protectionnistes, les changements d'alliances impérialistes, les réformes économiques et sociales marquent une accélération brutale dans la course au profit et creusent de manière encore plus phénoménale le fossé entre bourgeois et prolétaires. De décembre 1990 à mai 1991, des émeutes de la faim éclatent dans toute l'Albanie. Les investisseurs occidentaux reculent face à tant d'incertitude quant aux perspectives de profit. Les années 1991-92 sont marquées par l'effondrement total de l'industrie albanaise et la persistance de troubles sociaux. De décembre 1991 à février 1992, une deuxième vague d'émeutes déferle sur le pays. A chaque fois, ces émeutes débouchent sur des pillages et incendies de commissariats, bâtiments publics, usines, magasins et dépôts de vivre,... (4) L'Albanie, classée à hauts risques, est placée sous perfusion de l'aide internationale pour éviter l'explosion sociale.
Les Etats allemand, turc et nord-américain appuient financièrement l'armée albanaise pour la transformer en une armée puissante, prête à l'affrontement. Mais malgré ces préparatifs bourgeois, la lutte de classe nous a montré une fois de plus comment une situation préparée par la bourgeoisie peut devenir incontrôlable.
L'attraction du mythe du paradis occidental est alors si forte que l'ouverture des frontières se solde par un exode massif que l'Etat albanais, mais aussi tous les Etats environnants et principalement l'italien, se voient obligés de réfréner violemment. Il ne s'agit pas tant d'exode de capitaux vu que l'Albanie est plutôt une zone de désertification des capitaux mais d'exode des prolétaires subjugués par le mythe qui prétend que passer à l'ouest signifie la fin de toutes les misères. Rappelons-nous l'afflux des quelques 40.000 réfugiés débarquant malgré tout dans le sud de l'Italie en mars et août 1991. La moindre rumeur d'un bateau en partance, d'une délivrance de visas avait pour résultat le rassemblement de milliers de jeunes dans les ports ou devant les ambassades occidentales, comme cela c'est également passé à Cuba. Par la suite, cet exode a continué à faire l'objet d'un trafic clandestin crapuleux. On ne peut s'y tromper lorsque l'on sait que les passeurs d'émigrants clandestins vers l'Italie désignent leurs clients du terme saisissant de viande sur pied et que le prix de la traversée varie entre 450 et 600 dollars (5).
Avec la faillite des pyramides financières, les prolétaires d'Albanie font encore les frais de la désillusion totale qui accompagne la prise de conscience qu'à l'Est ou à l'Ouest, c'est l'argent qui fait et défait les politiques, ouvre ou ferme les frontières, s'amasse dans les poches des uns en vidant les poches des autres. Le mythe de l'argent facile est puissant qui a conduit les moindres économies des prolétaires dans ce gouffre à fric que sont les sociétés d'épargne, la désillusion dure à encaisser quand on y a tout misé et qu'on doit tout y laisser.
En mai 1996, le soir des élections législatives qui attribuent la totalité des sièges du parlement au Parti Démocratique, le drapeau de la Vefa, la plus importante compagnie financière compromise dans les pyramides trône à la tribune des vainqueurs. Un journaliste commente: "La Vefa illustre le miracle du capitalisme, le miracle albanais, le miracle d'un pays qui s'arrache enfin de la misère." Avec la faillite des pyramides financières dont celle générée par la Vefa, le sentiment de trahison est très fort au sein de la population, tant ces sociétés d'épargne sont liées au gouvernement Berisha et au Parti Démocratique (6). D'autant plus qu'en 1992, c'est au cri de "fitoi!" (victoire!) que le peuple albanais plébiscitait, tel un libérateur, son nouveau président, Sali Berisha qui, au nom de la lutte contre la tyrannie du régime stalinien avait réussi à re-sceller l'union nationale. C'est à cette époque qu'est lancé un appel à l'aide internationale pour relancer l'économie en Albanie et que le principal partenaire de l'Albanie devient les Etats-Unis.
Aujourd'hui la situation est toute autre. La faillite des sociétés d'épargne a fait basculer le climat social. Contrairement à ce qui s'est passé en Macédoine ou en Bulgarie où la bourgeoisie se targue d'avoir pu contenir le mécontentement des laissés-pour-compte avec de maigres compensations, en Albanie, les manifestations et autres formes de protestations se généralisent, démontrant clairement que le prolétariat ne se laisse pas dompter par l'Etat. En effet, à Skopje, le gouvernement et la banque nationale ont paré au plus pressé en organisant des "comités de dédommagement des victimes lésées" menant enquêtes, procès,... Pire, à Sofia, pour tout dédommagement, le gouvernement a érigé un monument "à la mémoire des victimes de la pyramide" (7).
En Albanie, la revendication est: "on veut notre argent, on veut être remboursé à 100 %." Tout au long du mois de janvier les manifestations se font de plus en plus houleuses et la police anti-émeute souvent débordée se livre à des charges violentes.
Lorsque le gouvernement prend des mesures pour stopper les spéculations, il est trop tard, il ne contrôle plus la situation. Le 10 janvier 1997, il engage des poursuites contre deux institutions qui sont à la base de la constitution de ces pyramides: Xhaferri et Populi.
Même la Banque Mondiale et le Fond monétaire International interviennent pour mettre un terme à ce type d'entreprise. Ces institutions soulignent le fait que ce sont des entreprises privées basées sur la seule spéculation, qui permettent à certains de s'enrichir très vite mais qui ne rencontrent pas nécessairement les intérêts de développement du capital qui est d'abord basé sur la relance de la production. Le 4 février, Tritan Shehu, vice-premier ministre reprend ce point de vue à son compte et proclame (après s'être lui-même largement rempli les poches de cet argent facile!): "Nous sommes résolus à détruire ces épargnes pyramidales, car ce n'est pas là l'avenir de l'Albanie. Notre avenir, c'est la production et on va travailler de plus en plus." Pour être plus exact, il aurait dû dire: "et on va faire travailler de plus en plus."
Le gouvernement Berisha est autant désavoué par la bourgeoisie mondiale que par le prolétariat qui sort de sa torpeur.
A Peshkopija, dans sa grande commisération, le président Berisha demande aux gros épargnants de se faire connaître (tant pis pour les petits!). En réponse, des attroupements se forment dans la rue centrale... Et une centaine de personnes attaquent le commissariat à coups de pierre. Six policiers sont blessés. Puis les émeutiers mettent le feu aux bâtiments de l'administration communale. Le slogans sont: On veut notre argent! et A bas Berisha!.
Le 19 janvier à Tirana, la police anti-émeute intervient en force place Skanderbeg pour disperser une foule en colère de plus de 5.000 personnes réclamant le remboursement des sommes déposées dans les sociétés d'épargne. Le Parti Socialiste toujours maintenu dans l'opposition par le scrutin (contesté) de mai 1996, profite de la situation de mobilisation du prolétariat pour prendre sa revanche sur le Parti Démocratique. Appelant à participer à cette manifestation, il espère se mettre à la tête d'un mouvement de protestation pacifique comme à Belgrade ou à Sofia. Mais cette manifestation, et toutes celles qui vont suivre vont vite faire abandonner au Parti Socialiste et aux autres partis de la bourgeoisie tout espoir d'empêcher l'explosion de la terrible colère qui gronde dans tout le pays comme en témoignent déjà, le même jour, les affrontements à Berat.
A Berat (100 km au sud de Tirana), des pierres volent contre les bâtiments de la police, de la justice, les bureaux ministériels et ceux du Parti Démocratique. Deux cents manifestants sont arrêtés. Le Parlement en appelle à l'armée pour protéger les bâtiments officiels.
Le 24 janvier à Lushnjë, 100 km au sud de Tirana, localité où les pyramides ont lésé le plus de monde, des manifestants jettent des engins explosifs au premier étage du bâtiment de la municipalité. Le feu prend. Les deux mille personnes rassemblées dans le centre ville font barrage et empêchent les pompiers d'accéder à l'incendie. Les manifestants exigent que leur argent, déposé dans la fondation Xhaferri mise en faillite la semaine dernière, leur soit remboursé.
Fin janvier, il apparaît que Berisha ne se rend pas compte de l'ampleur du mouvement et pense mettre fin aux désordres en laissant libre cours aux habituelles pratiques de la police secrète, le SHIK (ex-Sigourimi, police secrète de l'époque stalinienne (8)). Plus les rassemblements tournent à l'émeute, plus la police devient brutale. Le SHIK fait régner son habituelle terreur: arrestations, interrogatoires, tabassages, emprisonnements, assassinats, disparitions,...
De son côté, l'opposition bourgeoise, principalement regroupée autour du Parti Socialiste, se structure pour mener sa campagne contre le gouvernement Berisha. Le 30 janvier, dix partis de l'opposition dont le Parti Socialiste se coalisent en un Forum pour la Démocratie. Ce Forum exige la démission du gouvernement Berisha jugé responsable du chaos économique mis en évidence par les effets dévastateurs des entreprises pyramidales et appelle à la constitution d'un gouvernement de technocrates pour gérer la crise en attendant l'organisation d'élections anticipées.
Toujours, le 30 janvier, Koha Jone, le plus important journal "indépendant", porte-parole d'"intellectuels indépendants" (une des composantes de l'opposition bourgeoise), publie un manifeste proclamant: "Il est clair que la colère du peuple est dirigée contre un Etat qui s'érige en juge après avoir acquitté les voleurs." L'opposition sait utiliser les mots dans lesquels les prolétaires en lutte peuvent se reconnaître. Mais pour l'opposition, cet Etat qu'elle condamne, ce n'est pas le pouvoir de la classe bourgeoise, c'est le gouvernement Berisha. De plus, des membres de la rédaction de ce journal, des dirigeants du Parti Socialiste et autres figures connues de l'opposition bourgeoise, accusés d'être à l'origine des troubles sont arrêtés. Tous les ingrédients sont là pour enfermer le mouvement dans une alternative bourgeoise: soutenir l'opposition martyr contre le nouveau tyran: Berisha.
Sur le plan politique bourgeois, voici donc le tableau: à la mobilisation prolétarienne, l'opposition désigne comme cible Berisha tandis que, jetant en prison côte à côte prolétaires en lutte et membres de l'opposition bourgeoise, le gouvernement pousse les premiers à se ranger sous les drapeaux de cette seconde qui n'a pour but que de laminer le mouvement par le passage aux urnes (électorales/mortuaires).
Le calcul est intelligent mais il ne tient pas compte du potentiel révolutionnaire que contient cette série de manifestations du mécontentement prolétarien. Il est clair que dans le mouvement, les prolétaires expriment beaucoup plus que simplement l'argent perdu et la démission de Berisha. Le mécontentement encore encadré par l'opposition bourgeoise fait de plus en plus place à l'éclatement de la haine de classe contre l'Etat comme en témoignent les fréquents débordements débouchant sur le saccage des bâtiments officiels.
Mais la frontière entre la lutte prolétarienne spontanément dirigée contre l'ensemble des structures de l'Etat bourgeois et la bataille de l'opposition bourgeoise pour restructurer l'Etat ne s'opère pas encore assez clairement dans le mouvement. Et ce manque de délimitation qui s'exprime, par exemple, dans le fait que l'opposition bourgeoise n'est pas chassée des manifestations (et également dans le fait qu'une partie du mouvement demande justice à l'Etat pour qu'il sanctionne les responsables des pyramides financières) laisse encore le champ libre à l'opposition pour prendre en mains les rênes du mouvement.
Début février 1997, Berisha promet que tous ceux qui ont été spoliés seront dédommagés soit en argent liquide soit en livrets d'épargne. Le remboursement devrait débuter le 5 février grâce à la saisie des comptes de deux des principales sociétés de fonds de placement. Mais, d'une part, plus personne ne fait confiance dans ces bouts de papier que l'Etat leur délivrerait une nouvelle fois en échange de promesses. D'autre part, le même jour, la plus importante des entreprises de pyramides à Vlorë, Gjallica, annonce sa mise en faillite, laissant un trou de 360 millions de dollars, et proclame sa totale impossibilité de remboursement.
Suite à cette nouvelle, le 5 février, à Vlorë (ville portuaire de 60 à 80.000 habitants à 210 km au sud de Tirana), 30.000 personnes descendent dans la rue. Comme la manifestation se dirige vers le port, les flics chargent et tentent de chasser les manifestants à coups de pompes à eau et de matraques. Des membres masqués du SHIK frappent des manifestants et les emmènent dans leurs voitures. Les affrontements avec la police font deux morts et une centaine de blessés, la plupart du côté des manifestants. Mais par la suite, un groupe de policiers anti-émeute se fait encercler. Plusieurs d'entre eux, déshabillés par les manifestants, courent dans les rues en sous-vêtements. Les forces de l'ordre se replient!
Cette journée marque le début d'une mobilisation permanente à Vlorë: chaque jour commencera par un grand rassemblement (vers 10 heure) qui se prolongera par une manifestation. Vers 17 heure, une nouvelle réunion décide des actions à organiser pour le lendemain. Les chefs de tous les partis de l'opposition, présents à ces manifestations, appellent au calme. Au bout d'une semaine de manifestations, les appels au calme ne sont toujours pas suivis. Néanmoins, le mot d'ordre des manifestants reste A bas Berisha!
A Tepelenë, le Forum pour la Démocratie appelle à un rassemblement. Seule une soixantaine de personnes s'y présentent alors que la mobilisation est de plus en plus forte. Le mouvement occupe la rue et ne veut pas se laisser distraire par des discours sur la démocratie.
Ces exemples montrent que les prolétaires disent oui à l'opposition quand elle réclame le remboursement des sommes engagées dans les sociétés d'épargne et quand elle crie A bas Berisha! Ils disent non quand elle appelle au calme et à réfléchir sur la démocratie. Mais si dans la bouche des prolétaires A bas Berisha! peut signifier A bas l'Etat!, dans la bouche de l'opposition A bas Berisha! signifie A bas le gouvernement Berisha! et débouche sur la revendication d'élections anticipées. Le mouvement charrie ces deux perspectives tout à fait antagoniques. Ces oui et non qui s'expriment dans le mouvement démontrent encore la difficulté du prolétariat à choisir son camp. Il a du mal à se dépêtrer des alternatives bourgeoises. Il réagit positivement ou négativement aux injonctions des partis bourgeois mais n'en est pas encore à définir sa propre direction.
C'est sur cette ambiguïté, ce manque de clarté que va reposer toute la tactique de la contre-révolution qui va pousser le mouvement à quitter la rue et à reprendre le droit chemin du vote pour exprimer son désaccord. Voilà la voie toute tracée de la pacification du mouvement soutenue par la bourgeoisie mondiale qui, faisant référence aux situations semblables bien que moins explosives en Bulgarie et en Roumanie, ne cesse de souligner le "passage salvateur par l'isoloir".
Dans beaucoup de villes les manifestations, toujours encadrées par les partis de l'opposition, sont de plus en plus houleuses, il y a des débordements fréquents, la police est de plus en plus brutale et arrête massivement.
A Tirana, le parti de Berisha se mobilise et mille personnes participent à un rassemblement pour la démocratie et la non-violence (comme toujours, ceux qui sont les plus conséquents dans l'organisation du terrorisme d'Etat préfèrent le discours de la non-violence qui leur garantit le monopole de la force armée). Le SHIK continue à faire régner la terreur. Ses membres investissent les cafés où des discussions animées sur les derniers événements regroupent du monde et tabassent à la ronde.
Le 9 février est marqué par une escalade dans la violence de la répression. A Vlorë, dans la nuit, la police emprisonne ceux qu'elle juge être les meneurs. Les manifestants se réunissent devant les bâtiments de la police et exigent la libération des prisonniers. Les flics tirent, il y a au moins 26 blessés.
Le jour suivant, le 10 février, toujours à Vlorë: 40.000 personnes manifestent et mettent le feu au quartier général du Parti Démocratique. Il y a à nouveau 81 blessés dont un meurt des suites de ses blessures par balles. Des localités environnantes (5.000 venant de Fier, plusieurs centaines de Berat, Tepelenë, et d'ailleurs encore), les prolétaires se solidarisent avec la lutte de leurs compagnons de Vlorë et viennent renforcer leurs rangs.
A Tirana: les forces de l'ordre n'arrivent pas à empêcher des rassemblements. La tension monte. Les manifestants crient "Vlorë, Vlorë!"
Les affrontements à Vlorë font traînée de poudre et deviennent l'emblème de la révolte dans tout le pays.
Gjirokaster est traversé par la manifestation la plus massive jusqu'à ce jour. Le 11 février, à Vlorë, 30.000 personnes assistent aux funérailles du manifestant assassiné la veille par la police qui se fait particulièrement discrète ce jour-là. Mais la tension monte, à tout moment semblent pouvoir exploser des affrontements "dangereusement incontrôlés".
Jusqu'ici, le mouvement est marqué par des manifestations de plus en plus tumultueuses qui débouchent sur de graves affrontements avec les corps de police et l'incendie de bâtiments de l'Etat (principalement, les sièges du Parti Démocratique et les municipalités) et qui sont marqués par des arrestations massives et de nombreux morts. Mais le fait d'avoir plusieurs fois fait reculer les forces de l'ordre marque la tendance à rompre avec le schéma habituel des manifestations tout au long desquelles, c'est l'Etat qui garde l'initiative des affrontements, et cela constitue un saut de qualité important.
La répression par laquelle Berisha pensait décimer le mouvement, produit l'effet contraire. Loin de faire reculer le mouvement, elle attise la combativité, renforce la détermination à lutter jusqu'à gain de cause. Et plus encore, le sentiment de vengeance se fait jour. Non seulement vengeance contre la police qui frappe, isole, torture, massacre, mais plus globalement contre tout ce qui a conduit à cette situation extrême, contre toutes ces dures années de survie précaire sans jamais savoir de quoi demain sera fait, contre toutes ces promesses au nom desquelles on s'est toujours plus serré la ceinture, contre la torture de la faim, contre les intimidations, les humiliations quotidiennes, contre tout le rapport social travail salarié/capital, contre l'Etat.
Les limites du mouvement continuent à s'exprimer par contre dans le fait que les partis de l'opposition ne se font pas encore jeter des manifestations et que les prolétaires attendent que l'Etat leur rende justice et punissent les sociétés frauduleuses.
Le même jour, le 11 février, le gouvernement envisage de proclamer l'état d'urgence à Vlorë. Le Premier Ministre, Meksi, annonçait déjà à la radio: "il faut défendre l'ordre constitutionnel" et à une situation extraordinaire, il faut répondre par des "mesures extraordinaires". Mais le décret soumis au Parlement rencontre l'opposition de députés du Parti Démocratique qui, venant de la région de Vlorë, se rendent compte que cette mesure ne ferait qu'accentuer la tension que les arrestations et assassinats ont particulièrement aiguisée ces derniers jours. Pour éviter que la haine des flics ne se retourne contre l'ensemble des structures de l'Etat, le gouvernement décide alors de limoger le commissaire de police en place à Vlorë.
Dans la semaine du 12 février, le mouvement s'élargit dans presque toutes les villes du sud et dans quelques villes du nord. Les manifestations deviennent de plus en plus massives et les affrontements plus forts. A Fier, il y a encore un mort du côté des manifestants.
Le 19 février se déroule à Tirana une nouvelle grande manifestation que la police n'a pas pu empêcher. Partout on crie "Vlorë, Vlorë!"
Le 20 février, une quarantaine d'étudiants débutent une grève de la faim à l'université de Vlorë. Ils appellent à la non-violence, réclament la démission du gouvernement Meksi, la formation d'un gouvernement de technocrates pour assurer l'intérim jusqu'aux nouvelles élections, le limogeage des responsables de la télévision, des poursuites judiciaires contre les responsables des brutalités policières! Quel programme! Pour ces étudiants, l'attaque brutale du niveau de vie des prolétaires qui ont tout perdu dans les faillites, la répression des luttes,... n'est que le fait de quelques vilains qui ont abusé de leur poste de responsabilité. Et la revendication d'un gouvernement de technocrates laisse supposer qu'il pourrait y avoir un gouvernement neutre au-dessus des classes! Comme pour tous les réformistes du monde, il ne s'agirait que d'un problème de mauvaise gestion, soluble dans les élections.
Avec leur programme de remise à neuf de l'Etat, ces étudiants se situent clairement du côté de la contre-révolution. Contre-révolution qui se concrétise également dans les moyens de lutte proposés: face à la répression de plus en plus féroce, on propose de tendre l'autre joue. Alors qu'une force collective se dégage de la rue et commence à prendre le dessus face aux assauts meurtriers des policiers anti-émeute, ils proposent à chacun de s'aliter, de dilapider ses énergies vitales,... Et pourquoi pas se mettre à genoux et prier... pour apitoyer l'Etat qui au moment-même reçoit des appuis internationaux pour payer et suréquiper ses différents corps de police.
En effet, fin février, Berisha envoie son ministre de l'intérieur en Allemagne percevoir une avance pour payer de nouveaux équipements aux forces de police. D'autres gouvernements expriment leur appui au gouvernement de Berisha. Les Etats-Unis qui avaient misé sur le gouvernement Berisha pour faire de leur soutien à l'Albanie une tête de pont dans la région, estiment que Berisha et son parti ont dilapidé ce capital d'abord dans le scrutin contesté de mai 1996 et ensuite dans la faillite des sociétés d'épargne spéculatives soutenues par le gouvernement. Aujourd'hui, soucieux de hâter la réconciliation nationale, les Etats-Unis exercent une pression maximale sur le gouvernement de Berisha pour le contraindre à engager le dialogue avec l'opposition regroupée autour du Parti Socialiste.
Le 28 février, le gouvernement Meksi/Berisha décide de déloger les grévistes de la faim qui occupent l'université. Un groupe de policiers en civil, des membres du SHIK, s'apprête à investir les bâtiments. La réaction ne se fait pas attendre: de nombreux prolétaires se reconnaissent, malgré les revendications réformistes des étudiants, dans tous ceux qui sont réprimés par l'Etat, et prennent donc position pour agir face à la violence policière. En fait, la rumeur selon laquelle la police secrète s'apprêtait à évacuer par la force les grévistes de la faim a conduit plus d'un millier de personnes armées de couteaux et de fusils à se rassembler devant l'université. Le nombre de manifestants qui accourt ne cesse de croître et ce sont bientôt dix mille manifestants qui, de l'université, se rendent au siège du SHIK et l'attaquent à coups de pierre. Des affrontements à l'arme à feu ont lieu entre manifestants et membres du SHIK. Ceux-ci se retranchent dans leurs bâtiments. Loin de les abandonner derrière leurs murs, les manifestants repartent à l'assaut et y mettent le feu à l'aide de grenades. Trois membres du SHIK restent pris par les flammes et meurent brûlés vifs. D'autres qui essaient de s'enfuir se font lyncher. En tout il y a six morts parmi ces salauds du SHIK. C'est pas encore énorme quand on sait que c'est dans ces bâtiments que beaucoup de frères de classe ont disparu, torturés et assassinés par ces corps d'élite formés des meilleurs tortionnaires bourgeois. De notre côté malheureusement, il y a aussi trois morts parmi les manifestants et une trentaine de blessés.
Les manifestants, qui ont aussi eu vent de l'hésitation du gouvernement à déclarer l'état de siège à Vlorë, se dirigent vers une caserne de l'armée, enfoncent les portes et prennent toutes les armes qu'ils peuvent y trouver sans rencontrer la moindre résistance de la part des officiers et des soldats encasernés. Une mitrailleuse lourde est installée devant l'université. Les affrontements continuent toute la nuit du 28 février et se prolongent jusqu'au 1er mars.
Ces combats marquent la fin d'une première période où les vagues de protestations et autres expressions prolétariennes sont encore trop prisonnières du fait d'attendre réparation de l'Etat et de l'illusion que l'Etat autrement gouverné pourrait être plus juste, équitable,... et le début d'un soulèvement insurrectionnel où le prolétariat n'attend plus rien du gouvernement et lui mène la guerre ouverte, reprenant le chemin de l'action directe contre l'Etat, de l'affirmation classe contre classe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas toute une série d'idéologies, de pièges, de perspectives bourgeoises (ce qui dans une période internationale comme celle-ci est inévitable) y compris dans cette période cruciale où l'ennemi se structure pour récupérer et diriger un mouvement qui lui échappe.
La poudre était déjà sur toutes les routes, dans toutes les villes, qui ne demandait qu'à être mise à feu. L'étincelle jaillie de Vlorë a propagé l'explosion à toute allure dans le sud du pays.
A Vlorë, Sarandë et Delvinë la situation est déclarée "hors de contrôle". Dini, ministre des affaires étrangères italien déclare que la révolte est dirigée par "des bandes de délinquants excités par des extrémistes de gauche [qui ont comme objectif d'] attaquer Tirana."
A Lushnjë, des manifestants interceptent deux fourgonnettes bourrées de policiers anti-émeutes et obligent ceux-ci à abandonner celles-là. Une quarantaine de flics sont ainsi désarmés.
A Tirana, toujours le 1er mars, le Parlement est convoqué en session extraordinaire afin de débattre des mesures à prendre pour mâter la révolte de Vlorë. Le soir même, Berisha annonce la démission du gouvernement Meksi. Décision qui n'aura aucun impact sur le mouvement!
Tandis que le Forum pour la Démocratie dénonce une "tentative du président Berisha et du Parti Démocratique de tromper encore une fois le peuple albanais afin de garder le pouvoir qui s'appuie sur le vol des voix électorales, sur un système financier spéculatif, sur la violence et la terreur" et appelle à se mobiliser pour de nouvelles "élections libres", le prolétariat, lui, répond par la réelle critique pratique des perspectives électorales: l'armement généralisé de la lutte contre l'Etat!
Dimanche 2 mars, en réponse à la démission du gouvernement, la résidence de fonction du président Berisha, installée sur les hauteurs de la ville de Vlorë, est pillée puis incendiée!
Près du port de Vlorë, dix mille insurgés cernent la garnison de la base stratégique de Pacha Liman. Les soldats abandonnent leurs positions. Resté seul, le commandant ouvre les portes aux insurgés. Il deviendra organisateur de la défense de Vlorë face à une possible intervention des troupes toujours à la solde de Berisha.
Lorsque les insurgés prennent d'assaut une caserne, ils marchent sur les baraquements, non pour attaquer les soldats mais pour obtenir les armes. Nulle part, les conscrits encasernés ne s'opposent aux pillages. Au contraire, partout les soldats et même la plupart des officiers accueillent les insurgés avec sympathie. Plus encore, il y a fraternisation: les prolétaires sous l'uniforme se reconnaissent dans la lutte de leurs frères de classe insurgés et rejoignent le mouvement avec armes et bagages.
Le gouvernement avouera vite ne plus pouvoir compter sur son armée.
A Sarandë (300 km au sud de Tirana), environ trois mille manifestants brandissant des bâtons déboulent dans les rues sans rencontrer aucun barrage. Impressionnée par la détermination des manifestants, la police disparaît subrepticement des lieux. Les prolétaires pillent et incendient le commissariat (vide) et les voitures de police abandonnées. Le même sort est réservé aux bâtiments du SHIK. Quatre cents fusils d'assaut Kalachnikov tombent ainsi aux mains des insurgés qui, continuant leur parcours, attaquent le tribunal, le parquet, prennent d'assaut la prison et libèrent une centaine de prisonniers. Ensuite, les prolétaires insurgés se donnent un nouvel objectif: l'attaque de la succursale de banque, cet antre du capital où tout leur fric a été englouti, abandonnant ainsi leurs illusions quant à obtenir de l'Etat réparation. Tout le centre ville est en flamme. A aucun moment, la police n'a essayé d'intervenir.
A Himaren (ville côtière entre Vlorë et Sarandë), les émeutiers ont mis le feu à la maison communale et au commissariat.
A Delvinë (entre Sarandë et Gjirokaster), les émeutiers ont incendié la préfecture de police, le parquet de Justice et, là aussi, ils ont pillé une succursale de la banque d'épargne.
A Levan (village situé entre Vlorë et Fieri), un groupe de manifestants entre dans une caserne et pille des dépôts d'armes. Il ne rencontre aucune résistance.
A Gjirokaster, déjà en grève générale illimitée depuis plusieurs jours, les émeutiers envahissent le commissariat, se servent en armes, libèrent les quinze détenus qui s'y trouvent puis incendient le bâtiment. Les policiers n'ont pas opposé de résistance. Le lendemain, un complexe commercial appartenant à la société d'épargne Gjallica est incendié.
Des barrages routiers sont érigés par les insurgés sur les routes de Vlorë-Sarandë, et à Tepelenë.
A Tirana, une nouvelle manifestation de six mille personnes est marquée par des affrontements violents au cours desquels des cameramen d'Italie et d'Allemagne sont roués de coups. La télévision est identifiée pour ce qu'elle est: une police au service de l'Etat, police par l'image sélectionnée nous imposant ce qu'il faut penser des événements, police de l'image procurant aux flics les photographies des manifestants les plus engagés dans les affrontements. Les manifestants en viennent aussi à prendre d'assaut les voitures de police, les retournent et y mettent le feu. Les forces de police se retirent.
Face à cette situation, la bourgeoisie impose des mesures exceptionnelles: elle décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire albanais, pour une durée indéterminée et "jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel et public". Ce qui veut dire couvre-feu à 20 heure, contrôles policiers avec droit de tirer sans sommation, interdiction de tout rassemblement de plus de quatre personnes et droit d'ouvrir le feu pour disperser les foules. Légitimation que les polices anti-émeute ou secrète n'avaient pas attendue pour tirer dans le tas!
"Vous êtes terrorisés, parce que nous voulons faire disparaître la propriété privée. Mais dans la société telle qu'elle est, mais dans votre société, la propriété privée est supprimée pour neuf hommes sur dix; si votre propriété existe, c'est précisément que, pour ces neuf dixièmes, elle n'existe pas. Vous nous reprochez donc de vouloir abolir une propriété qui suppose nécessairement la dépossession totale de l'immense majorité.En un mot, vous nous reprochez de vouloir abolir votre propriété à vous. En vérité, c'est bien ce que nous voulons."
-K.Marx, Manifeste du Parti Communiste, 1848, Ed. La Pléiade, Eco.I, p.177-
A Tirana, Berisha veille à éliminer toute situation qui rassemble du monde et pourrait "dégénérer": les marchés, les rallyes, les manifestations sportives,... Il fait jeter en prison des centaines d'"agitateurs potentiels".
Lundi 3 mars, en dépit de tout, alors que tout le sud du pays a pris les armes contre l'Etat, le Parlement reconduit pour cinq ans le mandat présidentiel de Berisha. Loin de réaliser l'ampleur du mouvement, Berisha décide de rétablir l'ordre par la force et loin des caméras.
Il censure les ondes et la presse. En dehors des canaux officiels, les chaînes de télévision, les radiodiffusions, les journaux sont interdits. L'immeuble du journal Koha Jone, le journal le plus important de l'opposition, est incendié à l'aide de cocktails molotov par des membres de la police secrète. Une vingtaine de personnes sont arrêtées. La censure ne laisse paraître qu'un seul quotidien (pro-gouvernemental) Rijlinda Demokratika qui consacre toutes ses colonnes à la réélection à la tête de l'Etat de Sali Berisha.
Berisha ordonne l'encerclement militaire de la zone de Vlorë à Sarandë. Mais l'armée albanaise n'est, à ce jour, pas fiable. Les prolétaires appelés sous les drapeaux ne sont pas prêts à tourner leurs armes contre les prolétaires en lutte contre l'Etat. Dans le sud du pays, le mouvement de désertion et de fraternisation est général.
Pour le gouvernement il s'agit d'abord de "liquider la révolte communiste", ce n'est qu'après qu'on pourra discuter, comme le déclare Tritan Shehu, ministre des affaires étrangères et chef du Parti Démocratique. Pour resserrer la discipline au sein de l'armée, Berisha limoge le chef de l'Etat-Major de l'armée l'accusant de ne pas avoir fait suffisamment preuve de zèle pour mâter la rébellion et d'avoir failli à la sécurité des postes militaires, casernes et dépôts d'armes en laissant les insurgés les envahir et se servir en armes. Il le remplace par un conseiller militaire membre du SHIK. Le gouvernement rappelle aussi aux militaires qu'ils encourent des sanctions pénales s'ils refusent d'obéir aux ordres.
Un engagement direct de l'armée contre les insurgés risquant d'étendre le mouvement de désertion et de fraternisation au nord du pays, les blindés envoyés dans le sud sont finalement conduits non par des soldats mais par des membres du SHIK. Et derrière les soldats chargés de pointer l'artillerie vers les bastions du mouvement insurrectionnel, se tiennent les unités de surveillance, police militaire, services secrets,... Tout est planifié pour empêcher les soldats d'abandonner leurs postes ou de retourner leurs armes contre leurs officiers.
Berisha somme les insurgés de rendre les armes et rappelle à ceux qui ne veulent pas déposer les armes qu'ils s'exposent aux tirs sans sommation.
Jusqu'à Fier, une centaine de kilomètres au sud de Tirana, l'armée reprend le contrôle de la situation. Berisha décide aussi l'isolement du sud du pays en coupant toute communication que ce soit par téléphone, satellite, etc.
A Tirana, depuis la proclamation de l'état d'urgence, des queues se forment devant les boulangeries. Les prix ont augmenté de 30 à 40 %.
A Vlorë, d'un côté, les derniers "ressortissants étrangers" et journalistes sont évacués par des hélicoptères de l'armée italienne, les corps de police anti-émeute et de l'armée se sont repliés, seuls des hommes de la police secrète habillés en civil restent sur place. De l'autre, quatre personnes sont exécutées alors qu'elles s'apprêtent à rendre les armes à la demande du gouvernement.
Mardi 4 mars, Sali Berisha refuse une nouvelle fois les propositions d'élargir le gouvernement à l'opposition, malgré les pressions internationales, accusant toujours le Parti Socialiste de fomenter la "rébellion armée".
Le gouvernement américain s'inquiètent de la tournure des événements. Autant il comprenait que laisser courir les arnaques financières brides abattues puis affronter le prolétariat de plein fouet ne pouvait que mener la situation en Albanie dans des eaux dangereuses, autant il comprend que débarquer avec les forces de l'OTAN en Albanie pourrait provoquer l'extension des troubles à ce que la bourgeoisie mondiale appelle la "poudrière des Balkans" dont elle redoute tant l'explosion.
De leur côté, à la déclaration de guerre de Berisha, les prolétaires répondent par l'armement généralisé!
A Vlorë, les armureries de plusieurs casernes sont dévalisées. Les insurgés se préparent à recevoir l'armée: des tireurs prennent position sur les toits des maisons, des barricades sont dressées à l'entrée de la ville avec des carcasses de voitures, des guetteurs prennent position sur des collines voisines pour surveiller les abords de la ville. Un pont est miné. A quelques centaines de mètres au-delà du pont, des blindés apparaissent. Quelques minutes plus tard, sans engager de combats, ils font demi-tour et s'en vont.
A Styari (10 km de Sarandë), l'armée doit faire face à une farouche résistance. L'offensive militaire est repoussée au bout de quarante minutes. Après ce premier engagement, l'armée se retire.
A Sarandë aussi, loin de penser à rendre les armes, la question qui se pose est: où prendre les armes pour se protéger? Les insurgés décident d'aller voir du côté des bâtiments de la police et de la marine militaire. Et c'est réellement toute la ville qui y va: les enfants, les femmes, les hommes. Les commissariats sont déjà abandonnés tandis que dans la marine, il ne reste que quelques officiers que les soldats déjà ralliés au mouvement ont renvoyés chez eux. Les insurgés s'emparent d'une batterie d'artillerie, de canons et de mitrailleuses lourdes pouvant contrôler la région dans un rayon de 30 km ainsi que de six navires de guerre. De la base navale, ils ramènent quantité d'armes et de sacs bourrés de munitions. De dix mille à quinze mille hommes en armes se réunissent au centre ville pour organiser les barricades, leur surveillance et une défense en cas d'attaque. Des groupes de jeunes armés de kalachnikovs et de pistolets mitrailleurs s'en prennent à des journalistes turcs, grecs et français et exigent que les cassettes d'enregistrement soient détruites.
L'armée attaque: des unités de l'armée tentent de prendre le port à revers mais les insurgés armés les attendent de pied ferme. Malgré l'envoi des blindés, la base navale de Sarandë reste aux mains des insurgés.
Pour prévenir toute nouvelle arrivée des blindés de l'armée, toutes les routes vers le nord sont coupées. A un barrage, un membre de la police secrète repéré à bord d'une voiture banalisée est brûlé vif, deux autres parviennent à s'enfuir, le quatrième est pris en otage.
Sur la route qui conduit à Sarandë, cinquante soldats de l'armée régulière passent du côté de l'insurrection avec trois blindés.
A Delvinë, des unités de l'armée tirent sur les insurgés à partir de Mig-15, faisant des dizaines de morts. Deux des pilotes qui refusent de tirer sur la population s'enfuient à bord d'un MIG-15 et demandent l'asile politique en Italie. La décomposition de l'armée par la lutte est telle que même les officiers se refusent à tirer contre les "civils". Berisha croit pouvoir compter sur une réelle force mais il doit bien vite se rendre compte que malgré ses remaniements, l'armée n'est pas prête à faire front contre les insurgés.
Face au triomphe militaire de l'insurrection, la bourgeoisie réorganise et fortifie sa réponse politique. Ainsi à Sarandë, se constituent un Conseil Communal Autonome dirigé par des responsables des partis de l'opposition bourgeoise et un Conseil de Défense dirigé par un colonel à la retraite. Ces Conseils formulent des conditions à la remise des armes: des élections anticipées, la démission du président Berisha et la formation d'un gouvernement de technocrates pour assurer la transition. Une des premières mesures que prennent ces Conseils est d'organiser des équipes "d'autodéfense contre les pillards" et de "protection des biens"! Ces politicards magouilleurs sont par ailleurs en contact direct avec Berisha auprès de qui ils insistent pour que l'armée qui encercle Sarandë s'abstienne d'intervenir parce qu'ils savent que, dans ce cas, ils ne contrôleraient plus rien. C'est l'ensemble des fractions bourgeoises qui cherchent le moyen de liquider/contrôler le mouvement; la fraction la plus apte améliorera sa position dans le rapport de force face aux autres fractions. Ainsi, au nom du combat pour la démocratie, le chef du Conseil de Défense de la ville ordonne que les insurgés ne portent plus de masques (ce qui correspond à la nécessité policière d'identifier les têtes du mouvement)! Et chaque journée commence par la diffusion de l'hymne national albanais.
Il est clair que dans ces Conseils, ce n'est pas le prolétariat qui s'exprime. La remise des armes en échange d'un nouveau gouvernement, le respect de la propriété privée, le salut au drapeau,... c'est, sans conteste, le programme de la bourgeoisie. Ces Conseils représentent une nouvelle tentative des partis de l'opposition bourgeoise de reprendre le contrôle du mouvement et lui donner une direction. C'est la contre-révolution qui, au sein même du mouvement, se réorganise et de manière bien plus pernicieuse que celle qui, en face, pointe ses canons sur les villes insurgées.
Car s'il ne fait pas de doute pour les prolétaires insurgés que l'armée qui leur fait face est un ennemi à abattre (en le désarmant, en fraternisant avec les soldats, en le démoralisant, en poussant à sa décomposition,...), les bourgeois qui se retrouvent à leurs côtés, eux aussi les armes à la main, à lutter contre un "ennemi commun" ne sont pas reconnus comme étant l'autre face du même ennemi à abattre. Et pourtant, les partis de l'opposition affûtent leurs armes autant contre le gouvernement Berisha que contre le prolétariat. L'opposition bourgeoise, qui prend également les armes contre le gouvernement mais pour les diriger principalement contre le prolétariat, utilise les consignes de l'ordre, de la lutte contre le chaos, de la désorganisation économique pour se présenter comme la seule alternative valable, c'est-à-dire l'unique alternative qui pourra nourrir les prolétaires.
Mais malgré ces sabotages, le mercredi 5 mars marque une nouvelle extension de l'insurrection. Le mouvement insurrectionnel s'étend à Memaliaj et Tepelenë, où les prolétaires descendus dans la rue, incendient le commissariat et pillent les magasins. Les carcasses calcinées des camions viennent à point pour construire des barricades. Les insurgés s'emparent des armes lourdes de la brigade d'artillerie de l'armée. Mortiers, canons, batterie anti-aérienne, missile sol-air tout cela passe aux mains des insurgés qui les installent sur les hauteurs de la ville.
A Gramsh (15 km de Gjirokaster), pour bloquer l'avance des blindés, les insurgés dynamitent un petit pont après l'avoir pris aux soldats qui le contrôlaient.
Dans le nord, moins touché par le mouvement, le gouvernement distribue cinq mille armes aux membres du Parti Démocratique pour affronter les insurgés. A l'entrée et à la sortie de chaque ville, de solides barrages sont érigés pour contrôler tous les mouvements.
Le jeudi 6 mars et les jours suivants, le soulèvement atteint toujours plus de villes et de villages.
Pour lutter contre la passivité de l'armée, Berisha a annoncé l'arrestation de quatre officiers accusés de n'avoir pas défendu leurs casernes contre les pillages. Le gouvernement a également réclamé l'extradition des deux pilotes albanais qui se sont enfuis en Italie à bord du MIG-15. Ils sont inculpés de désertion.
Mais Berisha est obligé de se rendre compte qu'il ne sert à rien de continuer à donner des ordres si ceux-ci ne sont pas suivis. Il ne ferait qu'achever de ridiculiser l'impact des forces armées. Le défaitisme se propagerait encore plus largement.
Finalement, pour faire baisser la tension, tant du côté des insurgés que de ce qui reste de son armée, il suspend pour 48 heures (jusqu'au dimanche 9 mars à 6 heure du matin) les opérations militaires engagées dans le sud et promet d'amnistier ceux qui rendront les armes volées à l'armée... s'ils n'ont commis aucun délit! Ce qui réserve le droit à l'Etat de condamner tous ceux qui ont pris les armes!
D'autre part, lui qui refusait jusque là toute collaboration avec l'opposition, est obligé, sous la pression de délégations européennes et d'une mission diplomatique grecque, des avertissements du gouvernement américain... et des événements, d'accepter une première rencontre. Il s'agit d'un véritable appel de la bourgeoisie mondiale à rétablir l'unité nationale contre le prolétariat! Face au danger prolétarien, les partis bourgeois concurrents, le Parti Démocratique et les partis d'opposition sentent la nécessité d'allier leurs forces et c'est conjointement qu'ils appellent au calme.
Pour toute réponse, les insurgés renforcent leurs positions. Le délai pour rendre les armes, la promesse d'amnistie, les appels au calme, tout est rejeté unanimement.
Vlorë, Sarandë, Delvinë, Gjirokaster et Tepelenë restent aux mains des insurgés. En prévision de nouvelles attaques de l'armée, les insurgés ont renforcé leur dispositif de défense, dressé des barrages et des points de contrôle pour retarder l'avancée des forces armées.
A Sarandë, les blindés pris aux forces armées ont été déployés aux entrées de la ville.
Le mouvement s'étend encore à Himaren et Samilia...
Il est important de souligner ici que c'est le prolétariat, par sa volonté, par sa détermination à lutter coûte que coûte, qui a défait l'armée. C'est la combativité prolétarienne qui a semé le défaitisme dans les rangs de l'armée et qui a mis en échec les mouvements des troupes fidèles au poste. Dans les rangs du prolétariat, c'est la fête, l'euphorie, leur détermination a payé, ils ont remporté une véritable victoire.
Les prolétaires ont tout perdu d'avoir fait confiance dans les promesses de changement et aujourd'hui ce n'est pas avec quelques menaces (à la place des promesses), qu'ils vont abandonner les armes. D'autant plus qu'ils savent que rendre les armes aujourd'hui, c'est laisser le SHIK reprendre en mains la répression, qui ne peut être que terrible!
Le prolétariat est à ce moment-là en position de force, il est armé jusqu'aux dents, déterminé à ne pas se laisser faire. Mais c'est aussi maintenant que se pose la question cruciale de déterminer avec plus de clarté quelle direction donner aux futurs affrontements.
Que faire de cette force? Quelle extension et quels objectifs donner à la lutte? Contre qui diriger toutes ces armes? Contre les seules forces gouvernementales? Que faire de ce pouvoir qu'il détient entre ses mains? Il contrôle des villes entières, les routes qui y mènent,... La pénurie s'installe, il faut organiser l'approvisionnement. Sur quels critères? Ceux du Conseil Communal Autonome de Sarandë qui remettent en avant la défense de la propriété privée? Quelle direction donner à tout cela?
Et il semble bien qu'à toutes ces questions, le prolétariat n'ait pas pu répondre. Cette direction à donner à la lutte, il l'a laissée aux mains de l'opposition bourgeoise qui, de son côté, n'a pas attendu qu'il se décide pour la lui confisquer. Au contraire, la contre-révolution a profité de ce moment d'indécision pour reprendre le dessus.
Un journaliste s'étonne du silence de ses confrères:Révolution
"Elle est longue la liste des mots utilisés pour définir ce qui se passe ('les événements') en Albanie: et on se refuse à utiliser le mot révolution. On nous avait assuré qu'en Europe, il n'y aurait plus jamais de révolution: et en voici une. Les 'insurgés', 'ceux qui se sont soulevés', qui produisent le 'chaos' ou l'anarchie... sont des 'rebelles', des 'mutins'. Et ils pillent.Mais pas une radio, pas une télévision, pas un journal n'a utilisé le mot 'révolution'. Ça ne convient pas. Et c'est un événement face auquel l'éditorialiste européen reste perplexe; surtout l'espagnol, drogué par la question basque..., comme le gouvernement, les politiciens, les penseurs qui arrêtent fréquemment de penser...
'Révolution', défini maintenant par Miguel Artola (un cours du Collège Libre des Emérites), 'est une action violente qui donne lieu à un changement de régime et à une nouvelle société. La violence est inévitable et il n'est pas facile de prévoir ou d'appliquer celle qui sera suffisante et d'éviter celle qui ne sera pas nécessaire pour conquérir le pouvoir'... Elle a commencé parce que s'est créée une banque démocratique pour voler les épargnes du peuple. Une autre a commencé lorsqu'une poignée de marins de la Mer Noire ont refusé de manger de la viande avariée. Mais c'est toujours pour autre chose. Les albanais ont vécu de nombreuses années sous l'oppression d'un régime communiste très particulier; la démocratie est arrivée d'Occident, et on leur a volé leurs épargnes. Ils ont un tas de bonnes raisons pour opposer le chaos à ces ordres!"
(Eduardo Haro Tecglen - Visto/oído El País 15/3/1997)
La contre-révolution nationale et internationale déploie ses Comités de Défense, de Salut Public, son aide humanitaire,... Si la révolution n'est pas capable de donner à manger, c'est la contre-révolution qui le fera. Partout il s'agit de substituer la véritable alternative révolution prolétarienne ou réorganisation capitaliste par celle de Salut National ou chaos généralisé. Ainsi on fait en sorte que tout le monde se soumette au "salut public", à la "sauvegarde de la nation", etc.
La tension extrême qui avait tenu en éveil et prêts au combat tous les prolétaires en armes fait place à un certain engourdissement... pendant que d'autres s'organisent!
Le même jour à Vlorë, un Comité de Salut Public, cartel de tous les partis de l'opposition bourgeoise, présidé par le chef local du Forum pour la Démocratie et un Comité de Défense formé d'ex-officiers jetés de l'armée lors de purges menées ces dernières années par Berisha, sont créés. Au cours de leur première conférence de presse, les représentants du CSP trônent sous un grand drapeau albanais. De même qu'à Sarandë, ils posent des conditions à la reddition des armes: élections anticipées et formation d'un gouvernement de technocrates pour assurer la transition, retrait de l'armée des collines qui entourent la ville. C'est à nouveau tout le programme de l'opposition bourgeoise qui est affirmé. Ainsi que le montrent encore les mesures prises par la suite. Le 10 mars, le CSP lance un appel "à tous les policiers honnêtes" à se présenter à lui pour l'aider "à rétablir le calme et la paix". Le 11 mars, dans une déclaration signée avec l'ambassadeur d'Italie à Tirana, le CSP s'engage "à favoriser la remise immédiate des armes en possession des habitants" et "à assurer l'ordre public et le retour progressif à la normalité administrative" de la ville.
Comme à Sarandë, ces Comités/Conseils se portent garants du désarmement du prolétariat, du retour à l'ordre bourgeois, à la paix... du capital. Ils entendent défendre le monopole d'Etat des armes, le respect de la propriété privée des nantis et l'organisation du marchandage de la force de travail (viande sur pied!) des prolétaires.
La paix, pour eux, signifie désarmer le prolétariat pour revenir à la paix sociale. Paix qui n'est pas une paix. Il s'agit, pour l'Etat bourgeois, de s'assurer du monopole des armes pour que, dans la guerre perpétuelle qu'il livre au prolétariat, celui-ci soit dépossédé de toute réponse, pour que le prolétariat ne puisse pas armer sa colère. Leur paix, c'est mener leur guerre en paix, contre un ennemi sans défense. Des prolétaires muselés, pieds et poings liés, voilà le programme de nos bourgeois.
Même la revendication du remboursement intégral de leurs économies perdues dans les opérations pyramidales ne vient plus qu'en second plan.
Cette revendication a, aux moments les plus forts du mouvement, subi la transformation révolutionnaire d'une demande d'intervention de l'Etat en une critique pratique de l'économie bourgeoise: le prolétariat en armes se réappropriant l'argent planqué dans les banques.
Tandis que, partant de la même revendication, la contre-révolution opère souvent selon ce schéma: délaisser les revendications dites économiques: salaires, prix des denrées, ici les épargnes,... pour passer à ce qu'elle qualifie de niveau supérieur: des revendications dites politiques qui reviennent toutes à revendiquer la chute du gouvernement en place au nom d'un manque de démocratie. Comme en Pologne où Lech Walesa encore à la tête du comité des grévistes à Gdansk (1980), disait: "Il vaut mieux avoir des droits que l'assiette pleine." Et la lutte qui partait d'un point de vue prolétarien, contre l'augmentation du prix de la viande c'est-à-dire contre l'augmentation du taux d'exploitation a été déviée en une lutte pour des réformes démocratiques et enfin pour un nouveau gouvernement (9). En Albanie aussi, la revendication du remboursement intégral de l'argent placé dans les sociétés d'épargne dont la perte a constitué pour la plupart des prolétaires une brutale aggravation des conditions de vie, est laissée de côté pour mettre l'accent sur la revendication d'élections anticipées et la démission de Berisha.
Au travers de ce passage d'une revendication dite économique à une revendication dite politique, la contre-révolution organise l'abandon du terrain de classe au profit du terrain de la réforme bourgeoise.
Plus tard, une fois le changement de gouvernement opéré et face au fait que l'Etat ne remboursera pas les prolétaires (!), le discours fera porter toute la responsabilité à l'ancien gouvernement l'accusant d'avoir mené si mal les affaires qu'il est difficile de redresser le cours des choses, que les conditions sont difficiles, qu'il faut du temps et surtout que tout le monde doit s'y mettre pour remettre l'économie à flot. Ce qui, pour les prolétaires, signifie encore plus se serrer la ceinture,... toujours au nom d'un avenir meilleur. Et tant que les prolétaires se laisseront berner par des promesses de ce genre, il en sera ainsi!
Vendredi le 7 mars, les insurgés du sud refusent toujours de rendre les armes. Au contraire même, les arsenaux continuent à être pillés.
L'Union Européenne appelle le président Berisha à différer le plus longtemps possible une intervention armée et à convoquer des élections anticipées. Mais, malgré ces pressions et le premier pas pour organiser conjointement la "reddition des rebelles" avec les partis de l'opposition, Berisha refuse toujours d'envisager des élections.
A Tepelenë, un Comité de Salut Public semblable aux autres est créé.
Samedi le 8 mars, à Gjirokaster l'insurrection gagne du terrain: durant la trêve de 48 heures que le gouvernement a lui-même décrétée, six hélicoptères gouvernementaux se posent à l'aéroport de la ville d'où débarquent soixante cinq agents des services spéciaux de Tirana. Un groupe d'insurgés essaye d'empêcher l'atterrissage tandis que hommes, femmes et enfants se dirigent vers des casernes pour s'emparer des armes. Ils mettent la main sur d'impressionnantes réserves d'armes et de munitions avec l'approbation de quelques deux mille soldats tout heureux de déserter et de rejoindre les rangs des insurgés. Quantité de fusils, revolvers, lance-grenades, bazookas, pistolets mitrailleurs, grenades, munitions, mines et sept chars d'assaut tombent aux mains des insurgés. Le bureau de la douane est également attaqué.
Du côté des forces gouvernementales, c'est le sauve-qui-peut. Trois hélicoptères sont pris par les insurgés. Les autres arrivent à redécoller avec seul le pilote à bord. Les troupes débarquées, privées de leurs arrières, fuient vers la montagne. Les insurgés les poursuivent avec trois blindés. Leur fuite durera plusieurs jours à travers les montagnes pour regagner le nord, évitant les barrages, villages et autres places fortes défendues par les insurgés. C'est un berger qui les informera sur l'effondrement de l'armée et des structures officielles.
A chaque carrefour de Gjirokaster, des barrages se dressent. Toutes les voies d'accès à la ville sont bientôt barrées. Les insurgés prennent possession de la radio locale. Les bâtiments des douanes sont pillés puis incendiés. Les insurgés prennent aussi possession du poste de frontière avec la Grèce. Douaniers, fonctionnaires et policiers se rallient au mouvement. Ce qui permet aux insurgés d'aller se ravitailler en Grèce.
Avec Vlorë, Tepelenë, Himaren, Memaliaj, Delvinë, Sarandë et Gjirokaster, les villes les plus importantes du sud sont désormais aux mains des insurgés. Le triomphe de l'insurrection à Gjirokaster signifie la perte pour le gouvernement de la plus importante clé stratégique et militaire de la région. Des journalistes commentent ainsi la situation: "c'est l'anarchie totale, il n'y a plus de police, plus d'Etat."
"L'armée n'interviendra jamais contre les civils. Elle n'existe plus", commente un ancien ministre de la défense, M. Perikli Teta.
Quelques heures plus tard à Gjirokaster, vers midi, se forme un Comité de Salut Public et un Comité de Défense de la ville présidé par le général Gozhita, destitué par Berisha 18 mois plus tôt, qui appellent à remettre les armes volées et ordonnent que "les commerces ouvrent leurs portes" tout en déclarant que "ceux qui commettent des pillages seront punis".
Dimanche le 9 mars, la ville de Permët tombe aux mains de l'insurrection. Les insurgés se mobilisent contre les forces gouvernementales dépêchées la veille dans la région. Les affrontements font cinq morts et bien d'autres blessés du côté des insurgés. Une brigade entière de soldats passe du côté des insurgés. Une fois l'attaque repoussée, les insurgés attaquent, pillent et détruisent le commissariat, le tribunal, l'hôtel de ville, deux banques et plusieurs magasins. Des barricades sont érigées aux entrées de la ville, notamment en direction de Korça où se sont retirées les forces gouvernementales.
Le mouvement insurrectionnel gagne seize autres villages de la région de Permët.
A Permët aussi, un Comité de Salut Public, cartel représentant tous les partis d'opposition et le Parti Démocratique (préfigurant l'accord qui va suivre) est constitué.
L'extension du mouvement insurrectionnel, et surtout la chute de Gjirokaster (base militaire indispensable à toute intervention militaire du gouvernement), achève de convaincre Berisha. C'est sans doute cet élément nouveau faisant dangereusement basculer le rapport de forces qui a décidé le président à conclure un accord avec le Parti Socialiste, principal parti de l'opposition bourgeoise. L'accord prévoit l'instauration d'un gouvernement de "réconciliation nationale", la planification de nouvelles élections législatives d'ici le mois de juin et l'élargissement de la promesse d'amnistie à tous ceux qui, civils ou militaires, ont participé au mouvement insurrectionnel. Les deux partis relancent l'appel à rendre les armes et fixent cette fois le délai à une semaine.
Les Comités de Salut Public et Comités de Défense (où siègent tous les partis y compris des représentants locaux du Parti Démocratique) et où le Parti Socialiste joue un rôle clé, saluent l'accord.
Le Parti Socialiste jure que dans trois jours il aura dissout tous les comités surgis du mouvement...
A Sarandë et Vlorë, les insurgés vont exprimer leur premier désaveu de la politique des Conseils/Comités de Salut Public. A Sarandë, approuvant les accords pris avec Berisha, le président du Conseil déclare: "Lorsque le président nommera le gouvernement et que la date des élections aura été fixée, il faudra déposer les armes." Pour la première fois, il n'est pas applaudi et la foule se disperse en silence. Les jours suivants, ce sont les rassemblements quotidiens sur la place publique qui reprendront leur rôle d'organe de décision.
A Vlorë, la manifestation quotidienne se déroule cette fois sans drapeau ni banderole ni chef de l'opposition et débouche sur des pillages et incendies de magasins. Plusieurs personnes soupçonnées d'appartenir à la police secrète sont arrêtées. Une liste de personnes à éliminer en échange d'une certaine somme a été découverte sur l'une d'elle.
Le même jour, dans le nord, le prolétariat commence à prendre les armes: il exproprie un des plus grand dépôt d'armes du nord de l'Albanie à Shkoder. A Peshkopia, Lezha-Kuksi et Lacy, face à la généralisation des expropriations, l'armée se replie dans le désordre.
Lundi le 10 mars, il apparaît que le pari du Parti Socialiste de tout reprendre en mains en trois jours semble bien compromis. D'autant plus que le mouvement s'étend encore à Skrapari, Malakastra, Kelcyra, Berat, Poliçan, Kuçova, Gramsh.
A Berat, les insurgés dévalisent trois caisses d'épargne et pillent plusieurs magasins, des réserves alimentaires de l'Etat et les armureries de trois casernes. La garnison et les forces de police abandonnent la ville sans tirer et les insurgés se partagent les armes des commissariats et des casernes. Un Comité de Salut Public s'est constitué avec pour première intention d'organiser la remise des armes! Il exige aussi la démission de Berisha. Il est évident que chaque fois que la bourgeoisie réussit à imposer cette revendication, elle ne fait qu'utiliser les faiblesses du mouvement prolétarien et prépare ainsi son désarmement en échange de la démission de Berisha et de la planification de nouvelles élections.
A Gramsh (à 60 km au sud de Tirana) où est installée une importante usine d'armement, les insurgés se sont emparés de trois casernes et ont incendié le commissariat. Les insurgés remontent vers Fier, ville située au nord de la zone tenue par les insurgés. Ils prennent le contrôle de plusieurs routes aux alentours et font reculer les forces de l'ordre qui retirent une partie de leurs barrages dans cette région.
A Skrapari, les insurgés ont dévalisé des armureries de l'armée, attaqué l'aéroport militaire de Kuçova et pris le contrôle de Poliçan (entre Skrapari et Berat) où est installée une usine d'armement et de munitions. Les affrontements ont fait quatorze blessés.
Face au fait qu'il ne peut plus compter sur l'armée, Berisha arme ses partisans: à Bajram-Curri et Kukes, deux petites villes du nord situées dans des montagnes d'accès difficile, des partisans de Berisha pillent d'importants dépôts d'armes.
Mardi 11 mars, les Comités de Salut Public de huit villes du Sud se rencontrent à Gjirokaster et créent un Front National de Salut du Peuple dont les exigences sont la démission de Berisha, un profond remaniement de la police secrète, le remboursement des épargnants spoliés et l'organisation d'élections parlementaires démocratiques, confirmant par là leur fonction de piéger le mouvement dans une alternative bourgeoise. Le président du CSP de Sarandë confirme: "Il ne sera pas question de rendre les armes tant que l'instauration de la démocratie ne sera pas garantie."
Du côté du gouvernement, un nouveau premier ministre, Bashkim Fino, est désigné pour former un gouvernement de "réconciliation nationale". Sa première démarche est de recruter des renforts pour la police et d'empêcher le soulèvement de Durrës où trois prolétaires ont été assassinés.
A ce jour, treize villes sont aux mains des insurgés: Poliçan, Kelsyra, Permet, Kuçova, Shrapar, Berat, Gjirokaster, Sarandë, Delvinë, Himaren, Tepelenë, Menaliaj, Vlorë.
Et Kruma, Burrel et Laçi, petites villes du Nord viennent s'ajouter à la liste.
Le mercredi 12 mars, la situation est tendue. Contre toute attente, le gouvernement de "réconciliation nationale" n'a pas l'impact souhaité sur le mouvement. Au contraire, les mesures qu'il prend pour réorganiser les polices durcissent les positions des insurgés dont le mouvement continue à gagner le nord.
A Elbasan, dernière étape avant Tirana (en venant du sud), la tension est extrême. Et tandis que l'armée et la police secrète se replient à 50 km au sud-est et à 70 km au sud-ouest de la capitale, les insurgés renforcent leurs positions et s'emparent des armureries laissées par l'armée. L'usine d'armement, de munitions et d'explosifs de Mjeksi (au sud d'Elbasan) est également pillée.
Après Elbasan, l'armée disparaît également de Fier, Cerrick (après un affrontement avec la police secrète) et Gramsh où les insurgés ont incendié le commissariat et pillé trois casernes.
Shkoder, la plus importante ville du nord est à son tour gagnée par le soulèvement. Les casernes assiégées sont abandonnées par les soldats. Les insurgés s'attaquent également aux prisons, ils en défoncent les portes et libèrent les détenus. Une succursale de banque est dynamitée, le tribunal saccagé. Les négoces sont éventrés et chirurgicalement vidés. Après avoir été mise à sac et à feu, la maison communale est aujourd'hui occupée par quelques familles. Des barricades sont faites d'immondices semi-brûlées, de carcasses de voiture, sur un tapis de verres brisés.
L'importante base aérienne de Gjader, près de Lehze, à 80 km au nord de Tirana, tombe également aux mains des insurgés.
Se repose alors pour la bourgeoisie internationale la nécessité d'éviter à tout prix la propagation du mouvement au-delà des frontières.
Face aux dangers d'extension du mouvement au nord du pays, limitrophe avec le Kosovo où la plupart des prolétaires sont d'origine albanaise (10), l'ex-Yougoslavie ferme ses deux principaux postes frontières avec l'Albanie.
Les gouvernements des USA, de la France et de l'Italie appellent leurs ressortissants à quitter l'Albanie. Moscou et Belgrade commencent à évacuer les membres et les familles de leur personnel diplomatique.
Des unités militaires dont un régiment de chars d'assaut se positionne le long du fleuve Shkumbin. Mais à Sauk, face à la caserne de la banlieue de Tirana, un officier instructeur portant l'insigne des blindés sur le col exprime que l'armée ne réagira pas en cas d'insurrection. "Nous ne pouvons pas tirer sur notre peuple." Ce sentiment est partagé par la quasi-totalité de l'institution. Les soldats et les officiers exprimeront ce sentiment à différentes reprises.
Le Parti Démocratique de Berisha continue d'armer ses partisans autour de Tirana, notamment à Kavaja, désormais la seule ville sous contrôle gouvernemental au sud de la capitale. Des camions amènent du nord albanais et de la province serbe du Kosovo des mercenaires généreusement rémunérés. Dans les villes du nord, les partisans de Berisha pillent aussi les arsenaux.
A Tirana, des membres de la police secrète ont pénétré dans l'académie militaire et dans trois autres dépôts d'armes des environs, dont celui de l'aéroport, et ils les ont dévalisés. Sept dépôts de la brigade de défense anti-aérienne sont dévalisés, l'un d'eux contenant 10.000 armes légères. Le SHIK distribue les fusils d'assaut à ses hommes de main et à des fidèles du Parti Démocratique.
Les bourgeois font des commentaires paniqués. "Un président qui a perdu toute autorité, un gouvernement de 'réconciliation nationale' qui n'a pas plus d'emprise sur les événements, une armée qui tourne les talons au premier coup de feu,... jamais dans l'histoire récente, un pays du vieux continent n'avait connu avec une telle rapidité la déliquescence en cascade de toutes ses institutions, de tous ses instruments chargés de faire respecter l'ordre public. Il s'agit d'un réel effondrement de l'Etat."
L'écrivain albanais Ismaïl Kadare (qui vit à Paris depuis 1990) réclame l'intervention d'une force tampon en Albanie. "Un arbitrage international est nécessaire quand tout un pays roule vers le précipice. Peu importent les formes et les procédures, tout est bon pour empêcher une tragédie d'une telle ampleur."
A sa suite, tous les partis bourgeois de l'Albanie lancent un appel conjoint en faveur d'une intervention armée des forces européennes "afin de ramener l'ordre constitutionnel". La décomposition de l'Etat est telle que la bourgeoisie est chaque fois plus favorable à l'intervention d'autres instances internationales pour rétablir l'ordre.
Le 13 mars à Tirana, après s'être retirée des régions du sud du pays où elle fut la seule à combattre les insurgés, la police secrète est omniprésente.
Un cortège de blindés et de Mercédes défile autour de la place centrale Skanderbeg. Les hommes du SHIK tirent des rafales d'armes automatiques et crient très fort pour montrer qu'ils redeviennent les maîtres du centre névralgique de Tirana. Des blindés sont déployés Boulevard des Martyrs et de la Nation où sont situés le palais présidentiel, le Parlement et autres bâtiments gouvernementaux.
La plupart des ministères et des administrations ont fermé, ainsi que les banques et les commerces. Les rues sont désertées. Les tirs d'armes automatiques sont incessants. Six personnes dont deux enfants ont été tués, la plupart victimes de balles perdues ou d'explosions accidentelles de mines ou de grenades. Les matons ont également abandonné les prisons, laissant s'évader quelques six cents détenus.
Malgré l'omniprésence du SHIK, Tirana n'échappe plus à la frénésie des pillages. De grandes masses de manifestants venus des faubourgs exproprient les dépôts d'aliments, entre autre un énorme entrepôt de farine situé dans la banlieue de Lapraka. D'autres manifestants pillent et exproprient l'Ecole de Police ainsi que la zone résidentielle de Tirana où se trouvent quelques ambassades, réussissant lors de cette incursion à s'approprier des kalachnikovs, des bombonnes de butane,... Les sentinelles du Quartier Général de la Garde Nationale (qui se trouvent seulement à 300 mètres de ces objectifs) ne bougent pas le petit doigt face à cette action. Les casernes sont pillées autant pour s'emparer des armes que des vivres qui y sont stockées, des meubles, des sanitaires, des chauffages,... Il ne reste des casernes qu'une carcasse désossée.
Dans le centre de Tirana, les cibles privilégiées des prolétaires sont les bâtiments publics et les entreprises où le travail est si détestable et tellement mal payé. Des chantiers, bâtiments, immeubles,... il ne reste rien. Jusqu'aux poutres des toits et tiges d'acier des armatures sont emportées. Il n'y a plus de meubles ni de machines, plus de tuiles ni de corniches, plus de devanture ni de portes, plus aucun éclairage, tous les fils électriques, interrupteurs, etc. ont été arrachés, plus de sanitaires ni de chauffage, jusqu'à la moindre tuyauterie a disparu, plus de vitres ni de pavements, il ne reste que des trouées à la place des fenêtres,...
Presque chaque personne possède désormais au moins une arme, kalachnikov ou autre.
"Il n'y a pas d'armée", commente un journaliste, "les soldats abandonnent les casernes et rentrent chez eux. La police dont nombre d'agents ont troqué l'uniforme pour des vêtements civils, se limitent pour le moment à la surveillance des prisons et des bâtiments officiels. Mais cela n'a pas empêché les fuites massives: dans trois pénitenciers les prisonniers ont réussi à s'évader et plus d'un millier de prisonniers savourent actuellement une liberté inespérée..."
Le préfet de Tirana lance un appel télévisé au calme au nom de tous les partis politiques. Mais en fin d'après-midi, Tirana semble sur le point de basculer dans la révolte.
Les employés fidèles au poste dans les ministères engouffrent ordinateurs, dossiers dans leurs véhicules aux plaques jaunes (gouvernementales). Soldats et policiers désertent leur poste et rentrent chez eux. Même les caïds du SHIK disparaissent de la scène.
A Tirana, au sein de la bourgeoisie, c'est la débandade.
Les ambassades diffusent un ordre d'évacuation générale. Une compagnie de Marines est déployée devant l'ambassade américaine. Un pont aérien a été mis en place entre les unités de la marine italienne patrouillant dans le Golfe de Tarente et le port de Durrës. Trois super-pumas de l'armée de l'air et deux couguars de l'armée de terre françaises, six hélicoptères de l'armée allemande issus de la force de stabilisation de l'OTAN en Bosnie, des hélicoptères Cobra de l'armée des USA,... et quinze navires militaires albanais et d'autres encore de la flotte grecque sont mis à l'oeuvre pour évacuer leurs "ressortissants étrangers" respectifs, protégés par des unités de para-commandos, marines,... A plusieurs reprises les opérations sont interrompues par des tirs de fusils, de canon anti-aérien, de lance-missile portable sol-air.
Au soir du mercredi 13 mars, la ville historique de Korça (sud-est du pays) est pillée. Les prolétaires se sont rendus à la caserne de Poceste où ils ont pris les armes et quatre blindés.
A Lezha, des prolétaires investissent le bâtiment de la police secrète (dont les membres ont disparu) et la banque d'Etat dont ils dynamitent le coffre-fort.
Les notables de la ville créent aussitôt un Comité de Sauvegarde de Lezha pour essayer de calmer le mouvement. Ils traversent la ville en voiture en lançant, à l'aide d'un mégaphone, des appels au calme qui se font couvrir par les fusillades.
"L'armée s'est effondrée, l'Etat a vacillé"... commente un journaliste avant de quitter Tirana.
En effet, si la lutte en Albanie marque, comme ce fut le cas en Irak (11), un moment de rupture avec la situation internationale de paix sociale, c'est précisément ce contexte de non-lutte internationale qui empêche le mouvement d'aller plus loin. La paix sociale internationale pèse d'un terrible poids sur l'extraordinaire mouvement du prolétariat en Albanie, tout comme elle a pesé hier sur l'insurrection prolétarienne en Irak: le prolétariat en Albanie a besoin d'étendre la lutte internationalement mais il ne trouve ni l'appui ni la compréhension nécessaire auprès du reste du prolétariat mondial qui, abruti par la campagne internationale de la bourgeoisie, ne se reconnaît pas dans la lutte de ses frères en Albanie, et imagine encore moins la force réelle des ruptures qui y ont eu lieu.
Ce manque de soutien international exigerait en Albanie une affirmation plus nette encore des perspectives révolutionnaires que le prolétariat y trace; mais si dans le cours des affrontements, le prolétariat a reconnu l'ensemble de ses ennemis, il lui est plus difficile d'affirmer maintenant les niveaux organisatifs capables de déjouer les cartes de rechange successives qu'abat la bourgeoisie pour reprendre le contrôle de la situation.
Quand le prolétariat prend d'assaut un ensemble de structures de l'Etat bourgeois, défait l'armée,... quand à la propriété privée, il oppose la réappropriation collective, pillant les banques, dépôts, magasins, chargements,... quand à la Justice qui consacre l'omnipotence du bourgeois, isole le prolétaire et le conduit criblé de droits, tout droit en prison, il oppose sa force collective de classe, incendiant commissariats, tribunaux et ouvrant les prisons,... quand aux protestations pacifiques organisées par l'opposition, il répond par l'armement généralisé... il affirme pratiquement, la nature spontanément révolutionnaire de sa lutte.
Mais pour donner force et continuité à ces affrontements, le prolétariat doit impérativement structurer des niveaux organisatifs qualitativement supérieurs capables d'impulser une direction plus claire et assumer ainsi une rupture bien définie d'avec les alternatives bourgeoises; dans le cas contraire, on rétrocède le terrain gagné. Et malheureusement, nous sommes obligés de constater que le prolétariat en Albanie n'a apparemment pas dégagé de regroupements, associations, organes,... qui lui soient propres, qui revendiquent ses actions de classe, qui expriment, par leur existence même, la nécessité de s'organiser en dehors et contre toute structure de l'Etat bourgeois, qui revendiquent clairement la destruction de l'Etat, la généralisation internationale de la lutte, l'affirmation du mouvement communiste,... (12) Au cours d'un processus révolutionnaire, on arrive toujours à un moment où un saut de qualité est indispensable dans la direction, dans l'internationalisme; si le prolétariat ne le donne pas, la bourgeoisie profite de ces circonstances pour se réorganiser.
Ainsi, une fois la colère explosée, l'armée défaite, Tirana en proie à la panique des bourgeois, se posait la question du que faire de cette position de force acquise au cours des affrontements. Ce qui se joue à ce moment, c'est la nécessité d'une définition et d'une délimitation beaucoup plus claire de nos ennemis. Sans cela, les oppositions que la bourgeoisie a créées pour donner une direction politique au conflit -oppositions qui ont habilement marché aux côtés du prolétariat dans ses affrontements à l'Etat-, tenteront et réussiront à le confiner dans une simple opposition au gouvernement de Berisha.
Quand le prolétariat fait la critique des perspectives électorales, en occupant les rues et en attaquant l'ensemble des structures de l'Etat, quand le prolétariat crie A bas Berisha! consigne qui de manière limitée et confuse exprime A bas l'Etat!, l'opposition transforme le tout en une revendication d'élections anticipées, solution prônée par la bourgeoisie mondiale pour nier la critique initiale de notre classe.
Le saut qualitatif excluant ce piège démocratique aurait consisté à traduire dans les mots d'ordre ou, autrement dit, à inscrire sur les drapeaux du mouvement, la stricte réalité de ce qui se faisait dans la rue! On aurait alors remplacé A bas Berisha! par des mots d'ordre reflétant le mouvement réel: A bas l'Etat, ses flics et ses politiciens au gouvernement comme dans l'opposition!, A bas le parlement!, A bas les élections!, Vive l'armement généralisé du prolétariat! Il ne s'agit bien sûr pas d'une question de mots. Il s'agit de rendre conscient ce qui se passe dans la réalité, d'assumer consciemment la direction révolutionnaire que prend naturellement la lutte du prolétariat (13), de brandir clairement le drapeau communiste. A travers l'histoire de notre classe, même dans les moments les plus forts de la lutte, il apparaît que ce que dit le prolétariat de sa propre lutte reste en-deça de sa pratique réelle. Ainsi en Albanie, le drapeau unificateur du mouvement est resté extrêmement pauvre puisqu'il n'a jamais véritablement dépassé la consigne conservatrice de A bas Berisha!, une consigne qui donnait toutes les armes à l'opposition socialiste pour récupérer le mouvement.
Garder la consigne "A bas Berisha!" signifiait accepter (ce que cherchait avidement l'opposition) qu'une fois ce dernier écarté, il n'y avait plus de raison de lutter. Et de fait, la démission de Berisha est devenue la condition pour rendre les armes.
Comme souvent dans tout mouvement de lutte, il apparaît une fois de plus que ce n'est pas la combativité qui manque mais la définition claire des objectifs de classe. Ici, une fois encore, ce n'est pas d'armes ou de courage (comme le croient en général les militaristes et guerrilleristes de tous types) dont les prolétaires ont manqué mais de la définition claire de ceux contre qui diriger leurs armes.
C'est là toute la limite actuelle de la rupture des prolétaires d'avec la contre-révolution. Et tandis qu'à ce point culminant, le prolétariat ne va pas donner de suite au mouvement, la bourgeoisie internationale quant à elle va battre le rappel pour organiser le soutien à l'Etat albanais dans sa lutte contre l'insurrection. D'un côté la bourgeoisie mondiale unifiée, et de l'autre -isolé- le prolétariat en Albanie; la bourgeoisie dispose d'une très longue expérience pour défaire le prolétariat pays par pays. Et le plus tragique, c'est qu'il continuera à en être ainsi tant que le prolétariat ne s'organisera pas en force internationale et ne se dotera pas d'une centralisation/direction révolutionnaire.
"Nous avons toutes les capacités militaires pour calmer le jeu et régler cette affaire. A condition de frapper vite et fort."
"L'Eurocorps compte cinquante mille hommes parfaitement opérationnels. Une force de quelque dix mille soldats, soit le cinquième à peine des effectifs, lourdement équipés, blindés compris, suffirait à reprendre la situation en main."
"Et pour contraindre les insurgés à rendre leurs kalachnikovs? Nous disposons de moyens de pression largement suffisants. Par exemple, établir une sorte de donnant-donnant: la restitution des armes volées contre la fourniture de nourriture."
(Le Soir - 15 mars 1997)
Voilà, bien résumé, ce qu'entendent les bourgeois par aide humanitaire: le désarmement du prolétariat par l'intimidation militaire et la menace de l'affamement!
Le 15 mars, Berisha lance un appel aux volontaires désireux de maintenir l'ordre dans la capitale pour qu'ils rejoignent l'armée ou la police albanaise en échange d'un salaire de quatre cents dollars, ce qui équivaut à quatre fois le salaire moyen. Le gouvernement promet également de tripler le salaire des policiers qui se représenteraient à leur poste. Plus d'un millier d'anciens officiers se présentent au ministère de la défense afin de panser les blessures de l'armée tandis que des milliers de jeunes rejoignent plutôt les rangs de la police. Pas besoin de montrer ses papiers pour être enrôlé! Des fusils et des munitions leur sont distribués.
Le 16 mars, l'Etat albanais reçoit l'appui de ses confrères italien et grec qui sont prêts à envoyer des experts pour conseiller la police et l'armée albanaises et les aider à rétablir l'ordre.
Les 17 et 18 mars, des experts de l'Union Européenne venus à Tirana discutent avec le gouvernement albanais afin d'évaluer la portée et l'envergure d'une mission d'aide humanitaire.
Tandis que ces messieurs discutent de comment "normaliser la situation en Albanie", ce qui se passe dans la rue va, peu à peu changer de caractère. Alors qu'elle était devenue vivante, pleine de prolétaires armés discutant des prochaines actions, alors qu'elle était devenue le lieu de tous les assauts, pillages, incendies, barricades,... la rue va, peu à peu, céder la place à des affrontements d'une toute autre nature.
Pour expliquer cela, nous allons faire une petite parenthèse.
Le mode de production capitaliste place chaque unité de production en opposition aux autres et génère ainsi la guerre perpétuelle de chacun contre tous. L'ouverture des frontières de l'Albanie a cruellement mis à nu et fait exploser ces contradictions. Non pas dans le sens où ces contradictions auraient constitué une nouveauté pour l'Albanie -les lois du capitalisme ont toujours régi l'Albanie!- mais parce que la tentative protectionniste de diriger l'économie albanaise imposait jusqu'alors une certaine discipline au sein de la bourgeoisie, discipline rendue possible par des salaires réels relativement bas (par rapport aux autres pays), mais qui ne faisait que postposer l'éclatement de toutes ces contradictions. Et c'est précisément ce report (une pratique propre à tout type de capitalisme populiste et protectionniste) qui a aggravé l'explosion lorsque celle-ci est devenue inévitable. C'est pour cela également que la guerre permanente que se livrent les bourgeois s'est faite de manière tellement chaotique quand tout a explosé.
Lorsque l'Albanie a ouvert ses frontières, toute une série de jeunes loups capitalistes, attirés par la baisse des salaires et avides de s'enrichir rapidement sur ce qu'ils considéraient comme un prolétariat innocent, naïf, et domestiqué, se sont précipités et se sont emparés d'un ensemble de secteurs. Mais tout cela n'a fait qu'exacerber la lutte concurrentielle pour un profit rapide et n'a pas tardé à se transformer en une guerre de rapine concrétisée par d'innombrables affrontements armés inter-bourgeois, jusqu'à aboutir à une lutte chaotique entre entreprises et maffias rivales (tout comme cela s'est passé dans d'autres pays tel l'ex-URSS).
Dans ce cadre, le gouvernement Berisha lui-même semble avoir plus obéi à ses intérêts privés, concentrés autour du Parti Démocratique, qu'aux intérêts plus globaux de la bourgeoisie dans son ensemble. Or, en règle générale, les secteurs de la bourgeoisie qui contrôlent les appareils centraux de l'Etat assurent cette hégémonie précisément parce qu'ils ont prouvé leur capacité à laisser au second plan leurs intérêts privés au profit des intérêts généraux de leur classe. Il semble ici que Berisha, notamment au travers de ses sociétés pyramidales, s'est bien plus préoccupé de sa fortune personnelle que des intérêts de la bourgeoisie en général et de la cohésion de l'Etat. C'est ce qui explique sans doute aussi que tant de fractions bourgeoises se soient retrouvées derrière le mot d'ordre "A bas Berisha!".
Au mois de mars 1997, en plein mouvement insurrectionnel du prolétariat, et tirant parti de la déstabilisation de l'Etat, différentes fractions bourgeoises en profitent pour passer à l'action militaire et régler des comptes. Outre les partisans de Berisha qui ont profité de la situation d'illégalité générale pour piller eux aussi des casernes afin de s'armer, d'autres ont profité de cette même situation pour s'armer et protéger militairement leurs usines, commerces et autres entreprises. Ainsi bon nombre de patrons (14) venus hier s'installer en Albanie parce que la main-d'oeuvre y est vraiment bon marché et que les lois sont telles qu'ils peuvent gérer leurs affaires à peu près à leur guise, sans scrupule quant aux taxes, aux lois sociales,... ne peuvent plus compter aujourd'hui sur les forces de police pour protéger leurs propriétés privées. Ces gros propriétaires et patrons s'entourent donc maintenant de milices privées, de troupes de surveillance, de comités de vigilance, de "bandes armées" pour sauver leurs exploitations des pillages généralisés... tâche que ces milices n'ont par ailleurs pratiquement jamais pu assumer dans le cours du mouvement.
Entre ces milices armées par les patrons et les Conseils de Salut Public, Comités de Sauvegarde, Comités de Défense,... qui eux aussi se sont armés pour rétablir l'ordre, les groupes de prolétaires armés sont de plus en plus coincés.
Afin de donner le coup de grâce et d'augmenter la confusion générale qui réussira à désarmer le prolétariat, les médias, mettent dans le même sac les actions du prolétariat en armes et les actions des milices de défense de la propriété privée. "Bandes armées" (15) est devenu l'appellation type pour amalgamer des actions de nature totalement différentes pourvu qu'elles soient armées.
Les pillages par exemple, peuvent être de nature de classe tout à fait antagonique selon ceux qui les font et selon le contenu de l'action. Quand les prolétaires pillent les dépôts de vivre ou d'armes, c'est notre classe qui critique la propriété privée, l'Etat et l'ensemble du rapport social capitaliste. Cette expropriation exprime les intérêts de l'humanité. Il s'agit d'une appropriation collective, d'une réappropriation de ce que les prolétaires produisent mais dont ils sont toujours privés. C'est le prolétariat qui nourrit et arme sa lutte contre l'Etat et le règne de la marchandise.
Quand d'autres pillages apparemment semblables de dépôts de vivre et d'armes sont opérés, soit par des trafiquants qui organisent le commerce des denrées qui se font rares et qui en profitent pour les vendre aux prolétaires, à des prix inabordables,... soit par les milices engagées pour protéger les entreprises capitalistes,... soit par les sbires de Berisha,... il est clair que les critères ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les intérêts de l'humanité qui s'expriment ici, mais bien ceux du profit, ceux de la tyrannie séculaire du taux de profit contre l'être humain. Il s'agit d'une appropriation privée, pour des intérêts privés de groupes de bourgeois qui luttent pour imposer leurs intérêts de fraction et qui ont pour objectif d'améliorer leur position dans la guerre compétitive que se livrent entre eux les capitaux. C'est la perpétuation en armes du système capitaliste.
Autre exemple, les attaques de commissariats aussi peuvent être de nature tout à fait différente. Quand des trafiquants attaquent des commissariats parce que la police tente de reprendre le contrôle de leur commerce, ou exige un pourcentage, ils mènent une guerre inter-bourgeoise pour le contrôle d'un marché. Cette attaque s'inscrit tout à fait dans la reproduction du système capitaliste. Mais par contre, quand le prolétariat attaque un commissariat, liquide ses occupants et incendie les bâtiments de la répression, il s'attaque à son ennemi mortel, à celui qui le réprime directement, à celui qui le maintient privé de toute propriété, à l'Etat capitaliste. Son action s'inscrit dans le processus de destruction de l'Etat bourgeois.
Les "bandes armées" qui, pour mener à bien leur propre guerre de concurrence, pillent les dépôts de vivres, les casernes, attaquent les commissariats,... constituent le bras armé de la contre-révolution, celui qui restaure la terreur contre le prolétariat.
Ainsi, un barrage routier installé dans Vlorë rançonne tous les automobilistes qui passent par là. Si ceux-ci n'obtempèrent pas, ils sont tout simplement criblés de balles.
A nouveau, autant le prolétariat en armes a organisé des barrages pour stopper l'avance des troupes militaires, pour arrêter les membres de la police secrète,... pour défendre sa lutte, y compris en vue d'obtenir des fonds pour cette dernière, autant ceux qui rançonnent les automobilistes -catégorie par essence a-classiste-, n'ont rien à voir avec sa lutte et se situent tout à fait du côté de l'Etat qui, tous les jours, exerce ce genre d'intimidation. Les journaux surnomment ces rançonneurs de "bandits", de "rebelles", de "mafiosi", de "crapules",... au même titre que n'importe quel prolétaire ayant pris les armes contre l'Etat. Pourtant, il est clair qu'on a affaire ici à une milice privée au service de l'ordre capitaliste. Cette bande armée (un patron et ses sbires) qui sévit à Vlorë et qui concurrence le Comité de Défense de Vlorë, revendiquant comme tout le monde la démission de Berisha (mais avec l'objectif de faire de bonnes affaires en trafiquant), a peu à peu repris en mains le contrôle des mouvements des groupes de défense, de la circulation des armes. Elle a assassiné froidement tous ceux qui ne répondaient pas à ses ordres. Pour défendre ses intérêts mercantiles privés, cette bande armée fait régner l'habituelle terreur bourgeoise et, de ce fait, défend les intérêts privés capitalistes en général. Description des journalistes: "Des organisations criminelles ont profité de la situation de désordre en Albanie pour faire des affaires en or, notamment dans le trafic de drogue et d'armes. Des businessmen italiens ont continuellement des rapports d'affaires avec des collègues albanais."
Et, pour achever la description du rôle éminemment contre-révolutionnaire de cette "bande armée", voici ce que proclamera son leader à l'arrivée des troupes italiennes: "Les soldats italiens sont nos frères... Celui qui veut toucher à l'un de leurs cheveux devra passer sur mon cadavre."
D'autres exemples:
Le 27 mars par exemple, le prolétariat donnera une réponse de classe à ces bandes venues racketter un village. Fortement armés par le pillage d'une importante caserne, les habitants, refusant le racket, se sont défendus et ont vengé leurs dix-huit morts.
Les trafiquants de viande sur pied espèrent également faire de bonnes affaires avec la nouvelle vague d'émigration. Ils débarquent ainsi sur les côtes italiennes plus de dix mille réfugiés clandestins (chiffres inférieurs à ceux de 1991 qui avaient dépassé les quarante mille) qui seront rapidement rapatriés en Albanie (16). En effet, ils ne sont pas considérés comme des "ressortissants étrangers", des diplomates, des ambassadeurs ou des cadres d'entreprises,... pour qui on affrète navires, hélicoptères, avions afin de les évacuer. Au contraire, il s'agit de simples prolos qui ont fui vers l'Italie soit attirés par le mythe du paradis occidental soit pour échapper à la répression. Ils ont payé entre 500 et 1000 dollars leur place sur un rafiot pourri qui n'est même pas sûr d'arriver (17). A Durrës, ceux qui mènent ce commerce de viande sur pied s'y connaissent et sont efficaces! Une flotte de plus de cent vedettes rapides leur permet de contrôler toute la côte et d'organiser leur commerce notamment avec l'Italie et la Grèce. Sur la côte, ils racolent et rassemblent les candidats, en se gardant bien de leur dire ce qui les attend en Italie! En mer, ils menacent pêcheurs et capitaines de bateaux pour garder le contrôle du trafic. La police complice ne les empêche pas de se livrer à leur trafic.
Sur base de ces exemples, on comprend la facilité avec laquelle les bourgeois ont amalgamé les actions prolétariennes avec ces bandes armées de commerçants sans scrupules, sans critère, sinon ceux de la bourgeoisie: le profit et la guerre de tous contre tous. Et ce sont les bourgeois eux-mêmes qui traitent les prolétaires en armes de mafieux, gangsters, sauvages, violeurs,... cannibales! On comprend aussi pourquoi les prolétaires se sentent de plus en plus coincés entre ces "bandes armées", les unes, répondant à leurs stricts intérêts privés, patrouillant en tous sens dans un but immédiat de ramasser un maximum de fric, les autres (Comités de Défense, de Sauvegarde ou de Salut Public) dont le but correspond plus à l'intérêt de la bourgeoise mondiale: le rétablissement de la paix sociale là où la colère prolétarienne s'est exprimée le plus fortement.
Telles sont les bases sur lesquelles les affrontements du début du mouvement vont progressivement céder la place à des affrontements de toute autre nature. Revenons maintenant au déroulement des événements.
Le lundi 19 mars, des représentants du gouvernement et des organismes internationaux discutent des objectifs de l'intervention et de la manière d'acheminer l'aide humanitaire. L'Etat nord-américain s'oppose à une intervention militaire de l'OTAN (18), l'Etat allemand définit le conflit comme "une affaire interne",... Les experts coïncident dans le rejet de l'intervention militaire directe pour assurer le rétablissement de l'ordre en Albanie (ils ont conscience du danger de généralisation) et considèrent plus efficace les mesures d'assistance à l'armée et à la police, afin que ces institutions rétablissent l'autorité de l'Etat, assurent la protection des aéroports, des ambassades et des principaux bâtiments officiels. C'est-à-dire que la bourgeoisie perçoit qu'il ne faudrait pas commettre à nouveau l'erreur de mener une répression frontale, comme l'a fait Berisha, qui n'a eu pour effet que de galvaniser la combativité des prolétaires en lutte. La bourgeoisie sait que pour rétablir la paix sociale, le bâton n'est pas suffisant, la carotte aussi est indispensable: il est bien plus efficace de présenter son intervention comme une aide humanitaire. La bourgeoisie sait qu'elle doit se présenter comme celle qui nourrit les prolétaires et constitue donc la seule solution au problème de la survie. Reste encore à déterminer quels effectifs. En attendant, le gouvernement Bashkim Fino, soutenu par l'Union Européenne, est invité à prendre d'urgence des mesures d'"assistance sociale et humanitaire" pour pacifier le pays. Les forces de la bourgeoisie mondiale se dirigent alors vers une intervention où la présence unitaire étrangère appuiera les forces répressives locales et utilisera l'action humanitaire comme vitrine.
Le 20 mars, l'armée italienne effectue sa première opération sur le sol albanais. Des fusiliers marins d'une unité d'élite de l'armée italienne débarquent sur une plage proche du port albanais de Durrës.
Le 25 mars, 40 tonnes d'aide française en vivres et médicaments arrivent à l'aéroport de Tirana.
Le 26 mars, les négociations de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) débouchent finalement sur la création d'une "mission humanitaire protégée par une force multinationale sous mandat de l'ONU". "Il s'agira d'une mission d'escorte, d'une mission humanitaire, pas de maintien de l'ordre." "Le plan OSCE s'efforcera de créer les conditions politiques aptes à la tenue d'élections générales anticipées d'ici l'été prochain. Mais sa mission de police essentielle sera d'assurer la protection rapprochée dans l'acheminement des convois de secours alimentaires et médicaux dont les municipalités ou les hôpitaux pillés et mis à sac ont le plus pressant besoin."
Il est clair qu'il s'agit là d'une mission de maintien de l'ordre mais l'OSCE fait tout pour apparaître en sauveteurs et non en agresseurs. La grande peur de la bourgeoisie reste le danger d'internationalisation du conflit. Pour l'OSCE, il faut à tout prix éviter que le prolétariat, toujours armé, continue sa lutte non seulement contre l'armée albanaise mais encore contre les armées européennes. Cette extension de la lutte amènerait à reconnaître l'ennemi de classe dans un panel beaucoup plus large de fractions bourgeoises dont les fractions qui soutiennent le plan de l'OSCE: les Comités de Défense, de Sauvegarde ou de Salut Public... le gouvernement Bashkim Fino,... soit l'ensemble de la bourgeoisie albanaise et internationale.
Malgré les nécessités du capital mondial, malgré les accords conclus autour des stratégies à mener en Albanie, aucun état-major n'est prêt à envoyer ses soldats dans le sud de l'Albanie où la situation reste explosive. Un combattant affirme: "je préviens les soldats italiens: je ne leur conseille pas de venir à Vlorë; s'ils le font nous les tuerons." En Espagne, El País titre le 3 avril "Peur dans le sud" et souligne que "le peu de disponibilité à déployer des forces dans le sud de l'Albanie manifestée par la dizaine de pays qui ont envoyé hier les représentants de leurs Etats Majors respectifs à la réunion convoquée à Rome constitue le premier problème de la mise en marche de la Force Internationale de Protection (FIP)." Le journal ajoute: "aucun des huit pays qui, parmi les participants à cette rencontre étaient prêts à coopérer à la partie militaire du plan, ne semblait disposé à envoyer des soldats dans cette zone..."
La bourgeoisie craint plus globalement, que ses véritables objectifs soient dévoilés. En ce sens, elle insiste: "La force militaire multinationale accrochée à son mandat humanitaire refuse de s'immiscer dans des affaires de police intérieure qui pourraient très vite l'exposer à des attentats terroristes."
De ce jour au 12 avril, un contingent de 6.000 soldats environ devra débarquer en Albanie. Les premiers objectifs de la mission sont de sécuriser les ports de Durrës et Vlorë, l'aéroport de Tirana et les principales voies de communication entre le nord et le sud de l'Albanie.
Le 9 avril, un navire chargé d'une centaine de membres du SHIK est arrivé à Brindisi pour contrôler de près les mouvements des réfugiés albanais. Si les candidats à l'émigration sont sévèrement rejetés d'Italie, on voit qu'il n'en est pas de même pour tous ceux qui collaborent à la sauvegarde de l'Etat. Que ce soient les "ressortissants étrangers" ou les membres de la police secrète, ceux-là reçoivent un bon accueil en Italie. Face au danger prolétarien, la bourgeoisie sait mettre au second plan sa guerre concurrentielle pour mieux mener sa guerre contre le prolétariat. Les financiers des faillites des sociétés d'épargne pyramidale ont, par ailleurs, de loyaux collègues en Italie. Par exemple, une chaîne de supermarchés des Pouilles appartient à la désormais célèbre Vefa.
Le 12 avril, le commando Jaubert arrive à Durrës pour sécuriser la zone de débarquement des troupes de l'armée française.
Le lundi 14 avril, un pont aérien entre Pise et Tirana a été mis en place afin d'acheminer le matériel et la logistique sur place. Plusieurs C-130 de l'armée de l'air italienne ont déjà atterri à Tirana.
Le 15 avril, débute l'opération Alba. Les 6.000 soldats des forces multinationales débarquent dans les ports de Durrës et de Vlorë. Un cargo affrété par le programme alimentaire mondial décharge 360 tonnes de farine et 36 tonnes de légumineuses.
Autant la bourgeoisie était effrayée de voir à quel point le prolétariat s'était armé, autant le débarquement des forces multinationales est impressionnant. La dimension des navires, des chars et autres véhicules, l'armement sophistiqué,... ont de quoi intimider! Les voix prolétariennes qui s'élèveront contre cette intimidation seront peu nombreuses, ce qui démontre une fois de plus l'isolement de l'extraordinaire lutte du prolétariat en Albanie. Un isolement que la bourgeoisie mondiale a réussi à imposer. Sur place, face à cette impressionnante invasion militaire, on n'entendra que quelques insultes: l'humanitarisme impose dictatorialement sa terreur.
A Tirana, la situation redevient normale pour le capitalisme: les journaux reparaissent normalement, les échoppes sont approvisionnées, la circulation est dense. Les seules armes visibles sont celles des quelques policiers accoudés à leur véhicule blindé.
Le 17 avril, une délégation de l'OSCE rencontre à Vlorë les représentants du Comité de Salut Public. Le président de ce Comité confirme son rôle contre-révolutionnaire quand il affirme: "L'opération Alba peut dégénérer si elle reçoit la mission de pénétrer de force dans nos foyers pour nous prendre nos armes", rejoignant par là à 100 % les préoccupations des émissaires de l'OSCE. On constate ici que les peurs de la bourgeoise en Albanie sont exactement les mêmes que celles des humanitaristes internationaux.
Du 1er au 7 mai, la police réapparaît dans les rues de Shkoder, Berat, Burrel, Kukes, Kruje. Mais les institutions de la Justice ne sont pas opérationnelles: des postes de police, des prisons, des tribunaux,... il ne reste rien. Avant de quitter les bâtiments, les prisonniers évadés ont pris soin de faire brûler leur dossier puis d'incendier les bâtiments eux-mêmes,... Quelques jours auparavant, on pouvait lire dans la presse: "Le chef de l'administration pénitentiaire en Albanie a annoncé hier que le pays n'avait plus que 27 prisonniers en prison contre 1.300 qui s'y trouvaient avant la fuite massive d'inculpés le 13 mars passé. Sur ces 27 prisonniers, 9 sont rentrés en cellule de leur propre gré."
Un magistrat s'étonne: "Après 45 ans d'interlude, nous avons pris soin de faire de bonnes lois. Nous avons une charte constitutionnelle définissant les droits de l'homme. Il y a un ministre de la Justice, des associations privées de magistrats, le droit d'appel, un nouveau code criminel,... Mais nous avons négligé d'éduquer le peuple à ce nouvel esprit. Qu'ont fait les insurgés?" se demande encore ce dévoué magistrat qui voudrait nous faire entendre que depuis la mort d'Enver Hoxha, il n'existe plus de système répressif en Albanie. Comme si de bonnes lois et un bon fonctionnement judiciaire changeaient la nature du terrorisme d'Etat. "Au lieu de porter plainte en Justice, ils ont pris la route directe: piller les banques. Ils n'ont pas confiance dans l'Etat et ses lois. Même ce propriétaire d'usine à Shkoder: la Justice lui avait fait des offres spéciales pour assurer la protection de son exploitation mais celui-ci a préféré engagé ses propres vigiles."
Le 14 mai, les partis de l'opposition menacent de boycotter les élections décidées pour le 29 juin 1997. Ils remettent en question la loi électorale prévoyant un mode de scrutin majoritaire. La polarisation de l'attention autour de cette polémique tente d'installer toujours plus fortement l'idée que la solution à tout ce qui s'est posé dans le mouvement est d'aller voter pour sanctionner la politique de Berisha. Alors que spontanément les prolétaires s'en sont pris à l'Etat et toutes ses structures: ses banques, ses commissariats, ses tribunaux, ses prisons, ses casernes, ses dépôts,... ils se laissent confisquer cette lutte totalisante pour ne finalement réclamer que la tête de Berisha et encore, par vote démocratique.
Si au départ, la revendication de la tête de Berisha pouvait encore signifier A bas l'Etat!, aujourd'hui, avec la récupération faite par l'opposition socialiste, la réclamation de la démission de Berisha n'est que la solution politique approuvée par l'ensemble de la bourgeoisie mondiale pour désarmer les prolétaires et reprendre les négociations par les voies qui lui assurent le retour de la garde du monopole des armes.
Le 21 mai, l'accord global passé entre les dix partis prévoit notamment la nomination d'un nouveau chef de la police secrète exhauçant par là, partiellement, une des revendications des Comités de Salut Public qui revendiquaient un remaniement profond de la police secrète.
Le 4 juin, le président Sali Berisha échappe à une tentative d'attentat lors d'un meeting électoral du Parti Démocratique, à trois semaines des élections législatives anticipées prévues pour le 29 juin 1997. Cet événement illustre la tension qui règne encore dans le pays malgré les promesses électorales.
A de rares exceptions près, personne n'a rendu les armes dérobées lors du pillage des casernes. L'état d'urgence et le couvre-feu sont toujours en vigueur.
Le 27 juin, parti de Tirana, un convoi d'observateurs internationaux escorté par des soldats italiens et roumains progresse vers la pointe sud-ouest jusqu'à Gjirokaster, passant par Memaliaj, Tepelenë,... localités qui, en mars, étaient toutes gagnées par le mouvement insurrectionnel notamment marqué par le pillage des casernes et l'armement généralisé du prolétariat. Les prolétaires saluent le passage des chars par des insultes mais la caravane passe sans problème. Cet exemple démontre l'état général de la lutte à ce moment: décomposition de la force insurrectionnelle, haine des nouvelles propositions pour instaurer l'ordre mais prédominance de l'impuissance,... la résignation refait son apparition.
A deux jours des élections législatives anticipées prévues pour le dimanche 29 juin, les observateurs estiment que les conditions à la tenue d'un scrutin libre et démocratique ne sont pas réunies. Mais le 29 juin, la bourgeoisie peut enfin saluer en Albanie l'effectif "passage salutaire par l'isoloir" qui, à Bucarest comme à Sofia, avait permis cette soudaine "métamorphose" du danger de la révolution en civique défilé obéissant au dépeçage démocratique. De l'isoloir ressort l'isolé! Le spectre de la révolution s'éloigne -provisoirement- de l'Albanie avec le retour de la focalisation de toute l'attention sur les tractations politiques.
Le 23 juillet, quelques mois après avoir été réélu pour un second mandat présidentiel, Sali Berisha adresse une lettre de démission de la présidence de la république albanaise qu'il occupait depuis cinq ans. C'est ainsi que s'accomplit le spectacle de la réconciliation nationale. Dernier acte programmé par l'opposition pour faire admettre aux insurgés de rendre les armes. Le but -"stabiliser la situation, restaurer l'autorité bafouée de l'Etat, rendre une légitimité perdue au futur gouvernement et favoriser un indispensable climat de réconciliation nationale"- devrait enfin être atteint.
Le 12 août 1997, les six mille hommes de la "force multinationale de protection" quittent l'Albanie.
"Internationalement, non seulement il n'y a pas d'autre lutte prolétarienne importante, mais en plus l'isolement du prolétariat en Albanie est renforcée par l'occultation systématique de tout ce qui s'y passe. La bourgeoisie mondiale s'assure que dans le monde on ne parle pas de lutte prolétarienne ni de révolution en Albanie, mais bien de chaos, de désordre, d'anarchie..."
"La paix sociale internationale pèse d'un terrible poids sur l'extraordinaire mouvement du prolétariat en Albanie, tout comme elle a pesé hier sur l'insurrection prolétarienne en Irak: le prolétariat en Albanie a besoin d'étendre la lutte internationalement mais il ne trouve ni l'appui ni la compréhension nécessaire auprès du reste du prolétariat mondial qui, abruti par la campagne internationale de la bourgeoisie, ne se reconnaît pas dans la lutte de ses frères en Albanie, et imagine encore moins la force réelle des ruptures qui y ont eu lieu."
Pour répondre à cette question, nous avons repris les caractéristiques dégagées en octobre 1993 et nous les mettons en regard avec les événements en Albanie afin de vérifier leurs similitudes et dissemblances.
Notre texte soulignait en premier lieu l'action violente et décidée du prolétariat qui occupe la rue, s'affronte directement aux structures de l'Etat, ses bâtiments, commissariats,... et qui fait tomber les barrières de la propriété privée, dans un mouvement d'expropriation et de réappropriation général.
Les événements en Albanie confirment fortement cette caractéristique. Le prolétariat en Albanie a pris d'assaut des commissariats, des bâtiments de la police secrète, des casernes, des tribunaux, des prisons, des locaux du parti au gouvernement, des dépôts de vivre, des succursales de banques, des maisons de bourgeois, des centres commerciaux, des entreprises,... Les incendies visaient la destruction de centres de répression, d'accumulation du capital, d'organisation de la contre-révolution,... et les pillages donnaient lieu à des expropriations/réappropriations collectives.
Notre texte sur les caractéristiques générales des luttes faisait remarquer: "Le fait d'occuper directement la rue tend à produire une rupture violente avec toutes les catégories par lesquelles le capital divise les prolétaires: le cadre restreint de l'usine, de la mine ou du bureau vole en éclats. Chômeurs, femmes que le capital condamne au travail domestique, vieux, enfants,... s'unifient dans l'action directe." Comme en Birmanie il y a une dizaine d'années, en Albanie aussi ces barrières ont volé en éclats et la lutte s'est généralisée à tous les secteurs et dans tout le pays.
Les pillages ont d'abord principalement visé les casernes car le premier objectif du mouvement, passant le cap de la simple protestation pour se muer en soulèvement insurrectionnel, était l'armement. Ils ont ensuite visé les banques parce que c'est là qu'ont été englouties les épargnes. Puis, face à la pénurie, ce sont les dépôts de vivre qui ont été visés. Et enfin, ils se sont généralisés aux commerces, bâtiments publics, usines,... c'est-à-dire tous les endroits de stockage de marchandises, cachant des réserves en tout genre,... jusqu'aux murs, poutres et toitures.
Le texte soulignait encore la forme d'une déflagration imparable que prennent ces révoltes, sans progression quantitative de luttes partielles avant l'explosion, caractéristique accompagnée du fait que le vieil arsenal social-démocrate n'a aucun effet face à l'action décidée et violente du prolétariat et que le syndicalisme est totalement incapable de répondre et d'encadrer la généralisation de la violence prolétarienne. Le cadre réformiste contrôlant habituellement les tentatives de luttes est rapidement débordé.
En Albanie, fait marquant, policiers, soldats (sauf corps spécialisés, troupes d'élite,...) ont refusé de tirer sur les prolétaires en lutte. Il est à remarquer également que la tournure prise par les événements a engendré un génial effet de surprise qui a indéniablement constitué un obstacle à la mobilisation rapide des forces de la contre-révolution.
Il y eut bien quelques tentatives de canaliser la grogne de plus en plus pressante dans quelques manifestations pacifistes, grèves de la faim,... Mais ces tentatives ont brutalement été balayées par l'explosion soudaine et générale de mouvements quasi insurrectionnels. L'armement fut aussitôt généralisé et les forces armées habituellement envoyées pour mâter la révolte ont dû reculer. Plus encore, beaucoup de soldats ont laissé là leur uniforme et ont rejoint leurs frères de classe, ouvrant les casernes et contribuant à l'appropriation des armes.
Autre caractéristique soulignée par le texte d'octobre 1993: le fait que "ces révoltes éclatent généralement sans objectif précis et explicite et proposent rarement quoique ce soit de positif."
En Albanie, on peut constater cette absence de revendication positive concrète, même si le point de départ a été cette formidable escroquerie financière qui a dépossédé le prolétariat de ses quelques économies. Ce qu'il y avait derrière tout cela, c'était une situation totalement précaire pour le prolétariat, une dépossession toujours plus aiguë de ses moyens de vie. En Albanie, la coupe était pleine, mais la rage qui s'est exprimée à cette occasion est une rage contre la privation en général. De plus, la façon dont cette rage a été portée par le prolétariat en une révolte généralisée s'attaquant non pas aux seules sociétés d'épargne mais à un ensemble de structures de l'Etat bourgeois, exprime la dimension beaucoup plus totale qu'a prise la lutte en Albanie.
Face à l'attaque de la bourgeoisie, concrétisée par cette escroquerie financière, ce que dit le prolétariat, c'est NON! Il s'agit d'une explosion de rage qui dit NON, ce qui ne constitue pas une revendication positive et est dès lors beaucoup plus difficile à transformer en proposition réformiste. Tout le temps que dure cette déflagration sociale est caractérisé par ce NON intransigeant, et donc par l'absence de revendication concrète positive.
C'est l'opposition bourgeoise qui, dans la mesure où le prolétariat n'est pas parvenu à doter sa révolte d'objectifs propres, a insufflé dans le mouvement la revendication limitative de la démission du président Berisha canalisant le mouvement de lutte contre l'Etat en une politique bourgeoise de remplacement d'un gouvernement par un autre. C'est précisément cette question de la "démission de Berisha" qui constituera le passage du NON prolétarien face à l'ordre bourgeois imposant une augmentation de la misère au OUI récupérateur se concrétisant dans la réforme politique de l'Etat bourgeois. Cette revendication apparaîtra chaque fois plus opposée au NON prolétarien et finira par supplanter et faire oublier la question de la récupération de l'argent déposé dans les banques.
Jusqu'ici, le mouvement de lutte en Albanie correspondait globalement aux caractéristiques des luttes de l'époque actuelle dégagées en octobre 1993.
Mais quant à la caractéristique qui souligne que, même en ces moments intenses et aigus, la puissance de l'idéologie bourgeoise est si forte que, seule une minorité va participer à l'action directe,... la situation en Albanie se différencie nettement.
L'armement et la participation à l'action directe furent généralisés. Même chose pour les règlements de comptes avec les membres identifiés du SHIK, la mise à sac des bâtiments publics, administrations communales, tribunaux, commissariats, prisons, la prise des casernes, les pillages... Pendant que certains opéraient plus directement, d'autres, et parfois des masses d'autres, agissaient pour faire rempart afin d'empêcher les forces de l'ordre d'arriver sur le lieu de l'action proprement dite. Les prolétaires en armes se sont organisés pour bloquer les routes, organiser la défense de leurs bastions,... Il est indéniable, qu'en Albanie, la participation à l'action directe ne fut pas que le fait d'une minorité. Elle fut massive, générale.
Notre texte soulignait par ailleurs qu'une fois passé l'effet de surprise, la contre-offensive bourgeoise reprend le dessus et, d'un grand coup de massue fait tout rentrer dans l'ordre,... Ici aussi la situation se différencie nettement.
En Albanie, le mouvement est allé plus loin que la plupart des affrontements qui se déroulaient à l'époque (Los Angeles, par exemple) en s'armant de façon généralisée et en faisant durer sa lutte plus que le temps d'un éclair dans le sombre ciel de l'austérité générale et extrême que le capital fait régner de façon toujours plus écrasante dans le monde. Entre le moment où la lutte a dépassé le cadre étouffant des manifestations de protestation pacifique pour devenir quasi insurrectionnelle, et la propagation du mouvement au nord du pays culminant avec l'évacuation de Tirana par les forces bourgeoises, deux semaines de radicalisation et de généralisation du mouvement se sont écoulées.
Mais cette généralisation s'est faite sans organisation de liens entre les différents endroits touchés par le mouvement. Le mouvement insurrectionnel a embrasé un tiers du territoire albanais, comme une traînée de poudre. C'est-à-dire qu'il a suffi d'une étincelle en un endroit pour que le feu courre sans autre effort, les échos d'une bataille victorieuse suffisant à encourager d'autres à faire de même. Pourtant ce n'est pas le manque d'enthousiasme ni d'armement qui peuvent expliquer le fait que les insurgés soient restés cantonnés dans leurs villes respectives sans chercher à centraliser la lutte. C'est à nouveau le manque de perspectives, de détermination des objectifs de classe qui a laissé le soin aux Comités de Défense, de Sauvegarde, de Salut Public,... de prendre en charge les liens par les habituels canaux que l'Etat met toujours en place: les représentations démocratiques des divers partis bourgeois, d'abord au sien du Comité des huit villes puis au travers de l'organisation des élections nationales.
Ainsi que le souligne le texte d'octobre 1993, en Albanie se vérifie le fait que l'absence de direction révolutionnaire permet à la bourgeoisie de reprendre le contrôle de la situation.
La bourgeoisie niera toujours la nature de classe des affrontements et par là leur dimension internationaliste, c'est-à-dire qu'elle met tout en place pour cacher que ce qui s'exprime ponctuellement en Albanie est un moment de la lutte unique et mondiale du prolétariat. Le danger pour la bourgeoisie étant justement que les prolétaires du monde entier se reconnaissent dans la lutte de leurs frères d'Albanie (et d'ailleurs) et se décident à prendre les armes contre tout l'appareil démocratique qui jusqu'ici fait encore tant recette! Ce que dit la bourgeoisie des événements en Albanie (comme de tous ceux ce qui secouent le monde), c'est qu'ils n'ont évidemment aucun lien les uns avec les autres. A ses yeux, ils ne peuvent être que le fait de particularismes.
En ce sens, la principale faiblesse du prolétariat en Albanie trouve sa source dans la faiblesse actuelle des luttes du prolétariat mondial. Dit autrement, la principale faiblesse du prolétariat de cette région est l'isolement international, le fait qu'ailleurs le prolétariat reste à ce point dominé et affaibli qu'il est incapable de développer partout des actions semblables à celles de ses frères en Albanie. Pire, il a été incapable de comprendre que c'était sa propre classe qui luttait en Albanie!
Ceci est également une constante de la situation actuelle: le manque de direction et de programme révolutionnaire, questions décisives dans le cours de l'action, sont complémentaires de l'absence de conscience internationale de la lutte, et ces deux carences du prolétariat mondial se renforcent réciproquement. La tragédie du prolétariat dont la lutte dans une région va plus loin que dans d'autres, est une question tout aussi historique que géographique et concerne autant son programme que son isolement. Dans cette tragédie convergent le manque de théorie et de direction révolutionnaire et le manque de lutte du prolétariat d'autres régions du monde.
C'est grâce à cette faiblesse actuelle du prolétariat mondial que la bourgeoisie a pu isoler "la question albanaise" en tant que question particulière (comme elle l'avait fait avec "la question kurde"). C'est ainsi que dans un premier temps la bourgeoisie présente le spectacle de la commisération, de la compassion et que la presse mondiale parle, en termes a-classistes, d'"albanais" (la division nationale donne de bons résultats) , de "victimes" et du "désespoir qui a conduit à de telles exactions",... des "abus de pouvoir", des "parasites de la démocratie", des "entreprises de corruption",... mettant en avant des particularismes tels la "difficulté de ce pays le plus pauvre d'Europe et le plus marqué par un demi-siècle de stalinisme, le plus tribal,... à faire connaissance avec la liberté, l'économie de marché",... la "difficulté d'un peuple qui ne connaît pas assez le goût du travail, de l'effort, de l'esprit de sacrifice,... à faire l'apprentissage de la démocratie" (19),... La social-démocratie défendra toujours la coexistence de différents modes de production (capitaliste, socialiste, féodal,...), de différents mondes (développé, sous-développé,... tiers-monde, quart-monde,...), de différents régimes (démocratiques, totalitaires,...) pour mettre les "catastrophes", "drames", "tragédies", "génocides",... sur le dos d'un manque de développement capitaliste, d'un manque de démocratie. Et jamais bien sûr, ces événements ne sont reliés à quelque chose de global, de fondamental, de commun; dans les explications des médias, aucune des catastrophes actuelles n'est liée à la nature de cette forme sociale de production. Il s'agit de problèmes particuliers qu'on attribue à telle ou telle personnalité, à telle ou telle irrégularité ou mauvaise gestion. Le plus important pour la bourgeoisie est de nous imposer une vision selon laquelle chaque lutte est le résultat de quelque chose de différent qui n'a rien à voir avec son système mondial d'exploitation; le plus important pour elle, c'est d'éviter que les prolétaires d'une autre partie du monde se rendent compte que ceux qui luttent sont également des prolétaires, d'éviter qu'ils comprennent que c'est la dictature du capital qui exacerbe inévitablement l'exploitation, qui crée la misère, les guerres,... et que c'est notre lutte, la lutte des prolétaires en armes contre l'Etat, qui viendra à bout de toute cette inhumanité.
La bourgeoisie a même mis en réserve d'autres particularismes à mettre en avant pour miner le terrain sur lequel le prolétariat en lutte pourrait à nouveau se lancer. Les événements actuels ont déjà permis de réalimenter les conflits de frontières avec la Grèce, permettant à la bourgeoisie de tabler sur le sentiment nationaliste/sécessionniste grec parmi "la minorité grecque" qui réside principalement dans le sud de l'Albanie (20). Tant que le prolétariat lutte -une lutte par essence unificatrice et destructrice de tout sentiment nationaliste- la bourgeoisie ne peut articuler son attaque à ce niveau mais, comme on peut le constater dans la propagande de différentes fractions, elle n'a pas écarté la possibilité d'utiliser dans un futur proche le sentiment pro- ou anti-grec pour créer dans le sud de l'Albanie des mouvements séparatistes.
D'autres fractions ont lancé l'idée d'une "Albanie ethnique", c'est-à-dire d'un l'Etat albanais élargi au Kosovo et à la Macédoine. Elles tenteraient ainsi de mobiliser le peuple albanais dans une lutte de réunification/libération nationale.
Une autre polarisation bourgeoise que les journalistes ont mise en avant pour expliquer la différence de force du mouvement au sud et au nord, c'est la division du peuple albanais en deux grandes ethnies: les Guègues au nord et les Tosques au sud (21). Au travers de tous ces particularismes, il s'agit, pour la bourgeoisie, de prévenir les affrontements classe contre classe en enfermant tout mouvement dans des polarisations dont les deux termes sont bourgeois.
La première phase du mouvement passée, la commisération a vite fait place à la condamnation des "exactions",... toute la misère du monde ne justifiant évidemment jamais, aux yeux de la bourgeoisie, que les prolétaires aient recours aux armes. Les mots qu'elle utilise alors pour qualifier les prolétaires ne sont plus les "pauvres albanais" mais les "cannibales", les "sauvages", les "ivrognes", les "incontrôlés", les "gangsters", les "mafieux", les "malfaiteurs", les "bandits", les "profiteurs",... Des journalistes et parlementaires latino-américains ont été jusqu'à dire que la situation en Albanie se caractérisait par la présence dans les rues de masses de violeurs échappés des prisons. Et bien entendu, comme nous l'avons déjà souligné, par tous ces moyens, on cherche à créer l'amalgame entre les actions armées du prolétariat et les actions armées de fractions bourgeoises défendant leurs intérêts particuliers, alors que les critères (les buts et les moyens) sont totalement antagoniques.
Toujours pour reprendre le contrôle de la situation, la bourgeoisie tente de transformer cette lutte contre l'ensemble du système en une lutte de réformes des institutions, de casser la force de classe, les liens de solidarité, la conscience collective qui se développent dans la lutte, en reconduisant les prolétaires dans les voies électorales. A la force de classe, les urnes opposent l'individu isolé. A la conscience collective, elles réimposent le libre arbitre nécessairement reproducteur de l'idéologie dominante. Aux liens directs entre prolétaires en lutte en dehors et contre les structures de l'Etat bourgeois, les élections réimposent la médiation par le bulletin de vote.
Enfin, dernière caractéristique importante que dégage notre texte sur les caractéristiques des luttes actuelles: le décalage entre la force de l'action et l'absence de conscience que les prolétaires ont de la force et de la portée de leur action.
Malgré l'ampleur qu'a pris le mouvement et la clarté des objectifs de classe affirmés dans le contenu même des actions menées, il semble que ne se soient pas dégagées du mouvement des minorités se revendiquant du contenu éminemment classiste de ces actions qui véhiculaient pourtant toutes les déterminations de la lutte du prolétariat contre ce système de mort, pour la révolution communiste. Il est évidemment difficile d'affirmer la perspective du communisme dans un pays où l'exploitation s'est opérée pendant des décennies au nom du communisme. Mais il ne s'agit fondamentalement pas d'une question de nom. Du point de vue révolutionnaire, ce qui importe c'est le développement de minorités d'avant-garde qui revendiquent la portée révolutionnaire du mouvement et son rattachement à la lutte mondiale d'un prolétariat rompant avec tous les pièges de la démocratie. Ce qu'il y a de tragique en Albanie, c'est que ces minorités n'ont pas existé ou n'ont en tout cas pas eu la force suffisante pour se faire connaître et tenter de donner une autre direction à la révolte. Et ceci n'est évidemment pas une faiblesse propre au prolétariat en Albanie, mais une caractéristique du prolétariat mondial qui, alors qu'il a reçu tant de coups et subi tant de défaites, n'est toujours pas parvenu à un minimum d'organisation révolutionnaire internationaliste.
Partout les producteurs de la richesse mondiale -les prolétaires!- se laissent enfermer dans les négociations avec les capitalistes qui n'ont bien entendu comme critère essentiel que la rentabilité; partout les pièges démocratiques mènent encore les prolétaires par le bout du nez au travail ou aux abattoirs, et partout on entend: "ça ne sert à rien de lutter, cela ne changera pas,..." Et des pires "tragédies", "génocides", "drames", "catastrophes", semant la mort à tous vents, le bon citoyen arrive encore à conclure: "c'est la vie"!!!
Les prolétaires ont été tellement mis au pas ces dernières années que leur colère est bien trop souvent restée profondément enfouie (22). Dès lors, quand enfin, certains de nos frères de classe la laisse exploser et se battent les armes à la main contre l'Etat capitaliste, cela fait chaud au coeur.
Par les actions qu'il a menées, le prolétariat en Albanie a exprimé ce que les prolétaires du monde entier ressentent et, en cela, il se situe à l'avant-garde!
Le prolétariat en Albanie s'est fait l'écho de ce que tous les prolétaires portent en eux: la lutte contre l'exploitation capitaliste, pour le communisme. Cet écho est tel que, par exemple, dans un village de Hongrie, les ouvriers d'une petite entreprise de construction qui n'avaient pas reçu leur salaire se sont dirigés vers la maison du patron en criant: "Il est temps de faire comme en Albanie ici!" De même en Pologne, lors d'une manifestation, les ouvriers en colère scandaient: "Albanie, Albanie!" Dans d'autres ville d'Europe, on a aussi crié "Vlorë! Vlorë!"
La lutte du prolétariat en Albanie redonne confiance dans la force historique du prolétariat mondial.
Ce monument de la dissociation, des virages opportunistes, des zigzags entre autonomisme et stalinisme, ce champion du repentir qu'est Toni Negri, s'est rendu en Italie le 24 juin 1997 et s'est immédiatement fait arrêter.Voici ce qu'a déclaré à cette occasion, ce si célèbre "marxiste":
"Je sais bien que j'ai commis de nombreuses erreurs, pour lesquelles je suis coupable. Mais je sais aussi que l'Etat italien n'est pas complètement innocent."
Corriere della Sera - 25 juin 1997
Attention camarades, l'Etat ne serait peut-être pas complètement innocent!
Le détonateur de ce phénomène d'assentiment général n'est pas que l'ETA soit plus ou moins criminelle. Même lorsque cette organisation posait des bombes dans les supermarchés et tuait de façon indiscriminée, l'Etat espagnol n'est jamais parvenu à obtenir une mobilisation populaire de l'ampleur de celle à laquelle on assiste aujourd'hui face à l'exécution par l'ETA d'un personnage directement impliqué dans le parti au gouvernement et donc dans son action répressive. Ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est qu'en profitant de l'imbécilisation croissante de l'opinion publique, et par le biais d'une mise en scène très efficace, l'Etat est parvenu à associer les citoyens à leur maître, en allant jusqu'à amalgamer l'action de l'ETA à ce que l'actuelle idéologie dominante considère comme le mal en soi: les nazis et les camps de concentration. Le point culminant de cette campagne a consisté à assimiler de façon spectaculaire la situation de tel ou tel type détenu par l'ETA à celle des prisonniers des camps de concentration nazis! Faut-il préciser que les médias se gardent bien de faire cette assimilation lorsque c'est l'Etat espagnol qui emprisonne, torture ou tue (1)!
Ce que démontre ce répugnant spectacle des campagnes radio/télévisées pour le "ruban bleu" (2), c'est précisément la capacité de manipulation démocratique de l'Etat, la capacité de ses appareils à pratiquer l'amalgame ainsi que l'importance des moyens de diffusion dans cette politique de manipulation et de fabrication de l'opinion publique en fonction des intérêts bourgeois.
Il faut également signaler ici que l'ensemble des secteurs politiques a collaboré à cette campagne (à l'exception évidemment des principaux accusés: l'ETA et Herri Batasuna, son aile politique). En effet, même les traditionnels alliés de l'ETA que sont les autres groupes nationalistes basques ou les groupes de guérilla de divers pays, y ont contribué. L'exemple des Tupamaros uruguayens (actuellement dans leur phase légaliste) est d'autant plus parlant que ce groupe s'est toujours montré très proche des positions de l'ETA et a ardemment défendu ses militants, s'engageant, entre autre, dans la lutte contre leur extradition. Il est caractéristique de toute cette campagne d'amalgame que les Tupamaros, qui ne se sont jamais inquiétés des pratiques criminelles de l'ETA lorsque cette organisation tuait des prolétaires en posant des bombes de façon indiscriminée, se sentent obligés maintenant de prendre leurs distances vis-à-vis de l'ETA... alors qu'il s'agit de la liquidation de Blanco, un bourgeois, un homme de l'Etat. Il semblerait par ailleurs, selon certaines déclarations parues dans la presse, que c'est également ce qu'aurait fait le groupe "Sentier Lumineux" au Pérou (3).
Voici comment par exemple, Rafael Larreina, un parlementaire basque et vice-général de Eusko Alkartasuna, s'émeut et participe aux mythes télévisés:
"...alors que deux mois se sont écoulés depuis l'assassinat de Miguel Angel Blanco, nous observons avec un certain recul les conséquences de cet événement et les faits qui se sont produits ultérieurement. Le crime au ralenti de Ermua, à peine quelques jours après l'image saisissante de Ortega Lara sortant de sa terrible captivité, déclencha une réaction d'horreur et d'indignation sans précédent que tous, indépendamment de notre appartenance politique, nous avons partagé dans ce pays. La réaction populaire a été, elle aussi, évidente et tranchante, et elle devrait servir d'élément de réflexion aux dirigeants de Herri Batasuna et de l'ETA pour qu'ils déterminent s'ils sont réellement engagés dans le processus de construction nationale, s'ils acceptent et actent la volonté populaire et désirent l'indépendance de Euskalherria."
Répugnance et haine, voilà ce que nous ressentons vis-à-vis de cette unité nationale de "tous, indépendamment de [leur] appartenance politique", vis-à-vis de cette communion pour la reconstruction nationale, de ce choeur qui réclame plus d'Etat, plus de démocratie, plus de paix... c'est-à-dire plus de contrôle, plus de répression, plus de police.
Nous savons que l'objectif de cette campagne est la fortification de l'Etat, nous savons que son plus grand succès, c'est justement la participation populaire à cette revendication d'un Etat plus démocratique, d'une répression plus grande et nous savons que cette campagne "contre le terrorisme de l'ETA" vise fondamentalement à fortifier l'Etat bourgeois. Nous savons aussi que cette campagne est fondamentalement préventive face à l'action toujours possible du prolétariat, une perspective qui terrorise la bourgeoisie (4), nous savons qu'avec cette campagne on frappe aujourd'hui-même le prolétariat international, le prolétariat en Espagne et plus encore celui qui se trouve au Pays Basque.
Mus par notre répugnance et notre horreur pour toute cette campagne étatique, mus par notre envie de marquer notre solidarité avec le prolétariat principalement et directement attaqué par cette impressionnante vague de lamentations, de domestication, d'affirmation de la démocratie et du terrorisme de l'Etat, nous publions pour suivre la traduction d'un excellent article intitulé "desprecio del lazo azul" (notre mépris pour le ruban bleu) dont nous ne connaissons pas les auteurs et qui fut publié (en espagnol) dans la revue EKINTZA ZUZENA (5). "Ecrit trouvé à l'Université du Pays Basque" est la seule signature apposée au bas de ce texte qui, soit dit en passant, déborde largement le contenu annoncé dans le titre.
Nous voulons également exprimer notre solidarité aux camarades qui, dans ces moments difficiles pour le prolétariat au Pays Basque, ont le courage de produire et faire circuler des textes comme celui-ci, des textes de profond mépris pour le ruban bleu.
Notre mépris pour le RUBAN BLEU
Non pas pour les petites âmes individuelles bien intentionnées, mais pour l'idée en soi de paix démocratique.Si nous affirmons qu'il est faux le pacifisme du ruban bleu auquel on veut nous faire croire, ce n'est pas parce que la violence armée de l'ETA ou de toute autre organisation nous parait non critiquable mais parce que nous pensons que cette histoire de mobilisations contre "les violents" est un phénomène manipulé qui ne sert qu'à distraire de la corruption globale et légale sur laquelle repose le jeu du capital; de la violence quotidienne que l'Etat et le Capital exercent sur les populations, leur administrant la mort en vie; de la prostitution généralisée ou soumission à l'argent à laquelle on nous condamne, et enfin, à engourdir une politique d'en bas qui veut s'élever contre la domination de l'argent.
Vous embrassez les institutions démocratiques bourgeoises en proclamant votre foi en elles, et vous acceptez ainsi leur violence, la soumission, la tromperie. Aucun pouvoir ne peut se maintenir sans son Ministère des Mensonges, indispensable tant pour imposer ceux-ci aux populations que pour que les serviteurs du Capital et de l'Etat eux-mêmes les acceptent en toute bonne foi et puissent fonctionner comme de bons serviteurs. Le truc essentiel, c'est que la majorité -qui se convertit rapidement en tout ce qu'on veut- fasse ce qui lui est demandé mais à la condition que chacun croit qu'il agit de son plein gré, par sa propre volonté. On obéit comme les serfs au Pharaon. C'est la même chose. Notre production de gratte-ciel, de moyens de transport qui ne servent à rien de ce qu'ils disent. Notre prolifération de choses insensées sans aucune utilité réelle, finalement, c'est la même chose que la construction des pyramides pour l'éternité. La même majorité, le même aveuglement, mais cette fois se fondant sur la décision, le choix, la volonté de chacun.
Placez-vous au bord de n'importe quel trottoir pour observer les embouteillages qui se produisent grâce à l'auto personnelle (institution démocratique par excellence) et vous verrez comment, effectivement, tout le monde (la majorité) va plus ou moins à la même heure au même endroit, mais chacun pour son compte, avec sa voiture et par sa volonté. Rappelez-vous que ce tacot qu'ils nous vendent comme moyen de transport (et qui en réalité a entraîné la mort de transports utiles comme le tramway ou le chemin de fer) exige chaque fin de semaine et à chaque période de vacances le sacrifice régulier et progressif de milliers de vies, bien plus que tous les terrorismes réunis (sauf qu'il faut supporter la pollution, les autoroutes, les impôts, les petites guerres pour l'essence là-bas en bordure du développement...) Mais bien sur, on nous fait croire que c'est nous qui l'avons choisi, alors qu'il s'agit d'une obligation. Personne n'avait demandé l'automobile, c'est la domination du développement qui a nécessité la création de besoins afin de maintenir l'illusion que l'argent sert à satisfaire de tels besoins (qui ne l'étaient pas) pour continuer à faire travailler (sans nécessité), pour divertir les masses, et enfin, pour faire circuler le Capital et maintenir les institutions de l'Etat. Ensuite, le fait que des milliers de personnes meurent, il suffit de le camoufler sous le couvert de l'imprudence, l'accident, ou le hasard, bref quelque chose de naturel qu'on ne peut qu'accepter.
Autre chose qu'on nous fait croire, c'est qu'au travers de quelques fêtes électorales tous les x temps, le peuple se trouve représenté dans les institutions bourgeoises. C'est-à-dire que le calcul des opinions individuelles concernant les visages et les noms qui leur sont offerts équivaut au peuple. Quel énorme mensonge! Il en résulte donc que comme le peuple n'est rien d'autre que ce qui est en deçà de chacun, le commun, allons, il n'y a pas de Christ qui puisse le représenter (...).
La majorité, c'est la majorité de nos opinions (créées et dirigées par les moyens de formation de masses, la famille, l'école et, enfin, la morale) qui s'en laissent conter, qui se laissent compter et qui produisent un ensemble sur lequel s'assied le pouvoir. Mais d'aucune façon nous ne pouvons confondre cela avec la force de négation latente dans les coeurs qui n'ont pas été totalement soumis à la foi. Cette foi dans le fait que chacun sait ce qu'il veut, que chacun sait où il va, cette foi dans le futur, par laquelle on mène à bien l'administration de la mort.
Et comment font-ils? En ne faisant pas vivre les gens, en créant un présent vide avec l'excuse d'un meilleur futur, un présent non vécu en échange de son futur, de sa mort; car le futur est toujours la mort non déclarée (attente, temps vide qu'il faut remplir de quelque chose, ennui). Voyez la propagande, surtout à la banque (véritable église contemporaine). Remarquez comme on s'intéresse à ce que l'enfant ait déjà un plan d'épargne et même de pension! Qu'il commence à se sacrifier pour son futur, maintenant! (ou que quelqu'un le fasse pour lui, cela revient au même).
Voyez la façon dont s'est transformée la notion de voyage: on nous fait croire qu'un voyage signifie un tronçon vide permettant d'arriver à tel endroit de manière à ce que ni la destination ni ce qui se passe pendant le voyage n'ait d'importance. On crée un temps vide qu'il faut remplir de quelque chose, bien sûr (TV, musique,...). L'idéal à atteindre c'est que le vide ne soit rien de plus qu'une formalité bureaucratique. Ce critère, on peut l'appliquer à ce qu'on nous vend comme étant la vie. Depuis l'enfance on nous fixe des objectifs jusqu'à nous faire croire en leurs mensonges jusqu'à ce que nous les assimilions comme si c'étaient nos propres idées. Ainsi la mort nous arrive sans qu'on se rende compte de ce qui s'est passé.
Le travail que l'on fait est réellement inutile (étant donné qu'il n'obéit pas aux besoins réels mais à ceux du Capital). Quant à ce temps libre que l'on achète (loisir avec travail, paix avec guerre, gloire avec sacrifice, richesse avec épargnes des uns ou avec exploitation des autres), il ne peut être un temps de nature distincte de celle du temps de travail, de guerre ou de pénitence. Ce temps est vide. Tout comme la paix gagnée par la guerre n'est rien d'autre que la guerre non déclarée, ce qu'on appelle le temps libre en vient à être franchement du travail non déclaré, compté de manière très précise en fraction de temps (véritable monnaie de l'argent), 15 minutes de bonheur (dans un sauna thaïlandais), deux jours et demi de bonheur (dans l'évasion du week-end), 1 mois de bonheur (pour se griller au soleil méditerranéen): mais en secret on sait qu'une ration de bonheur doit avoir été coupée et déterminée par quelqu'un, comptabilisée. Et cela, on se l'offre au coeur comme un mensonge et à son désir comme une insulte. C'est un mensonge que l'on puisse vivre une tranche de vie libre à faire valoir sur une tranche de vie d'esclave; c'est simplement que l'un est dans l'autre et que "Le prix change le goût du bonbon".
Et ainsi, on se trouve devant une tentative d'administration de la mort, de domination parfaite, de réduction du peuple à une simple masse, entravée dans son aboutissement par le refus latent de se laisser réduire à cet ensemble et à cette idée. C'est la guerre du bon sens commun contre l'idée fixe et dominatrice.
On pourrait parler des misères que crée nécessairement l'empire du développement au-delà de ses limites, misères qu'en grande partie on supporte mais qui ne doivent pas nous faire oublier que ce que nous subissons ici n'est rien d'autre que la misère fortunée qui fait que la majorité vit de substituts: qu'on prenne les appartements pour des maisons, qu'on appelle toiles les plastiques, qu'on aspire à ne payer ni un chauffeur ni un wagon, mais plutôt à faire soi-même le chauffeur et que cela nous plaise... Vous aurez des tas d'exemples dans vos vies. On se rend compte à mesure qu'on y fait attention.
Qu'il soit clair que ce qu'on nous vend comme la paix n'est rien que la guerre et que le soi-disant système de libertés n'est rien d'autre que la même domination de toujours, améliorée, perfectionnée.
Que cette domination tombe donc ou qu'elle trébuche tout au moins, faute précisément de ce dont elle a le plus besoin: notre foi.
Ecrit trouvé à l'Université du Pays Basque.
Parallèlement nous avons montré que dans le cadre de cette guerre permanente, tous les capitaux tendent à s'investir, se déplacer, se concentrer et que dans ce sens, la théorie de l'existence de pays qui seraient impérialistes tandis que d'autres ne le seraient pas est totalement erronée et sans autre fondement que celui de servir de couverture idéologique à certaines fractions du capital mondial pour mobiliser des masses en leur faveur dans cette gigantesque guerre impérialiste pour la répartition du monde.
C'est à cela que correspond le concept d'"impérialisme" développé par la bourgeoisie pour préserver ses intérêts et canaliser la lutte prolétarienne vers une lutte interbourgeoise de libération nationale (1). Ainsi par exemple, en Amérique Latine, au siècle passé et au début de celui-ci, le prolétariat s'opposait globalement à l'ensemble de la bourgeoisie; mais après la défaite de la vague révolutionnaire qui ébranla ce continent et le monde entier, vont se développer (dès 1921, et sur base de la politique de l'IC) un ensemble de politiques "anti-impérialistes" qui mèneront toutes sans exception à la liquidation du prolétariat et à sa soumission aux intérêts de l'une ou l'autre fraction bourgeoise, considérée comme progressiste ou nationaliste. Ce sont très précisément ces objectifs qu'a systématiquement poursuivis la social-démocratie sous toutes ses variantes, depuis le marxisme-léninisme (stalinisme, maoïsme, trotskisme) jusqu'au populisme de masse (cardénisme, péronisme, varguisme) en passant par ses formes les plus radicales: libertaires ou guérilléristes. Ces courants, tous partisans de la libération nationale, s'accordent pour nous présenter invariablement l'impérialisme comme synonyme d'un pays ou d'un groupe de pays, cachant de cette manière la nature profonde du capital lui-même qui dans la réalité assujettit toute question d'espace géographique ou de drapeau national à ses nécessités d'accumulation. La valeur en procès se caractérise précisément par cette loi fondamentale qu'est la recherche permanente de la plus grande valorisation possible même si cela implique des changements permanents d'espaces géographiques, d'alliances, de drapeaux nationaux, de positions politiques, de coalition militaire.
La théorie dominante ayant cours à propos de l'impérialisme entend expliquer que le développement économique est inégal et polaire; en réalité elle est incapable d'expliquer quoi que ce soit, et encore moins la raison pour laquelle certains grands empires coloniaux, comme le Portugal, sont "moins développés" que d'anciennes colonies comme le Canada, les Etats-Unis ou le Brésil (nous utilisons ici la terminologie de nos ennemis -pays développés, moins développés, sous-développés-).
Nous n'allons pas expliquer ici notre conception globale du capital mondial et de son développement contradictoire. Pour nous opposer à l'idéologie dominante des pays développés et sous-développés, riches et pauvres, impérialistes et néo-coloniaux (une question sur laquelle -comme pour tant d'autres sujets- la droite et la gauche convergent parfaitement), nous allons simplement reproduire et souligner ici un article publié il y quelque temps dans The Wall Street Journal Americas, article qui nous parait montrer le fonctionnement réel du capital mondial, beaucoup plus clairement que tous les traités et écrits d'économie politique marxiste sur l'impérialisme.
Et effectivement, malgré son côté carré (n'oublions pas qu'il s'agit d'un journal d'affaires de la grande bourgeoisie) et paternaliste (le centre bourgeois international parle de ses alter ego latino-américains "sous-développés"), malgré le fait également qu'il fasse exclusivement référence à un groupe économique (l'entreprise Siderar et la famille Rocca), cet article illustre bien la réalité de la valeur en procès dépassant frontières et océans, s'associant, accaparant ici un marché, rompant là des alliances et en créant de nouvelles, s'adaptant à toutes les formes de domination bourgeoise (du fascisme à l'anti-fascisme en passant par les flics génocidaires d'Argentine)... se foutant des drapeaux nationaux ou s'en revêtant lorsque nécessaire et changeant de secteurs en fonction de la rentabilité. Il démontre que le développement même du capital ridiculise le concept de capital national (le concept de bourgeoisie nationale est lui-même un non-sens) et que la distinction de la bourgeoisie en fonction du secteur productif tel que cela se faisait au siècle passé a perdu en soi tout sens historique (2). Et pour finir, ce court article fait apparaître tel qu'on l'a répété à de si nombreuses reprises, que la détermination fondamentale du capital est le profit, et que les déterminations formelles et "matérielles" du capital -secteur économique, formes politiques, drapeau national, etc.- sont déterminées par un élément essentiel qui caractérise fondamentalement la formation sociale bourgeoise: le taux de profit. Autrement dit, le rythme de valorisation de la valeur détermine tous les autres éléments du capital: le secteur dans lequel il s'investira, ce qu'il produira, le parti politique qu'il défendra, le drapeau national dans lequel il se drapera.
The Wall Street Journal Americas
Siderar sort en bourse et scelle son succès.
La famille Rocca remet la sidérurgie argentine à flots.
Par Jonathan Friedlând
rédacteur du The Wall Street Journal
BUENOS AIRES - Lorsqu'il s'agit de sauver des compagnies, il est difficile de dépasser la Siderar S.A. d'Argentine. Voilà 3 ans, la vieille entreprise sidérurgique de l'Etat perdait plus de 1 million de dollars américains par jour. Cette semaine, Siderar a fait ses débuts sur les marchés financiers internationaux avec quelques solides profits.Une situation en bourse évaluée à 78 millions de US$, cela suppose plus qu'un modeste flux d'argent pour les actionnaires majoritaires de Siderar, la famille Rocca. Cela représente surtout une importante consécration de leur passage d'adjudicataires gouvernementaux à celui d'entrepreneurs mondiaux capables d'étonner Wall Street. "C'est grandiose de voir un groupe de gestion en Amérique Latine concentré sur une stratégie d'opérations internationale" dit José Levy, analyste de Bear Stearns & Co.
Les Rocca, qui passent leur temps entre Buenos Aires et Milan, sont devenus ces trois dernières années les plus grands pourvoyeurs mondiaux de pipe-lines sans couture, utilisés dans l'industrie du pétrole; ils gèrent, par le biais d'entreprises situées en Argentine, en Italie et au Mexique, quelques 31% des 2.000 millions de US$ qui composent le marché mondial des exportations. Ils jouent également un grand rôle dans les secteurs de l'acier, de la construction et de l'exploitation pétrolière, en plus de posséder des participations dans des compagnies argentines privatisées au début des années '90.
L'an passé, les recettes consolidées de son consortium, Organización Techint, atteignirent 2.800 millions de US$. Le groupe ne publie rien sur ses bénéfices ou sur d'autres données financières, mais les banquiers disent que les dettes de Techint sont faibles en comparaison de ses liquidités.
"Le grand secret de notre groupe c'est le taux élevé d'investissement dans nos principales affaires et notre prudence dans le payement des dividendes" déclare Agostino Rocca, directeur de Techint. "Nous pourrions absorber sans problème les fluctuations de l'économie argentine." Le grand-père de Rocca, qui dirigea l'Industrie italienne de l'acier sous le gouvernement de Benito Mussolini, s'enfuit à Buenos Aires en 1945. Soutenu par quelques industriels italiens et accompagné par un groupe d'ingénieurs loyaux, Agostino Rocca développa l'industrie argentine de l'acier pour un autre homme très puissant: le président Juan Perón.
Techint construisit de tout, des barrages comme des autoroutes, et devint en peu de temps, l'entrepreneur préféré du gouvernement. Ses installations, principalement à Campana, près de Buenos Aires, bénéficièrent de contrats très avantageux: l'entreprise vendait des pipe-lines à des prix gonflés à l'entreprise pétrolière de l'Etat après avoir acheté à prix réduits l'acier brut de la sidérurgie de l'Armée.
L'importance d'exporter
La bonne période toucha à sa fin avec la crise de la dette en 1980 et l'effondrement de l'économie argentine, mais, au lieu de fuir en Europe comme le firent de nombreux argentins fortunés, les Rocca purent voir l'importance des exportations. Ils injectèrent 600 millions de US$ sur le site industriel de Campana, le convertissant en l'unique producteur intégré de pipe-lines pour l'industrie pétrolière de la région. Sur le site, l'acier fondu est versé dans d'énormes moules, puis on passe au procès de fabrication et à la finition. Les pipe-lines s'en vont alors tôt ou tard pour le Moyen-Orient ou la Mer du Nord.Lorsque le patriarche de la famille mourut, en 1978, il fut enterré près du site. Plusieurs rues portent son nom et on a érigé une statue en son honneur. Ce côté paternaliste est encore très profond. La quasi totalité des cadres supérieurs de Techint ont commencé leur carrière avec la compagnie, ce qui est peu commun en Amérique Latine. Augustino Rocca, le directeur de 50 ans qui fut conseiller de Mc Kinsey & Co avant d'entrer à Techint en 1976, vit dans le même complexe urbanistique que son père à Buenos Aires. Ses deux frères Paolo et Gianfelice dirigent également des divisions de Techint.
La famille Rocca "est consciente que le capital et les actifs fixes, c'est comme des cartes de poker, ça va et ça vient" dit l'un des cadres de Techint. "Ce qui est vraiment important pour elle, c'est de disposer de personnes honnêtes."
L'importance que Techint accorde à son personnel a placé l'entreprise en bonne position lorsqu'en 1990, l'Argentine commença à tout vendre, depuis l'entreprise téléphonique jusqu'aux silos à grains.
La compagnie disposait de fonds recueillis lors d'une campagne d'exportations en 1980 quand elle avait décidé d'ouvrir des bureaux de marketing de Dubaï à Singapour; elle disposait également du personnel nécessaire pour analyser et gérer de nouvelles affaires. Techint se fit donc une place dans le secteur des routes à péages, investit dans une voie ferrée qui traverserait la région céréalière, elle prit une participation dans un gazoduc, elle mit la main sur quelques champs de pétrole et obtint une participation minoritaire dans la Telefónica Argentina S.A.
Elle dépensa également 140 millions de US$ dans l'achat de Somisa, l'entreprise sidérurgique de l'armée. En 1993, cette entreprise n'avait plus vu d'investissement depuis bien longtemps, elle était virtuellement dirigée par des militants syndicaux et avait un déficit accumulé de 900 millions de US$. "Somisa était hors de contrôle lorsque Techint prit les commandes" dit Steve Darch, président de ING Bank en Argentine, "la remettre en route a nécessité beaucoup de travail". Techint l'a fait rapidement. Elle a négocié avec les ouvriers, investi dans de l'équipement neuf, vendu l'usine d'énergie et d'autres actifs de l'entreprise et intégré les produits à son réseau de ventes.
En deux ans, les heures de travail par tonne d'acier se réduisirent de plus de la moitié, tandis que les exportations doublèrent largement, stimulées par les conditions favorables de la devise. L'entreprise qui aujourd'hui porte le nom de Siderar "se considère très compétitive" dit Stuart Quint, analyste de Montgomery Asset Management à San Fransisco. Les actions qu'on a commencé à négocier le mardi sont divisées en deux: celles qui se vendent à la Bourse de Buenos Aires et un placement privé de ADR pour investisseurs institutionnels des Etats-Unis et d'Europe. Les actions de Buenos Aires qui sont sorties sur le marché à 2,125 US$ ont fermé le mardi à hauteur de 11% à 2,35 US$. (Hier il n'y a pas eu d'activité boursière à Buenos Aires du fait des festivités du premier mai). Les ADR sortirent à 17 US$ et fermèrent hier à 19,25 US$.
Le cas Tamsa au Mexique
Les gérants de Techint firent également des merveilles en 1993 lorsqu'ils prirent les commandes de Tubes d'Acier du Mexique S.A. (Tamsa), manufacture de pipe-line pour l'industrie pétrolière dont le siège est à Veracruz. Lorsque sa ligne de produits s'intégra à Siderar, on y vendait de tout: depuis un jet Lear jusqu'à une participation à une compagnie de téléphone cellulaire. La dévaluation du peso mexicain qui fit s'effondrer une grande partie de l'industrie mexicaine, fut un soulagement pour Techint: Tamsa exporte 80% de son produit, tandis que ses coûts se calculent essentiellement en pesos.Techint a payé en janvier 190 millions de US$ pour l'entreprise italienne d'Etat Dalmine S.A. Cet achat place Techint, en qualité de premier producteur mondial de pipe-lines pour l'industrie pétrolière, devant les producteurs japonais et Mannesmann Gmbh en Allemagne, et cela à un moment où l'industrie exige de meilleurs produits et promet plus de bénéfices.
Ce fut également comme un retour à la maison. En son temps, le grand-père Rocca dirigeait déjà Dalmine sous le gouvernement de Benito Mussolini.