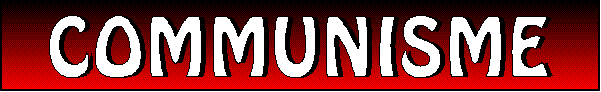
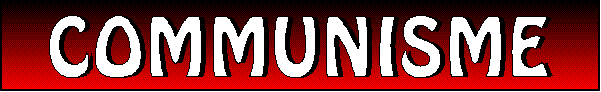
Cependant, l’action idéologique internationale de la contre-révolution réussit encore et toujours à nier socialement et mondialement cette réalité. On ne reconnaît pas le prolétariat dans ces luttes et on accepte encore moins d’assumer le caractère révolutionnaire de ces dernières.
Comme cela a toujours été le cas pour les luttes révolutionnaires dans l’histoire (les luttes révolutionnaires au Mexique et en Russie au XXè siècle étaient considérées comme des luttes paysannes face au féodalisme), les faits sont attribués à différentes couches sociales, voire même à des “ethnies”, qui, bien évidement, ne peuvent en tant que telles avoir une perspective révolutionnaire: lumpenprolétariat, paysans, indigènes, étudiants, habitants des banlieues et des bidonvilles, mineurs, ouvriers, petits-bourgeois, etc. Comme nous l’avons déjà souligné dans nos publications antérieures, cela contribue à maintenir les cordons sanitaires qui divisent le monde en régions et pays afin que les prolétaires d’autres régions ne se sentent pas solidaires de ces luttes. Cette question est fondamentale dans l’actuelle reproduction de la domination bourgeoise. Il est évident que ces mécanismes de domination fonctionnent parce que le prolétariat lui-même, au niveau international, n’a pas conscience de constituer une seule et même classe, ni d’avoir un projet social révolutionnaire, ce qui détermine (et est à la fois aggravé par) l’extrême faiblesse et l’isolement des noyaux révolutionnaires au niveau international.
Dans ce numéro, indépendamment de la thématique propre à chaque texte, nous voulons insister sur un axe central : l’analyse de cette négation du caractère révolutionnaire de la lutte du prolétariat. Une négation qui, de manière invariante dans l’histoire, part non de ce que la lutte contient d’antagonique à l’ensemble de la société actuelle, mais de ce que les protagonistes expriment, défendent comme consignes ou écrivent sur leurs drapeaux. Une négation qui se base également sur la propagande d’un ensemble de solutions bourgeoises, réformistes, gestionnistes, autonomistes que l’on tente d’imposer au mouvement dans le but de le limiter à l’horizon capitaliste et de l’éloigner de sa perspective révolutionnaire.
Le premier aspect de cette négation, nous l’analysons plus particulièrement dans “A propos des luttes prolétariennes en Argentine” (troisième partie), mais également dans les textes sur le Pérou et la Bolivie, en mettant en évidence, comme l’ont toujours fait les militants révolutionnaires, que la lutte du prolétariat est révolutionnaire par son contenu et non par ce qu’expriment les drapeaux du mouvement, sans quoi, il serait impossible de trouver une seule lutte révolutionnaire dans l’histoire. En ce qui concerne la lutte de classe en Argentine, reprenant des éléments déjà avancés dans des numéros antérieurs, nous insistons sur l’antagonisme pratique et général entre la société bourgeoise et les intérêts prolétariens, entre l’ensemble des expressions idéologiques du mouvement et la pratique objective du prolétariat, antagonique à la propriété privée et l’Etat. C’est sur cette base que nous affirmons l’alternative invariante: soit la catastrophe que ce système implique pour l’espèce humaine continue à s’aggraver, soit le prolétariat détruit de manière révolutionnaire l’Etat et le capitalisme.
Le second aspect de cette négation est constitué par les théories (ou mieux dit, les idéologies) à la mode qui nient cet antagonisme et tentent de présenter des solutions intermédiaires. Le dénominateur commun de ces idéologies est de présenter la possibilité de “changer le monde” sans la dictature révolutionnaire du prolétariat, c’est-à-dire sans la révolution sociale destructrice du capital et de l’Etat bourgeois. Le lecteur verra que cet axe est présent, à différents niveaux, dans tous les textes : dans les discussions à propos des luttes prolétariennes en Argentine, dans les critiques à Holloway, Negri et Hardt, dans les textes sur les luttes en Bolivie et au Pérou, dans la reproduction de textes et la dénonciation de l’incroyable histoire des colimaçons, de l’autonomie et des comités de bon gouvernement de Marcos au Mexique.
Ce à quoi nous lui avons répondu: “S’il fallait attendre que le prolétariat se soulève aux cris de ‘Dictature du prolétariat, destruction du capital’, pour pouvoir enfin appeler par son nom la violence de classe contre la propriété privée et l’Etat, jamais les révolutionnaires n’auraient d’occasion de le faire. Que ce soit durant la Commune de Paris ou pendant la révolution russe, ou lors de n’importe quel autre exemple historique de lutte révolutionnaire du prolétariat, jamais les mots d’ordre n’ont clairement exprimé ce que le prolétariat était alors en train de réaliser. Et nous n’allons pas énumérer ici la quantité de mots d’ordre carrément bourgeois qui étaient à la mode au sein de ces mouvements qui, malgré cela, ont constitué une expression concrète et internationale de la ‘violence révolutionnaire du prolétariat’. Ce sont précisément nos ennemis, et plus généralement l’opinion publique, qui envisagent les choses uniquement sur base de ce que les protagonistes disent ou s’imaginent (et qui sont invariablement et inévitablement les idées de la classe dominante). Les militants révolutionnaires, quant à eux, n’ont aucune crainte à affirmer le contenu réel du mouvement, à contre-courant et indépendamment de ce qu’en disent les protagonistes. Souviens-toi de Blanqui ou de Marx, lorsqu’ils affirmaient que le prolétariat en France luttait pour sa propre dictature, ou encore de Ricardo Flores Magón qui soutenait que la lutte du prolétariat au Mexique était une lutte pour l’abolition de la propriété privée, de l’église et de l’Etat. Ces affirmations à contre-courant du contenu du mouvement, émises par ces révolutionnaires du passé, constituent en outre un élément décisif de l’action révolutionnaire de direction. Le renversement de la praxis au sein du prolétariat s’opère précisément par cette pratique décisive, par l’organisation de ces affirmations en force de direction vers les objectifs réellement révolutionnaires. En ce sens, il nous paraît non seulement important de continuer à affirmer le caractère révolutionnaire du mouvement du prolétariat en Argentine, en 2001-2002, mais tout aussi crucial de dénoncer les mots d’ordre bourgeois, notamment ceux du fameux sous-commandant Marcos, comme nous l’avons fait dans notre texte, en dénonçant les courants gestionnistes qui sont précisément ceux qui développent cette idéologie antagonique à l’action révolutionnaire du prolétariat ”.
En synthèse, on peut dire que la lutte du prolétariat est révolutionnaire par son contenu, parce qu’elle assume dans la pratique son antagonisme au capitalisme, et non pas en fonction de ce qu’en disent les protagonistes et encore moins sur base de ce que peuvent proclamer les fans de Marcos et compagnie (évidemment présents aussi en Argentine) qui, fondamentalement, ne font que reproduire l’idéologie de la bourgeoisie au sein du mouvement.
Pour éclaircir ce qu’entendent les révolutionnaires par lutte révolutionnaire, précisons d’abord, que contrairement à ce que théorise la social-démocratie (marxisme-léninisme, trotskisme, proudhonisme, gestionnisme libertaire inclus), il n’y a pas deux sortes de lutte, l’une économique, l’autre politique, l’une immédiate, l’autre historique, l’une revendicative et l’autre révolutionnaire. Rappelons ensuite que cette séparation idéologique constitue une arme redoutable aux mains de la bourgeoisie à l’encontre du prolétariat, arme qui a longtemps servi et sert encore à perpétrer ses pires horreurs: par exemple, pour faire bosser toujours plus les prolétaires et les payer toujours moins au nom de la révolution sociale et/ou du socialisme (aujourd’hui à Cuba comme hier en Russie), alors qu’en réalité, tout le monde l’aura compris, il s’agit d’augmenter le taux d’exploitation capitaliste, en totale opposition évidemment aux objectifs (immédiats et historiques) d’une révolution prolétarienne. Aucune véritable révolution prolétarienne ne peut se développer sur la base de cet antagonisme. Tout au contraire, la généralisation de la lutte pour les besoins immédiates détermine la révolution sociale: l’objectif invariant de la révolution prolétarienne est de travailler le moins possible et de vivre le mieux possible, objectif qui en fin de compte, est exactement le même que celui pour lequel luttait l’esclave quand il s’opposait à l’esclavage, il y a de cela 500 voire 3000 ans. La révolution prolétarienne n’est pas autre chose que la généralisation historique de la lutte pour les intérêts matériels de toutes les classes exploitées de l’antiquité, sa nature n’est pas différente de cette généralisation historique de la lutte pour les intérêts immédiats, économiques du prolétariat, et c’est exactement pour cela qu’elle s’affirme comme une révolution essentiellement humaine, contre la déshumanisation historique de l’homme menée à son expression maximale par le capitalisme. Par conséquent, la lutte pour l’amélioration absolue des conditions de vie est révolutionnaire, vitale et elle ne réalisera ses objectifs que par l’affirmation de la révolution (2). La lutte du prolétariat pour l’appropriation de la plus grande partie du produit social est donc inséparable de sa lutte pour la réduction de l’intensité et de l’extension de la journée de travail. C’est dans ce processus d’affrontement au capital et à sa concentration en force de domination (Etat) que le prolétariat s’approprie pas à pas tout ce qui est produit, et abolit le travail salarié et, en dernière instance, le travail tout court.
En Argentine, le prolétariat entre en lutte parce qu’il n’a pas d’autre issue face à la détérioration brutale de ses conditions d’existence. Dans ce processus, il se retrouve inévitablement confronté aux différentes fractions bourgeoises et à l’Etat. Dans sa pratique, il liquide la fameuse séparation entre l’économique et le politique par le simple fait qu’il ne peut y avoir de solution économique sans “faire de politique”, ou mieux dit, sans une opposition totale à toute la politique de la classe dominante. Cette affirmation n’est pas le fruit de quelques élucubrations proférées par l’un ou l’autre militant, elle peut être vérifiée par tous dans la pratique: c’est aux cris de “qu’ils s’en aillent tous” que s’est exprimée, en Argentine, la critique généralisée de la politique, présente dans la généralisation de tout mouvement révolutionnaire. D’aucuns prétendront pourtant que, pour certains prolétaires, voire même pour l’ensemble du prolétariat, la lutte ne se borne qu’à des préoccupations immédiates. Ce à quoi nous répondrons que, même s’ils ne croient se mobiliser que pour ces fameux intérêts immédiats (affirmation totalement absurde puisque le développement même de l’associationnisme prolétarien, en opposition à la propriété privée organisée, suppose toujours des éléments, même balbutiants, portant à la résolution de l’antagonisme de classe), la lutte elle-même révèle l’antagonisme historique. Indépendamment de la conscience qu’en ont les protagonistes, les faits mettent en évidence que la vie du capital rend toujours pires les conditions immédiates des prolétaires et démontre donc que le progrès du capital exige l’aggravation des conditions de la vie humaine. L’unité de l’immédiat et de l’historique n’est pas une question de conscience, mais d’antagonisme pratique vital. Comme le disait Marx: “Peu importe ce que tel ou tel prolétaire ou même ce que le prolétariat tout entier s’imagine être son but, momentanément. Ce qui importe, c’est ce qu’il est réellement et ce qu’il sera historiquement contraint de faire conformément à son être. Son but et son action historique lui sont tracés visiblement et irrévocablement, dans les circonstances mêmes de sa vie comme dans toute l’organisation de la société bourgeoise”.
Le caractère révolutionnaire de la lutte du prolétariat en Argentine ne surgit donc pas de la conscience qu’il aurait de ses objectifs, mais de sa pratique effective. Et précisément, ce que nous constatons c’est que le décalage, entre la pratique et les niveaux de conscience explicites (3), exprimé par le mouvement est encore plus considérable que ce qui en a été dit. Et s’il nous semble indispensable de souligner la force révolutionnaire de l’action du prolétariat, nous ne pouvons nous empêcher de pointer la faiblesse de conscience, de direction, qu’a affiché le mouvement.
Le mouvement révolutionnaire se voit encore cadenassé par un ensemble d’illusions qui le limitent quant à ses perspectives, et c’est à cela que se réfèrent les camarades lorsqu’ils disent que cette lutte n’est pas révolutionnaire. Mais ce point de vue est idéaliste car il s’appuie, non pas sur les déterminations contenues dans le mouvement, sur l’opposition objective entre deux projets antagoniques, mais sur les idées exprimées.
La principale faiblesse du mouvement, c’est justement l’illusion existant en son sein et consistant à penser qu’il puisse y avoir une solution non révolutionnaire à la situation sociale. Sa principale limite idéologique, c’est de partir des idées aberrantes de la majorité qui, même en plein milieu de la lutte, se figure pouvoir solutionner les problèmes qui nous affectent sans passer par la destruction des fondements mêmes de la société du capital. Ce décalage, dont nous avons déjà parlé, semble être une caractéristique qui se confirme dans les mouvements prolétariens actuels, et est sans doute produit par la contradiction entre la catastrophe de plus en plus visible du capital mondial et la totale inconscience de classe qui caractérise le prolétariat mondial: inconscience de constituer une classe, inconscience du projet historique communiste.
Dans les chapitres suivants, nous reviendrons sur cette contradiction particulière au développement de notre mouvement. Pour ce faire, nous allons débuter par l’énumération de quelques éléments de force, propres au type d’organisation territoriale caractéristique du mouvement en Argentine, non pas pour faire l’apologie de cette expérience particulière (les conditions qui ont produit ce mouvement existent aujourd’hui sous d’autres latitudes et tendront à se généraliser), mais dans le but d’entrer plus profondément dans l’analyse des caractéristiques des luttes de classes actuelles et de mettre en exergue les “nouveaux” éléments de force et de faiblesse qui, selon nous, ne constituent en aucun cas un “privilège” ou une “difficulté” particulière à ce pays mais, comme l’exprime très bien la “lettre ouverte au prolétariat argentin” publié dans la revue n°54 (“vosotros sois tan solo unos de los primeros”, “vous, vous êtes seulement parmi les premiers”), indiquent le type d’affrontements de classe qui tendra à se reproduire (4).
Il est indispensable d’analyser cette contradiction parce que c’est en elle que s’insère la pratique révolutionnaire actuelle.
Inutile de préciser que les points soulignés ci-dessous sont, en réalité, des éléments inséparables et s’enchevêtrant les uns aux autres. Si nous les avons fragmentés de la sorte, c’est uniquement pour mieux nous faire comprendre.
• Le premier élément qualitatif se manifeste dans la constitution du prolétariat en classe (5), dans son organisation en assemblées territoriales, en opposition aux pouvoirs de l’Etat. Assemblées de piqueteros, ensuite assemblées de quartiers qui, dans bien des cas, centralisent ou au moins se coordonnent avec d’autres structures, telles les assemblées de certaines usines, d’imprimeries, de travailleurs en lutte, de comités de quartiers, de services (soulignons le fameux cas des “motoqueros” (6)), du secteur publics et organisent également des assemblées d’assemblées, appelées des Coordinadoras, etc. Ce niveau d’organisation revêt une importance primordiale dans la mesure où elle traduit une rupture non seulement avec les illusions individuelles et individualistes, dérivées directement du marché et de son image spectaculaire, mais aussi avec la planche de salut que pouvait encore représenter la profession ou la corporation. La catastrophe de la société capitaliste a réduit en poussières toutes les promesses d’avenir meilleur, et mis en évidence le fait que ce n’est qu’organisé en classe que le prolétariat peut aspirer à défendre ses intérêts les plus immédiats. Cette organisation du prolétariat en classe révèle non pas une conscience explicite de la nécessité d’agir comme force prolétarienne, mais traduit au moins une conscience implicite du fait que seuls, nous ne sommes rien, qu’il est vain de s’unir par catégorie professionnelle, et qu’exclus ou inclus (selon la séparation idéologique de la bourgeoisie), si l’on se s’unifie pas, on est foutu! C’est précisément cette unification territoriale entre hommes et femmes, chômeurs, travailleurs, retraités, pensionnés, employés, étudiants,… qui confère un caractère exceptionnel à la lutte.
• Ceci détermine un second élément qualitatif qui se concrétise dans le fait que les structures associatives du prolétariat se sont directement constituées en assumant les problèmes globaux, concernant l’ensemble de la communauté entrée en lutte. La moindre revendication sectorielle, catégorielle, syndicale,… s’est avérée totalement absurde et ridicule, ce qui a sérieusement limité l’action contre-révolutionnaire des différents appareils de l’Etat (pouvoirs municipaux, partis, syndicats, institutions, ONGs,…) destinés principalement à canaliser et endiguer légalement le mécontentement. Ou pour le dire autrement, comme la structuration du prolétariat en tant que classe du capital se base sur cette séparation (et que tous les appareils de domination sont prévus pour pouvoir répondre sur cette même base), l’unification territoriale implique toujours, historiquement, un saut de qualité dans l’organisation du prolétariat en tant que classe contre le capital.
• Cependant, cette généralité, cette globalisation n’est pas abstraite, comme c’est le cas pour l’unité démocratique formulée par un gouvernement, un parti ou la télévision qui, au nom du peuple ou de la nation, se fonde sur la renonciation consciente ou inconsciente de ses propres intérêts particuliers. Tout au contraire, à travers l’unité qui se développe dans l’action telle qu’elle s’est déroulée en Argentine, personne n’a renoncé à rien. Pour la première fois dans leur vie, beaucoup de prolétaires ont agi en fonction de leurs propres intérêts particuliers et c’est dans la partie qu’ils ont retrouvé la totalité, qu’ils ont trouvé les intérêts du prolétariat comme totalité; dans la défense de leurs intérêts immédiats et particuliers, ils se sont ressentis organiquement, comme faisant partie du prolétariat en tant que totalité en lutte. Dans chaque quartier, dans chaque action de piqueteros, dans chaque entreprise, dans chaque usine occupée, on a ressenti la nécessité d’assumer l’action, le combat, la discussion… autour d’une lutte qu’on a vécu pour la première fois comme unique, dans chaque endroit on a commencé à vivre la lutte comme une totalité organique.
• La production matérielle en fonction de la lutte et des besoins de ceux qui luttent (boulangeries, potagers…), l’organisation de services au sein même des quartiers, totalement désertés par les structures de l’Etat et indispensables à la lutte (les services de santé, par exemple), la mise au service du mouvement de certaines usines occupées (les imprimeries), ont constitué une importante affirmation révolutionnaire du prolétariat, ébauchant, ne fut-ce qu’élémentairement et grossièrement, une société où ce ne serait pas le marché et le taux de profit qui dirigeraient tous les aspects de la production matérielle, mais la dictature des producteurs et de leurs besoins humains. Il est évident que ce type de pratique est extrêmement difficile à maintenir à longue échéance, surtout en dehors d’une période de lutte ouverte. Cette difficulté est encore accrue par l’importance actuelle de l’idéologie gestionniste en Argentine, idéologie qui, alliée aux idéologies en faveur du troc, de l’autogestion et de la “non-lutte pour le pouvoir”, rend d’autant plus indispensable la critique permanente de la soi-disant possibilité de changer la société sans détruire la dictature marchande (7).
• Toutes ces structures, au travers desquelles le prolétariat s’affirme comme force sociale, sont assumées en opposition totale au pouvoir de la classe dominante et agissent en tant que telles. Agir et non déléguer, agir comme nécessité vitale et surtout agir en tant que force contre l’Etat, constitue l’axe unificateur. L’action directe apparaît ainsi comme une question de vie ou de mort, comme l’objectif explicite de toutes ces assemblées.
• Simultanément, ce passage à l’action passe par la discussion, par la réunion, par le fait d’assumer qu’il ne faut avoir confiance en personne sinon en “nous-mêmes”. Ceci implique un processus de négation de toutes les structures d’autorité et de gestion de la société bourgeoise, de toute la structuration de la domination démocratique. Le mécontentement généralisé se transforme dès lors en capacité d’agir et de penser collectivement et unitairement. Des forums, des discussions, des formations, des cours sont organisés dans les quartiers, des locaux et des biens sont occupés, la propriété privée se voit défiée, ainsi que les structures juridiques qui la protègent. Dans cette action théorico-pratique se trouve contenue l’ensemble de la critique implicite de la délégation, du parlementarisme, voire même les premiers balbutiements de la critique de la démocratie.
En raison du caractère contradictoire qu’ils contiennent, nous mentionnerons particulièrement les désirs d’horizontalité, de “démocratie directe”, de lutte contre le verticalisme, de lutte de la base contre la direction présents au sein du mouvement. Si, d’une part, la critique des syndicats et des partis va s’afficher ouvertement, et en ce sens, une rupture embryonnaire avec tout le spectre politique, de même que l’affirmation d’une structuration de la communauté de lutte recherchant les formes adéquates à son développement, on va retrouver, d’autre part, une fétichisation des formes de décision, vues comme garanties en soi. Signalons à ce propos que la fétichisation de la forme, l’idéologie de la démocratie de base, maintient encore, aux quatre coins du monde, les masses prolétariennes enchaînées à des formes horizontales de décisions, les empêchant de voir que l’importance réside dans le contenu de la décision et non dans sa forme. C’est la perspective et la direction du mouvement qui est importante, non le fait que la décision soit adoptée par une majorité ou par une minorité, ce qui n’a jamais constitué et ne constituera jamais une garantie en soi. C’est pourquoi il s’avère indispensable d’analyser, ne fut-ce que sommairement, la face cachée de ces assemblées.
Par ce biais, la critique des partis, des syndicats et autres structures de l’Etat est également réduite à une simple critique de la forme: on les critique pour leur bureaucratisme, leur corruption, mais rarement parce qu’ils représentent la classe ennemie, parce que ce sont des partis et des syndicats du capital, de l’Etat bourgeois. On ne voit pas que le pourrissement généralisé des fractions politiques, syndicales, judiciaires,… de la bourgeoisie argentine est l’expression même de la pourriture du système social capitaliste. Ce qui explique la recherche désespérée de garanties dans le contrôle politique citoyen. Les décisions prises à la base sont considérées comme une garantie en soi, oubliant ainsi le fait que le capitalisme s’impose aussi au moyen de décisions démocratiques prises par tous, que les impressionnantes conditions d’exploitation qu’impose le système ne peuvent être détruites qu’en s’attaquant aux bases mêmes de la production de marchandises.
Pire encore, prétendre opposer démocratie à bureaucratie, c’est ignorer que démocratie et bureaucratie ont toujours fonctionné de pair, que toute démocratie, même de base, produit de la bureaucratie, que le système électoral, basé sur l’individu démocratique, produit nécessairement l’individu bureaucratique. Demander à la démocratie de liquider la bureaucratie, c’est comme demander à l’entreprise capitaliste de sauver l’humanité et d’oublier son essence même: le profit.
La totalité de la critique anti-bureaucratique reste ainsi embourbée dans le cloaque démocratique, dans cette puante et misérable idéologie bourgeoise de l’individu contrôlant majoritairement ses représentants, du citoyen imbécile et impuissant luttant pour que ses dirigeants politiques ne pourrissent pas. L’absence de vision sociale fait triompher le formalisme politique. Faute de programme social ouvertement révolutionnaire, on tombe dans la solution politique: le démocratisme, le contrôle politique de tout et, en dernière instance, l’apologie de la base, de la majorité (ou de l’unanimité).
La démocratie, mode d’organisation de la société capitaliste et de la dictature du capital par excellence, dont la force réside en la dissolution, dans l’individu atomisé, de toute force ou projet historique antagonique, ne peut servir la lutte du prolétariat, ni comme méthode d’organisation, ni comme perspective (idéologies du socialisme démocratique) (8).
A ce propos, ouvrons ici une petite parenthèse pour rappeler qu’il ne manque pas d’exemples historiques où des majorités, sous le contrôle de tous, ont adopté des décisions totalement contraires aux intérêts du mouvement, et où des minorités révolutionnaires ont assumé des décisions qui ont fait avancer l’ensemble du mouvement. Aucun mouvement révolutionnaire n’a pu avancer et ne pourra le faire, sans l’audace de minorités assumant organiquement les intérêts de la totalité, sans l’action de prolétaires d’avant-garde qui, sans consultation démocratique préalable, conspirent et s’organisent clandestinement, sans militants qui, à contre-courant, affirment le caractère prolétarien et révolutionnaire d’une lutte là où prédominent les illusions démocratiques, sans la présence de ceux qui, au sein des assemblées ou des soviets dominés par des idées de pacification sociale, ou au sein des assemblées constituantes, indiquent et assument la voie de l’insurrection.
L’idéologie de la démocratie de base, de la démocratie directe, du contrôle démocratique en assemblée, de l’horizontalisme (qui ne prédomine pas qu’en Argentine, mais aussi un peu partout dans le monde, y compris dans des moments de lutte), amène à prendre les décisions en fonction du plus petit commun dénominateur, qui est toujours bourgeois et réformiste, avec, pour résultat objectif, l’isolement des minorités en rupture avec l’idéologie dominante. Dans ce contexte démocrate, les positions révolutionnaires sont vues comme étant “trop théoriques”, “trop abstraites”, “trop politiques”. C’est le réformisme le plus plat qui prédomine, sous forme de gestion du quotidien. La soumission de la vie humaine à la dictature du capital et la nécessité de la révolution sociale qui en découle, questions centrales s’il en est, sont évacuées au nom de l’unité: il faut “être pratique”, “il ne s’agit pas de prendre le pouvoir, mais de développer un contre-pouvoir”, “il faut faire des choses concrètes et non discuter de politique”. Et comme toujours dans l’histoire, la théorie contre-révolutionnaire, exhibée comme une nouveauté, se concentre sur la liquidation de l’aspect le plus important de la perspective révolutionnaire: la question du pouvoir, la question de la révolution sociale.
Le lecteur comprendra donc que l’importance que nous donnons aux discussions sur la lutte de classes en Argentine, réside dans le fait que ces discussions transcendent, et de loin, ce qui s’est posé dans ce pays et qui se posera inévitablement et plus puissamment encore sous d’autres latitudes.
Les conceptions dominantes servent toutes à camoufler, dévier, entraîner sur des voies de garage la puissance et la force développée par le prolétariat.
Contre la gauche bourgeoise (contre la social-démocratie, c’est-à-dire contre le léninisme, contre les staliniens et leurs variantes trotskistes, contre l’idéologie des groupes guérilleros marxistes-léninistes et/ou nationalistes), les communistes ont toujours affirmé qu’il ne s’agit pas de prendre le pouvoir de l’Etat mais de le détruire, qu’il ne s’agit ni d’occuper l’Etat bourgeois ni de gérer le capitalisme à l’instar des bolcheviks (pratique théorisée plus tard par le marxisme-léninisme), mais qu’au contraire il faut détruire l’Etat et le capital (9). Pour les révolutionnaires, la révolution du prolétariat n’est pas une révolution politique, visant à occuper l’Etat et à gérer le capital, c’est une révolution sociale qui s’affirme comme pouvoir, comme puissance sociale contre la société marchande et l’Etat capitaliste. Si la clé du capitalisme est la dictature de la valeur se valorisant, la clé de la transition révolutionnaire réside dans la dictature du prolétariat abolissant le travail salarié, autrement dit, dans la dictature des besoins humains contre toutes les lois marchandes, jusqu’à l’abolition même de la marchandise et l’instauration de la communauté humaine mondiale.
Bien sûr, certains autres secteurs de la gauche bourgeoise, qui hier s’autoproclamaient libertaires ou autonomes et s’affichent aujourd’hui comme post-modernes, markistes (du sous-commandant Marcos), alternatifs ou alter-mondialistes, n’hésitent pas à reprendre cet abc à leur compte. Mais ils ne le font pas pour affirmer la nécessité d’une révolution sociale qui détruise le capital et l’Etat, mais au contraire pour s’opposer à cette révolution au nom d’une rébellion qui n’a pas pour objet la destruction du pouvoir du capital. Ils font mine d’ignorer ou nient purement et simplement, que seul le développement de la force destructive révolutionnaire peut simultanément organiser une société nouvelle. Comme l’a résumé le camarade précédemment cité, la mode aujourd’hui est d’affirmer : “Nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous sommes des rebelles sociaux”, “Nous ne voulons pas prendre le pouvoir, nous voulons construire un autre pouvoir, issu de la base…” sous-commandant Marcos ”.
Evidemment, cette théorie contre la révolution, comme tout ce que le capital produit matériellement et idéologiquement, est présenté comme nouveau (à l’instar des autres marchandises, la mode du nouveau étant inhérente à la phase actuelle du capital), en affirmant que désormais la “vieille” opposition entre réformisme et révolution est dépassée. Pas besoin d’être une lumière pour reconnaître, derrière ce soi-disant dépassement, la vieille théorie réformiste en putréfaction, utilisant pour l’occasion de nouvelles et attrayantes formulations. La clé du réformisme reste cependant identique, son essence n’a pas bougé d’un iota: la possibilité de changer le monde, petit à petit, sans révolution sociale, sans détruire le capital et l’Etat. En d’autres termes, le réformisme développe une propagande contre la révolution, qui, selon lui, n’est plus nécessaire pour “changer le monde”.
La théorie de ces contre-révolutionnaires (explicitement ou implicitement, c’est effectivement ce qu’ils sont) se manifeste aujourd’hui en affirmant que l’on peut “changer le monde, sans prendre le pouvoir”, comme le défend le titre même de ce livre cité un peu partout, et dont l’auteur est un certain John Holloway. Ce courant de pensée soutient que la guerre de classes (qu’implicitement, ils nient) s’éteindra sans que la dictature du prolétariat, et donc la destruction de la dictature du capital, ne soit nécessaire. C’est donc en toute logique, l’entièreté de la social-démocratie qui sympathise avec ce courant incarnant ce que ce parti historique a toujours représenté. Ses principaux représentants se nomment Antonio Negri, Michael Hardt, John Holloway, le sous-commandant Marcos et ses disciples, de même que toute une série de groupes (comme le collectif Situaciones, déjà critiqué dans un numéro précédent) aux quatre coins de la planète. Leur terminologie est la copie conforme de celle qu’utilisent les milieux autoproclamés alternatifs lorsqu’ils font leur show: autogestion, dignité, multitude, réseaux diffus, contre-pouvoir, économie alternative, horizontalité,… on en passe et des meilleures.
Il ne s’agit évidemment pas uniquement de théories ou d’idées dénuées d’importance, elles revêtent au contraire un réel poids social. En effet, au fur et à mesure que le prolétariat tente de rompre avec l’encadrement politiciste et populiste du gauchisme classique (marxisme-léninisme, trotskisme,…), comme on a pu le constater en Argentine et ailleurs, les vieilles théories réformistes, gestionnistes et libertaires sont remises au goût du jour (et donc appelées à jouer un rôle contre-révolutionnaire important) grâce à un efficace ravalage de façades (nouvelles formules, nouvelles phrases, nouvelles terminologies, rien que du neuf !) et à une solide dose de propagande internationale. Alors que, de leur côté, les révolutionnaires du monde entier sont persécutés, emprisonnés et coupés de toute forme de diffusion, ce genre de théories, qui clament que la révolution ne sera pas nécessaire pour changer le monde, jouit de toutes les condescendances possibles et imaginables auprès des grands médias, et les discours de leurs représentants sont diffusés par les télévisions nationales, ou à l’occasion de grandes conférences organisées dans les meilleures universités. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, on doit subir la croisade d’un idiot de l’acabit de John Holloway, qui parcourt le monde pour annoncer sa bonne nouvelle : “il est possible de changer le monde sans prendre le pouvoir”. Et, comme une horloge bien huilée, on va le retrouver dans les endroits considérés comme les plus chauds du point de vue de la lutte de classes, Colombie, Chiapas, Buenos-Aires,… distillant sa propagande en faveur de cette “nouveauté”. Le livre a même été présenté à Buenos-Aires, par l’auteur en personne, dans un local de piqueteros du “MTD” Solano (Mouvement des travailleurs au chômage) ! C’est dire l’importance de s’affronter à de telles positions ! Quand serons-nous capables d’escracher ce type de sujet ?
Invité au 180è anniversaire de l’Université de Buenos-Aires, en juin 2001, John Holloway a déclaré à propos du Mouvement Sans Terre du Brésil et des zapatistes: “…Et ces mouvements, avec toutes leurs différences, ont en commun le fait qu’ils ne tentent pas de conquérir le pouvoir de l’Etat, ni militairement, ni électoralement. Ils ne conçoivent pas la violence comme un moyen de transformation du monde. Et bien que leurs actes ne soient pas clandestins, ils défient ouvertement le pouvoir”. Comme si la non-violence et la non-clandestinité constituait une vertu moderne, édulcorée qui plus est, d’un clin d’œil au légalisme! Comme si Bernstein n’avait jamais été critiqué! Comme si concevoir la transformation du monde, sans la violence révolutionnaire était d’une quelconque originalité!
Les livres de ces auteurs à la mode ne traînent franchement pas sur nos tables de nuit et il nous en a coûté d’avaler l’immonde traité de conservation de la société produit par le Sieur Negri, afin de publier les commentaires et extraits que l’on trouvera plus loin dans cette revue. Pour la même raison, aucun d’entre nous n’étant disposé à se dévouer pour lire cette autre merde qu’est le livre de John Holloway, nous avons décidé de reprendre une critique qui nous a semblé intéressante et valable. Nous la reproduisons ici, malgré certains problèmes et désaccords, sans en connaître ni la source, ni l’auteur (10).
Toutes ces positions, opposées à la lutte pour le pouvoir, se basent sur la théorisation des faiblesses du prolétariat. Comment opère-t-on ? Et bien, par exemple, on prend la critique ébauchée par le prolétariat en Argentine à propos de la démocratie représentative et répressive et la critique des organisations gauchistes qui la défendent (et prônent l’assemblée constituante et autres réformes démocratiques comme perspective), et on constate que dans cette lutte on ne parle pas explicitement de la destruction révolutionnaire du capitalisme. Que font ces messieurs ? Au lieu de critiquer cette faiblesse, ils font l’apologie du manque de perspective que cela génère, comme si le “contre-pouvoir” de la rue était en soi une alternative!
Que ce soit bien clair, le contre-pouvoir, s’il n’est pas réduit à un simple jeu de mots, n’existe que s’il agit CONTRE LE POUVOIR du capital, s’il s’y oppose pratiquement et insurrectionnellement. Son objectif doit être la destruction du pouvoir du capital, autrement dit, la dictature de ce contre-pouvoir détruisant pratiquement la société bourgeoise. Dans le cas contraire, les rapports marchands d’une part, et l’inefficacité politique de tout gestionnisme populaire face à l’Etat capitaliste d’autre part, finissent inévitablement par détruire ce contre-pouvoir, par le dissoudre pratiquement dans la société civile. C’est au moment où le prolétariat doit opérer un saut de qualité que le rôle de ce genre de théories, qui veut “changer le monde sans prendre le pouvoir” (ce qui revient pratiquement à dire sans destruction révolutionnaire du pouvoir du capital), montre toute l’ampleur de sa force contre-révolutionnaire.
Ce qu’il y a de plus désolant là-dedans, c’est le manque de critiques et de dénonciations de ces positions contre-révolutionnaires (et nous ne considérons pas comme critiques dignes de ce nom celles qui émanent du parlementarisme ou de ceux qui ne jurent que par l’assemblée constituante), ce qu’il y a de plus triste, c’est la voie royale offerte au gestionnisme et à tout ce discours à la mode sur le “pouvoir de base” en Argentine qui, nous le répétons, s’oppose à l’indispensable révolution sociale. L’absence de conscience explicitement révolutionnaire, le manque de minorités révolutionnaires, pèsent terriblement sur notre mouvement. De ce point de vue, le mouvement du prolétariat en Argentine, en 2001-2002, est effectivement moins profond que beaucoup d’autres mouvements prolétariens du XXème siècle, non seulement en regard de la grande vague révolutionnaire de 1917-21, mais également en ce qui concerne les mouvements des années 1966 –73, période durant laquelle la question de la révolution sociale s’est ouvertement posée, et des minorités plus ou moins claires mais avec une incidence sociale certaine ont tenté de la mener à bien dans certaines villes des Etats-Unis, de Chine, d’Italie, de France, d’Espagne, du Pérou, du Mexique, du Chili, d’Uruguay, en Argentine également, tout comme, quelques années plus tard, dans bon nombre de pays du Moyen-Orient.
Même si nous ne nions pas la conscience implicite du mouvement, qui a rendu possible tout ce que le prolétariat a affirmé et que nous avons déjà souligné, il nous faut pourtant constater combien l’inconscience de classe du prolétariat est profonde, combien sa méconnaissance du programme révolutionnaire, le manque de critiques ouvertes et explicites de la société marchande (reflété par toutes les illusions sur l’économie alternative) et, plus particulièrement, le manque de présence de la théorie révolutionnaire concernant la destruction de l’Etat sont criants. C’est d’autant plus manifeste lorsque les discussions dominantes restent coincées entre une théorie réformiste qui prône la prise du pouvoir et une théorie réformiste qui prône la non prise du pouvoir, sans que jamais ne s’affirme face aux deux, la théorie révolutionnaire sur la destruction du pouvoir bourgeois.
Bien entendu, les décennies de contre-révolution internationale, la rupture de la relation organique et théorique avec les mouvements révolutionnaires du passé, les dizaines de milliers de militants massacrés par la terreur d’Etat ou détruits par l’isolement qui a suivi “le retour à la démocratie”, pèsent profondément sur le mouvement du prolétariat en Argentine. C’est pourquoi les préoccupations portent plus sur la meilleure façon de gérer l’usine occupée que sur la meilleure façon de faire la révolution, et il n’est pas jusqu’à l’Université des Mères de la Place de Mai de s’interroger sur la façon de rendre les usines autogérées rentables! Quels que soient les arguments utilisés pour justifier cette soumission aux lois despotiques du capital, à nos yeux ils ne font que confirmer le caractère profondément réactionnaire de ces idéologies pro-économie alternative et “contre-pouvoir”. Si les besoins d’extension et de radicalisation du mouvement contre la dictature du capital ne parviennent pas à s’imposer, ces soi-disant “espaces de liberté” finissent par se soumettre à cette dictature et l’ensemble des rapports humains retombe sous le joug de la loi de la valeur. La boucle est bouclée et l’autogestion montre sa véritable et invariante fonction historique: freiner le processus révolutionnaire, au moment même où l’Etat bourgeois est désorganisé, contribuer aux moments décisifs de la bataille, à faire diversion au sein des secteurs radicaux du prolétariat, l’épuiser dans une activité productive qui, tôt ou tard, se soumet à la dictature de la valeur, isoler les fractions radicales du prolétariat, facilitant ainsi la réorganisation de l’Etat bourgeois et sa répression sélective.
Seuls les complices de nos tortionnaires et des assassins de nos frères peuvent ne pas se réjouir de la suppression des lois d’impunité. Et ici déjà il faut immédiatement stopper toute spéculation sur la plus ou moins grande complicité des personnages de l’Etat (Menem, Alfonsin, Kischner, De la Rua,… viennent de la même fosse à purin) et savoir que le responsable, c’est l’Etat bourgeois : c’est lui qui a perpétré les massacres et c’est encore lui qui a voté et approuvé l’impunité. Certains nous diront: “c’est notre lutte qui les a annulées !”. Et c’est vrai, la lutte contre l’impunité, et en particulier la force des escraches, a obtenu ce résultat. Mais même si l’Etat a annulé l’impunité parce qu’il ne pouvait pas faire autrement, cela reste malgré tout lui qui décide de formaliser ce résultat. Bien entendu, il ne le fait pas pour nier sa fonction essentielle de domination, mais au contraire pour reprendre le contrôle de la situation et le monopole de la violence: seul l’Etat peut juger et pardonner. C’est lui qui formalise juridiquement le rapport de force que les escraches sont parvenus à imposer dans la pratique. Il espère de cette manière regagner l’autorité qu’il a perdue dans la rue. L’objectif de l’opération juridique est de canaliser la rage au sein des appareils de l’Etat, d’affaiblir l’action directe que développe la condamnation sociale et, en fin de compte, de liquider ce qui fait le plus peur: les escraches. Pour y parvenir, l’Etat continue en même temps d’affiner les mécanismes de répression de ce type d’action prolétarienne. Une fois de plus, la carotte et le bâton cherchent à liquider l’action directe.
Au sein du mouvement, si tout le monde exprime sa joie, parce qu’il nous paraît juste à tous qu’un tortionnaire, qu’un assassin pourrisse au fond d’une tôle, nous sommes néanmoins nombreux à nous méfier de ces réjouissances, à douter qu’on les laisse longtemps croupir en prison et à appeler à la vigilance et à la continuité des escraches. Cela nous a fait chaud au cœur, lors de différentes discussions camarades, de constater la force des positions sur la question, qu’elles proviennent de camarades de HIJOS ou de camarades issus des commissions des escraches des assemblées de quartiers: “Il est évident qu’on se réjouit à l’idée qu’ils aillent au trou, mais nous ne luttons pas pour cela, nous luttons pour la condamnation sociale et continuerons à lutter pour elle”. Ce que les tortionnaires et les responsables des disparitions craignent le plus, c’est l’isolement social, le mépris exprimé à leur encontre dans les lieux publics, la répudiation par leur propre famille à qui ils ont toujours caché leur puante fonction sociale, ils paniquent à l’idée du scandale et de la honte qui leur pend au nez, à l’idée de devoir tout vendre pour déménager loin et vivre dans la crainte d’un prochain escrache, ils redoutent de finir dans un asile de fous, sont terrifiés à l’idée que ne ressorte, dans les moindres détails, l’étendue de leurs crimes, et finalement ils en arrivent à avoir peur de tout être humain…Pour certains d’entre eux, la condamnation juridique ressemble à une délivrance dans la mesure où elle est délimitée et précise tant sur la durée que sur le type de châtiment (la prison). Châtiment qui, lui aussi, correspond à l’idéologie dominante, à la religion et aux objectifs du pouvoir judiciaire: expier ses péchés, accomplir sa peine pour se laver de ses fautes. Tout comme la disparition de nos frères, la condamnation sociale que la lutte impose, n’a quant à elle, aucune limite: ni oubli, ni pardon, ni faute expiée, ni grâce divine. Par cette condamnation sociale, le prolétariat développe sa force, en mobilisant un grand nombre de personnes (quartiers, voisins, amis…), ce qui le renforce socialement et rend cette puissance plus destructrice encore par l’élimination de cette immonde vie de tortionnaire caché. En ce sens, la continuité de la lutte contre les bourreaux d’hier établit avec les organes de répression actuels de l’Etat un rapport de force qui empêche ces derniers d’agir en toute impunité. Les bourgeois les plus lucides savent pertinemment que cela sape les forces répressives d’Argentine et d’ailleurs ce qui, en dernière instance, pourrait contribuer à leur déstructuration et, finalement, à leur liquidation révolutionnaire.
Et réciproquement, dans les pays où la lutte contre l’impunité n’a pas atteint une telle force, comme dans l’actuelle Espagne post-franquiste, les escadrons de la mort et les diverses formes de répression en général, n’ont eu de cesse de se développer démocratiquement et continuent de le faire, sous la férule de gouvernements socialistes et populistes : l’appareil répressif du franquisme, resté intact, continue à se moderniser, les social-démocrates, de leur côté, ont organisé des escadrons de la mort et les prisons espagnoles d’aujourd’hui, avec leurs terribles FIES, équivalent des Quartiers de Haute Sécurité en France, sont considérés par les prisonniers comme de véritables centres d’extermination.
La lutte contre l’impunité, les escraches en Argentine, ont servi d’exemples au prolétariat de nombreux pays. Si le gouvernement de Kischner abroge les lois qui octroyaient l’impunité, c’est parce que, grâce à cela, non seulement la bourgeoisie, les flics, les militaires argentins pensent pouvoir dormir sur leurs deux oreilles (même si certains pourront être condamnés), mais également parce que, de cette manière, il espère arrêter la généralisation et l’internationalisation des escraches, pour que d’autres bourgeois, d’autres répresseurs,… ailleurs dans le monde, puissent dormir tranquilles. Sinon, pourquoi les médias internationaux, toujours complices de la répression et du terrorisme d’Etat, mèneraient-ils une telle propagande autour de cette abrogation et applaudiraient-ils à tout rompre ce cheminement vers “la solution démocratique”?
Pour en revenir à l’Argentine, signalons encore que c’est ce moment précis que va choisir le gouvernement, comme par hasard, pour sortir son plan de pacification sociale, qui inclut la répression des prolétaires conséquents, le dénigrement des escraches et des piquets. Il ne faut donc pas s’étonner si la bourgeoisie argentine considère maintenant que le droit humain le plus fondamental soit le droit à la libre circulation et si, sans honte, elle traite les piquets de fascistes. Rien d’étonnant non plus à ce qu’elle considère, une fois les responsables des tortures et des disparitions condamnés (juridiquement), que les escraches soient antidémocratiques, que la justice de la rue soit, par essence, fasciste et qu’il faille faire confiance à la justice démocratique. Au fait, Bush ne dit rien de très différent pour justifier les massacre aux 4 coins de la planète !
Ce que le mouvement du prolétariat en Argentine a apporté à la lutte internationale est incommensurable. Il ne fait aucun doute que l’associationnisme territorial, les piquets, les différentes formes d’escraches seront les principales caractéristiques des luttes les plus conséquentes qui ne vont pas manquer de se développer ailleurs dans le futur.
Mais, comme nous avons pu le constater tout au long de ce texte, les
problèmes rencontrés sont énormes, les tactiques liquidatrices
variées et complexes, et la conscience implicite dont a fait preuve
le prolétariat en Argentine bien insuffisante pour assurer la continuité
et le développement du mouvement.
• Le prolétariat s’est organisé en force, mais sans réelle
conscience de classe et en ignorant son projet historique.
• Le prolétariat a défié la propriété
privée, mais sans affirmer socialement que l’humanité ne
peut survivre qu’en détruisant la propriété privée.
• Le prolétariat a défié l’Etat et lutté
ouvertement contre lui, mais n’a pas proclamé socialement la nécessité
de le détruire.
• Le prolétariat s’est opposé pratiquement aux formes
démocratiques et à imposé sa force antidémocratiquement
(piquets, occupations d’usines, escraches,… ne respectent évidemment
aucune lois démocratiques), mais la critique de la démocratie
en tant que dictature du capital brille par son absence.
• Le prolétariat est descendu dans la rue et a imposé
sa force contre la marchandise et la loi de la valeur, ce qui constitue
une brutale affirmation révolutionnaire, mais n’a pas conçu
de direction qui revendique le contenu de cette action et qui proclame
ouvertement la nécessité de la dictature contre le marché
et ses lois.
• Le prolétariat a affirmé son mouvement révolutionnaire
contre toute la société du capital, mais ne l’a fait qu’implicitement,
sans affirmer ouvertement et socialement la nécessité de
la révolution sociale.
Eclaircissons quelque peu cette question de la conscience implicite et explicite. Dans sa pratique contre le capital et l’Etat, le prolétariat a fait preuve d’une conscience qui ne parvient pas à s’exprimer avec la force nécessaire pour permettre de généraliser et d’approfondir son mouvement. Le mot d’ordre “Qu’ils s’en aillent tous, qu’il n’en reste plus un seul!” constitue, cependant, un mot d’ordre qui va bien au-delà de la politique, notamment comme critique de la démocratie ; il est bien plus clair que les mots d’ordre que l’on peut retrouver dans des mouvements insurrectionnels nettement plus puissants, y compris celui d’octobre 1917 en Russie où “Pain et Paix” représentaient les mots d’ordre centraux. Plus claire aussi est la conscience implicite qu’a le mouvement dans les mois précédant décembre 2001 sur le fait qu’il faille abattre le gouvernement, qu’il faille généraliser la révolte prolétarienne non seulement contre tel ou tel politicien pourri, mais contre le système dans sa totalité, contre la démocratie qui est une dictature. C’est ce qu’exprime le groupe de rock Bersuit (dès 2000) dans ses chansons: “C’est l’explosion, c’est l’explosion… de ma guitare, de ton gouvernement,… et s’il te venait le moindre doute, viens la prendre, vois comme elle est dure, si ça c’est pas une dictature, alors c’est quoi?…”. Ou encore lorsqu’il dénonce : “tous”, “ceux qui ont le pouvoir et vont le perdre”, “ce sont tous des narcotrafiquants” et “qu’ils aillent tous se faire foutre”, “les démocrates de merde et les capotes pacifistes”, “élections, re-élections, pour moi, c’est quand même la merde, fils de pute”, … “et si tout ce merdier, ce n’est pas le système, c’est quoi alors ? c’est pas le système, c’est quoi alors ? …” (11).
Les carences dont nous avons parlé auparavant pèsent néanmoins lourdement sur le mouvement. Les drapeaux de la révolution sociale ne sont pas clairement brandis. Il est dramatique de constater que, malgré la force révolutionnaire du mouvement, la dénonciation de la propriété privée et de la société marchande ait été si faible, que la dénonciation de tel ou tel fils de pute12 ou même de “tous les fils de pute” n’ait pas été élargie au système social qui les a engendrés, qu’on n’ait pas suffisamment gueulé que c’est la propriété privée des moyens de production qui assassine aux 4 coins de la planète. Il est tragique que nos cris n’aient pas eu la force d’imposer l’évidence: si nous n’abolissons pas la société marchande, c’est elle qui abolira l’espèce humaine. Il est profondément conservateur qu’au lieu de parler de la révolution, on prétende changer la vie quotidienne sans détruire la société. Il est tragique de constater le peu de dénonciation de la dictature du capital, de la dictature de la valeur, et du fait qu’il est impossible d’accommoder la vie à cette dictature. Il est catastrophique de voir, qu’au lieu de tout cela, c’est la contre-révolution qui réapparaît, dans chaque cercle prolétarien, dans chaque usine occupée, conduisant de toutes les façons possibles, à se soumettre à la dictature de la rentabilité. Le manque de théorie communiste est criant, tout comme est flagrante la méconnaissance, y compris de la part des minorités les plus actives du prolétariat, du projet social de notre classe.
L’isolement du prolétariat en Argentine est fondamentalement un problème idéologique, un manque d’affirmation théorique: les protagonistes n’ont même pas conscience de l’unité qui existe dans l’action qu’ils ont développée. Il ne fait pourtant aucun doute que, dans toute la région sud-américaine, la lutte du prolétariat s’est radicalisée depuis le début de ce XXIème siècle. En Bolivie, au Pérou, en Equateur, au Paraguay et, dans une moindre mesure, dans d’autres pays de la région (Brésil, Chili, Uruguay), le prolétariat a développé le même type de luttes (routes bloquées, piquets, manifestations violentes, escraches) et combattu les mêmes ennemis (mêmes bourgeois, mêmes entreprises, mêmes plans du FMI, mêmes forces de police, coordonnées par le même centre impérial, mêmes discours syndicaux et mêmes épouvantables pacificateurs social-démocrates). Mais, de toute évidence, cette réelle unité d’action, cette communauté de lutte pratique et la communauté d’objectifs révolutionnaires qu’elle implique, n’ont pas été explicitées au sein du mouvement, pas plus que n’y eut de véritable affirmation théorique des objectifs révolutionnaires communs à tout le mouvement.
Le chauvinisme argentin, assorti d’une espèce de complexe de supériorité raciste développé depuis toujours par la bourgeoisie locale vis-à-vis du prolétariat originaire d’autres pays de la région (le mépris à l’égard de l’“indien”, qu’il soit bolivien, péruvien, paraguayen ou même argentin, jouit de la puissance d’un préjugé socialement admis, et les divers gouvernements –y compris celui de Menem- n’ont jamais éprouvé la moindre gêne à les exploiter et ainsi diviser), le fait d’imputer la faute à tel ou tel “fils de pute” (les interprétations des partis politiques et des syndicats présentent la misère comme le fruit de la corruption ou de la putréfaction, considérée comme une spécialité argentine, pour masquer, qu’en réalité, il s’agit de l’expression inévitable de la catastrophe de cette société dirigée par le profit) sont toutes des idéologies qui séparent le prolétariat en Argentine de ses frères, et le prolétariat en général de la révolution sociale.
Affirmer cette perspective, diriger le processus d’affirmation prolétarienne jusqu’à l’organisation du prolétariat en classe, en parti, en force révolutionnaire, voilà la tâche des révolutionnaires du monde entier.
| Le programme invariant du justicialisme
de Perón à Menem Menem : “Le justicialisme n’a jamais combattu le capital ; au contraire, il a fait en sorte que le capital arrive pour favoriser la croissance de la République. Et c’est ce que nous avons fait à partir de 1989”. Par ailleurs, Menem a toujours souligné le fait que Perón, dès 1944, déclarait : “Il faut laisser de côté le collectivisme en Argentine et rendre possible l’entrée de capitaux. Ici, nous ne voulons ni le collectivisme, ni le marxisme, ni le communisme. Nous aimons fondamentalement l’Argentine, et le justicialisme est la vérité en politique.” |
| Les veuves de la révolution
Raùl Abraham Tristement, avec l’apathie des vaincus, culminent les pages chaotiques du dernier livre à la mode au sein de la petite bourgeoisie bien-pensante et coupable : “ Alors, comment changeons-nous le monde sans prendre le pouvoir ? ” se demande-t-il. “ A la fin du livre comme au début, on ne le sait pas ”. Il ne manquait plus que cela. John Holloway commença son exposé à Rosario de façon assommante : “ Le capitalisme est une merde ”, dit-il, et il reçut une ovation d’une claque de joyeux anticapitalistes. Y avait il encore un doute? Non, mais c’est pas parce qu’on le sait que ce n’est plus vrai. C’est toujours bien de le dire et –surtout– cela n’emmerde personne, et certainement pas les capitalistes qui cachent pudiquement les puissants orgasmes qui les transportent quand ils entendent les critiques éthiques adressées au capitalisme. Rien ne sonne mieux aux oreilles du capital qu’une critique de ce genre: le capitalisme corrompt, le capitalisme tue, le capitalisme est une merde. Cette immense accusation glisse sur les consciences aguerries de ceux qui effectivement corrompent et tuent. Cela les assimile à une force de la nature et cela les met au même niveau que n’importe quelle autre forme d’organisation sociale : l’esclavagisme ne fut (n’est) certainement pas beaucoup mieux. Comme on pouvait le prévoir, Holloway passa sous silence (pas par ignorance, je l’affirme) le fait que le capitalisme freine le développement des forces productives, qu’il éjecte des travailleurs en les condamnant non pas à être séparés de leur production mais purement et simplement à revenir à des formes pré-capitalistes de production et –last but not least– que le capitalisme est en train de détruire les conditions matérielles de reproduction de l’existence de l’humanité, sciant la branche sur laquelle nous sommes tous assis: la planète Terre. Sans doute Holloway apprécie-t-il peu cette façon de présenter les choses : on le sait, démontrer avec la rigueur des chiffres que la façon irrationnelle de produire et de s’approprier l’excédent mène à la barbarie prend beaucoup de temps, est très fastidieux et requiert de complexes études dans des disciplines aussi arides que l’économie ou d’autres tout aussi ennuyeuses. Il est bien plus rapide et bien plus efficace de nous révéler que “ l’Etat ne danse pas, l’Etat ne rit pas”. Ce qui se réfère, bien évidemment, au fait que nous, les hommes, nous pouvons le faire. Remarquable constatation. Seules de longues années d’études dans de vénérables universités européennes peuvent conduire à de tels sommets de sagesse. Ou peut-être suffit-il d’écouter les profondes réflexions du sous-commandant Marcos qui a réussi à convaincre Holloway que “c’est en posant des questions qu’on avance”. Nous n’aurions rien à redire à cela. Malheureusement, notre savant irlandais, peut-être sous l’effet d’une surdose de mezcal, a écouté le sous-commandant mais n’a pas regardé aux alentours. Marcos – dont la production théorique est pour le moins superficielle- opère comme le grand-prêtre de la “ nouvelle révolution ” et -comme tout prêtre- il tente de sauver les âmes, même au prix de la sienne. De telle sorte qu’il préconise le vieux principe du “ faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ”. Et qu’est-il en train de faire au Chiapas si ce n’est construire un appareil d’Etat ? Avec les particularités que chaque situation propose mais en tentant de répondre aux quelques questions fondamentales auxquelles doit répondre tout qui prétend construire pouvoir, contre-pouvoir ou antipouvoir: Qui organisera et comment s’organisera la production, la circulation et la distribution des biens et des services dans la société ? Ces questions l’irlandais les ignore, ce qui est mal en soi, ou les méprise, ce qui est pire encore. Pour Holloway tout se réduit au fait que les révolutionnaires du 20ème siècle –tous- se sont trompés. Parce qu’ils ont perdu. On pourrait aussi faire quelques inférences sur son échelle de valeur, mais tel n’est pas l’objectif de cette note. Le mépris de l’irlandais pour la force avec laquelle le capitalisme à écrasé les expériences révolutionnaires, sans cacher ses mensonges, Dieu nous en préserve, est olympien. Pour apaiser la douleur que l’échec des révolutions du siècle passé provoque en lui, Holloway tente des explications historiques abusives. Il est effectivement assez fallacieux d’oser suggérer un parallélisme possible entre les passages du féodalisme au capitalisme et une hypothétique construction du socialisme entre les “ interstices ” du mode de production capitaliste. Ces “lézardes” du système seraient ainsi susceptibles de s’élargir et de se transformer en grandes allées où – tôt ou tard- passera un homme nouveau, délivré des plaies individualistes. Serait-ce cela la “ voie hollowayenne vers le socialisme ” ? C’est tout à fait adorable, et très bucolique même : une nouvelle Arcadie nous attend où le lion s’étendra aux côtés de l’agneau. Malheureusement, et sans prétendre à l’analyse marxiste, l’expérience indique qu’en général le lion bouffe l’agneau et si, à certain moment, il marque quelques hésitations, c’est juste parce qu’il choisit à quelle sauce l’accommoder. A ce sujet, il conviendrait peut–être de rappeler à Holloway la fable du scorpion et de la grenouille. “ C’est dans ma nature ”, dit le scorpion tandis qu’il s’enfonce dans la rivière après avoir piqué le crédule batracien. Il ne serait sans doute pas superflu non plus que certains leaders politiques sud-américains, toujours prompts à triompher lors d’élections organisées par le système pour trouver une solution au rendement décroissant du taux de profit, réfléchissent là-dessus. Peut-être que dans l’imagination de Holloway se cache une forme d’organisation sociale constituée de petites communautés, autosuffisantes, qui troquent des produits avec d’autres communautés semblables à elles, en toute égalité. Le puissant rayonnement de leur exemple agirait comme stimulant pour que de plus en plus de groupes humains s’organisent de cette manière et, au bout du compte, nous nous retrouverions face à un monde transformé sans avoir “ pris ” le pouvoir. Pour Holloway, depuis Saint-Simon et jusqu’à nos jours, il ne s’est rien passé, mais en cela il faut reconnaître qu’il n’est pas le seul : à force d’être à ce point post-modernes, certains philosophes, français en général, en sont devenus pré-modernes et, à force de discours hermétiques –moins c’est compréhensible mieux c’est- ils s’en prennent à la science et à sa sournoise idéologisation. En se déchaînant contre le néo-positivisme, ils prônent le retour des sorciers. Belle façon de jeter le bébé avec l’eau sale. Il cache, ou travestit, beaucoup de choses, l’irlandais devenu chiapanèque. Mais s’il en est une qui n’est pas dissimulée, c’est sa prise de position dans le débat “ Réforme ou révolution ”. Alors qu’il nous affirme que la question est aujourd’hui dépassée parce que toutes deux étaient erronées, il prend parti pour la première. Il a droit de le faire –cela ne fait aucun doute- mais ce gros malin l’esquive et se dit révolutionnaire d’un genre nouveau, alors qu’il n’est rien d’autre qu’un triste réformiste de seconde main, si on lui concède l’honnêteté, chose qui est elle aussi discutable. Non content de “ démystifier ” le savoir révolutionnaire, Holloway s’en prend au fétichisme du capital, il nous rappelle la séparation entre le producteur et son produit, l’aliénation que suppose pour le travailleur le fait de ne pas dominer les moyens de production et il décrit pour nous l’aliénation que ce divorce forcé implique pour l’âme humaine: merci ! Enfin non, pas tant que ça finalement, puisque les conclusions que tire Holloway sont perverses: il suppose que c’est dans les espaces laissés libres par le mode de production capitaliste que nous pourrons résoudre la tension intrinsèque entre la forme de production –sociale- et l’appropriation de l’excédent, individuel. S’il y a bien quelque chose de clair chez l’irascible philosophe de Trêves, c’est bien le caractère tranchant de ses arguments qui ne sont pas en demi teintes : l’humanité a l’opportunité de remplacer un mode de production irrationnel et antiscientifique par un autre dans lequel la planification nous évitera le spectacle honteux de la faim, de la guerre, des maladies et d’autres fléaux évitables puisqu’il ne s’agit pas de phénomènes naturels, et ce du point de vue scientifique. Mais cette possibilité, seul le développement colossal des forces productives provoqué par la globalisation capitaliste commencée au 16ème siècle nous l’offre. Ce n’est que depuis cette formidable accumulation de richesse produite par le capitalisme qu’on peut penser à la construction d’un mode de production rationnel. Mais quelqu’un croit-il par hasard que le créateur de l’armée rouge pariait sur le triomphe de la révolution en Allemagne pour de simples sympathies personnelles envers les spartakistes? Il est certain que le capitalisme a démontré une capacité de survie supérieure à celle espérée du temps de Marx et que les expériences de construction du socialisme ont échoué. C’est comme cela ! Tant pis ! Le chemin sera plus difficile et la récompense plus douce, et cela en dépit de tous ceux qui ne se sont pas remis de la commotion cérébrale causée par les blocs de maçonnerie tombés du mur de Berlin mais qui, durant des années, refusèrent de voir que l’existence du mur (et non sa chute) était l’aberration de la pensée révolutionnaire. Le capitalisme ne tombera pas parce que quelqu’un l’affirme –ni sous l’effet de ces quelques lignes– mais encore moins parce que quelqu’un propose d’organiser des carnavals qui revendiquent l’hédonisme. Ce n’est pas du volontarisme pur que sortira quelque chose de positif, mais bien de l’étude des conditions objectives de la formation économique sociale qui nous occupe, de l’appréciation correcte du rapport de force de chaque moment, de la force qu’on applique sur les maillons pourris du système et –fondamentalement– de notre capacité à fédérer toutes les forces antisystème et à nous approprier la richesse que le développement actuel de forces productives permet de générer. Pour ce faire, tous les acteurs sociaux impliqués dans la lutte contre le capital devront unir leurs efforts, articuler les alliances de classe nécessaires et –de façon critique– dicter un programme d’organisation de la production et de la distribution des biens à toute la société. A moins que quelqu’un n’imagine que le capitalisme permettra que la propriété des moyens de production changent de mains sans lutte, ou que la création de “ phalanstères ” au XXIème siècle finira par faire tomber un système qui corrompt, avilit et assassine. |
| L’université des Mères
au service de la rentabilité des entreprises Les Mères de la Place de Mai, maintenant consultants d’entreprises, offrent des consultations gratuites en marketing et en commerce à des usines autogérées. Elles ont démarré sur base d’une demande d’ex-employés de Cerámicas Zanón. Actuellement elles forment des ex-travailleurs de Bruckman et des supermarchés Tigre. “Il y a trois principes que tout projet économique doit respecter: être rentable, productif et efficace”. La définition ne provient pas d’un cadre de multinationale ou d’un consultant d’entreprise, mais de Sergio Schoklender, le mandataire légal des Mères de la Place de Mai qui, il y a quelques mois, a commencé à conseiller les usines autogérées par le biais d’une association baptisée “Rebeldía y Esperanza” (“Révolte et Espoir”). Comme s’il s’agissait d’un consultant en affaires, mais tout à fait gratuitement, l’association offre aujourd’hui un service complet d’assistance à ce type d’usines. Ses services vont du marketing à la comptabilité en passant par un service de consultation pour le développement industriel et le dessin des marques et des logos. Ce type de services est offert par l’ensemble des professionnels qui composent le corps enseignant de l’Université Populaire des Mères de la Place de Mai et travaillent totalement “ad honorem”. “Nous avons commencé par hasard, à partir d’une demande émanant de l’usine de Cerámicas Zanón, gérée aujourd’hui par les ouvriers. Ils nous ont contacté parce qu’ils avaient besoin de placer leurs produits et n’avaient ni couverture légale ni structure administrative pour les facturer”, dit Schoklender. Le premier pas accompli par “Rebeldía y Esperanza”, constituée en association sans but lucratif, fut d’accorder la possibilité à Zanón de facturer les comptes et les ordres de payements de l’entité et, grâce à cela, l’usine de céramique a pu retrouver quelques uns des canaux traditionnels de commercialisation. “L’opération la plus importante que nous avons réalisée est l’accord pour fournir, via un distributeur, la chaîne Easy”, soutient Schoklender. “L’accord conclu porte sur la vente de 140.000 m2 de céramiques, ce qui représente 1,5 million de dollars par mois et, chose importante, c’est la première fois qu’une usine autogérée place ses produits dans une multinationale”, ajoute-t-il. Pour revenir sur les marchés et s’y imposer, Zanón a lancé deux nouvelles lignes de produits : Piedras del Sud et Fasinpat (Fabrica sin Patrones – Usines Sans Patrons-) et son prochain objectif est de commencer à exporter une partie de sa production. “Nous sommes en train de faire les premiers pas dans cette direction, en utilisant le réseau de contacts internationaux dont disposent les Mères”, reconnaît Schoklender. Le mandataire légal de “Rebeldía y Esperanza” a assuré que le prochain projet, sur lequel il travaille déjà afin de lever la saisie conservatoire à laquelle l’usine est soumise par la pression des créanciers, consistera à élaborer une proposition à présenter devant la Justice afin d’alléger la pression des créanciers que traîne l’usine en justice. Schoklender signale également qu’en plus de Cerámicas Zanón, l’association travaille sur d’autres projets d’assistance patronale, tous soumis à une unique condition: être des usines autogérées ou sous contrôle ouvrier. “Nous collaborons, avec les travailleurs de Bruckman, au réaménagement de certaines machines tombées en désuétude et nous assistons les ex-employés du Supermarché Tigre qui tentent de rouvrir le magasin”, dit Schoklender. Alfredo Sainz, de la rédaction du journal “LA NACION” |
| “Tant qu’ils ne seront pas en taule, les escraches continueront. Et
une fois qu’ils seront au trou, on s’occupera des complices, et après
les complices ce sera le tour des idéologues. Les escraches n’ont
pas de terme. Je pense que nous sommes suffisamment nombreux, car il y
a eu un important travail qui a duré trois mois, et que le quartier
n’oublie pas, que le quartier ne se tait pas, que le quartier est là.
Aujourd’hui est un jour de joie.”
Carlos Pisoni, du groupe H.I.J.O.S.
|
Malgré les gigantesques problèmes que tout ceci pose au développement international de la lutte du prolétariat, malgré la faiblesse objective que manifeste le prolétariat d’un pays lorsqu’il n’arrive pas à empêcher “ son propre ” Etat d’envoyer des militaires pour réprimer la lutte de ses frères dans le monde et contribue ainsi à cette répression, des prolétaires s’opposent à ce processus et il est essentiel de le faire savoir ! C’est, dans ce contexte, que nous aimerions souligner la lutte du prolétariat contre Aguila III.
Comme dénoncé un peu partout, aujourd’hui un nouveau saut de qualité est donné à la prolifération des bases militaires étasuniennes dans le monde, et en particulier en Amérique latine : sur tout le continent américain, les bases existantes ont été renforcées et de nouvelles bases ont été créées (particulièrement en Amérique du sud, où jusqu’ici l’opposition prolétarienne avait réussi en de nombreuses occasions à empêcher ces installations). Les forces militaires des Etats-Unis ont par exemple obtenu la permission de s’installer au Paraguay pour préparer et réaliser des cours de formation et des opérations spéciales avec les forces armées locales. De vastes contingents des forces armées nord-américaines sont déjà arrivés dans la zone des trois frontières : Argentine, Brésil et Paraguay. Selon le journal texan “ El Sol ” (aux Etats-Unis) “ plusieurs versions circulent également sur l’ intention d’installer au minimum deux bases militaires en Argentine, une en Patagonie et une autre près de Buenos Aires ”. Le journal avertit que l’Amazonie est déjà encerclée par des soldats étasuniens qui “ assurent pouvoir prendre possession de la région à n’importe quel moment. ”
C’est dans ce contexte qu’a été planifié Aguila III, que la presse internationale définit “ comme une des manœuvres militaires conjointes les plus importantes de l’histoire ” et certainement “ comme la plus grande opération réalisée en Amérique du sud ”. Selon le plan, les forces armées des Etats-Unis, d’Argentine, du Brésil, de Bolivie, du Chili, du Paraguay et d’Uruguay devaient participer à cette opération militaire. Aguila III était prévu pour octobre 2003 sur le territoire de Mendoza et San Luis en Argentine.
Le gouvernement des Etats-Unis exigea l ‘“immunité diplomatique” pour ses troupes. L’objectif déclaré d’Aguila III était la lutte contre l’insurrection, contre l’ennemi “ intérieur ”. Sa fonction essentielle était évidemment de centraliser, entraîner et préparer l’intervention répressive contre nos luttes. Pour cela, le plan Aguila III prévoyait la participation de conseillers aguerris par l’expérience répressive, et trempés au feu des guerres de répression policière que l’armée des Etats-Unis mène en Irak et en Afghanistan. Ceux-ci auraient supervisés les manœuvres : “ des instructeurs des USA... qui ont l’expérience réelle... dans des évènements récents ”, disait le Pentagone.
Dès que le prolétariat prit connaissance de l’existence de ces opérations, il reprit le chemin de la lutte. Dans la quasi totalité des provinces d’Argentine (Mendoza, Córdoba, Capital Federal, Neuquen, Santa Fe, Santa Cruz,... ), d’importants affrontements contre cette opération éclatèrent. Des comités se créèrent pour centraliser les luttes. Diverses revendications et divers mots d’ordre furent lancés : on revendiqua la solidarité avec les prolétaires qui aujourd’hui même en Irak, subissent cette grande guerre de répression policière contre notre classe, on lança des mots d’ordre contre l’intervention en Afghanistan, on revendiqua aussi la lutte contre les exercices militaires (Unitas 42, opérations navales...), contre le ALCA, contre le FMI,... et encore beaucoup d’autres “ contre ” qui enrichissent la lutte de notre classe. Dans le même temps, apparaissaient des formes élémentaires d’autonomie et de direction classiste.
Il faut souligner que ces luttes se sont déroulées au moment où le Congrès National argentin discutait de l’octroi ou non de l’immunité exigée par l’Etat des USA pour ses troupes. Le respect et l’importance de la souveraineté nationale n’étaient que des sorties de secours face aux mobilisations que prévoyait l’Etat en Argentine. Il faut souligner également que dans la majorité des pays de la planète, l’impunité généralisée pour les troupes étasuniennes intervenant hors de leurs frontières a été approuvée sans aucun problème par les Etats nationaux. Cette incroyable mesure, qui au fond revient à se foutre des sacro-saints droits de l’homme au nom des intérêts globaux du capital et plus particulièrement des intérêts impériaux des Etats-Unis, fut institutionnalisée partout et même acceptée, sans grande réticence, par les Nations-Unies. Mais en Argentine, où la lutte contre toute impunité constitue un exemple international, l’Etat avait très peur que l’approbation demandée par la Maison Blanche ne provoque une forte réaction prolétarienne. C’est pour cela que le Congrès spécula sur le refus d’octroyer l’impunité (il est symptomatique que cela soit l’un des seuls pays où les bourgeois se sont posés la question de la non-obéissance aux grands manitous du monde!) et qu’abondèrent les discours sur “ l’autonomie nationale ” et la possibilité de limiter Aguila III.
Mais, dans tout le pays, le prolétariat est descendu dans la rue pour exprimer ouvertement son refus du plan Aguila III “ avec ou sans impunité ”, “ avec ou sans autorisation parlementaire ” ce qui, dans les faits, allait à l’encontre des tentatives mises en œuvre par le Congrès pour canaliser la lutte du prolétariat. Ce dernier manifestait ainsi un mépris objectif pour les laïus sur la souveraineté nationale et les limites parlementaires que d’aucuns voulaient justement imposer au sujet de l’impunité des super-flics made in USA.
Ces luttes, totalement passées sous silence par les médias bourgeois tant nationaux qu’internationaux, se situent objectivement dans la continuité de celles de 2001/2002 et renforcent, parmi les rangs de la bourgeoisie internationale, la peur de voir le prolétariat structurer ses luttes de manière beaucoup plus continue. Nous ne pouvons nous étendre ici sur le détail des luttes qui se sont déroulées de septembre à octobre 2003, mais il nous importait de souligner que le plan Aguila III n’est pas passé ! Les militaires en furent pour leurs frais et n’ont pu faire leurs manœuvres. En Argentine, c’est de cette façon que le prolétariat a affronté “ sa ” propre bourgeoisie, “ son ” propre Etat, l’ensemble des Etats (y compris celui des Etats-Unis) qui constituent ses “ répresseurs ” directs.
C’est un excellent exemple de défaitisme révolutionnaire!
L’époque moderne est dépassée. Verdun, le nazisme, Hiroshima, le Vietnam, Sabra et Shatila… cette modernité est arrivée à terme, finie, dépassée. La globalisation a mis fin au pouvoir de l’Etat-nation, ce responsable des guerres impérialistes, et nous devons nous en réjouir. Nous sommes maintenant entrés dans l’ère du post-modernisme.
Avec la fin des régimes coloniaux, et surtout avec la chute de l’URSS et des barrières que cette dernière opposait au marché capitaliste mondial, nous avons assisté à une globalisation des échanges économiques et culturels. A la place de l’Etat-nation, une “ nouvelle ” forme de souveraineté, un “ nouveau ” sujet politique a fait son apparition : l’Empire. Il ne s’agit pas des Etats-Unis, même si ceux-ci y occupent une place privilégiée et il ne s’agit pas non plus d’impérialisme. “ Ni les Etats-Unis, ni aucun Etat-nation ne constituent actuellement le centre d’un projet impérialiste. L’impérialisme est fini. Aucune nation ne sera un leader mondial, tel que l’ont été les nations européennes modernes ” (a). Il s’agit d’un pouvoir “ déterritorialisé ” qui s’étend sur toute vie sociale. “ Contrairement à l’impérialisme, l’Empire n’établit aucun centre de pouvoir et ne s’appuie pas sur des frontières et des barrières fixées. Il s’agit d’un appareil de pouvoir décentré et déterritorialisé qui incorpore progressivement la totalité de l’espace mondial à l’intérieur de ses frontières ouvertes et en expansion continue ” (b).
Contrairement à la gauche traditionnelle qui voit cette globalisation d’un mauvais œil, et qui voudrait mettre des barrières à la circulation des flux capitalistes, Negri et son collègue Hardt ne sont pas en soi contre la globalisation des rapports : ce qui est défini comme ennemi, c’est “ un régime spécifique de rapports globaux que nous nommons Empire ”, mais “…le fait que se soit constitué un Empire face aux vieilles puissances européennes est une bonne nouvelle. Qui veut encore avoir à faire avec ces classes dirigeantes européennes, asphyxiées et parasitaires, qui nous ont conduit de l’ancien régime au nationalisme, du populisme au fascisme, et qui maintenant soutiennent un néolibéralisme généralisé ? Qui voudrait continuer à vivre avec les idéologies et les appareils bureaucratiques qui ont nourri et soutenu les abjectes élites européennes ? Et qui parvient encore à supporter ces formes d’organisation des travailleurs et ces corporations qui ont perdu tout esprit de vie ? ” (c). L’Empire est donc, contrairement à ce qu’en dit la gauche traditionnelle, une réalité positive qui “ balaye les cruels régimes du pouvoir moderne ” et qui, en rendant la réalité toujours plus égale partout, toujours plus supranationale, rend partout possible l’organisation de “ contre-pouvoirs ”. L’Empire rend possible l’alternative, mieux, elle la fabrique : “ l’Empire n’est rien d’autre que la fabrique d’une dimension ontologique de l’humain qui tend à devenir universelle ”. Cet humain s’exprime dans “ les résistances, les luttes et les désirs ” d’un “ nouveau prolétariat ”, un nouveau sujet : la multitude. “ Les forces créatives de la multitude qui soutiennent l’Empire sont en grade de construire de façon autonome un contre-Empire, une organisation politique alternative des flux et des échanges globaux. Les luttes visant à contester et subvertir l’Empire, ainsi que celles cherchant à construire une réelle alternative, se développeront sur le terrain impérial lui-même – en réalité, ces nouvelles luttes ont déjà commencé à émerger. A travers celles-ci et d’autres types de luttes, la multitude sera appelée à inventer de nouvelles formes de démocratie et un nouveau pouvoir constituant qui, un jour, nous conduira, à travers l’Empire, à son dépassement ” (d).
Dès le départ, les auteurs annoncent la couleur. Ils commencent par retracer certains aspects de l’histoire du capitalisme et de la lutte de classes, et cherchent à démontrer l’omnipotence actuelle du capital sur tous les aspects de la vie, mais cette description de la dictature capitaliste bascule immédiatement dans la reproduction bien sage de l’idéologie dominante. Ainsi, à la suite de toutes ces idéologies réformistes qui cherchent à vendre au prolétariat “ des nouveaux moyens de lutte ” en argumentant “ une nouvelle période ” ou de “ nouvelles conditions d’exploitation ”, le couple Negri-Hardt s’acharne à présenter les symptômes actuels du développement capitaliste (tendances au monopole, chute des barrières protectionnistes, affirmation de la fraction libre-échangiste, centralisation accrue des moyens de répression, etc.) comme un nouvel âge du capitalisme : le capitalisme globalisé. Là où nous ne voyons quant à nous que continuité des empiètements du capital, accentuation de la crise, progrès de la barbarie capitaliste, Negri et Hardt se mettent quant à eux directement au diapason de tous ceux qui veulent à tout prix nous servir la même vieille merde capitaliste dans une nouvelle soupière : pour eux aussi, comme Bernstein en son temps, il existe donc un “ nouveau capitalisme ”, la globalisation. Ils en parlent évidemment avec la prétention de critiquer ce “ nouvel âge ”, mais la question est que dès le départ, on ouvre ici la porte des justifications et de la révision des tâches du prolétariat. Selon les auteurs, la nouvelle ère qui s’ouvre –la globalisation- appelle le prolétariat à de nouvelles tâches. Cette route mènera les auteurs, au bout d’une série de raisonnements et de développements plus “ marxistes ” les uns que les autres, à réviser entièrement la question de la destruction de l’Etat.
Mais n’anticipons pas. Cet arrimage terminologique à la globalisation, à l’idéologie bourgeoise actuelle n’est qu’un apéritif. Il ne suffirait pas à soulever d’un poil l’intérêt de l’intelligentsia social-démocrate à l’œuvre autour du mouvement antiglobalisation s’il n’était accompagné de quelques modernités. Passons sur le passage de l’époque moderne à l’époque post-moderne, (sans oublier cependant la perle définissant l’Empire comme une réalité positive qui “ balaye les cruels régimes du pouvoir moderne ”, sans oublier non plus le symptôme, ô combien nouveau, d’un soi-disant “ sursaut d’intérêt pour le concept de ‘guerre juste’ ” qui serait propre à l’Empire, comme si toute guerre impérialiste ne cherchait pas toujours à se définir comme telle), et venons-en directement à la vision des luttes actuelles.
Pour les auteurs, les luttes contemporaines “ sous l’Empire ” déterminent “ non pas un nouveau cycle de lutte internationaliste ”, mais “ plutôt l’émergence d’une nouvelle qualité des mouvements sociaux ”. C’est logique : s’il y a un nouveau capitalisme, il y a forcément une nouvelle qualité des mouvements sociaux ! Comme toujours, sous prétexte de situations nouvelles, on cherche à inscrire une césure entre hier et aujourd’hui en définissant de “ nouvelles ” caractéristiques aux luttes actuelles, en leur attribuant une “ nouvelle ” qualité, en donnant d’autres tâches au “ nouveau prolétariat ”, à la “ multitude ”. Dans ce contexte, tout ce qui peut servir comme analyse des forces et faiblesses des luttes prolétariennes passées n’a plus de raison d’être puisque étrangère à la nature, à la qualité même des luttes actuelles. Aujourd’hui, plus de luttes internationalistes donc (parce qu’elles ne communiqueraient plus horizontalement entre elles, parce qu’elles s’attaqueraient directement et à la verticale au sommet -à l’Empire- et bla bla bla), mais des mouvements “ radicalement différents ” (1) , “ biopolitiques ” (économiques, politiques et culturels, dans le jargon des auteurs), déterminés également par une “ nouvelle ” composition du prolétariat et l’apparition d’un “ nouveau ” sujet : la multitude et ses désirs.
“ La composition du prolétariat s’est transformée et notre compréhension doit s’adapter à ces mutations… Conceptuellement, par prolétariat, nous entendons une large catégorie comprenant tous ceux dont le travail est directement ou indirectement exploité et sujet aux normes capitalistes de production et reproduction … Auparavant, la catégorie de prolétariat était identifiée et, dans une certaine phase, réellement subsumée par la classe ouvrière industrielle, dont la figure type était constituée par l’ouvrier mâle des grandes usines… Nous sommes de nouveau face au devoir d’analyser et comprendre la nouvelle composition du prolétariat en tant que classe…Parmi celles-ci, la force de travail immatérielle (impliquée dans la communication, la coopération et dans la production et reproduction des émotions) occupe une position toujours plus centrale…Nous devons nous pencher plus attentivement sur les formes de lutte à travers lesquelles ce nouveau prolétariat exprime ses besoins et ses désirs ” (e).
Remarquons qu’avant même d’introduire le “ nouveau ” sujet -la multitude-on est déjà en plein dans la conception social-démocrate des classes. Le prolétariat n’est pas décrit dans son mouvement, dans son antagonisme à la bourgeoisie, au capital ; il n’est pas non plus défini par son projet, son histoire, son parti, ses luttes, mais reste fondamentalement un objet statique à analyser dans son immobilité et son immédiat, exactement comme le présente l’ensemble de la social-démocratie, exactement comme le conçoit le stalinisme. Selon Negri, face à l’ouvrier industriel d’hier, l’actuel ouvrier de l’immatériel est aujourd’hui au centre, et nous devons “ étudier ” ses caractéristiques, cette sociologie du nouvel exploité “ central ” déterminant évidemment de nouvelles tâches, de nouveaux objectifs.
Les auteurs passent donc par le concept (statique et tordu, ici) de prolétariat, mais c’est essentiellement pour aboutir à la mise en avant … de son exact contraire : la multitude. Et ainsi, de fil en aiguille, en partant de l’ouvrier exploité et du prolétaire internationaliste, en sautant à la force de travail industrielle puis immatérielle, on aboutit à la multitude : “ …sous les cendres de l’Empire s’est consumé le bûcher du sujet internationaliste prolétarien… et qui a pris la place de ce sujet ? … on peut affirmer que l’enracinement ontologique d’une nouvelle multitude doit devenir un acteur positif et alternatif dans l’articulation de la globalisation… ” (f). “ Loin d’avoir été défaites, toutes les révolutions du XXè siècle ont rénové et transformé les termes de la lutte de classe, posant les conditions d’une nouvelle subjectivité politique : une nouvelle multitude se retourne contre l’Empire ” (g). Et voilà comment, tout en revendiquant férocement “ l’école de la lutte des classes ” et l’existence du prolétariat, on emprunte la pente des “ nouvelles conditions capitalistes ” pour glisser en douceur vers de “ nouvelles tâches ” et finalement, après être passé par la “ nouvelle subjectivité politique ”, aboutir … à la dissolution du prolétariat dans la multitude. Pardon, dans la “ nouvelle ” multitude !
L’insistance avec laquelle Negri-Hardt attachent le mot “ nouveau ” à tous les concepts, la fréquence avec laquelle cet adjectif est utilisé à toutes les pages, est inversement proportionnel au peu de “ nouveauté réelle ” que contient cet énième plaidoyer réformiste pour un monde “ de coopération ”. On retrouve les mêmes vieux symptômes des découvreurs de “ nouvelles phases ”, de “ nouvelle philosophie ”, de “ nouveaux sujets ” : une récupération de toutes sortes de références historiques, une description de la misère du monde et de sa répression, un appel à se soumettre aux mouvements réformistes à la mode, une prédiction sur un monde sur le point de basculer… et puis finalement aucun moyen concret, aucune perspective, aucune directive concrète pour l’action.
Des chapitres et des chapitres sur “ l’ordre mondial ”, sur “ le déclin de l’Etat-nation ”, sur “ la souveraineté américaine et le nouvel Empire ”, sur “ la souveraineté capitaliste ou l’administration de la société globale ”, et lorsque enfin, à la toute fin, on annonce les perspectives … rien, le vide !
Mais admirez plutôt le chef-d’œuvre : “ Il s’agit d’identifier et d’affronter les initiatives de l’Empire en empêchant qu’elles continuent à rétablir l’ordre ; il s’agit de traverser et de détruire les limites et les segmentations imposées à la nouvelle force de travail collective (tiens, encore une nouveauté ! NDR) ; il s’agit de relier les expériences de résistance et de les orchestrer contre les centres névralgiques du commandement impérial… ” (h)
Après 367 pages de philosophie, les auteurs parlent enfin d’action concrète, de pratique sociale. Nous arrivons au moment crucial de l’œuvre, au point de passage entre théorie critique et action pratique, nous arrivons au “ que faire ? ”, au saut de qualité…
“ …Bien que tout cela soit très clair conceptuellement, d’un point de vue pratique, ce devoir à accomplir par la multitude est encore assez abstrait… Quelles seront les pratiques spécifiques et concrètes qui animeront ce projet politique ? Nous ne le savons pas encore. ” (i)
Un chef d’œuvre : près de 400 pages de “ pensée radicale ” pour avouer finalement qu’on n’a aucune idée des “pratiques spécifiques et concrètes qui animeront ce projet politique ”…Un aveu d’impuissance livré avec un culot à faire pâlir d’envie n’importe quel politicien qui se hasarderait à commenter publiquement les perspectives pour l’emploi formulées par son parti !
Evidemment, ce n’est pas tout à fait vrai, parce qu’un bon réformiste se doit d’évoquer l’une ou l’autre perspective concrète, et si l’on surmonte la déception que nous a procuré cet aveu d’impuissance, on obtient tout de même rapidement quelques pistes. Negri et Hardt se sont mis à deux pour être plus forts dans leurs propositions et ont gardé le meilleur pour la fin : “ Ce que nous pouvons néanmoins apercevoir est un premier élément d’un programme politique de la multitude globale, une première instance politique : la citoyenneté globale. ” (j) Et c’est parti ! Pour tous ceux qui douteraient encore des intentions gestionnistes contre-révolutionnaires des auteurs d’ “ Empire ”, à ce point, tout devient clair. Negri-Hardt exigent une carte d’identité pour tous, appellent à revendiquer auprès de chaque Etat une reconnaissance juridique des migrations, encourage la multitude à exiger d’obtenir un contrôle sur ses mouvements migratoires (sic !), etc. “ Le droit universel de contrôler ses propres mouvements est l’instance radicale de la multitude pour une citoyenneté globale ” (k) . Si vous n’avez pas tout compris, ne vous en faites pas trop, les auteurs non plus ! L’important est de constater à quel point, dès qu’on quitte le monde des belles intuitions philosophiques, le marxisme de salon n’a plus rien à envier au plus grossier des réformismes. Bill Clinton exige “ une carte de santé universelle ”, Toni Negri demande des cartes d’identité de résident pour tous. “… Ce qui signifie que tous (les sans-papiers) devraient jouir des mêmes droits de citoyenneté dans le pays où ils vivent et travaillent ” (l). Passons rapidement encore sur le travail, “ cette activité créative fondamentale de la multitude ”, passons sur le “ droit à un salaire social et une allocation garantie pour tous ”, passons, passons, surtout, passons ! En fait, il suffirait finalement de se précipiter sur les conclusions du livre pour saisir directement où nous mènent les marxologues et autres philosophes.
On pourrait évidemment maintenant se demander si, d’un point de vue communiste, tout cela vaut vraiment la peine d’être lu, analysé et critiqué. C’est vrai que certains éléments du programme Negri-Hardt frisent à ce point le ridicule qu’il est assez légitime de se poser la question. Mais avec “ Empire ”, Negri et Hardt visent tout particulièrement la marge radicale du mouvement antiglobalisation : la philosophie du bouquin est formatée à l’adresse d’une certaine radicalité en acte autour de l’anti-globalisation. Et c’est précisément au moment où le prolétariat cherchera à se dégager des idéologies pacifistes ou anti-organisationnelles qui polluent ces milieux, c’est précisément quand se joueront des sauts de qualité visant à rendre opérationnelle la lutte contre le capitalisme que l’idéologie de “ l’Empire et de la multitude ” joueront le rôle de garde-fou et empêcheront les ruptures de se développer, de se généraliser. Cette façon de caresser le “ mouvement antiglobalisation ” dans le sens du poil n’a pour fonction que de chercher à le soumettre à ses propres faiblesses, à l’enfermer dans une critique spectaculaire du capitalisme, une critique nourrie d’idées aussi bien organisées et responsables que les manifestations dans lesquelles elles s’expriment, bref dans une “ critique ” qui ne passe pas à l’acte.
Plus largement, c’est aujourd’hui que se construisent les idéologies “ radicales ” qui demain serviront à freiner, voire à paralyser les mouvements anticapitalistes. Ainsi, c’est quand le prolétariat manifestera sa volonté de partir à l’assaut réel de la propriété privée, qu’on nous sortira que cela n’est pas nécessaire aujourd’hui, que “ Produire signifie toujours plus, construire de la coopération et de la mise en commun de la communication ”, qu’en ce sens “ le concept même de propriété privée devient un véritable non-sens ” … que “ le sujet de la production est plutôt la communauté ”… que ce qui n’a pas été éliminé, “ c’est les régimes politiques et juridiques qui soutiennent la propriété privée ”… que “ la propriété privée ne peut éviter de devenir un concept toujours plus abstrait… toujours plus éloigné de la réalité ” (m). Le tour est joué. Puisque la propriété privée n’existe plus (ou quasi), notre action peut être de deux ordres : prendre conscience et faire prendre conscience à la multitude de la disparition de la propriété privée, exiger ensuite la démission ou le départ des coquilles vides -les régimes politiques et juridiques- qui les soutiennent…
“ Nous participons aujourd’hui à la plus radicale et profonde mise en commun dont on ait jamais fait l’expérience dans toute l’histoire du capitalisme… Notre réalité économique et sociale… est envahie de services et de relations produits de la coopération… ” (n). Puisque nous vivons dans la coopération, la communication, la communauté, il ne reste plus qu’à découvrir que les véritables maîtres du monde, c’est nous. C’est simple, il suffit de lire : “ L’Empire prétend être le maître de ce monde parce qu’il peut le détruire. Quelle horrible illusion ! En réalité, c’est nous qui sommes les maîtres du monde, c’est nous qui le générons continuellement avec notre désir et notre travail…Cette nouvelle réalité contraint la théorie politique à une redéfinition radicale … Dans la société biopolitique, la décision du souverain ne peut nier à aucun moment le désir de la multitude. ” (o)
A la trappe, la violence révolutionnaire, la dictature du prolétariat, l’organisation en force de notre classe sociale ! Plus besoin, puisque nous sommes déjà les maîtres du monde, et que le pouvoir est incapable de nier nos désirs. Les millions de prolétaires qui crèvent de faim et d’angoisse dans le monde seront vraiment heureux de l’apprendre. Eux qui commençaient à douter sérieusement de la capacité des capitalistes à entendre leurs désirs, Negri est là pour effacer leurs doutes.
Mais Negri va plus loin encore, et ici on est dans le domaine des perles (mais l’a-t-on jamais quitté ?!), il essaye de récupérer le mot d’ordre de destruction de l’Etat en assimilant à l’auto gouvernement la consigne historique de Marx. Nous n’avons jamais imaginé que Negri était un ennemi de l’Etat, il l’a d’ailleurs clarifié publiquement à différentes reprises (cfr. notre “ perle de la bourgeoisie ” dans Communisme n°46). Mais le travail de révision qu’il fait ici est tout simplement remarquable. Il réussit à faire dire à Marx le contraire de ce qu’il affirme par une pirouette dont seuls les révisionnistes sont capables. Ca vaut les billets de banque des ex “ pays socialistes ” avec la tête de Marx imprimée dessus. Observez plutôt.
Negri-Hardt nous explique que le “ Big government is over ” en se démarquant tout d’abord de la façon dont les “ conservateurs américains ” ont raillé les “ démocrates ” américains avec ce slogan. Il précise néanmoins, que “ comme nous avons été éduqués à l’école de la lutte de classe, nous savons pertinemment bien que le big government a également été un instrument de la redistribution de la richesse sociale et que, sous la pression de la lutte de classe ouvrière, il a été utilisé comme une arme dans les conflits pour l’égalité et la démocratie. ” (p) Vieille théorie social-démocrate de l’Etat, selon laquelle l’Etat ne serait pas l’organisation en force de la bourgeoisie, mais un simple instrument neutre sur lequel peuvent intervenir les différentes classes de la société. Sans commentaires ! Mais Negri va beaucoup plus loin : ce temps-là est passé. Les gros gouvernements socialistes et communistes ont conduit aux camps… En rappelant que Marx dénonçait il y a déjà 150 ans que toutes les révolutions jusqu’ici n’avaient fait que perfectionner l’Etat plutôt que de le détruire, il nous explique que le mode d’organisation de l’économie actuelle rend inutile l’assaut à l’Etat, et que la seule possibilité réside dans “ l’auto-constitution de la force de travail en gouvernement ”… ce qu’il appelle destruction de l’Etat. Le tour est joué ! “ Non, nous ne sommes pas des anarchistes, nous sommes des communistes qui ont vu à quel point la répression et la destruction de l’humanité ont été menées par les big governments socialistes et libéraux. Et nous avons vu également comment tout cela se concentre aujourd’hui dans le gouvernement impérial, au moment même où les circuits de la coopération coopérative ont rendu la force de travail dans son ensemble capable de s’auto constituer en gouvernement. ” (q) Les théories de Negri-Hardt ont éliminé toute référence à la violence révolutionnaire, à l’organisation du prolétariat en force, à l’assaut à la propriété privée… et ils assimilent maintenant le gouvernement auquel ils aspirent de tous leurs vœux (un gouvernement de citoyenneté globale, de démocratie active) à la destruction de l’Etat !
La ficelle est grosse. Mais la boucle est bouclée et nous permet de conclure en résumant à nouveau la pensée du livre. En gros, “ Empire ” a cherché tout au long des chapitres de nous présenter le monde comme unifié, globalisé, subsumé par un ordre impérial qui exerce son contrôle partout et nulle part à la fois. Dans ce monde, tous les niveaux de la pyramide qui le constituent, participent à sa reproduction. L’Empire étend sa domination sur tous les aspects de la vie sociale, mais d’un autre côté, partout s’exprime “ la vie, le désir, la communauté ”. Le travail est production de la vie. Les ONG, par exemple, transforment la politique en une question qui regarde la vie générique et étendent leur action sur tout l’espace biopolitique. “ Et à ce niveau universel, les activités des ONG coïncident avec les initiatives de l’Empire qui, sur le terrain du biopouvoir, vont au-delà de la politique pour satisfaire les besoins de la vie elle-même. ” (r) L’Empire étend son règne au-delà de l’Etat-nation, au-delà de la politique, partout et sur tout, mais il est contraint de voir se développer des forces qui développent la vie générique, et ses souverains sont contraints d’obéir aux désirs de la multitude. Empire et multitude sont deux réalités qui coïncident. La propriété n’a plus qu’une existence juridique. Tout est mis en commun. Il ne manque presque rien pour passer à un autre monde. Nous sommes proches du dénouement. Comment ? De façon pacifique, et en tout cas, pas en cherchant à s’emparer du “ commandement ”, mais en s’auto-organisant en gouvernement.
Peut-être le chapitre final sur le militant nous en dira-t-il plus ?
“ Il convient de souligner immédiatement que cette nouvelle militance n’est pas la réplique des formules organisatives de la vieille classe ouvrière révolutionnaire. ” (s) On s’en doutait, Toni, qu’on allait vers une “ nouvelle ” militance, on s’en doutait ! “ Les militants doivent résister au commandement de l’Empire de façon créative. En d’autres termes, la résistance est immédiatement liée à un investissement constitutif dans le monde biopolitique, tourné vers la création de dispositifs coopératifs de production et de communauté ” (t) Vous avez dit “ communisation ” ? Vous avez dit “ gestionnisme ” ?
“ Il y a une vieille légende qui pourrait illuminer la vie future de la militance communiste : la légende de Saint François d’Assise… Pour dénoncer la pauvreté de la multitude, il en adopta la condition commune et y découvrit la puissance ontologique d’une nouvelle société. Le militant communiste fait la même chose… ” (u)
Se mêler aux altermondialistes, aux bonnes sœurs des ONG, travailler dans la joie avec les curés de la coopération…
“ Dans la postmodernité, nous nous trouvons encore dans la situation de François, à opposer la joie d’être à la misère du pouvoir. Il s’agit d’une révolution qui échappera au contrôle, parce que le biopouvoir et le communisme, la coopération et la révolution restent ensemble simplement dans l’amour, et avec innocence. Telle est la clarté et la joie irrépressible d’être communiste ”. (v)
Amen !
En fin de compte, beaucoup d’abstractions et beaucoup de religion, pour finalement chanter le monde actuel. Tout comme Bernstein dévoilait ce que faisait “ tout bas ” la social-démocratie en disant “ tout haut ” que la révolution violente était une idée dépassée, Negri décrit la réalité immédiate dudit mouvement anti-globalisation (en fait la pratique et l’idéologie social-démocrate “ antiglobalisation ” active au sein des mouvements prolétariens qui s’attaquent au capitalisme) et met des mots et des perspectives sur tout ce qu’il contient de plus réformiste (ONG, idéologies de la coopération, pacifisme, charité …) Il flirte avec ses tendances gestionnistes, fait l’apologie de ses pires faiblesses, et lui vend finalement l’image de sa propre misère : absence de sujet révolutionnaire, apologie du “ refus ”, pacifisme, idéologie de la conscientisation, autogestion, auto-gouvernement,... Résultat : son livre est une excellente théorisation du réformisme présent dans les mouvements actuels.
Pas d’action révolutionnaire, le monopole de la violence laissé à l’Etat, pas d’attaque de la propriété privée, de la valeur, pas d’affrontement avec la classe ennemie, pas d’organisation,… reste un peu d’ONG, un peu de revendication pour la citoyenneté mondiale et une vraie démocratie, un peu d’éthique et de philosophie confuse, un peu d’amour pour la multitude, un peu de commisération, beaucoup, beaucoup, beaucoup d’idéalisme et de gestionnisme.
En résumé, on a commencé par dénoncer le renforcement à tout niveau du contrôle capitaliste sur les êtres et on a abouti à la revendication “ d’une organisation d’un pouvoir politique productif et une unification biopolitique gérée, organisée et dirigée par la multitude -une démocratie absolue en action ” (w) . Dans la plus pure tradition populiste du capitalisme de gauche et du stalinisme que les auteurs disent pourtant réfuter, on est parti du prolétariat pour aboutir à la négation de son rôle historique, à sa dissolution dans une multitude pacifique et démocratique.
a- Michael Hardt / Antonio Negri, Empire, Préface.
b- Ibid.
c- Ibid., 4è p., ch. II.
d- Ibid., Préface.
e- Ibid., 1ère p., ch. III.
f- Ibid.
g- Ibid., 4è p., ch. III.
h- Ibid.
i- Ibid.
j- Ibid.
k- Ibid.
l- Ibid.
m- Ibid., 3è p., ch. IV.
n- Ibid.
o- Ibid., 4è p., ch. II.
p- Ibid., 3è p., ch. VI.
q- Ibid.
r- Ibid., 3è p., ch. V.
s- Ibid., 4è p., ch. III.
t- Ibid.
u- Ibid.
v- Ibid.
w- Ibid.
Toni Negri prend très au sérieux sa tâche de concilier ceux qui luttent et ceux qui réprimentMais comment se fait-il que tous les pompiers internationaux de la lutte de classe passent par l’Argentine ?Toni Negri a donné une conférence à Grisinopoli, une usine occupée qui fonctionne comme important centre social pour les piqueteros et autres combattants de notre classe. Apparemment, il y en a qui croient encore en ce monsieur et vont jusqu’à accepter qu’il s’exprime. Quant à Toni Negri, il n’a en tout cas pas hésité, juste après sa visite à l’usine, à se rendre auprès des pires ennemis de ce mouvement ! Guillermo Almeyra, dans un article publié dans La jornada de Mexicó et reproduit par Resumen Latinoamericano (n°354, 7/11/2003), écrit ceci : “A Grisinopoli, Negri a donné une conférence devant un auditoire composé principalement de dirigeants des groupes autonomistes et des secteurs piqueteros qui eux aussi ne jurent que par l’autonomie, mais ensuite, il a également été parler avec de hauts fonctionnaires du gouvernement, péronistes, ex-Montoneros pour la plupart, parmi lesquels on comptait, tirant sur son Havane, le ministre du Travail, Carlos Tomada, séquestré il y a quelques temps dans son ministère par les piqueteros autonomes, piqueteros qu’il avait alors dénoncés devant la justice et qu’il voulut réprimer en créant une brigade de police spéciale antipiquetera (chargée du service de renseignement et de la cooptation des dirigeants sociaux de manière “préventive”). Comme Voltaire, qui conseillait Frédéric Le Grand de Prusse ou La Grande Catherine, Negri conseille les péronistes sur la question de l’autonomie, et déclare qu’il en fera autant pour les dirigeants du Parti des Travailleurs et du gouvernement de Lula et pour Lula lui-même, ainsi que pour les dirigeants d’Etat et les socialistes chiliens”. Pour Toni Negri, il n’y a pas de contradictions de classe entre les hommes d’Etat et les prolétaires, entre ceux qui répriment et ceux qui luttent, entre les gouvernants et les piqueteros. Tout cela ne seraient que de malheureux malentendus ! Dans la multitude de Toni Negri, il y a place pour les exploités et pour les exploiteurs ! |
Nous n’avons pas la possibilité de faire ici une analyse des luttes récentes, mais nous reprendrons dans cet article quelques éléments publiés dans différentes publications et qu’il nous a semblé important de souligner.
Ainsi, il est tout à fait significatif que les Núcleos Anarquistas de Acción aient titré leur prise de position: “Bolivie et la question du pouvoir”, additionné du sous-titre “L’insurrection de El Alto pose le problème du pouvoir” et ce, totalement à contre-courant, au beau milieu des événements et avant la chute du gouvernement (1). Le texte dit ceci: “A la différence des révoltes qui ont eu lieu ces dernières années, la mobilisation populaire actuelle en Bolivie est parvenue à mettre sur la table la question du pouvoir politique. La bataille du gaz a permis de condenser un ensemble de revendications structurelles du mouvement de masses, qui étaient latentes ou émergeaient localement seulement, et qui aujourd’hui ont pris une forme nationale. De fait, dans la guerre du gaz, différents éléments ont provoqué l’actuel soulèvement; des revendications de classe se sont combinées et des revendications ethniques générées par la brutale oppression des peuples indigènes, locales et régionales. De ce point de vue, et au vu du saut de qualité qu’a représenté le soulèvement à El Alto, nous pouvons dire qu’aujourd’hui, en Bolivie une révolution s’est mise en marche, bien que la chute du gouvernement ne soit pas encore consommée. Et dans les faits, une alliance de classe s’est constituée entre le prolétariat qui agit de manière différenciée, ponctuellement avec les mineurs de Huanuni et d’autres contingents de mineurs qui se trouvent sur le chemin de La Paz, le mouvement paysan du haut plateau et des vallées, les “cocaleros”, les pauvres des villes et le semi-prolétariat des ateliers, de la tannerie, des transports, de la distribution, etc. (2)”
Bien que pour nous, il s’agisse exclusivement de l’affirmation du prolétariat comme classe et que nous critiquions ce qui est dit de l’alliance de classes car nous y constatons une concession à la sociologie (et au marxisme-léninisme), nous nous réjouissons du fait que des camarades, qui se disent anarchistes, assument ouvertement et explicitement, que le prolétariat est en train de mettre la question du pouvoir et de la révolution sur le tapis.
Soulignons encore que d’autres secteurs prolétariens d’Amérique n’ont pas hésité pas non plus à baser leur analyse des événements de Bolivie sur la contradiction entre l’humanité et le capital, et ce à contre-courant de toutes les idéologies particularistes dominantes. Pour nous, il s’agit là du point de départ de toute solidarité classiste avec nos frères en lutte.
Citons plus particulièrement une “Lettre ouverte aux exploité(e)s de Bolivie” signée par le Movimiento libertario cubano (3) dans laquelle, sous le titre “L’explosion populaire contre l’exploitation capitaliste. Ne faisons pas un seul pas en arrière jusqu’à la Révolution Sociale”, les contradictions en jeu sont on ne peut plus clairement exposées :
“Une fois de plus, la société marchande et l’Etat bourgeois se sont montrés incapables de garantir les conditions de vie à la majorité de l’Humanité. Le Capital, par sa logique propre, doit maintenir dans des conditions de vie misérables un nombre toujours plus grand de prolétaires à travers le monde. Face à cela les exploité(e)s de Bolivie, une nouvelle fois, sont descendus dans la rue, assumant ouvertement leur opposition à la propriété privée, et ils ont affronté les structures de l’Etat. La situation par laquelle passent les exploité(e)s de Bolivie, n’est pas différente de celle des autres pays. Ce sont les derniers râles du capitalisme mondial qui, dans son agonie, continue d’assassiner des milliers d’exploités(é)s tout autour de la terre...”
Les Núcleos Anarquistas de Acción soulignent aussi le rôle joué dans la lutte par les structures associatives du prolétariat ainsi que leurs tentatives de coordination et de centralisation: “En ce qui concerne les organisations avec lesquelles le mouvement de masse a agi, ce furent principalement les “Juntas Vecinales” (“Conseils de Quartier”), une forme d’organisation très répandue dans le pays. Dans El Alto, il devait y avoir près de 500 “juntas”. Celles-ci sont regroupées dans les “Fédérations de Juntas Vecinales” (FEJUVE) qui, conjointement à la “Central Obrera Regional”, dirigèrent la lutte. Actuellement, vu la répression (plus de 160 morts et 400 blessés), ils ont donné des instructions pour la constitution de comités d’autodéfense. Dans cette même ville une instance de coordination pour résoudre la question de l’autodéfense est également apparue, elle se nomme “Comando General Comunitario”, et est formée de la coordination entre la COR, la FEJUVE, et la CSUTCB (Confédération Syndicale Unique des Travailleurs des Campagnes de Bolivie). Cependant les 12 et 13 octobre, la résistance à la sauvagerie militaro-policière éclata de façon spontanée, sans organisation préalable d’aucune sorte, ce qui mit en évidence l’état de léthargie des organisations existantes. En général, l’état d’esprit de la base tend de jours en jours à dépasser la politique et les oscillations des directions, non seulement au niveau national mais aussi au niveau local. De fait, certains dirigeants ont essayé de dialoguer avec le gouvernement. Ils ont été ignorés ou rapidement mis aux pas sous les menaces de lynchage.”
Cette contradiction brutale entre le prolétariat en lutte et les organisations qui disent le représenter (et à de nombreuses reprises, pas seulement leurs dirigeants ou leurs sommets !), l’expulsion et la menace de lynchage de dirigeants, se sont étendus à l’ensemble du mouvement et constituent un saut de qualité important.
Il est intéressant et important de voir maintenant comment s’articulent les positions des organisations de gauche par rapport à la droite franche et ouverte. Le même communiqué dit : “Sánchez de Lozada a tardé à tomber à cause de l’appui des organismes internationaux, à commencer par l’ambassade nord-américaine, la OEA, le Pacte Andin et divers organismes internationaux qui voyaient dans sa chute un danger pour l’ensemble de la région étant donné que, depuis 20 ans de démocratie arrangée, excluante, raciste et répressive, l’ensemble des médiations bourgeoises traditionnelles ont fortement été remises en question. D’où l’appui que lui ont apporté aux heures les plus critiques, le “Movimiento de la Izquierda Revolucionaria” et “Nueva Fuerza Republicana” ainsi que les chambres des entrepreneurs, les banquiers, l’église et toutes les organisations patronales... Sánchez de Lozada tarda à tomber grâce à la stratégie des états-majors des organisations de masses telles la direction du “Movimiento al Socialismo”, du “Movimiento Indigena Pachakuti” et de la “Central Obrera Boliviana”. La politique qu’ils ont systématiquement soutenue est celle de la pression sur le gouvernement pour le “convaincre”, d’abord de faire une déclaration sur la question de savoir à qui appartenait le gaz, aux Boliviens ou aux sociétés transnationales. Ensuite, quand le mouvement de masses s’empare de la rue, les 12 et 13 octobre à El Alto, ces-mêmes dirigeants firent pression pour le “convaincre” de démissionner. Leur politique conciliatrice et timorée s’exprime clairement dans leurs appels à faire ‘la grève de la faim’ comme mécanisme de conciliation, à suspendre les assemblées générales de la COB et la participation de l’avant-garde à ces dernières, avançant pour argument des “questions de sécurité (!)” et enfin, à essayer de diminuer l’“action directe” du mouvement de masses.”
Ces organisations ont reconnu que, d’une manière ou d’une autre, les masses leur étaient passées par dessus la tête. Non seulement les vieux partis staliniens (Parti Communiste de Bolivie) et trotskistes (Parti Ouvrier Révolutionnaire)4 déclarèrent qu’à l’heure de la vérité: “ils n’avaient pas été à la hauteur des événements”, mais que c’était les “organisations sociales qui avaient combattu au moyen de gigantesques manifestations, a l’aide des barricades, de la dynamite, des pierres et des bâtons, le régime de Gonzalez Sánchez de Lozada et l’armée. Le “Movimiento al Socialismo” (MAS) de Evo Morales et le “Movimiento Indigena Pachakuti” (MIP) n’ont pas non plus été des “référents nationaux” de la rébellion. Les dirigeants des mineurs, des ouvriers d’usines, de la construction, des enseignants, des paysans, des journalistes, des travailleurs de la santé, des étudiants universitaires et du secondaire, des graphistes, des ouvriers des minoteries, des coopératives, des vendeurs, des artisans, des pensionnés, des chômeurs, des “colonizadores”, des ouvriers du secteur de la viande, des transports, mais aussi des conseils de quartier, professionnels, coopérativistes, mineurs et agricoles, les centrales ouvrières départementales et d’autres organisations populaires qui participèrent aux événements nationaux, furent tous d’accord sur le fait que les directions des partis et des syndicats furent “dépassées” par la fureur de la population.
Jaime Solares, secrétaire exécutif de la COB, tirant les conclusions de l’assemblée générale nationale de son organisation, résuma la question avec véhémence. Nous qui nous considérons comme étant des révolutionnaires, nous ne pouvons mentir. Aucun leader ni parti politique quel qu’il soit n’a dirigé ce soulèvement populaire. Ni Evo (Morales), ni Felipe (Quispe), ni nous mêmes n’avons mené la rébellion. Ce conflit, malheureusement, n’a pas eu de direction unitaire. Ce sont les travailleurs boliviens, à partir de la base, qui ont flanqué à la porte l’assassin “Goñi” (Gonzalez Sánchez de Lozada). Ce sont les masses furieuses qui ont mis une gifle à l’impérialisme nord-américain. Personne, que cela soit un individu ou un parti, ne peut s’approprier le leadership de ce conflit. Personne!”. (5)
Nous voudrions souligner que ce n’est pas la première fois que les organisations mentionnées ici reconnaissent cela. En février 2003, le prolétariat avait débordé toutes les organisations, critiqué leurs programmes, leurs pratiques et leurs dirigeants et, à la suite d’affrontements (qui firent 35 morts par balles et 210 blessés), ces derniers s’étaient déjà autocritiqués en disant qu’ils “n’avaient pas été à la hauteur des événements”.
Lors de l’assemblée générale élargie de la Confederación Obrera Boliviana, qui eut lieu après la démission de Goñi, toutes sortes de tendances se sont exprimées, mais celle qui domina le plus largement fut celle qui critiquait les organisations et les directions prétendant représenter le mouvement. Ainsi Miguel Zuvieta, représentant des mineurs (il faut souligner qu’il y eut 5000 mineurs sur pied de guerre présents à La Paz!), a déclaré: “Aucun syndicat, ni parti de gauche ne s’est imaginé l’amplitude du mouvement qui arrivait. Nous n’avions pas compris les leçons de février. Le massacre de El Alto (12 octobre) fut le détonateur qui fit exploser la guerre contre le gouvernement et contre l’impérialisme. A partir de ce moment-là, le conflit nous échappa des mains, il fut incontrôlable. Ceci nous impose l’urgente nécessité de mieux nous organiser... Avec la grève générale illimitée qui dura deux semaines, nous avons posé la démission de Goñi, mais nous ne pensions pas sérieusement à ce qui allait se passer ensuite...”
Dans cette séance plénière, il y eut un accord général contre tout ce que disaient les médias et les partis bourgeois, tant boliviens qu’internationaux concernant le fait que le remplaçant de Goñi serait bien accepté… “Carlos Mesa est un chien de garde de la bourgeoisie... c’est la même salope avec une autre jupe”. Au nom de travailleurs de la construction, Taca rappela que cette direction unique doit avoir un “contenu de classe” : “Carlos Mesa est le représentant d’une classe sociale et nous appartenons à une autre classe sociale. C’est pour cela qu’un matin ou l’autre il nous tirera dessus, exactement comme Goñi”. Alvarez, représentant des enseignants, exposa: “les bases ont montré à leurs dirigeants comment on doit lutter pour renverser un gouvernement... Malheureusement sans objectif et sans direction révolutionnaire, les travailleurs ont donné leur vie vaillamment, mais pas pour qu’il y ait un simple changement constitutionnel. Ceux qui se sont soulevés voulaient améliorer leurs conditions de vie et ils voulaient un nouveau type d’Etat... Le gouvernement est historiquement incapable de résoudre la crise structurelle du pays. C’est précisément pour cela qu’il faut faire une plate-forme de lutte qui permette aux exploités d’arriver au pouvoir et ainsi de ‘structurer’ un gouvernement révolutionnaire des ‘ouvriers et paysans’ .”
Les secteurs de la jeunesse se sont prononcés de la manière suivante: “(La jeunesse) est disposée à descendre dans la rue avec ses aînés, à prendre les armes dans une insurrection populaire pour abattre le capitalisme et le modèle néo-libéral, l’impérialisme yankee. On devra fermer les portes du Parlement bourgeois avec sa démocratie représentative, rejeter le référendum et la constituante de Mesa”.
Indépendamment de tel ou tel dirigeant ou représentant des prolétaires en lutte, indépendamment du caractère radical ou récupérable des prises de position qui se sont manifestées dans cette assemblée plénière, indépendamment de l’appartenance à telle ou telle organisation, nous voudrions souligner ici le fait que l’ambiance générale de cette réunion reflète une conjonction de forces particulièrement intéressante et exceptionnelle dans le monde actuel. On sentait que le prolétariat avait de la puissance et devait aller plus loin! Qu’il fallait révolutionner les organisations, en faire d’autres, faire tomber d’autres têtes de dirigeants! Cela fait longtemps qu’il n’y avait pas eu des milliers de prolétaires armés pour affronter l’Etat! Cela fait longtemps que l’on n’avait pas critiqué aussi ouvertement et massivement les organisations qui encadrent la militance prolétarienne! Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas proclamé ouvertement qu’il faut détruire le pouvoir bourgeois, le parlement bourgeois avec toute sa démocratie représentative (y compris la fameuse Constituante) et construire le pouvoir prolétarien pour faire la révolution sociale! (6)
-18 octobre 2003-
| Oventic, Chis, 8 août
L’autonomie indigène
(…) Les municipalités rebelles se sont créées d’abord et deux années plus tard elles se sont déclarées autonomes, elles aussi. Aujourd’hui l’autonomie indigène, l’autogouvernement des peuples rebelles est une réalité. Actuellement, il y a plus de 30 municipalités autonomes dont l’influence s’étend sur la moitié du territoire du Chiapas. A la fin de l’année 1994, les zapatistes ont commencé a former des municipalités indigènes administrées en accord avec les us et coutumes autochtones. L’annonce par l’Armée Zapatiste de Libération (EZLN) de la création de comités de bon gouvernement dans les cinq Colimaçons (appelés jadis Aguascalientes) représente une nouvelle étape dans ce processus ainsi que la consolidation de l’auto-organisation communautaire. La distribution de ces comités correspond aux différentes zones qui composent le mouvement en accord avec la géographie des peuples rebelles et les relations qui les unissent : les hauts- plateaux (tzotzil), le Nord (chol), Altamirano (tzeltal-tojolabal), la foret tojolabal et la foret tzeltal. Ce nouveau gouvernement régional représente un effort organisatif des municipalités pour affronter les problèmes de l’autogouvernement et pour construire un pont plus direct entre elles et le monde. Pendant presque dix ans, les communautés zapatistes ont résisté sans l’aide des autorités ni d’aucun budget officiel, soumises à un siège militaire et au harcèlement des forces gouvernementales et paramilitaires qui se sont soldés par des milliers d’indigènes déplacés de leur village d’origine… Aujourd’hui, cela fait sept ans qu’est né le premier Aguascalientes au cœur du territoire zapatiste, la première tentative de construire un espace de rencontre et de dialogue entre la société civile et les rebelles. C’est là qu’est née la Convention Nationale Démocratique qui fut la première tentative d’organiser une force de la société civile en faveur de la paix et de la démocratie. Mais la proposition a échoué. Le fonctionnement des Colimaçons Les municipalités autonomes sont intégrées par les communautés indigènes au sein des territoires sous influence zapatiste. Les communautés comprises dans chaque municipalité rebelle ont volontairement décidé d’y participer par l’intermédiaire d’assemblées communautaires. Les communautés organisées pour la résistance élisent, en accord avec leurs us et coutumes, c’est-à-dire en assemblée, leurs représentants au conseil municipal autonome, l’autorité collégiale de la municipalité rebelle. Les autorités et les délégués sont révocables s’ils n’accomplissent pas les mandats assignés par l’assemblée de communautés. A partir de maintenant, ils seront coordonnés régionalement par les Colimaçons… Les conseils autonomes sont composés d’un président, d’un secrétaire, des ministres de la justice, des affaires agricoles, du comité de la santé, de l’éducation, et du responsable du registre civil. Les fonctions imparties sont la justice, la santé communautaire, l’éducation, le logement, la terre, le travail, l’alimentation, le commerce, l’information, la culture et le trafic local. Certaines municipalités autonomes ont ouvert leurs propres registres de mariage, de naissance et de décès. En de nombreux endroits, elles reçoivent également l’aide des autorités traditionnelles ou du conseil des anciens. La portée des actions menées par les municipalités dépend de leur consolidation. Leur budget est obtenu par la coopération de ceux qui les composent ou par l’aide solidaire. Les membres des conseils autonomes ne reçoivent pas de rémunération… Les comités de bon gouvernement sont en route; ils affirment qu’ils accueilleront également des non zapatistes… Ils annoncent le retrait des renforts de l’EZLN et éliminent les taxes pour le passages sur les territoires rebelles. (…) Avant d’installer les comités de bon gouvernement des municipalités autonomes rebelles zapatistes, les commandants et commandantes se sont adressés à leurs peuples respectifs, aux indigènes des autres organisations qui cohabitent sur les bases d’appui zapatistes dans les communautés, aux femmes des municipalités autonomes, aux peuples de tout le Mexique, aux paysans, aux jeunes, … Aux insubordonnés du monde entier… Le premier tour de Colimaçon expansif dans l’assemblée célébré aujourd’hui à Oventic, fut donné par le commandant David : “ Nous désirons que tout commence bien dans ce Colimaçon, lieu de rencontre des différents mondes. Ici, c’est la maison de tous ceux qui rêvent d’un monde plus juste et plus humain ”. C’est avec une patience infinie que les commandantes Rosalinda et Esther ont composé ce message. Le commandant Tacho s’est adressé aux paysans du Mexique. Omar aux jeunes. Fidelia aux femmes (“ nous allons obliger obligatoirement notre respect ” a-t-elle dit, soulevant un tonnerre d’applaudissements). Parmi les accords proposés par les zapatistes -et qui doivent être approuvés et, si nécessaire, élargis par des organisations qui soient “ indépendantes ”- ressortent le respect de l’autonomie et de l’indépendance des organisations sociales, la promotion de formes d’autogouvernement et d’autogestion sur tout le territoire national et l’appel à la rébellion et à la résistance civile et pacifique face aux dispositions du mauvais gouvernement et des partis politiques. L’EZLN, à son tour, a proposé la formation d’un “ réseau de commerce de base ” entre les communautés et l’impulsion “ de la consommation de base dans des locaux et des commerces nationaux ”. Elle a également invité à “former un réseau d’information et de culture ” à l’échelle locale, régionale et nationale pour demander aux médias une information véridique et équilibrée, ainsi que l’organisation de la défense et de la promotion de la culture locale et des sciences et arts universels. Dans le plan, elle définit sept requêtes qui comprennent la défense de la propriété villageoise et communale de la terre et la protection et la défense des ressources naturelles; un travail digne et un salaire juste pour tous. A cela s’ajoutent les requêtes pour un logement digne, la santé publique gratuite, de la nourriture et des vêtements pour tous, ainsi qu’une éducation laïque et gratuite pour les enfants et les jeunes gens. Et également le respect de la dignité de la femme, des enfants et des vieilles personnes. Dans ce discours dix commandants se sont exprimés. Des milliers d’indigènes témoignent des premiers pas des conseils de gouvernement (…) Le Congrès National Indigène a célébré “ avec humilité et espoir le grand pas accompli par nos frères de l’EZLN dans la consolidation et l’approfondissement de leur processus d’autonomie ” avec la création des Colimaçons et les conseils de bon gouvernement, “ qui devront constituer les instances régionales permettant l’application concrète de leur autonomie et de leur libre détermination, en conformité avec ce qui a été établi dans les accords de San Andrès et l’initiative de la Cocopa ”, qui fut rejetée par le Congrès de l’Union. Les membres du CNI, une instance qui regroupe une bonne partie du mouvement indigène national, ont déclaré qu’ “avec cette instance, l’EZLN réaffirme sa vocation démocratique et pacifique, et nous montre de nouvelles voies et de nouvelles formes ” qui permettront d’exercer “le droit à la libre détermination des peuples indigènes ”. Ce pas, ont-ils ajouté, est “ une importante contribution à la défense de la souveraineté nationale qui, jour après jour, est livrée par l’Etat, dans la pratique et dans la loi, aux intérêts de la globalisation neolibérale ”. Les indigènes ont considéré “ l’initiative zapatiste des conseils de bon gouvernement ” comme “ la meilleure réponse à la trahison de l’Etat mexicain qui continue sans trêve à refuser de reconnaître constitutionnellement les droits indigènes concrétisés dans l’initiative de la Cocopa ”. Extraits de La Jornada, 9, 10 et 11 aout 2003. |
Autonomies, autogouvernement, auto-organisation, droits des indigènes, bon gouvernement, démocratie, paix… des paroles creuses, des racontars, du blabla à deux sous. Mais quand donc les gouvernements ont-ils été bons ? Qu’est-ce donc que le capitalisme sinon les autonomies locales et sectorielles ? Quand l’octroi de droits aux indigènes a-t-il permis que l’Etat les traite mieux ? Plus ils ont reçu d’autonomie, de droits, de démocratie et de paix, plus les prolétaires et particulièrement les prolétaires indigènes ont reçu de misère, de coups de bâton, de groupes paramilitaires et de drapeaux mexicains.
Contrairement à la propagande étatiste des amis de Marcos, jamais les droits démocratiques ne pourront résoudre le problème des indigènes, le problème de la terre, le problème de la misère et, comme l’avait constaté et exprimé Zapata lui-même: “Gouvernement militaire d’abord, et parlementaire ensuite; réformes dans l’administration pour qu’elle soit réorganisée; pureté idéale dans la gestion des fonds publics; responsabilités officielles scrupuleusement exigées; liberté de presse pour ceux qui ne savent pas écrire; liberté de vote pour ceux qui ne connaissent pas les candidats, administration correcte de la justice pour ceux qui n’ont jamais engagé un avocat. Toutes ces beautés démocratiques, tous ces grands mots dont nos grands-pères et nos pères se délectaient ont aujourd’hui perdu leur magique attraction et leur sens pour nos peuples. Ceux-ci ont vu qu’avec ou sans élection, avec ou sans suffrage effectif, avec la dictature profirienne et avec la démocratie madériste, avec la presse bâillonnée ou avec le libertinage de la presse, toujours et de toute manière, ils continuent à ruminer leurs rancœurs, à souffrir la misère, à avaler leurs interminables humiliations, et c’est pourquoi ils craignent avec raison que les libérateurs d’aujourd’hui soient identiques à leurs chefs d’hier…” (Manifeste “ Au peuple mexicain ”, signé par Emiliano Zapata et d’autres généraux le 14 août 1914.)
Face à toute tentative de canaliser la lutte révolutionnaire vers les droits démocratiques, ce même manifeste déclare explicitement : “ On ne s’est pas lancé dans la révolte pour conquérir d’illusoires droits politiques qui ne donnent pas à manger, mais bien pour donner le morceau de terre qui doit lui procurer nourriture et liberté ”.
L’Etat bourgeois fait tout ce qu’il peut pour convaincre ses sujets que le problème n’est pas le système social capitaliste, que le problème est une simple question d’autonomie et de transformation de mauvais gouvernements en “ bons gouvernements ”. Ricardo Flores Magon disait très clairement qu’il ne fallait “ rien attendre d’aucun gouvernement parce que les gouvernements ne sont rien d’autres que les gardiens de la classe capitalistes ”. A l’opposé, le très médiatisé commandant Marcos, affirme aujourd’hui : “ En tant que commandant militaire des troupes zapatistes, je vous communique qu’à partir de maintenant, les Conseils Autonomes ne pourront recourir aux forces des milices pour les travaux du gouvernement. Ils devront, toutefois, s’efforcer de faire ce que doivent faire tous les bons gouvernements, c’est-à-dire recourir à la raison et non à la force pour gouverner. ” (1)
1- Extrait de Regeneracion, 29 juin 1911.
Perle de la bourgeoisieExtrait de “Les Colimaçons, le réalisme magique et les trous dans la couche d’ozone”, de John Holloway“ Le trou dans la couche d’ozone s’agrandit… mais aujourd’hui il y a d’autres trous… les trous dans le capitalisme… Les zapatistes constituent un des plus grands et des plus beaux trous dans le capitalisme aujourd’hui… La célébration de la naissance des Colimaçons et le communiqué qui l’a annoncée (“ La treizième stelle ”) souligne encore une fois la magie et le réalisme, le réalisme magique du non zapatiste. ” MEMORIA n°176 - octobre 2003.
|
Sur l’autonomieLe secret de la révolution, c’est l’autonomie. Mais pas n’importe quelle autonomie : très précisément, celle du prolétariat par rapport à la classe ennemie. Concrètement, cela signifie que le secret de la révolution est la constitution du prolétariat en classe, et donc en parti opposé à tout l’ordre établi. Plus concrètement encore, cela implique la condamnation du parlementarisme, du syndicalisme, du frontisme, et les révolutionnaires l’ont exprimé par cette formule synthétique: “s’organiser en dehors et contre tous les appareils de l’Etat bourgeois”.Cette opposition, cet antagonisme historique, est la seule autonomie dont les révolutionnaires se revendiquent. Parler d’autonomie tactique, en se référant à des groupes d’action face à l’Etat bourgeois, est évidemment également correct, mais il ne faut jamais perdre de vue la centralisation programmatique, la centralisation de la direction, du projet historique du prolétariat mondial. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’affirmer l’autonomie en général de quelques groupes vis-à-vis d’autres groupes, mais simplement l’autonomie opérationnelle, logistique, locale ou temporelle en réaffirmant simultanément la centralisation organique de tous ces groupes comme partie d’un tout luttant pour un seul objectif révolutionnaire. Toutes les tentatives de mises sur pied d’internationales révolutionnaires par le prolétariat, tout en partant de l’action autonome des différentes expressions du prolétariat et en affirmant la nécessité de l’existence des différentes structures ou sections des différents pays, tentent en même temps toujours de se constituer comme force révolutionnaire unique centralisée internationale et internationaliste. Mais aujourd’hui on parle d’autonomie pour n’importe quoi, autonomie de gouvernements, régions autonomes, autonomie de groupes vis-à-vis d’autres groupes, d’assemblées vis-à-vis d’autres assemblées, autonomies d’entreprises, autonomies productives, autonomies de gestion, etc. Il faut formellement dénoncer cela comme étant l’apologie même de la société actuelle, dont la centralisation marchande se base précisément sur l’autonomie de tous ceux qui convergent sur le marché, de l’autonomie de chaque unité productive, de l’autonomie de décision par rapport à l’autre, de propriétés privées autonomes. En tout cas, quand nous entendons parler d’autonomie, essayons de définir clairement de quelle autonomie il s’agit, et n’ayons surtout pas peur de critiquer l’autonomisme à la mode et d’y opposer l’autonomie du prolétariat unifié et centralisé internationalement. |
Mais l’Etat a déjà son budget et refuse quelque augmentation que ce soit. Face à la maladresse et à la bêtise du gouvernement, les professeurs de Cuzco radicalisent leurs méthodes de lutte et débordent les consignes pacifistes du syndicat : ils séquestrent le train des touristes, bloquent les rues de Puno et Cuzco et s’engagent dans une lutte, pierres à la main, contre les gorilles policiers qui blessent et détiennent des centaines de prolétaires parmi les enseignants. Pendant ce temps-là, Toledo et les présidents des Etats capitalistes du continent se réunissent en sommet, promettant de “résoudre la pauvreté dans la démocratie et d’investir”.
Face à cela, la radicalisation et les débordements s’étendent à d’autres endroits : à Cañete, deux mille professeurs assaillent la sous-préfecture et séquestrent son directeur avant d’être repoussés à coups de grenades. La même chose se produit à Ayacucho et à Tumbes où le pont International est bloqué.
Les luttes se développent et se radicalisent. D’autres secteurs se mettent en grève tels les médecins et les infirmières. Le 26 mai les prolétaires agricoles, regroupés dans le Conseil des utilisateurs des districts d’irrigation, se mettent en grève de façon spectaculaire et immédiatement se produisent des blocages massifs de rues, la panaméricaine, la rue centrale et d’autres, au moyen de pieux, de pierres, de pneus… empêchant toute circulation de marchandises et de personnes, menaçant ainsi de paralysie la machine capitaliste dans le pays tout entier. Les chefs d’entreprises, la putain de presse, les politiciens, les ministres délestent leur rage face à la témérité du prolétariat, vomissant que les “grèves et protestations détruisent la démocratie et la stabilité du pays” (traduisez : l’ordre capitaliste et ses intérêts). Ils en appellent à la répression. Comme s’ils répondaient à la menace voilée de l’Etat face aux débordements, les prolétaires agricoles de Trujillo agressés par les flics, attaquent à leur tour, à coups de pierres le commissariat de la police routière.
Le 27 mai, les pillages et le vandalisme se généralisent surtout à Huancayo, à Huaraz et à Chancay où les prolétaires agricoles sont à l’avant-garde, mais d’autres prolétaires agricoles se joignent à la lutte et font cause commune avec la grève.
DANS LA RUE, SUR LES ROUTES CONQUISES, ON ROMPT LES DIVISIONS IMPOSÉES PAR LE CAPITALISME ENTRE LES PROLÉTAIRES : ILS NE SONT PLUS “AGRICULTEURS”, “ÉTUDIANTS”, “PROFESSEURS” OU “CHÔMEURS”, NON, TOUS SONT PROLÉTAIRES, VICTIMES DU CAPITALISME QUI LES AFFAME, TOUS SE RECONNAISSENT COMME FRÈRES ET COMBATTENT ENSEMBLE CONTRE LE MÊME ENNEMI : LE CAPITAL ET SES FORCES RÉPRESSIVES.
A Huarza et à Chancay, tandis qu’un groupe maintient les blocages de rues, d’autres prolétaires armés de pieux et de pierres font irruption sur les marchés et s’arrachent avec du riz, du lait et d’autres aliments dont ils ont besoin eux, les grévistes et leurs enfants, le tout sous le regard impuissant et lâche des flics ici en désavantage numérique. A Huancayo des centres commerciaux sont attaqués.
A Lima la bourgeoisie continue à gesticuler et à hurler: le ministre de la répression annonce que plus de 60 avenues sont bloquées. Cette salope et m’as-tu-vu d’Anel Towsend et les congressistes de PERÚ POSSIBLE, APRA, UNIDAD NATIONAL et d’autres exigent la méthode forte et l’application impitoyable des lois pénales contre ceux qui se seront rendus coupables de blocages routiers et de destruction de la propriété publique et privée. L’église, par la voix de l’évêque de Chimbote appelle elle aussi à la répression des prolétaires accusant le mouvement d’être “infiltré par des éléments ultra-gauchistes qui fomentent la violence”. Toledo, lui même depuis sa petite réunion à Cuszo lance sa menace au prolétariat insurgé : “qu’ils n’en doutent pas un seul instant, nous allons maintenir l’ordre avec fermeté”.
Entre Pativilca et Barranca, les prolétaires se jetèrent dans une sanglante empoignade contre la soldatesque plusieurs fois repoussée à coups de pierres ; le combat dura toute la journée et des centaines de nos frères furent blessés et détenus. Mais on n’en resta pas là ; à la tombée de la nuit les prolétaires se rassemblent à nouveau et attaquent des commerces, pillant différents magasins tout en lapidant des bâtiments officiels. Le jour suivant la ville de Barranca se réveille sous le contrôle de l’armée et les traces des combats sont encore visibles sur la route Panamericana. A Jauja, la radicalité prolétarienne frappe le commissariat de police de Apata qui est pris d’assaut et d’où sortent 16 flics tout cabossés au moment même où un bulldozer et des voitures de la police sont incendiées.
40 prolétaires sont détenus. Pendant ce temps, les grévistes s’affrontent aux flics à Huaraz, Loreto, Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Trujillo, Tacna où des centaines d’enseignants sont frappés par la répression. Le 29 mai, les étudiants de l’université du Haut-plateau sont chassés comme des mouches par les soldats après avoir mis les policiers à la porte de l’université. Là, l’Etat montra toute sa nature assassine: ils tirèrent pour tuer, après que les étudiants aient tenté de leurs arracher les fusils ; un jeunes prolétaire fut tué et plusieurs blessés ou disparus.
L’archi-putain de presse et la TV parlèrent sobrement d’ “excès” pour qualifier cette véritable chasse à l’homme, comme si tirer à coups de fusils sur des prolétaires était pareil qu’avoir bu ou mangé de trop.
Pendant ce temps, Nilver López, les racailles de “Patria Roja”, soutenus par la CGTP avaient hâte d’arriver à un accord et voulaient donc déclencher la grève des enseignants alors même que des milliers de prolétaires enseignants se battaient dans les rues. Les syndicats, pour ne pas rester à la remorque du prolétariat et se faire déborder, appelèrent à une “journée de protestation nationale” et se réunirent au préalable avec Toledo et le curé Bambaren pour voir s’ils arrivaient à lever l’état d’urgence ; et comme ils n’arrivèrent pas à un accord, Toledo leur certifia qu’ils n’auraient pas de problème lors de leur marche de protestation. Tout heureux, les syndicats crièrent aux quatre vents que la marche serait pacifique, et défilèrent sans encombre vu que le jour précédent le gouvernement avait ordonné le retrait des tanks de l’armée.
Et c’est toujours le même foutoir: le même défilé de pancartes, les mêmes slogans menaçants qui n’effrayent plus personne, les mêmes prolétaires moutons de la direction syndicale.
Les prolétaires enseignants coincés dans ce cirque syndical appelé SUTEP se divisèrent en deux fractions qui finirent par déclencher la grève sans heurt et sans éclat, chacun de son côté, ce qui au bout du compte ne représenta rien de plus que le sempiternel affrontement visant à déterminer qui s’accaparera et manœuvrera la direction syndicale en fonction, non pas des intérêts prolétariens, mais de ceux du parti, visant à voir qui négociera lors de la prochaine grève des enseignants.
1) Les luttes qui ont eu lieu, s’inscrivent dans le type de luttes qui au niveau mondial caractérisent la période actuelle (débordements des directions syndicales, attaques de bâtiments publics et privés, blocage des routes, incendies de bâtiments abritant les forces de répression, affrontements à la police et à l’armée, pillages). Alors que la bourgeoisie et ses porte-parole parlent de subversifs, de vandales, de désordre, de chaos, pour nous ces actes représentent des pratiques d’affirmation prolétarienne. C’EST LE PROLÉTARIAT, SES MÉTHODES RADICALES ET SON ACTION DIRECTE QUI SE SONT AFFIRMÉS ET ONT FAIT ACTE DE PRÉSENCE DANS LES RÉCENTES GRÈVES, OCCUPATIONS ET BLOCAGES, EN SE REVOLATANT CONTRE LES MISÉRABLES CONDITIONS AUXQUELLES LE CAPITAL NOUS SOUMET.
2) L’Etat a montré sont vrai visage, à la fois craintif et répressif. La Démocratie, la dictature du capital, commença par trembler devant la croissante vague de luttes, les paralysies et les occupations des rues. A tel point que 70% des soldats et presque 100% de la police furent appelés pour réprimer et tirèrent pour tuer les prolétaires pratiquement en état insurrectionnel.
3) Les blocages routiers (et donc la paralysie de la circulation de la force de travail, des marchandises, des aliments, etc.) et les pillages (devantures de magasin forcées, attaques de centres commerciaux) se révèlent être des méthodes de lutte générant un réel danger pour le fonctionnement normal de la machine capitaliste, bien plus que les grèves partielles et sectorielles. C’est ce qui explique la déclaration presque immédiate de l’état d’urgence et l’envoi de la répression pour déloger les prolétaires, nettoyer les rues et empêcher les pillages.
4) Il faut bien le dire aussi, au même titre que d’autres luttes de par le monde (Bolivie, Algérie, Argentine, etc.), le processus fut de courte durée et ne put se généraliser. De la même manière, une autre faiblesse de notre classe fut le manque d’associationnisme prolétarien, le manque d’instances de lutte autonomes, indépendantes des syndicats, pour diriger le processus. Et encore moins de velléités de destruction de l’ordre, prédominance des revendications partielles que chaque secteur défendait de son côté.
5) Le mouvement prolétarien qui a lutté charrie encore les tares que nos ennemis lui ont inoculées: la défense du syndicat “comme instrument de lutte”, remettant en question les seuls dirigeants et non l’institution elle-même ce qui est rend possible l’incrustation de racailles partitistes telles le SUTEP. De la même façon, la Démocratie, l’Etat, ne furent pas remis en question, la faute était imputée à Toledo et à son “mauvais gouvernement”. Enfin, le nationalisme lui aussi est incrusté parmi le prolétaires : tant dans les luttes urbaines que dans les luttes rurales, les torchons rouges et blancs étaient toujours présents. C’est d’autant plus grave que c’est sa propre patrie, sa propre armée patriotique qui noie dans le sang les protestations prolétariennes.
6) La déclaration de l’état d’urgence et la répression militaire qui s’ensuivit contre notre classe illustrent une fois de plus que quand la bourgeoisie ne peut continuer à maintenir sa dictature, quand revient le temps des remises en question et des révoltes, son exutoire naturel est toujours la répression. IL N’Y A PAS DE DÉMOCRATIE SANS DICTATURE RÉPRESSIVE LÉGALE ET ARMÉE. La raison d’être de la démocratie est de maintenir les privilèges de la bourgeoisie et d’extraire de nous, prolétaires, un maximum de valeur, qui à son tour reproduit le capital. LE PROLÉTARIAT EST DONC L’ENNEMI NATUREL DE LA DÉMOCRATIE, DU CAPITAL. CE N’EST QU’EN ABOLISSANT LE CAPITALISME ET L’ÉTAT QUI LE SOUTIENT, QUE NOUS POURRONS PASSER À UNE SOCIÉTÉ VÉRITABLEMENT HUMAINE, SANS FAIM NI MISÈRE. LES LUTTES RADICALES DE NOS FRÈRES DE PATIVILCA DE JAUJA, DE BARRANCA, DE CHANCAY, DE HUARAZ, DE CUZCO, DE BOLIVIE, D’ALGÉRIE ET DE LA PLANÈTE ENTIÈRE, NOUS MONTRENT LA VOIE À SUIVRE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF.
A travers le monde, un nombre grandissant de territoires se trouvent ainsi directement administrés par les instances mondiales des capitalistes réunis dans ces repaires de fripouilles et de meurtriers que sont l’ONU, le FMI et autre Banque mondiale. Des voix s’élèvent au sein du brouhaha des bourgeois qui se disputent violemment les parts de marché, pour réclamer une “gouvernance mondiale”. Régulièrement, l’Etat mondial du capital prend des contours encore plus perceptibles dans l’imposition terroriste de son ordre. L’ensemble de la planète ressemble à un gigantesque camp de concentration, où l’Etat et ses agents doivent tout contrôler, tout diriger, tout planifier. Plus la moindre parcelle ne doit leur échapper, tout doit être sous un contrôle absolu pour assurer que le processus de valorisation se déroule sans entrave, alors qu’au même moment le capital pousse davantage de prolétaires sur le bas-côté de la route dans une effrayante misère. Un gigantesque maillage quadrille ainsi la planète entière, maintenant truffée de bases militaires, où se concentrent et s’entraînent quotidiennement aux combats de rue les troupes de choc du parti de l’ordre capitaliste. En parallèle, sur les mers naviguent de puissantes flottes ayant pour mission de pouvoir intervenir à tout moment sur tous les continents au moyen de centaines d’avions embarqués, prêts à prendre l’air pour bombarder et soutenir l’intervention des troupes terrestres. A ce formidable déploiement militaire, il faut encore ajouter la création récente de toute une série de lieux qualifiés de “centres de détention” chargés d’emmurer vivants des milliers de prolétaires sans qu’il soit même nécessaire de les condamner par le cirque de la justice de classe. La terreur est ainsi organisée à une échelle planétaire et ce gigantesque dispositif se trouve renforcé par une surveillance accrue de tout ce qui circule par le téléphone, l’internet, le courrier. Tout est écouté, disséqué, analysé par des milliers de fonctionnaires, et ce, dans presque toutes les langues. Il est clair que les forces capitalistes, petites ou grandes, se préparent ici et maintenant à la guerre civile, à faire face à la généralisation des explosions sociales que la catastrophe capitaliste aura bien du mal à ne pas provoquer.
C’est dans ce contexte bien sombre que le 5 février 2004, une nouvelle explosion sociale a lieu en Haïti. En quelques jours, les prolétaires insurgés prennent d’assaut le commissariat central de la police de la ville des Gonaïves dont les flics locaux sont systématiquement éliminés comme agents actifs de la misère que nos frères de classe subissent. La semaine suivante, les événements s’accélérent, le mouvement s’étend rapidement à toutes les localités de la région de l’Artibonite et finit par embraser la 2ème ville du pays: Cap-Haïtien. Les villes tombent les unes après les autres: Hinche, Saint-Marc, Les Cayes, Jacmel, Mirebalais, etc. Partout, le même scénario se répète, les prolétaires insurgés vident systématiquement les prisons et ne font pas la distinction bourgeoise entre “prisonniers politiques” et “de droits communs”, démontrant une fois encore que les prisons ne sont là que pour enfermer des prolétaires qui d’une façon ou d’une autre refusent l’esclavage salarié et haïssent la propriété privée. Après la libération des détenus, le saccage des commissariats de police et autres bâtiments administratifs qui, de près ou de loin, représentent l’Etat tant détesté, ce sont les armureries et les dépôts de nourriture qui reçoivent la visite des “damnés de la terre”. Tout y est systématiquement et consciencieusement pillé par les prolétaires qui se réapproprient les richesses qu’ils ont produites, mais dont ils sont systématiquement dépossédés. Descendant des bidonvilles où le capital les a condamné à croupir, où il les a fixés comme force de travail excédentaire, les insurgés marchent finalement sur la capitale Port-au-Prince, menaçant directement le gouvernement du président et prêtre défroqué, Jean-Bertrand Aristide. Du côté bourgeois, la réponse ne se fait pas attendre: ainsi, pour la seconde fois en à peine une décennie, l’armée américaine, en collaboration ouverte avec les troupes françaises stationnées en Martinique et en Guadeloupe, intervient militairement pour rétablir l’ordre, faisant disjoncter au passage le fusible Aristide, littéralement incapable -son parti comme l’opposition parlementaire d’ailleurs- d’endiguer la guerre civile qui menace Haïti. Hier comme aujourd’hui, mais peut-être ici avec encore plus d’acuité tellement la catastrophe capitaliste est profonde et violente, le dilemme pour la bourgeoisie mondiale reste encore et toujours le même: comment gérer au mieux les turbulences sociales afin de les empêcher de s’approfondir et de s’étendre ? Car il n’est pas question pour les fractions bourgeoises concurrentes de laisser se développer et se fixer des noyaux de lutte -même dans une région où la paupérisation des prolétaires a atteint des sommets inouïs, comme ici en Haïti. Il n’est pas question de laisser la “maladie” sociale se répandre et se propager, d’autant que le processus d’accumulation mondial en pâtirait immédiatement.
Il y a deux siècles déjà, lors des troubles de 1791, la même question s’était posée aux fractions bourgeoises qui se disputaient de manière sanguinaire cette région. A l’époque, la stabilisation de la région qui, avec la culture de la canne à sucre représentait ce que le Moyen-Orient est aujourd’hui pour l’économie mondiale avec son pétrole, avait obligé les diverses fractions concurrentes du capital à mettre leurs divergences de côté pour faire face à LA première insurrection victorieuse “d’esclaves” sur le nouveau continent. Troupes et marines françaises, anglaises et espagnoles se liguèrent pour affronter les insurgés afin de les isoler en établissant un “cordon sanitaire” autour de l’île d’Hispaniola (l’ancien nom de l’île de Saint-Domingue, divisée en deux entités administratives: Haïti et la République Dominicaine) puis, dans un second temps, un corps expéditionnaire français composé de plusieurs dizaines de milliers d’hommes vint écraser dans un bain de sang cette intolérable attaque contre la propriété privée. Hier comme aujourd’hui, le quid de la question pour l’Etat mondial, c’est de réprimer le prolétariat qui lutte. Il est vrai qu’à l’époque, les révoltés ne faisaient aucun mystère de leur volonté d’étendre la rébellion à la Guadeloupe et à la Martinique pour ensuite s’en prendre à toutes les Caraïbes, voire même au-delà... Ces formidables luttes du passé, qu’aujourd’hui la bourgeoisie tente de limiter à quelques “grands hommes” comme Toussaint Louverture ou Dessalines pour mieux éliminer le mouvement social de subversion du capital qui s’était exprimé avec force à l’époque, mériteraient bien qu’on leurs consacre plus de temps pour les extirper de l’oubli dans lequel les ont plongées tous les adorateurs du monde de la marchandise. Mais malheureusement, l’état lamentable dans lequel se trouve actuellement notre classe et ses avant-gardes ne nous donne pas l’espoir qu’un jour prochain cette gigantesque tâche se réalisera. C’est pour cela que nous profitons de l’occasion pour interpeller nos camarades, nos frères de classe qui vivent et luttent dans cette région afin qu’ils saisissent l’importance de tels travaux pour l’ensemble du prolétariat. Nous, comme d’autres communistes avant nous, n’avons jamais saisi notre programme, le communisme, comme une théorie ou une pensée qui aurait germé dans quelques cerveaux géniaux -et de préférence bourgeois et européens-, mais bien comme le processus réel d’abolition de l’ordre social établi. Et dans ce cadre-là et dans la perspective de luttes futures, il nous semble essentiel de décrire, comprendre et discuter les leçons de ces mouvements -sans même parler de leur interconnexion avec les luttes qui eurent lieu sur le continent européen à la même époque. Camarades, comprenez que c’est la conjonction de toutes ces luttes et leur centralisation toujours plus puissante qui -aujourd’hui comme demain- fera surgir un prolétariat fort et puissant parce qu’organisé et armé des leçons que tous ses frères de classe, dans les siècles précédents et dans des lieux différents, auront su tirer de leur formidable affrontement à cette société moribonde. La clé de l’écroulement final du capitalisme ne réside pas stupidement et mécaniquement, comme certains idéologues social-démocrates tentent de nous le faire croire, dans le résultat de l’affrontement de notre classe uniquement dans certains pays occidentaux, mais sera immanquablement la synthèse de toute une série de luttes à travers toutes les époques et tous les continents. D’où l’importance de ne pas négliger une région ou une époque: à nos yeux, toutes ont leur importance.
Nous n’allons pas ici développer cet aspect important de la réalité de la lutte des classes, mais il nous paraît néanmoins important de souligner avec force que les grandes luttes que les prolétaires ont menées depuis 200 ans dans la région des Caraïbes constituent, d’une part, le patrimoine universel d’une classe qui lutte pour l’abolition de sa propre condition d’esclave et correspondent, d’autre part, aux grands affrontements auxquels la bourgeoisie mondiale a du faire face ces derniers siècles. La révolte des “esclaves” de 1791 à 1804 a joué un rôle bien plus important qu’on ne le croit durant la vague révolutionnaire qu’on ne peut plus aujourd’hui limiter uniquement à la “révolution française de 1789”. Les soulèvements dans les campagnes dirigés par “l’armée des piquets” de 1843 à 1848 font écho à une autre vague de lutte qui touche également l’Europe durant ces années-là. Il en va de même de ce que l’historiographie locale a baptisé des “luttes urbaines”, qui touchent toutes les villes de l’île entre 1865 et 1869 et qui correspondent, sans nul doute, après les défaites de 1848, à la reprise des luttes à travers le monde et, pour la première fois dans son histoire, au moment où le prolétariat mondial s’organise en un centre unique au sein de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT). Gigantesque vague de lutte qui aboutira à l’insurrection de Chalco (Mexico) en 1869 et aux événements parisiens de 1870-71, plus communément appelés “La Commune de Paris”. Rappelons encore les très importants soulèvements, tant dans les campagnes que dans les villes, de 1911 à 1920 qui se sont déroulés parallèlement aux événements révolutionnaires du Mexique, et la forte résistance du “mouvement des cacos” qui provoqua une nouvelle intervention militaire des USA qui occupèrent l’île pendant 19 ans afin d’y imposer l’ordre. Et cette liste est loin d’être exhaustive. Comme on peut le constater, cette région, et Haïti en particulier, constitue depuis fort longtemps un point de fixation dans le développement des luttes de classes qui empêche la bourgeoisie mondiale de négliger tout développement nouveau dans l’affrontement que les prolétaires mènent contre leurs exploiteurs.
Invariablement, comme nous le disions plus haut, toutes les fractions bourgeoises s’allient pour mater le prolétariat! C’est ce qui se passe aujourd’hui encore en Haïti où nous assistons à l’intervention, main dans la main, des troupes US et françaises pour rétablir l’ordre à Port-au-Prince au moment même où les prolétaires donnent l’assaut à la capitale. Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec les mensonges de la propagande bourgeoise qui nous présentent deux camps s’affrontant dans l’arène de la politique mondiale avec d’un côté les “méchants impérialistes US” et de l’autre la “patrie des droits de l’homme” -la France- prônant une politique moins brutale qui privilégierait la négociation. Nous devons une fois de plus dénoncer ce mensonge, cette fausse image de paix que la France veut donner à sa politique extérieure alors qu’au même moment, ce sont les troupes françaises qui interviennent de manière sanglante en Côte d’Ivoire, en Afrique centrale, voire même en Algérie où elles forment depuis des décennies les tortionnaires de la guerre que mène l’Etat en Algérie contre ses prolétaires qui refusent de courber l’échine devant les lois de l’économie capitaliste. Sans même parler de la répression directe que l’Etat en France mène contre ses propres prolétaires lorsque ceux-ci osent se rebeller contre leurs précaires conditions d’existence. Qui nous fera encore croire que la France est un paradis alors que circulent dans nos rues, comme dans n’importe quelle dictature bananière, des militaires armés jusqu’aux dents au nom d’un certain “plan Vigie-Pirate” censé rassurer bien plus nos exploiteurs que les prolétaires qui sont systématiquement contrôlés pour délit de faciès ! Et encore nous ne parlons même pas des charters qui quotidiennement quittent les aéroports avec des centaines de prolétaires entassés comme des animaux et expulsés de force parce qu’ils sont venus dans “la patrie des droits de l’homme” chercher de quoi survivre ! Non, nous prolétaires vivant en France, nous n’avons rien à faire envier quant à nos conditions misérables de survie aux autres prolétaires du monde. Ici aussi, nous vivons dans la merde, dans la misère, dans la débrouille ! Oui, nous aussi, nous avons pour ennemi la bourgeoisie, notre propre bourgeoisie, celle qui nous exploite en se présentant comme une bourgeoisie plus “civilisée et éclairée” que ses concurrentes, comme plus “humaine” … alors que ceux qui ne possèdent que leur force de travail ont autant de mal à survivre à Paris, qu’à Bagdad ou à Port-au-Prince! Comme nos frères de classe qui criaient: “A BAS ARISTIDE !”, nous aussi, nous crions: “A bas Chirac, à bas la droite, à bas la gauche ! Merde à la France ! Merde à la patrie des droits de l’homme qui pour nous n’est qu’une autre patrie de la misère mondiale du capital. A bas toutes les nations et toutes les frontières !” Nous ne pourrons jamais être solidaires de nos exploiteurs mais uniquement de nos frères de classe qui ici, comme en Haïti ou ailleurs dans le monde, luttent contre cette société anthropophage. Oui, la lutte du prolétariat en Haïti est la nôtre, et c’est important de le souligner et de le défendre face à toutes les idéologies pourries qui prétendent que dans “cette région économiquement arriérée”, lorsque le prolétariat lutte, ce ne sont que de vulgaires “révoltes de paysans” et qu’il leur faut encore “assumer des tâches démocratico-bourgeoises” afin de “fortifier le capitalisme naissant” dans ces pays, avant de parler de révolution sociale !
De l’autre côté de la frontière, en République Dominicaine, le même refus va se développer au début des années ’80 contre les mesures drastiques du FMI et se cristalliser en avril 1984 dans d’importantes manifestations qui seront réprimées de manière sanglante: une centaine de morts, des centaines de blessés, plus de quatre mille arrestations.
L’intensité des luttes qui se développeront durant toute
l’année 1985 et début 1986 (manifestations violentes, émeutes,
pillages, critique pratique de tout ce qui existe) entraînera la
nécessité pour la bourgeoisie de faire tomber le “régime
Duvalier” le 7 février 1986. Depuis lors, la situation sociale demeure
en effervescence malgré les tentatives de l’Etat de restaurer l’ordre
et la discipline capitalistes au travers de la mise en avant de diverses
fractions devant assumer ce rôle: depuis les militaires jusqu’au
“curé des pauvres”, l’apôtre de la “théologie de la
libération”, Aristide. Malgré les flux et reflux de la lutte
depuis 20 ans, rien ne permet pour l’instant de vraiment rétablir
l’ordre dans la région: notre classe est loin d’être définitivement
pacifiée, écrasée, comme l’atteste encore le dernier
soubresaut de février 2004. Nous avons tenté d’effectuer
une périodisation de ces luttes afin d’y voir plus clair et de ne
pas nous perdre trop dans les détails ; ainsi, nous pouvons distinguer
six périodes importantes, à savoir:
• 1ère période: Dans les années 1946-1957 ont
lieu d’importantes luttes prolétariennes. En réponse à
ces mouvements, la bourgeoisie organise les “Volontaires de la Sécurité
Nationale”, plus communément appelés “tontons-macoutes” qui
sèmeront la terreur dans les quartiers prolétariens (50.000
morts, 1 million d’exilés). Cette féroce répression
du “régime Duvalier” de “Papa Doc” et son rejeton “Baby Doc” s’étendra
de 1957 à 1986
• 2ème période: A partir de la chute du “régime
Duvalier” en février 1986, le prolétariat renforce sa lutte
par l’affirmation grandissante des besoins de notre classe, la tentative
d’autonomiser la lutte par rapport aux fractions bourgeoises qui tentent
de l’encadrer, son extension à la lutte contre l’impunité
dont jouissent les tortionnaires de “l’ancien régime” qui cristallisent
une haine incommensurable des prolétaires, à l’image de la
répression subie, et le refus de toutes les médiations imposées
par le légalisme bourgeois.
• 3ème période: Fin 1990, le manque de perspectives internationales
des luttes et leur isolement permet l’émergence du “populisme lavalasien”
et le processus de récupération et de cooptation de certains
secteurs du mouvement à travers l’adhésion aux élections
et la présidence d’Aristide. Le mouvement “lavalas”, qui en langue
créole locale signifie “l’avalanche”, “le torrent”, n’est pas seulement
un parti populiste issu pour une grande part des milieux religieux puisqu’il
regroupe en son sein à la fois la tendance “théologie de
la libération” et autres curés “de gauche” et “de base”,
mais aussi un important secteur gauchiste et “marxisant” connu sous le
nom d’OPL (“Organisation du Peuple en Lutte”). Mais, ce n’est pas “lavalas”
qui crée le torrent prolétarien, qui génère
la lutte, ce sont les luttes de notre classe qui poussent la bourgeoisie
à s’organiser pour mieux nous contrer, à se rapprocher de
nous pour mieux récupérer nos luttes. Ce sont les luttes
de notre classe qui obligent la bourgeoisie à secréter “lavalas”
afin de canaliser le torrent prolétarien qui risque de rompre les
digues et de se répandre aux alentours.
• 4ème période: Malgré les dégâts
infligés par le “régime lavalas” à l’autonomie prolétarienne,
notre classe continue à lutter et à défendre ses intérêts
propres au point que la bourgeoisie mondiale doit provoquer le coup d’état
militaire du 30 septembre 1991 envoyant Aristide en exil et laissant les
militaires seuls réprimer et briser le mouvement. Aristide et ses
“amis américains” organiseront le blocus économique de l’île,
ce qui poussera le prolétariat dans une misère encore plus
effroyable. La conséquence ne se fera pas attendre: une nouvelle
vague de lutte.
• 5ème période: La répression infligée
par la dictature militaire ne parvient pas à détruire le
mouvement de classe. En septembre 1994, Bill Clinton décide l’intervention
de l’armée américaine. Dans ses fourgons, le “curé
des pauvres”, Aristide fait son grand retour et profite de l’euphorie suscitée
par “la fin de la dictature” pour appliquer les “plans d’ajustement structurel”
du FMI et de la Banque Mondiale. Nouvel échec sanglant, nouveau
refus des prolétaires de se laisser sacrifier sur l’autel du “sauvetage
de l’économie nationale”.
• 6ème période: A partir de 2000/2001, le “régime
lavalas” est complètement discrédité, plus personne
ne croit aux discours du “curé des pauvres”, à part les “alter-mondialistes”
du Monde Diplomatique. L’accentuation de la misère et de la répression
vont faire éclater définitivement l’illusion Aristide avec
les événements de février 2004.
Il va de soi que la 2ème période est la plus importante, la plus riche au niveau du développement de la lutte et de l’autonomie de notre classe. De février 1986 à février 1991, c’est une succession de coups d’Etat militaires, de tentatives de putschs, de valses entre gouvernements civils et militaires pour tenter à chaque fois de contenir le mouvement de lutte prolétarienne qui s’affirme sur son terrain de classe. C’est une période où l’ensemble de la société est traversée par l’exacerbation des contradictions de classe au point que même l’armée n’y échappe plus: plusieurs mutineries éclatent dont l’important “mouvement des petits soldats” en novembre 1988. Malheureusement, par manque de place, nous ne pourrons pas développer ces intéressants aspects, nous nous en excusons auprès de nos lecteurs. Dès lors, nous allons dans les lignes qui suivent tâcher de nous attacher aux points forts ainsi qu’aux énormes faiblesses qu’ont charriés toutes ces luttes, et si on y est attentif, on remarquera que tout ce que nous allons décrire ici, ressemble furieusement à d’autres luttes qui ont secoué le monde ces dernières années. Ce qui démontre une fois de plus, non seulement l’homogénéité du capital et de ses contradictions à travers toute la planète, mais aussi la similitude des luttes que mène notre classe un peu partout dans le monde.
En ce qui concerne les “OP”, relevons tout d’abord un détail terminologique gênant: le mot “populaire” qui prête certainement à confusion même si ici, dans ce contexte de lutte, il désigne le prolétariat tendant à affirmer son autonomie de classe et non pas le “peuple” comme expression de la négation de l’antagonisme de classe. Plus tard, avec le reflux des luttes, certaines de ces tentatives d’auto-organisation du prolétariat seront détruites pour devenir directement des agents de l’Etat et de sa politique répressive dans les quartiers où elles se sont développées. Il en va ainsi de ces fameuses organisations appelées “chimères” qui ont fait les choux gras des médias occidentaux. Lesdites “OP lavalas” et autres “chimères” ne sont jamais au départ que des structurations du mouvement de notre classe qui s’exprime avec force contre la misère (“contre la vie chère”), contre la répression et l’impunité. En dehors et contre toutes les élucubrations journalistiques, nous devons affirmer que le processus qui engendre l’émergence des “chimères” est le processus historique des prolétaires visant à s’associer et à s’armer pour défendre leurs intérêts de classe: c’est dans les bas-fonds de Port-au-Prince comme Cité-Soleil, La Saline et autres bidonvilles où notre classe subit une incroyable misère (il faut s’y être rendu une fois dans sa vie pour se rendre compte que les mots ne suffisent même plus à décrire l’effroyable réalité), c’est dans ces bouges d’extrême laideur, balayés par la famine et le racket étatique, que des dizaines, des centaines de groupes armés se sont constitués pour tendre leurs mains vers le soleil, vers une vie meilleure.
Ainsi, la dite “Armée rouge” de Cité-Soleil, que les médias
accusent de tous les crimes de ces dernières années, est-elle
née durant la dictature de la junte militaire (1991-94) pour défendre
le quartier contre toute intrusion de ces sbires en uniforme (comme les
razzias opérées dans le quartier en décembre 1993)
dont la répression a fait dans tout le pays plus de 5.000 morts
en 3 ans. Ainsi, ladite “Armée cannibale” aux Gonaïves qui
n’est rien d’autre que le regroupement de divers groupes dont l’OPDR (“Organisation
Pour le Développement de Raboteau”), né en tant que groupe
militant pour la défense du quartier de Raboteau où les militaires
avaient opéré plusieurs razzias dont les massacres d’octobre
1991 et d’avril 1994. Cooptée, armée et financée,
à un moment de reflux des luttes, par le “régime lavalas”,
cette “Armée cannibale” qui semblait porter un indéfectible
soutien à Aristide finit par retourner elle aussi ses armes contre
“son bienfaiteur”, l’accusant ouvertement d’avoir “trahi les aspirations
populaires”. Suivra l’emprisonnement de son dirigeant Amiot Métayer
et son évasion spectaculaire au cours d’une manifestation violente
en août 2002. Devenu trop dérangeant, Métayer sera
assassiné en septembre 2003. Ces quelques exemples nous montrent
à souhait l’extrême contradiction qui traverse ces organisations
qui, au départ, se trouvent sur le terrain de notre classe, puis,
avec le reflux de la lutte, subissent un effroyable retournement leur faisant
perdre toute perspective classiste, pour finalement, avec le retour des
luttes, reprendre à nouveau leur chemin de classe, même si
un grand nombre de prolétaires ayant participé, dans les
“chimères”, à la défense du “prêtre des pauvres”,
ne sortent pas indemnes de cette collaboration de classe. Afin de redonner
toute la dialectique du processus et de ne pas tomber dans les schémas
classiques de la dichotomie et du manichéisme, nous affirmons que
lesdites “chimères” ont, à certains moments, exprimé
les besoins de la lutte de notre classe contre ses exploiteurs:
• en attaquant des gens de “l’opposition” bourgeoise en quête
d’un strapontin dans les appareils centraux de l’Etat ;
• en manifestant violemment, comme en avril 2003, “contre la misère
et le chômage” et dès lors contre les gestionnaires directs
de cette situation: le “régime lavalas” ;
• en déclenchant, à Port-au-Prince, les gigantesques
pillages qui ont précédé, accompagné et suivi
l’éviction d’Aristide par ses “amis américains” le 29 février
2004 ;
• en attaquant et en brûlant les luxueuses résidences
des bourgeois de “l’opposition”, mais aussi du “régime lavalas”,
événements sur lesquels la presse a préféré
ne pas trop s’appesantir afin de mieux occulter la véritable nature
des pillages et donc des “chimères” qui en assumaient la responsabilité
à ce moment-là.
A d’autres moments, et il en va de notre responsabilité de militants révolutionnaires de ne pas faire l’économie d’une terrible critique et de dénoncer les “chimères”, ou du moins celles qui ont trahi leur classe pour s’en aller trouver fortune comme vulgaire milice au service de l’Etat qu’elles combattaient hier encore.
Une autre forme de la rupture prolétarienne avec le légalisme parlementaire se matérialise lors des élections présidentielles de décembre 1990 qui verra Aristide porté au pouvoir: le prolétariat se manifeste à travers des appels au boycott, au refus de participer au cirque électoral. Ni Aristide, ni personne d’autre, c’est ce que mettent en avant les fractions les plus combatives du prolétariat qui, décidément, montrent toute la confiance et le respect qu’ils éprouvent pour les nouvelles institutions que la bourgeoisie s’est donnée. Certaines de ces fractions prolétariennes ont malheureusement justifié par la suite leur appel au boycott par la théorie selon laquelle il est “illusoire de vouloir ronger l’appareil d’Etat du-dedans” (ce qui est juste), et ont montré toutes les limites de leur compréhension de la lutte des classes en prônant la participation à des élections “quand les conditions auront changé”, “quand les structures de l’Etat seront différentes”.
Face aux appels à boycotter le cirque électoral, tous les partis politiques vont mener l’offensive pour encadrer le mouvement. Mais la tâche est rude d’autant plus que, malgré ses faiblesses, malgré ses manques de rupture, le prolétariat ne se laisse pas embrigader aisément. D’autres minorités de militants, secrétées par le développement de la lutte, porteront la critique des institutions bourgeoises à un niveau encore plus élevé. Parmi les nombreux documents de l’époque, citons la brochure intitulée “Goman/Akao”, publiée en 1987 par des camarades qui tirent ainsi les leçons de la lutte à laquelle ils viennent de participer:
“Les ennemis de classe ne peuvent se retrouver au sein d’une même organisation; nous devons construire une organisation autonome, de sorte à ne pas nous laisser conduire dans des directions opposées à nos intérêts. Nous ne devons être assujettis à quiconque, militaire, bourgeois/grandon [= grand propriétaire foncier, NdR] ou l’Etat.”
On ne pourrait être plus clair quant à l’auto-organisation de notre classe et la nécessaire rupture avec toute structuration étatique !
D’autres informations nous proviennent du nord du pays où les habitants de la “Cité du peuple”, un bidonville de Cap-Haïtien, privés d’électricité depuis… 3 ans, menacent de se soulever si les autorités de la ville ne rétablissent pas le courant très rapidement. On peut évidemment rester perplexe devant de telles menaces, mais elles sont révélatrices du climat de tension qui règne toujours en Haïti.
Si nous avons pointé la force de la lutte du prolétariat durant ces années autour de quelques axes comme la continuité de celle-ci, malgré une répression accrue obligeant en 20 ans l’Etat à se défaire de toute une série de prétendants au trône gouvernemental, comme la tentative du prolétariat de défendre de manière intransigeante ses propres intérêts de classe en ne pardonnant rien dans sa lutte contre l’impunité des tortionnaires, comme le fait d’essayer d’aller plus loin en rejetant les élections tout en entreprenant de s’auto-organiser contre tous les partis bourgeois, il faut aussi reconnaître l’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui la lutte de classe dans cette région. Impasse due à une série impressionnante de faiblesses que malheureusement nos frères de classe partagent avec d’autres prolétaires ayant lutté récemment à travers le monde. Et tout d’abord, pointons l’incapacité réelle de notre classe à maintenir durant toutes ces années de luttes une véritable continuité aussi bien associative que politique. A notre connaissance, les leçons des précédentes vagues de luttes n’ont fait l’objet de presque aucune analyse et l’absence d’une presse prolétarienne comme de diverses minorités d’avant-garde qui maintiendraient à contre-courant le drapeau de la révolution sociale et tireraient des leçons des luttes précédentes, fait cruellement défaut malgré le formidable potentiel de luttes que notre classe a développé durant toutes ces années. De même, très rares, si pas inexistantes, ont été les minorités qui ont tenté de se réapproprier les ruptures historiques que notre classe a déjà réalisées depuis plusieurs décennies avec la démocratie, le nationalisme, le parlementarisme, le tiers-mondisme… Le fait que trop souvent les militants d’avant-garde se soient limités à comprendre les évènements d’un point de vue strictement local est un autre exemple de l’état lamentable dans lequel se trouve notre classe. Le manque de perspectives, du à l’effroyable isolement dans lequel se sont développées ces luttes, est l’un des principaux fardeaux qui a véritablement empêché les prolétaires d’aller plus loin. Très peu de réactions ont eu lieu à travers le monde suite à tous ces événements.
Face à l’indifférence affichée par les prolétaires dans de nombreuses régions du monde, indifférence qui a permis finalement de réunir suffisamment de troupes pour réprimer cette nouvelle vague de lutte de nos frères de classe en Haïti, un petit événement à contre-courant de cette tendance générale est venu apporter un peu d’air frais dans cette nauséabonde paix sociale. Cela s’est passé en Argentine, où le prolétariat par une forte mobilisation a réussi à enrayer le processus d’envoi massif de militaires argentins en Haïti. Il est important de souligner ces petits détails car, comme on le verra de manière plus développée à propos d’Aguila III dans cette même revue, le prolétariat en Argentine nous montre la voie à suivre pour casser la toute-puissance actuelle de la bourgeoisie. Le prolétariat en Argentine par ce geste montre réellement ce que la solidarité prolétarienne veut dire. Par ce refus ouvert d’envoyer des troupes mater une révolte prolétarienne en Haïti, le prolétariat en Argentine nous montre à nouveau que c’est par le défaitisme révolutionnaire, directement contre sa propre bourgeoisie, que le prolétariat mondial sortira les luttes que mènent nos frères dans certaines régions de leur isolement pour les généraliser à toute la planète afin d’abattre le capitalisme et tous ses défenseurs.
L’ennemi cherche en permanence à déformer la conception révolutionnaire. C’est pour cette raison que les partisans des thèses de la non lutte pour le pouvoir s’obstinent à affirmer que la différence entre réforme et révolution est dépassée. C’est faux, rien n’a été dépassé ! Tant que la révolution sociale n’aura pas eu lieu, subsistera l’antagonisme entre révolution et sauvetage du capitalisme à l’aide de réformes ! Ce qui se passe en réalité, c’est que ces réformistes n’osent tout simplement pas assumer ce qu’ils sont. Ils savent que pour semer efficacement la confusion sur le plan idéologique, ils doivent se présenter comme un doux mélange de réformisme et de révolution. Mais même sur ce point, ils ne font preuve d’aucune originalité ! Kautsky a passé sa vie à faire de l’équilibrisme entre ce qu’on appelait alors réforme et révolution et, pratiquement, sa conception a agi comme l’un des freins idéologiques les plus puissants, c’est-à-dire comme une des meilleures armes de la contre-révolution.
Nous l’avons relevé dans les différents exemples de cette revue: ce n’est pas seulement la lutte pour le pouvoir que ces gens repoussent, non, ce qu’ils rejettent par dessus tout, c’est la lutte pour la destruction du pouvoir bourgeois et, par conséquent, la lutte pour la constitution d’un pouvoir prolétarien, la lutte révolutionaire dans sa totalité.
Et de fait, la lutte révolutionnaire est obligatoirement une lutte pour le pouvoir. Ou le pouvoir est entre les mains du capital, ou c’est la révolution qui le détient. Il n’y a pas de demi-mesure! Même si, régionalement, il peut y avoir une brève période correspondant à ce qui a été défini au cours de l’histoire comme la dualité des pouvoirs (par exemple, en Russie 1917) -et en laissant ici de côté le fait que ce concept n’a jamais servi la révolution mais a toujours été source de confusion- nous devons affirmer qu’une telle situation ne peut perdurer, elle doit nécessairement se résoudre, soit en faveur de la conservation de l’ordre, soit pour la révolution sociale: si l’on ne détruit pas le pouvoir du capital, celui-ci détruit nécessairement le pouvoir surgi de la révolte. Toute illusion de contre?pouvoir sans action destructive du pouvoir du capital ne peut que favoriser la réorganisation de ce dernier. Voilà ce que les actuels partisans de la théorie du contre-pouvoir passent volontairement sous silence. Ils omettent également de dire qu’aucune des situations actuelles n’est comparable à une situation définie comme dualité des pouvoirs. Et ce serait faire preuve d’une totale ingénuité -si ce n’était pure propagande bourgeoise- que de prétendre que les Colimaçons zapatistes pourraient un jour devenir un véritable contre-pouvoir ! Pour que le contraste soit encore plus évident, rappelons qu’en Russie en 1917, il s’agissait d’une insurrection prolétarienne contre l’Etat bourgeois et que, si l’on peut trouver un sens à parler de “double pouvoir”, cela faisait référence à la décomposition révolutionnaire des forces répressives qui refusaient de plus en plus ouvertement les ordres de l’Etat et qui, par régiments entiers, se soulevaient, se mettaient au service des organes prolétariens que la révolution créait au fur et à mesure de son développement.
Ceci étant dit, en cette période où le manque de connaissance du programme de la part du prolétariat et des avant-gardes qui s’affirment dans la rue est tout à fait tragique, il nous paraît indispensable d’affirmer quelques éléments centraux de la lutte révolutionnaire qu’occultent ou défigurent systématiquement l’ensemble des théories actuelles voulant “changer le monde sans prendre le pouvoir” ou prônant la “socialisation ou la communisation du monde” sans destruction du pouvoir du capital.
La révolution sociale implique deux aspects inséparables:
• la destruction de l’appareil armé de la bourgeoisie et plus
globalement celle de l’Etat capitaliste dans sa totalité, ce qui
inclut évidement toutes les institutions qui assurent la reproduction
de la domination de classe et l’exploitation (partis, syndicats, églises,
prisons, armés, écoles,...)
• la destruction de la dictature économique du capital, dictature
qui se nourrit de l’autonomie des structures productives, des décisions
autonomes prises par les unités productives basées sur la
propriété privée des moyens de production.
Si le premier point est bien connu des avant-gardes internationalistes, le second est malheureusement moins connu et a été très peu explicité par les différents groupes révolutionnaires au cours de l’histoire. Tout au long de son œuvre, Marx met en évidence que la clé de la société marchande (et le capitalisme est la société marchande généralisée!) réside dans le fait que la production est privée et qu’elle ne devient sociale qu’au travers de l’échange. L’indispensable destruction de la production pour l’échange implique la destruction du caractère privé de la production, et donc, la destruction des décisions autonomes des entreprises ainsi que des entreprises elles-même, en tant que sujet de décision libre et indépendante, base des droits démocratiques. Cela ne peut se réaliser que si la production est directement sociale ce qui implique la centralisation organique de toutes les décisions concernant la production, c’est-à-dire la dictature révolutionnaire des producteurs associés. La révolution ne doit pas seulement détruire le mode de distribution (comme voudrait le faire tout socialisme bourgeois), elle doit aussi détruire le mode et le contenu de la production et décider sur des bases totalement différentes quoi produire et comment le produire.
Autrement dit, la barbarie de la société capitaliste ne réside pas seulement dans le fait que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, comme se fatigue à le répéter le socialisme vulgaire. La barbarie de la société capitaliste réside dans le fait que l’objectif de la production n’est pas l’être humain mais le profit. Depuis des siècles, les marchandises produites ne sont que la caricature de ce dont l’être humain a besoin (les valeurs d’usage ne sont rien d’autre qu’un support pour la valeur!). Les choses et les services produits comme marchandises, contiennent la marque indélébile de la production privée de marchandises, une production dont le but est de réduire l’homme en esclavage. Non seulement les objets de consommation sont contaminés par la dictature historique du taux de profit –ils sont créés, non pas pour la vie humaine, mais pour être vendus-, mais les moyens de production eux-mêmes ont été conçus non pas pour épargner du travail mais pour augmenter le taux de profit. C’est pour cela que la révolution sociale implique la remise en question de la totalité de la production matérielle, la liquidation de toute décision autonome (d’entreprise, municipale, d’assemblée...) qui se prend nécessairement en fonction des possibilités d’échange. La base de la révolution sociale ne peut être que le changement total de l’ensemble des rapports de production et de l’objectif de la production, sans quoi tout discours sur la “ nouvelle société ” n’est que masturbation idéaliste. La profondeur de la révolution sociale se mesurera précisément à sa capacité à transformer radicalement (à la racine !) l’ensemble de la production, à sa capacité à abolir les décisions autonomes de la propriété privée et par conséquent les relations d’exploitation, à sa capacité à imposer organiquement et de façon généralisée des besoins humains qui fassent de toute production une production humaine. Pour la première fois, l’être humain ne sera plus déterminé par les rapports de production, ce sera lui qui, en décidant de tous les aspects de la production matérielle, anéantira la domination qu’exerce sur lui le monde objectif (l’économie) et pourra commencer à vivre sa véritable histoire en tant qu’humanité consciente.
Les réformistes, avec leurs théories de non lutte pour le pouvoir, nient l’ensemble des aspects de la lutte révolutionnaire: ils nient non seulement la nécessité de détruire le capital comme force politique, répressive et idéologique, ce qui est évidemment déjà très grave, mais ils récusent également la nécessité la détruire la production privée, dont le principe d’autonomie de décision constitue pourtant la clé de la production pour l’échange, l’essence du capitalisme comme mode de production marchand généralisé. Ils rejettent la destruction du capitalisme, mais aussi la construction conséquente et incontournable d’une force politique révolutionnaire centralisée. Le grand vide théorique qu’on retrouve chez ces réformistes à propos de l’Etat de la période de transition découle évidemment de leur idéologie de non destruction de l’Etat bourgeois et de leur rejet (implicite ou explicite selon les cas) de la dictature du prolétariat, qui est la négation en acte de tout Etat.
L’apologie des unités autonomes (ou des gouvernements locaux autonomes dans le cas de Marcos & Cie), de l’occupation et de la gestion autonome des entreprises, de l’autogestion de quartier, locale, productive, distributive et le concept même de défense de tous les particularismes en une entité supérieure (la multitude!) (1) , l’apologie des réseaux d’échange, des réseaux diffus, ne fait que pousser au développement de ces bases autonomes et de fait nécessairement privées, qui constituent la clé de la société marchande, de la société bourgeoise. Multitudes, réseaux diffus, autogestions, réseaux d’échange ne peuvent rien faire d’autre que produire en tant qu’unités privées autonomes, ils ne peuvent que reproduire le caractère privé de la production. Le maximum auquel cette très “libertaire” société multiple d’échange puisse aspirer est une petite réforme distributive (et même cela, nous le voyons tout à fait limité car le réformisme actuel, en pleine catastrophe sociale, est incapable de changements véritables), et encore, uniquement si cette petite réforme ne dérange pas trop l’une ou l’autre force du capital armé. Mais unités multiples et variées, Conseils de bons ou de mauvais gouvernements, “Caracoles” ou coopératives, entreprises grandes ou petites, fermes écologiques et/ou autogérées, occupées ou sous contrôle ouvrier, tous et toutes chercheront irrémédiablement à devenir rentables et se révéleront donc absolument impuissants face à l’absurde (inhumaine) production actuelle, fruit de siècles de dictature de la valeur ayant réduit l’être humain en esclavage. La dictature du taux de profit continuera à diriger ce qui est produit et comment on le produit.
La dictature révolutionnaire du prolétariat, au contraire, liquidera les racines mêmes de cette société, elle imposera la dictature des besoins humains contre toute production autonome et contre le mercantilisme qui en découle, elle liquidera la production pour l’échange (et donc pour le profit) et remettra en question la totalité des “choses” produites (qui, de fait, ont été conçues sur base de critères inhumains), afin de forger une production matérielle (2) enfin décidée par l’être humain, enfin conçue pour libérer l’homme du travail, une production en fonction de ses véritables besoins et désirs humains. Jusqu’à présent, l’homme n’a jamais décidé de sa propre histoire, ce sont les contradictions matérielles, et en particulier les rapports sociaux de production, qui se sont imposés à lui. Sans destruction du capital, la liberté de l’homme et l’autonomie de décision ne sont rien d’autre que dictature de la valeur sur l’espèce humaine. La condition pour que l’être humain entreprenne sa propre histoire est, justement, qu’il impose ses réels besoins d’être humain et qu’il détruise violemment et sans aucune complaisance la loi économique qui se dissimule derrière les mots liberté, autonomie, démocratie, autogestion...: la loi de la valeur.
| “N’espérez pas qu’un gouvernement
mette entre vos mains la terre, l’atelier, l’usine, la mine, le bateau,
le train, tout ce qui est nécessaire pour la production de la richesse.
Cela, nous devons le prendre les armes à la main en faisant fi du
“ droit ” que les capitalistes s’octroient à eux-mêmes de
retenir entre leurs mains ce que les mains de leurs travailleurs ont fait...”
Ricardo Flores Magon,
|