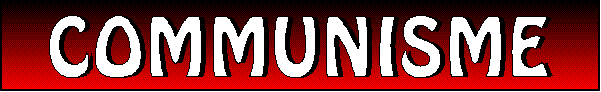
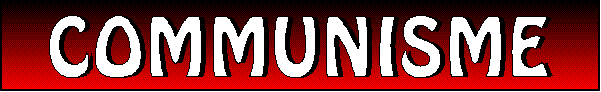

Notre point de départ est radicalement différent. Comme communiste nous n'analysons pas les événements pour simplement les comprendre, mais bien pour les transformer, les bouleverser et mettre le mot FIN sur cette société de misère, de guerre et de famine. Passer son temps à décrire les affres de cette société anthropophage, c'est se complaire dans un rôle éminemment passif et se transformer en laborantin pratiquant la biologie du capital plutôt que de participer à sa nécrologie, à son enterrement et à sa fin brutale. Partir du point de vue qui pour nous apparaît comme le plus évident, le plus essentiel, celui de la destruction de ce qui, quotidiennement, comme prolétaire nous détruit, c'est résolument se placer au cur des événements qui se déroulent là, sous nos yeux, c'est résolument être partie prenante de ces mêmes événements comme force agissante, comme avant-garde, même si aujourd'hui le mot lui-même effraie et est souvent compris dans sa version léninoïde.
Il y a 2 ans que les troupes anglo-américaines ont envahi l'Afghanistan au nom de la «lutte contre le terrorisme» et l'année dernière c'était le tour de l'Irak et, nulle part encore, nous n'avons pu lire ne fut-ce que quelques lignes sur la question centrale: mais où donc se trouve le prolétariat dans tout ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les idéologies qu'il affronte dans sa tentative de s'autonomiser de toutes les forces bourgeoises pour les abattre? C'est de cela que devraient discuter aujourd'hui les quelques noyaux de prolétaires qui, contre vents et marées, dans l'ambiance nauséabonde de paix sociale qui nous étreint, essayent de maintenir haut le drapeau de la révolution sociale. Et au lieu de cela, la plupart, sinon tous, restent englués dans la problématique de savoir si telle ou telle contradiction interbourgeoise est la plus fondamentale. Et lorsque nous disons cela, nous n'envisageons pas encore le pire: l'incapacité dans laquelle se trouve un grand nombre de prolétaires à voir dans ces événements la lutte de nos frères de classe. A l'indifférence la plus crasse pour ce nouveau massacre de prolétaires s'ajoute l'européo-centrisme et son racisme corollaire. Combien de discussions de type sociologique ne tournent-elles pas autour de la question de savoir s'il existerait ne fut-ce que l'ombre d'un prolétaire en Irak? C'est oublier un peu vite l'unicité du mode de production capitaliste, son caractère mondial depuis plus de cinq siècles maintenant, analyse que nous avons déjà eu l'occasion de développer à maintes reprises dans cette même revue et qui rend caduques toutes les élucubrations du style de celles affirmant qu'en Afghanistan, les USA voudraient développer le mode de production capitaliste, et défendant que c'est pour cela qu'ils ont envahi ce pays, ou encore qu'il n'existerait pas de prolétariat dans ces régions mais toute une série de tribus et de modes de production particuliers, comme le féodalisme... arguments entendus à maintes reprises et qui empêchent toute véritable discussion sur les besoins réels de notre classe et les réponses à y apporter, confondant lamentablement les modes de production immédiats, souvent héritiers d'anciennes structures précapitalistes qui ont maintenu certaines de leurs formes anciennes, et la subsomption de toutes celles-ci dans le mode de production capitaliste. Oublier que le capitalisme est l'unique mode de production qui, dans l'histoire des hommes, ait réussi à unifier tous les autres modes de production, c'est vraiment faire la part belle à toutes ces idéologies social-démocrates qui minent, aujourd'hui comme hier, le camp du prolétariat et le plongent souvent dans de fausses réponses comme le soutien aux luttes de libération nationale voire, pour les plus imbéciles, à l'anti-américanisme le plus vulgaire. Découvrir comme Attac, Le Monde diplomatique ou José Bové, que le capitalisme est mondial en 2004, c'est se foutre de la gueule de notre classe, de son histoire et des ruptures qu'elle a déjà opérées avec le vieux monde. Marx, dans le chapitre IV du premier tome du Capital, écrivait déjà en 1867 (insistons: en 1867!): «La circulation des marchandises est le point de départ du capital. Il n'apparaît que là où la production marchande et le commerce ont déjà atteint un certain degré de développement. L'histoire moderne du capital date de la création du commerce et du marché des deux mondes au XVIème siècle.» Sans commentaire.
Camarades, sortons de ce marais idéologique qu'est l'analyse bourgeoise pour véritablement reprendre le chemin de la révolution sociale et nous poser les questions que notre classe a besoin de résoudre. Descendons des balcons idéologiques du faux savoir des professeurs donneurs de leçon pour reprendre notre place au sein des luttes de classes et saisir les événements qui se déroulent là, sous nos yeux, autrement qu'avec les lunettes dont cette société en pleine décomposition voudrait nous affubler. Afin de faire marcher l'Histoire sur ses pieds et non sur sa tête, nous nous proposons de faire rapidement une première approche de ce qui se passe dans cette région du Moyen-Orient, si riche en lutte.
Malgré l'amnésie dont voudrait nous frapper la bourgeoisie, nous ne pouvons pas oublier que le Moyen-Orient et le Proche-Orient constituent une véritable poudrière sociale depuis des décennies. Un des critères majeurs d'intervention de toutes les bourgeoisies dans cette région demeure sans nul doute la nécessaire stabilisation de cette aire géographique régulièrement secouée par des désordres sociaux fort importants. En ne remontant pas trop loin, on peut déjà définir un cycle de lutte démarrant dans les années '70 du siècle passé avec, comme un de ses sommets, l'année 1979 qui vit un soulèvement prolétarien généralisé en Iran balayant en un seul coup la quatrième armée du monde, le Shah d'Iran et ses terrifiants services secrets. Un soulèvement que la bourgeoisie locale aura un mal fou à contenir tant et si bien qu'après avoir usé en quelques mois plusieurs prétendants au trône, elle fit appel à une fraction radicale de la social-démocratie parée aux couleurs locales du turban des ayatollahs pour briser, casser ce puissant mouvement de lutte. Une guerre lancée par l'Irak et soutenue par toutes les fractions bourgeoises de la planète, de l'URSS à la France, en passant par les USA et même Israël (on l'oublie un peu vite), est venue parachever ce travail en soutenant les ayatollahs dans leur ignoble uvre contre-révolutionnaire, en enrégimentant les prolétaires du coin dans la défense de la patrie, de l'islamisme voire du panarabisme. Voilà de manière très succincte comment réellement les bourgeois du monde entier se sont tous unis, toutes fractions confondues, pour faire face au seul cauchemar qui n'ait jamais cessé de les hanter, la révolution sociale, la mise à bas de leur système de mort.
C'est dans ce genre d'occasion, tout comme cela s'est passé au lendemain des insurrections parisiennes de mars 1871 ou russe d'octobre 1917, que nous pouvons parler de la matérialisation d'un processus qui engendre un véritable Etat mondial du capital regroupant toutes les fractions de la bourgeoisie défendant l'intérêt général du système, sa reproduction sur une base toujours plus élargie, et se concentrant en un point de gravité pour épouser de-ci, de-là, des structures étatiques déjà existantes. Lorsque la révolution sociale frappe avec toute sa puissance à la porte de l'Histoire, toutes les fractions exploiteuses choisissent d'oublier (pour un temps, cela va de soi) leurs intérêts immédiats et se rangent derrière la fraction la plus capable, la plus à même de défendre le capitalisme contre les assauts du prolétariat. L'Etat mondial est bien ce processus en mouvement, toujours en gestation, se dissolvant et s'affirmant toujours plus puissamment, exprimant l'organisation du capital en puissance dominatrice, en force d'exploitation nécessitant toujours plus d'assurer l'ordre social partout dans le monde en monopolisant la violence, en la laissant aux mains d'une seule classe: la bourgeoisie. Ce qui préoccupe au plus haut point le capital en tant qu'Etat mondial est que la catastrophe permanente qu'il engendre provoque immanquablement des réactions violentes, armées, non contrôlées... qu'il lui faut en permanence tenter de juguler pour maintenir sa domination. Il est évident qu'il est difficile dans ce cas-ci de raisonner en terme de pays, la réalité de ce processus (d'une fraction décidée à mettre de l'ordre dans une région socialement troublée) dépasse souvent la division bourgeoise communément admise entre Etats. On peut affirmer qu'au sein de l'Etat nommé USA ainsi que dans ses structures comme le Département d'Etat (State Department), le Pentagone, la CIA, l'US Airforce, l'armée, s'affirme aujourd'hui une fraction bourgeoise plus décidée que les autres à jouer le rôle de gendarme mondial avec le soutien de toutes les autres fractions, y compris celles avec lesquelles elle se trouve en concurrence, y compris aux USA même. Durant la guerre Iran-Irak, et malgré l'existence de deux blocs, toutes les fractions, même celles qui se déclaraient hier encore ennemies, ont remisé pour un temps leurs différences au placard afin de faire face ensemble à un prolétariat qui, ne l'oublions pas, venait de mettre à bas un des gouvernements les plus puissants de la planète: le régime du Shah.
La longueur de cette boucherie sans nom qui allait durer une bonne dizaine d'années, rappelant par plusieurs côtés l'abattoir humain de 1914-18, devait inévitablement engendrer sa contradiction. Désertions, refus de se battre, grèves, mutineries,... vont se répandre comme une épidémie sociale poussant les prolétaires sous l'uniforme à s'unir, à fraterniser pour faire face aux deux armées, comme ce fut le cas dans les marais autour de la Péninsule de Fao du côté de Bassora ainsi que dans les montagnes du nord-est de l'Irak autour de la région d'Halabja. La réponse des bourgeois sera à la hauteur du refus des prolétaires d'aller se sacrifier pour une cause qui n'est pas la leur: répression, emprisonnements, fusillades, rapts et bombardement chimique 1, voilà ce qu'avait à offrir ce monde moribond à ceux qui ne voulaient plus se soumettre à ses besoins anthropophages. Cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Une paix entre les deux belligérants fut nécessaire pour calmer les prolétaires des deux côtés de la frontière, même si l'épicentre du mouvement de mécontentement s'était dorénavant déplacé d'Iran vers l'Irak, où le régime de Saddam Hussein avait de plus en plus de mal à retenir la colère qui montait contre lui et contre les sacrifices que l'ignoble patrie avait depuis 10 ans réclamés de prolétaires maintenant exsangues. La solution pour maintenir cette colère hors de l'affrontement social fut vite trouvée: détourner ce trop-plein de misère et de colère vers un des riches voisins irakiens et laisser les miséreux assouvir leur haine contre la bourgeoisie et sa guerre, en participant comme mercenaires au pillage du riche Koweït. La suite on la connaît. Invasion irakienne de l'Emirat avec la bénédiction de l'Etat américain, qui parallèlement préparait la mise au pas du prolétariat en mettant sur pied la plus formidable coalition mondiale organisée depuis la seconde guerre mondiale. La remise en ordre de cette région était à ce prix. L'objectif numéro 1 de cette fraction bourgeoise était d'en finir une bonne fois pour toutes avec tous ces prolétaires qui, les armes à la main, défiaient depuis trop longtemps maintenant, l'autorité des exploiteurs, et secundo de se débarrasser de Saddam Hussein et de sa fraction, incapables d'assumer pleinement ce job. Malgré les 500.000 guerriers armés jusqu'aux dents et la formidable armada navale et aérienne, la Coalition ne put s'emparer de Bagdad. Les prolétaires à nouveau reprenaient leur chemin de classe et retournaient leurs armes contre leurs propres officiers. Bassora, Bagdad, Souleymania... et d'autres villes s'insurgeaient contre la bourgeoisie, faisant apparaître des organes d'auto-organisation de notre classe baptisés shoras (conseils), bloquant du même coup tous les rêves de la Coalition et jetant provisoirement ses plans guerriers à l'eau. Incapable de le faire directement elle-même, la Coalition laissait au nord les nationalistes kurdes, et Saddam Hussein pour le reste de l'Irak, faire le sale boulot de réprimer cette insurrection généralisée. La Garde Nationale qui avait été miraculeusement épargnée par les bombardements aériens se mit à massacrer, sous l'il attentif de la Coalition, les prolétaires insurgés.
Mais dans l'histoire des luttes de classes, il n'y a ni hasard ni miracle. Si les avions de la Coalition n'ont pas déversé leurs tonnes de bombes meurtrières sur cette armée spécialisée dans le maintien de l'ordre social bourgeois, c'était parce qu'ils imaginaient qu'elle pouvait encore accomplir quelques tâches dans l'une ou l'autre situation, au cas où... Et l'insurrection généralisée était ce cas-là. Ce scénario avait certainement été envisagé par la bourgeoisie mondiale dans ses différents plans. Qui prétend que nos ennemis sont stupides? Malheureusement pour nous, ils connaissent leurs intérêts généraux et il leur arrive souvent de réfléchir en terme de classe. Ici, il fallait bien laisser Saddam Hussein au gouvernement et remettre à une prochaine fois les sanguinaires plans de conquête établis par le Pentagone et l'ONU.
Les exploités allaient payer très cher le fait d'avoir osé prendre les armes et empêché la fraction la plus décidée de la bourgeoisie mondiale de remettre de l'ordre sous le masque de la Coalition en Irak. Après le million de morts de la guerre Iran-Irak et un autre million de morts dus à la guerre, aux bombardements aériens et à la répression de 1991, les 10 ans qui suivirent ne furent pas plus tendres pour nos frères de classe. Un gigantesque embargo fut décrété par ce repère de brigands qu'est l'ONU, tuant à petit feu des milliers d'enfants. Au total, un nouveau million de morts allait envahir les cimetières. Parallèlement à cet embargo, les bombardements militaires effectués sous couvert d'aide humanitaire (est-ce seulement un fait du hasard si militaire rime avec humanitaire?) ne cessèrent pas pour autant. Jour après jour, l'embargo était consolidé par l'aviation anglo-américaine qui déversa en Irak, depuis 1991, quasi autant de bombes qu'en Allemagne durant la seconde guerre mondiale. Cela permettait du même coup à Saddam Hussein et à sa clique de consolider leur emprise sur le prolétariat, puisque celui-ci ne pouvait plus rien bouffer d'autre que ce que le gouvernement irakien, avec l'aide des charognards de l'ONU distribuait sous forme de rations, le marché noir étant totalement inabordable pour le simple quidam. La faim fut une arme terrible entre les mains de la bourgeoisie qui en usa et en abusa pour détruire et soumettre nos frères de classe en lutte dans cette région. Dans le nord du pays, où nationalistes kurdes et islamistes se donnaient la main pour écraser le prolétariat, la politique consistant à échanger les armes contre de la nourriture fut systématiquement organisée, avec la bénédiction de l'ONU, des USA et de toutes les ONG présentes sur place. Cette politique coinçait chaque prolétaire en le mettant face au dilemme de savoir s'il devait lâcher son fusil pour bouffer, comme le leur conseillaient habilement tous les humanitaristes et autres droitdelhommistes présents sur place, ou se résoudre à profiter de celui-ci pour s'emparer par la force de ce dont il avait besoin pour lui et sa prole.
Après avoir affamé et bombardé les prolétaires pendant des années, sans trop de bruit dans les mass-média, les stratèges du Pentagone déclarèrent après les événements du 11 septembre 2001 que le temps était venu d'en finir avec cet abcès. Une nouvelle invasion, dans la foulée de celle de l'Afghanistan, fut planifiée. L'arrogance de ceux qui se considèrent aujourd'hui comme les maîtres du monde est tellement incroyable que le ministre de la guerre US, Donald Rumsfeld, annonçait qu'avec même pas le dixième de la précédente Coalition, il paraderait à Bagdad en quelques semaines. Plus prudents, les militaires du Pentagone dépêchèrent tout de même quelques 200.000 hommes, dans une coalition moins élargie que celle de 1991, même si derrière le cinéma du couple Chirac-Schröder et de leur acolyte Poutine, toutes les fractions bourgeoises de la planète s'étaient véritablement associées au shérif Bush sur l'objectif primordial de cette opération: mettre de l'ordre dans cette région. Aucun exploiteur ne fit défaut dans cette guerre contre le prolétariat et aucun de ceux qui annonçaient si tapageusement leur opposition à ce conflit ne fit quoi que ce soit de sérieux pour l'empêcher. Ce spectacle n'a évidemment pas empêché Chirac, Schröder ou Poutine qui, pour l'Etat français, d'organiser avec les troupes US le survol de leur espace aérien par les forteresses volantes B52 qui partaient directement d'aérodromes situés en Grande-Bretagne pour déverser leurs tonnes de bombes sur les villes d'Irak et sur les quartiers ouvriers de préférence, qui, pour l'Etat allemand, d'afficher une détermination pacifiste tout en versant discrètement des millions d'euros pour mener à bien l'opération de police menée par les troupes anglo-américaines. Jeu d'équilibriste qui permettait au chancelier SPD Schröder de gagner les élections législatives avec ses alliés écologistes surfant sur la vague pacifiste qui déferlait à ce moment-là en Europe, tout en prenant une part substantielle dans les 230 millions de dollars qu'envoya, sous couvert d'aide humanitaire, l'Union Européenne en Irak. Quant à Poutine, il reçut du gendarme mondial l'autorisation de remettre lui aussi de l'ordre en Tchétchénie en échange de son appui diplomatique et très discrètement militaire à la version II de la guerre du Golfe. Enfin, le spectacle contre la guerre ne pouvait être complet sans la scène des votes à répétition de l'ONU et les prises de positions médiatiques de son secrétaire général Koffi Annan, qui en même temps que la publication de ses résolutions, préparait l'invasion de l'Irak planifiée par le Pentagone en récoltant des informations ultra-confidentielles sous couvert d'aide humanitaire. Cet espionnage mené directement par les agents de l'ONU présents sur place dans le cadre de la politique d'aide aux populations civiles, et transmis directement à la CIA, n'est plus aujourd'hui qu'un secret de polichinelle.
Cette deuxième intervention en Irak n'était pas seulement une guerre généralisée entre divers capitalistes s'affrontant pour conquérir le monde et éliminer leurs adversaires dans une course folle, mais ressemblait furieusement également à une opération de police, comme il s'en passe quotidiennement dans les villes de Sao Paulo contre des gosses, jeunes prolétaires baptisés délinquants, par les escadrons de la mort appointés par de riches commerçants, permettant ainsi de les abattre plus facilement. Comme pour les policiers de Rio de Janeiro, les militaires US étaient appelés à remettre de l'ordre à un niveau supérieur dans une région où l'instabilité sociale était devenue trop importante. Voilà bien, au-delà des approches différentes dans la manière d'y procéder, l'objectif que poursuivait l'Etat mondial, toute bourgeoisie confondue. Les uns, sûrs de leur force, voulaient y aller sans aucune contrainte liée aux résolutions de l'ONU, les autres préféraient se rendre sur place sous la bannière bleue de l'humanitarisme et du droitdelhommisme, en espérant éviter de la sorte qu'une guérilla ne naisse et ne vienne déstabiliser la région toute entière ce qui, en cas de victoire sur les troupes d'invasion, risquait carrément de déstabiliser socialement le monde entier. Voilà pourquoi aujourd'hui, Chirac comme Schröder et Poutine ou Annan, tous font bloc derrière l'équipe Bush, tout en espérant secrètement voir les républicains américains mordre la poussière et être renvoyés dans l'opposition parlementaire lors des prochaines élections présidentielles américaines. Leur espoir est qu'un démocrate, le général Wesley Clark, ancien chef de l'OTAN, par exemple, devienne président et calme le jeu en mettant le paquet sur l'Irak, mais sous la bannière de l'ONU. Il est évident que ce sujet mériterait un développement plus important, mais tout ceci dépasserait l'objectif que cette courte contribution s'est fixé. Nous aurons certainement l'occasion de revenir plus amplement sur cette question.
Toujours est-il que cette fois-ci, les militaires et les humanitaires ne s'étaient pas trompés. L'opération de police fut rondement menée, les quatre semaines de conflit furent une véritable promenade, malgré les obstacles rencontrés et les quelques 55.000 civils tués sous le vocable ignoble de «dommages collatéraux». Les troupes américaines ne se sont pas privées de tirer sur tout ce qui bougeait. En haut lieu, des ordres avaient manifestement été donnés, incitant à tirer d'abord et à vérifier ensuite.
L'armée irakienne et ses forces spéciales avaient subitement disparu du champ de bataille, laissant la voie libre aux troupes anglo-américaines pour entrer dans Bagdad. La relative facilité des troupes d'invasion à traverser presque sans encombre tout le pays, du sud au nord, prouvait une seule chose: que les prolétaires en Irak mobilisés, enrégimentés, dressés dans les casernes et envoyés au front pour sacrifier leur vie sur l'autel de la patrie, avaient refusé de le faire. Comme durant la guerre Iran-Irak des années '80, comme durant la première guerre du Golfe, ici encore le prolétariat en Irak donnait l'exemple à ses frères du monde entier, en refusant de se battre en faveur de ses propres oppresseurs. Cette attitude admirable, personne dans tout ce que nous avons eu l'occasion de lire sur ces événements, ne l'a relevée. Ce petit «détail» en dit bien plus long que n'importe quelle analyse sur l'état d'esprit du prolétariat à ce moment-là. Voilà pourquoi Saddam Hussein a perdu la guerre, non pas à cause des trahisons avérées ou supposées de ses proches et de ses complices, mais tout simplement parce que la chair à canon des guerres, les prolétaires, d'habitude si dociles, refusaient de se battre, refusaient de mourir pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Des unités entières se sont ainsi auto-dissoutes en quelques minutes sur les bords des routes en abandonnant insignes, uniformes, officiers, chaussures, véhicules et chars pour se remettre en civil mais, et c'est important de le souligner, tout en prenant soin de garder leurs armes. Ainsi, les prolétaires désertaient, mais armés, et regagnaient leur domicile en attendant de voir ce qui allait se passer.
Un deuxième événement intéressant, toujours pour sortir des péripéties militaro-diplomatico-politiques tout à fait secondaires et sans intérêt pour l'analyse que l'on fait ici, fut sans conteste la manière dont nos frères de classe accueillirent ceux qui s'étaient pompeusement autoproclamés les «libérateurs du nouvel Irak». Ce n'était pas les grands débordements de joie que l'Europe occidentale avait connus lors du passage des troupes américano-britanniques après la retraite des troupes allemandes en 1945. Malgré le bourrage de crâne fait aux GI's, les «libérateurs» n'ont connu que très peu de liesse à leur arrivée. C'est avec une énorme méfiance que les prolétaires du coin ont reçu les troupes anglo-américaines, se souvenant encore fort bien que pendant des décennies ceux qui aujourd'hui venaient les «libérer» avaient soutenu Saddam Hussein, se rappelant encore très clairement qu'en 1991, après les avoir encouragés à se soulever contre Saddam, les «libérateurs» actuels les avaient laissés se faire massacrer par les forces de répression de ce même Saddam. A peine les troupes d'invasion s'étaient-elles débarrassées des dernières poches de résistance que les prolétaires se déversèrent par centaines de milliers non pas pour applaudir «leurs libérateurs», mais pour piller tout ce qui de près ou de loin pouvait représenter le pouvoir détesté du Parti Baas et de Saddam Hussein. Et les damnés de la terre ne s'arrêtèrent pas en si bon chemin. Tout fut pillé, des palais présidentiels aux casernes en passant par les ministères, et ils finirent même par s'en prendre aux résidences des quartiers chics ainsi qu'aux mosquées. Nous en voulons pour preuve un appel abondamment diffusé par un obscur «comité suprême de la révolution islamique», regroupant la plupart des imams, demandant «humblement aux fidèles de rapporter tout ce qui fut pillé». Les imams mettaient ces événements sur «un moment d'égarement» de la part des fidèles. C'est oublier de la part de ces vendeurs d'opium idéologique qu'en 1991, les prolétaires qui s'étaient insurgés à Najaf comme à Karbala, avaient pissé dans leurs bordels qu'ils s'évertuent à appeler «lieux saints». Cela montre toute la considération que nos frères de classe éprouvent pour ces vendeurs de paradis frelaté. Malgré le peu d'informations qui filtrent de cette région, on peut affirmer aujourd'hui que très peu d'objets pillés furent restitués, démonstration supplémentaire des limites actuelles de l'emprise que ces forces bourgeoises que sont les islamistes exercent sur le prolétariat en Irak.
Les troupes occupantes laissèrent faire, espérant sans doute calmer la rage des prolétaires, et ne préservant globalement des pillages que le fameux ministère du pétrole et tout ce qui de près ou de loin s'y rattache: puits, oléoducs, raffineries, terminal maritime, dépôts, camions de transports... La fraction regroupée autour de Bush-fils veut bien faire le sale boulot, au service des intérêts du capital dans son ensemble, mais elle n'en oublie pas pour autant ses intérêts immédiats liés au pétrole et à l'armement ce qui, en retour, a tendance à considérablement énerver ses concurrents qui n'oublient pas de rappeler à l'équipe Bush leurs propres intérêts. Pour rester dialectique, c'est uniquement ici que viennent se loger les dissensions suranalysées par toute une série de groupes qui se réclament de la révolution sociale, entre les bourgeois d'Halliburton et BP (British Petroleum), ceux de Total-Elf-Fina, les sociétés russes et chinoises des pétroles qui avaient passé avant-guerre des accords d'exclusivité d'exploitation du sous-sol irakien. C'est sous couvert de «respect de la propriété privée», sous couvert du «droit des gens» et autres balivernes juridiques que Chirac et consorts rappelèrent aux troupes occupantes qu'elles ne pouvaient laisser les prolétaires s'attaquer impunément aux bourgeois et à leur propriété. Un semblant d'ordre fut rétabli à coups de mitraillette et lorsque cela ne suffisait pas, c'est à coups de canon que les troupes d'occupation rappelèrent qui était le maître. Mais l'arrogance des dirigeants américains était telle qu'ils ne se donnèrent pas vraiment les moyens de contrôler une situation qui leur échappait déjà quelques jours seulement après avoir conquis Bagdad. Dopé par une victoire aussi facile, Donald Rumsfeld, contre l'avis même de toute une série de spécialistes dans la pacification sociale tel Bernard Kouchner qui était prêt à «soutenir les Américains» et se «mettre au service de l'Irak libre», dissolvait par décret non seulement le parti Baas et le gouvernement de Saddam Hussein, mais aussi l'armée irakienne, et même la police. Il provoquait ainsi un gigantesque chaos que les pillages et les occupations de bâtiments officiels par des centaines de familles démunies allaient généraliser. Pour tous ceux qui avaient cru au discours officiel des occupants sur le «nouvel Irak», la «fin de la dictature», la «démocratie»..., la désillusion fut bien grande.
Certains d'une victoire facile et disposant d'une force de frappe aussi colossale, les troupes US ne pouvaient à ce moment s'imaginer que quelqu'un tenterait de redresser la tête. Au Pentagone, les problèmes que les pillages et le chaos engendraient étaient considérés comme des épiphénomènes qui rentreraient vite dans l'ordre, une fois que la puissance de l'armée américaine aurait décidé d'y mettre fin. C'est pour cela aussi que l'après-guerre n'avait pas été planifiée par les stratèges qui avaient décidé de l'invasion. Ils pensaient qu'après la raclée que l'armée de Saddam Hussein allait recevoir tout le monde fermerait sa gueule et tout rentrerait dans l'ordre. C'était à nouveau sans compter sur la détermination des prolétaires à ne pas se laisser faire. Très vite, durant l'été, des manifestations se transformant en émeutes éclatent un peu partout, comme à Bassora les 10 et 11 août 2003 où plusieurs soldats britanniques sont massacrés par une foule excédée de vivre sous un nouveau joug et dans une situation de misère qui ne cesse de s'accroître. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, des milliers de prolétaires descendirent dans les rues à Fallouja, Ramadi, Mossoul... et commencèrent à parcourir les rues en demandant aux forces occupantes le rétablissement de l'électricité, de l'eau, des routes... et de la nourriture, bref tout ce qu'il faut pour survivre après une guerre. L'arrogance des troupes anglo-américaines, ainsi que les arrestations et la dispersion des émeutiers à coups de fusils automatiques, furent la seule réponse, même si de-là, des commandants régionaux plus malins se mirent à la tâche pour remettre un minimum d'infrastructures en route. Très vite, les troupes d'occupation vont reconnaître avoir emprisonné plus de 10.000 personnes pour «atteinte à l'ordre civil». Et les événements ne sont pas prêts de se calmer pour autant puisque depuis le début de l'année 2004, de plus en plus de chômeurs s'organisent pour revendiquer et manifester à travers l'ensemble du pays. Ainsi, le week-end du 10 et 11 janvier 2004 à Amarah, des milliers de prolétaires ont manifesté pour demander de meilleures conditions d'existence et ont fini par transformer leur défilé en émeute, s'attaquant aux responsables de leur situation misérable: la mairie, le QG du 1er bataillon d'infanterie légère britannique. Les policiers irakiens et les troupes anglaises n'ont pas fait dans la dentelle en tirant dans le tas. Le bilan est lourd: plus de 6 morts et des dizaines de blessés.
Alors que le discours officiel du «nouvel Irak» était que tous les malheurs, tous les maux dont souffrait l'Irakien étaient dus à la cupidité du régime de Saddam, la réalité que vit au quotidien le prolétaire est encore pire aujourd'hui que sous Saddam. Souvent la nourriture vient à manquer, et cela malgré l'énorme afflux de marchandises qui se déversent sur les trottoirs des grandes villes depuis que les frontières sont rouvertes au commerce. Du boulot et donc des salaires, il n'y en a plus non plus, accroissant du même coup l'état de misère dans laquelle une grande partie de la population se débat maintenant depuis plusieurs décennies. Officiellement, le taux de chômage avoisine actuellement les 70% de la population active. La dissolution de l'armée a accéléré la paupérisation en ne faisant plus rentrer les soldes pour des milliers de familles, sans même parler des infrastructures détruites et des dénationalisations/privatisations qui poussent toujours plus de prolétaires au chômage, à la misère. Il n'est pas étonnant dès lors, que certains prolétaires prennent les armes contre les troupes anglo-américaines et se mettent à pratiquer la guérilla, voire le vol à grande échelle pour survivre. Sabotages, attaques et pillages de convois, d'oléoducs, attentats contre des GI's en patrouille, contre des raffineries, virent ainsi très rapidement le jour, provoquant en retour des représailles menées avec toujours plus de violence et d'arrogance par les troupes US, cette situation provoquant à son tour un mécontentement et une réaction de rejet des troupes d'occupation, toujours plus généralisée. Les cibles témoignent du refus des prolétaires sur place de se laisser remettre au pas docilement. Cela vaut la peine qu'on s'y arrête un instant, pour mieux saisir ce qui se passe réellement en Irak.
Pas un jour ne passe sans l'annonce qu'un soldat américain ait sauté sur une mine ou se soit fait dégommer dans une embuscade. Il en va de même pour les policiers irakiens du «nouvel Irak» qui voient très souvent leurs bâtiments pris pour cible, et de préférence les jours de paye, lorsqu'ils s'y trouvent tous rassemblés. Mais si l'objectif ici est parfaitement compréhensible, il en va de même pour d'autres attaques menées actuellement contre ce qui de près ou de loin peut représenter la mise au pas des prolétaires de cette région. Rappelons qu'une des premières attaques qui ait eu lieu fut menée contre l'ambassade de Jordanie le 7 août. On apprendra plus tard, dans le courant du mois d'octobre 2003, que l'Etat jordanien, avec l'aide discrète des services secrets français, avait reçu dans la division internationale du travail de remise en ordre de la région, l'ingrate tâche de former 30 000 policiers à raison de 8 semaines de formation; pas étonnant donc que ces bâtiments aient été la cible d'un attentat. Le 19 août, c'est le quartier général de l'ONU qui est pris pour cible, tuant le chef de la mission sur place Sergio Vieira de Mello, ainsi que la plupart de ses collaborateurs. Est-il besoin de rappeler la haine des prolétaires face à cette institution mondiale qui a organisé pendant des années la famine, et qui participe actuellement de toutes ces forces à l'instauration de l'ordre en Irak? Dix jours plus tard, le 29 août, c'est au tour du dirigeant du Conseil suprême de la Révolution islamique en Irak, l'ayatollah Al Hakim, de périr dans un attentat à Nadjaf. Le 2 septembre, nouvel attentat contre le QG de la police de Bagdad, endommageant le bureau de son chef Hassan Ali, et le 20 septembre assassinat d'Akita Al Hachimi, membre de l'autorité irakienne provisoire nommée le 2 septembre par les USA et, auparavant, baasiste bien connue travaillant avec Tarek Aziz au ministère des affaires étrangères de Saddam Hussein. Le 18 septembre, nouvelle attaque contre la raffinerie de Baïji, la plus grande du pays, bloquant pour plusieurs jours l'exportation de pétrole. Le 23 septembre, nouvel attentat contre le Quartier Général de l'ONU qui, malgré le discours de Koffi Annan annonçant le départ de ses hommes après le premier attentat, avait encore laissé sur place plus de 4000 fonctionnaires, la plupart d'origine irakienne, pour continuer à faire leur sale boulot de pacificateurs. Le 10 octobre, assassinat de José Antonio Bernal, sergent-chef dans l'armée de l'air espagnole mais en réalité agent du service de renseignement espagnol (CNI). Sept autres agents de renseignements seront tués quelques semaines plus tard, le 29 novembre, obligeant le gouvernement d'Aznar à fermer son ambassade et à rapatrier toute une série de civils et de diplomates qui eux aussi travaillaient à la pacification du pays. Le 12 octobre une voiture piégée saute devant l'hôtel Bagdad qui héberge principalement des membres de la CIA, du gouvernement irakien provisoire, ainsi que toute une série de businessmen et d'entrepreneurs américains venus faire de «bonnes affaires» sur le dos de la misère de nos frères de classe. Le 23 octobre, au moment même où le Pentagone veut faire appel à l'armée turque pour venir mater la rébellion en Irak, une voiture piégée saute devant l'ambassade de Turquie. Le 27 octobre c'est Paul Wolfowitz, numéro 2 du Pentagone après Donald Rumsfeld, qui échappe de peu à la mort. Plusieurs roquettes sont venues s'écraser sur la façade de l'Hôtel Al Rachid où il séjournait. Le 3 novembre, trois explosions frappent le QG de l'armée américaine à Bagdad. Le 12 novembre, explosion d'un engin devant le tribunal de Rassafa à l'est de Bagdad. Depuis lors, plusieurs juges ont été assassinés. Le 21 novembre, attaque à la roquette contre le ministère du pétrole et contre l'hôtel Sheraton où un civil américain travaillant pour Halliburton a été grièvement blessé. En décembre, on apprenait que Paul Bremer, le responsable en chef de la pacification sociale en Irak avait échappé jusqu'à présent à 2 attentats, et le vendredi 19 décembre, c'est au tour d'Ali Al-Zalimi, haut dirigeant du Parti Baas, responsable de la répression lors du soulèvement de 1991, d'être lynché par des manifestants à Nadjaf.
Nous pourrions allonger indéfiniment cette liste, mais cela n'ajouterait rien à ce que nous disions plus haut; c'est tout l'appareil, les services, les organes, les représentants sur place de l'Etat mondial qui sont systématiquement pris pour cible. Loin d'être aveugles, ces actes de résistance armée ont une logique si nous prenons la peine de sortir un peu des stéréotypes et du bourrage de crâne idéologique que les bourgeois nous proposent pour seule explication de ce qui se passe en Irak. Derrière les objectifs, ainsi que dans la guérilla quotidienne qui est menée contre les forces d'occupation, on peut deviner les contours d'un prolétariat qui essaye de lutter, de s'organiser contre toutes les fractions bourgeoises qui ont décidé d'apporter l'ordre et la sécurité capitalistes dans la région, même s'il est encore extrêmement difficile de juger de l'autonomie de notre classe par rapport aux forces bourgeoises qui essayent d'encadrer la colère, la rage de notre classe contre tout ce qui représente de près ou de loin l'Etat mondial. Les actes de sabotages, attentats, manifestations, occupations, grèves... ne sont pas le fait d'islamistes ou de nationalistes panarabes, cela serait trop facile et irait dans le sens du discours dominant qui veut absolument enfermer notre compréhension dans une lutte entre «le bien et le mal», entre les «bons et les méchants», un peu comme dans un western, évacuant une fois encore la contradiction mortelle du capitalisme: le prolétariat.
Un exemple illustrera mieux notre propos. Cela se passe à Duluya, une petite ville au nord de Bagdad dans le fameux «triangle sunnite». Les américains doivent faire face à des tirs réguliers contre leurs hommes et leurs convois depuis qu'ils occupent la ville, fin mars 2003. En réaction, ils ont décidé de raser plusieurs milliers de dattiers qui bordent les routes de la région. Des rumeurs circulent sur une mystérieuse organisation baasiste qui serait à l'origine de ces attaques. Du moins, c'est ce que la presse arabe relaye dans ses colonnes, alors que le journal israélien Ha'aretz a une autre version au sujet de ces mystérieuses attaques: elles seraient l'uvre de «jeunes désuvrés» qui pour 1000 voir 1500 dollars payés par des organisations islamistes organiseraient le coup de main contre les troupes US. Et le journal de citer un de ces jeunes: «C'est le meilleur moyen de gagner aujourd'hui sa vie en Irak.» Comme par hasard, depuis que les troupes d'occupation ont rasé les dattiers et que des dizaines d'ouvriers agricoles ont été privés de leur gagne-pain, les attaques contre les GI's sont devenues encore plus fréquentes.
Et c'est ici que tout va se jouer dans les mois qui viennent, les prolétaires qui s'opposent très clairement à toutes les fractions mondiales du capitalisme auront-ils la force de ne pas sombrer dans l'islamisme radical voire le panarabisme qui, avec la capture de Saddam Hussein (dimanche 14 décembre), a l'air d'avoir le vent en poupe? Nos frères en Irak auront-ils la force de ne pas s'embourber dans une guerre populaire de libération nationale? La réponse ne peut pas venir du seul prolétariat sur place qui, tant qu'il restera aussi dramatiquement isolé, aura bien du mal à ne pas finir dans les bras de l'une ou l'autre des fractions bourgeoises qui tentent de l'enrôler comme chair à canon sous une de ses bannières. Tout dépend avant tout du rapport de force entre prolétariat et bourgeoisie au niveau le plus global, au niveau mondial, et particulièrement aussi, dans les pays dont les troupes d'occupation sont issues. Et là malheureusement, nous devons bien le constater, il n'est pas en notre faveur, même si de-ci, de-là, des bouffées d'oxygène nous parviennent de Bolivie, du Pérou... La responsabilité de nos frères de classe aux USA, comme dans les autres Etats prenant part directement ou indirectement à l'occupation de l'Irak, va une fois de plus peser dans la balance de tout son poids. Pour que cette guerre cesse, pour que cette boucherie prenne fin, pour que les prolétaires en Irak s'autonomisent de manière plus marquée du piège de l'islamisme et du nationalisme panarabe, il faudrait que nos frères de classe à travers le monde et plus particulièrement aux USA, en Angleterre, en Pologne, en Espagne, en Italie... réagissent, s'agitent, s'organisent et commencent à refuser de continuer à servir de chair à canon, transformant cette guerre en guerre sociale contre leur propre bourgeoisie.
Pour l'instant on ne voit pas grand chose bouger de ce côté-là. Le prolétariat aux Etats-Unis est non seulement englué dans un fervent patriotisme condensé dans le fameux slogan support our boys, et pour les plus critiques dans une croisade moutonnière appelant au pacifisme le plus béat. Il nous faut souligner dans ce contexte, et à contre-courant de cette ambiance, quelques réactions intéressantes qui ont eu lieu sur la côte ouest des Etats-Unis, au moment du déclenchement de la guerre, réactions dont rend compte un journal français et dont nous reproduisons quelques extraits dans l'encadré ci-contre.
C'est également à l'occasion de ces manifestations que des prolétaires ont fièrement brandi un calicot affirmant ne «soutenir uniquement que les troupes qui tirent sur leurs officiers». Superbe pied de nez au slogan officiel du gouvernement appelant à «soutenir nos troupes».
Mais si ce détournement nous paraît sympathique et indique la voie à suivre dans la lutte du prolétariat, force est aussi de constater que l'attitude exprimant avec force la position de toujours de notre classe, le défaitisme révolutionnaire, reste malheureusement terriblement isolée dans un marais où le pacifisme côtoie le tiers-mondisme le plus plat. Même parmi les associations de parents de GI's, à la pointe dans la lutte contre la guerre en Irak, tous misent aujourd'hui plus sur l'arrivée d'une équipe démocrate aux prochaines élections présidentielles -pour «ramener nos enfants au pays»- plutôt que sur une action directe contre l'armée qui les envoie «casser de l'arabe». Au sein de l'armée US, alors que la contradiction se fait toujours plus forte entre d'un côté la formation pour le métier de soldat, et de l'autre, la prosaïque réalité de n'être qu'un flic envoyé à travers la planète pour réprimer des miséreux issus du même milieu, mais peu nombreux sont encore ceux qui renoncent à ce mercenariat (Cf. encadré à la fin du texte).
Ce ne sont pas les 30 déserteurs actuels qui vont faire pencher la balance en notre faveur. Rappelons que lors de la guerre du Vietnam, ils étaient officiellement plus de 200.000! Ce ne sont pas non plus les déclarations courageuses, au milieu de l'hystérie patriotarde qui règne aux States depuis les attentats du 11 septembre, du caporal des Marines Stephen Funk qui du haut de ses 20 ans refuse aujourd'hui de continuer à tuer des civils et se déclare objecteur de conscience, qui vont changer grand chose à la situation de soumission catastrophique dans laquelle se trouve aujourd'hui le prolétariat aux USA par rapport à sa propre bourgeoisie. Il en va de même des autres Etats qui ne rencontrent, pour l'instant, quasi aucune opposition à l'envoi de troupes en Irak.
Mais soyons en sûrs, l'occupation sanglante de l'Irak n'est pas finie, les troupes américaines et alliées devront encore y rester pour longtemps et ce bourbier qui commence à ressembler à celui du Vietnam va certainement obliger le Pentagone à envoyer toujours plus de troupes pour faire face au nombre croissant d'attaques.
«Nous manquons de moyens pour mesurer si nous gagnons ou perdons la bataille mondiale contre le terrorisme. Mon impression est que nous n'avons pas aujourd'hui fait de progrès décisifs.» Extrait du mémorandum de Donald Rumsfeld au Congrès des USA, le 14 novembre 2003.
Les derniers chiffres en notre possession faisaient état de plus de 500 morts depuis le début de ce conflit, sans même parler de ceux qui se trouvent en mission secrète (undercover) et qu'on inhume discrètement dans le désert (plusieurs tombes ont récemment été découvertes). Les blessés dépassent aujourd'hui le nombre des 10.000 malgré les protections en Kevlar que la plupart des soldats portent et la prise en charge immédiate des blessés par des équipes spécialisées. Cela fait plus de dix blessés par jour, dont la plupart sont gravement atteints. Comme le signale le journal néo-conservateur américain, The New Republic: «... les médias ont toujours traité le nombre de morts au combat comme la mesure la plus fiable des progrès accomplis sur le champ de bataille, mais c'est le nombre de blessés qui révèle la situation sur le terrain.»
Jamais depuis le Vietnam, l'armée américaine n'a du faire face à un aussi grand nombre de blessés qu'elle rapatrie aux Etats-Unis dans des avions cargo et de préférence la nuit pour éviter les caméras et la démoralisation des troupes restées au pays. Les suicides dans les troupes engagées atteignent aujourd'hui le nombre de 13 et le nombre des soldats rapatriés pour «problèmes de santé mentale» (des soldats qui ont pété les plombs) s'élevait à 478, à la date du 25 septembre. Rappelons aussi que le nombre des attaques contre les troupes de l'ordre avoisinent aujourd'hui les 30 à 35 par jour, et que la plupart des troupes sur place y seront bientôt depuis plus d'un an. Cela commence à faire long et mécontente les hommes de troupe qui ne «comprennent plus pourquoi ils sont là». Ajoutons à cela l'incapacité du Pentagone de les remplacer par manque d'effectifs, et voilà un cocktail qui devient de plus en plus explosif pour la fraction bourgeoise qui s'affirme comme le gendarme mondial.
Doit-on voir dans tout cela les signes avant-coureurs d'une possible brèche dans l'unité nationale, une brèche qui 40 ans plutôt, autour de la guerre au Vietnam, avait provoqué une gigantesque fissure au sein même de la société américaine? A l'époque, l'unique espoir d'éviter de se faire horriblement blesser ou tuer pour un soldat, était de s'opposer par tous les moyens à son implication dans la guerre. Et ces moyens, d'une simplicité enfantine, consistaient avant tout à éviter tout affrontement avec l'ennemi. En pratiquant le «fragging» (littéralement «fragmentez les officiers») consistant à jeter des grenades sur les officiers, les soldats opposés à la guerre provoquaient ainsi une véritable terreur parmi leurs supérieurs amenant ceux-ci à perdre progressivement le contrôle de leurs troupes. En 1970, le Pentagone publiait le chiffre de 65.643 déserteurs soit l'équivalent de 4 divisions d'infanterie! Autres chiffres intéressants, l'existence de plus de 300 journaux clandestins contre la guerre édités directement par des soldats et qui contribuaient largement à casser l'isolement, tout en généralisant l'opposition à la guerre. Avec les manifestations quotidiennes aux USA et les sabotages, les grèves, les occupations... qui empêchaient réellement que la guerre continue, le gouvernement américain dut stopper, au début des années '70, son engagement au Vietnam et retirer petit à petit ses troupes. C'est en rappelant ces quelques faits significatifs de l'horrible cauchemar qu'ont vécu les bourgeois à l'époque, que nous pouvons non seulement mesurer l'énorme gouffre qui nous sépare aujourd'hui de cette période de lutte, mais aussi indiquer l'unique voie qui mettra fin à cette boucherie.
Notre conclusion ne peut être que provisoire. Nous avons tenté dans ces quelques lignes de saisir les événements qui se déroulent là sous nos yeux en tentant de sortir des catégories journalistiques qui ne peuvent certainement pas appréhender la réalité complexe de ce qui se déroule là-bas. Continuer de parler de chiites, sunnites, kurdes, baasistes, islamistes... de telle ou telle tribu, de tel ou tel clan, c'est effacer la contradiction essentielle qui pousse le capital à tenter de remettre de l'ordre dans une région troublée depuis plusieurs décennies par un prolétariat combatif et qui n'a pas encore accepté de se soumettre à la dictature de l'économie. Nous ne pouvons que renouveler l'appel à nos amis lecteurs et à tous les camarades, pour qu'ils considèrent la lutte que mènent nos frères de classe en Irak comme la leur. Nous ne pourrons rompre leur isolement qu'en généralisant nos luttes contre notre propre bourgeoisie, là où nous nous trouvons, et cela en restant intransigeant par rapport à notre programme et à nos objectifs de classe. Seul le défaitisme révolutionnaire peut ébranler significativement cette société, qui n'a pas d'autre projet que l'accumulation de montagnes de cadavres, et ouvrir les brèches décisives pour sa destruction violente.
Nassiriya le 25 mars«Je n'ai d'abord pas vu les tanks américains postés 200 mètres après le pont. Ce n'est qu'arrivé à 60 mètres d'eux que je les ai aperçus. J'ai immédiatement stoppé la voiture. J'étais à l'arrêt, en train de me demander si je devais faire des signes ou un demi-tour, lorsque les tirs ont retenti. Une longue rafale, des dizaines de balles... Ma femme et moi, à l'avant, avons été touchés de plusieurs balles dans la poitrine, les jambes et les bras, sans être tués. De mes quatre enfants, à l'arrière, deux, Mawra, 9 ans, et Zehra, 3 ans, sont morts instantanément. Des soldats américains sont arrivés et nous ont sortis de la voiture. Ils ont tenté de secourir mon fils Mohammed, 6 ans, qui agonisait. Il est mort cinq minutes plus tard. Ensuite les soldats nous ont emmenés, ma femme et moi, ainsi que mon dernier enfant vivant, ma fille Zainab, 5 ans, dans un bâtiment occupé par leur armée.»«Nous sommes restés toute la nuit dans ce bâtiment sans recevoir de soins, raison pour laquelle, selon un médecin, j'ai perdu ma jambe, qui aurait pu être sauvée. Nous avons été transférés le lendemain vers un hôpital militaire, où ils ont extrait une balle que ma fille Zainab avait dans un coin de la tête. Puis, le soir, apparemment à cause d'un arrivage de soldats américains blessés, un officier a donné l'ordre que tous les blessés irakiens soient emmenés hors de l'hôpital, devant la porte, par terre, dans le désert. Ils avaient besoin de lits. Or, il faisait très froid dehors. Ma fille pleurait. Nous avons demandé à être allongés dans un couloir, ou qu'on nous donne des couvertures. Rien. Zainab pleurait de plus en plus. Elle disait: «J'ai froid, papa, j'ai si froid.» Ma femme et moi étions immobilisés par nos blessures, incapables même de la tenir dans nos bras. Je me pissais dessus. Ma fille pleurait...» Daham perd connaissance durant la nuit. Lorsqu'il se réveille, à l'aube, il est sur une civière, en train d'être embarqué dans un hélicoptère. «Ils nous ont emmenés, ma femme et moi, sur un bateau-hôpital au large du Koweït. C'est là, plus tard, que nous avons reçu une lettre de mon frère nous apprenant que Zainab était morte le matin de notre départ.» Daham retient ses larmes. «C'est le froid qui l'a tuée, monsieur, c'est le froid. L'intervention chirurgicale avait réussi, elle était vivante. C'est cette nuit dans le désert, devant la porte de l'hôpital, sans même une couverture qui l'a tuée.» Daham Kassim écrase un mégot et allume aussitôt une autre cigarette. «Voilà comment, monsieur, sans raison, l'armée américaine a tué tous mes enfants...» Le Monde - 12/11/2003
|
| « Ils n'étaient pas les plus nombreux, mais les plus organisés
et les plus déterminés: à San Francisco, d'où
étaient partis les mouvements radicaux des années 60, les
pacifistes ont renoué avec une longue tradition militante. Ils avaient
préparé depuis des mois leurs actions de guérilla
urbaine à la première frappe sur l'Irak. A l'aube de ce jeudi,
mobilisés par leurs réseaux sur l'Internet, ils ont donc
convergé vers le centre-ville. Ils ont posé des plots orange
et un panneau «travaux» sur l'une des sorties principales du
pont, le Bay Bridge. Simple et efficace. L'accès à la ville
a été immédiatement rendu impossible à l'heure
où les banlieusards se rendaient au travail. Le pont a été
l'enjeu du rapport de force entre la police et les manifestants. Se déplaçant
par petits groupes mobiles, les manifestants, plusieurs dizaines de milliers
de l'aube à minuit, n'ont pas hésité à affronter
les forces de l'ordre. San Fransisco a été transformé
en champ de bataille. Entre l'émeute vitrines cassées,
magasins attaqués- et le happening: un groupe, Pukers for Peace,
les vomisseurs pour la paix, a ainsi organisé un vomit in
devant les bâtiments officiels. Pour les policiers ce fut une journée
de «lutte contre les communistes et les anarchistes». (...)
De l'autre côté de la baie, l'université de Berkeley a aussi retrouvé sa tradition militante, occupant le campus, et la police a arrêté 500 étudiants. A la nuit, la police avait arrêté 1350 manifestants, un chiffre jamais atteint depuis les grandes protestations contre la guerre du Vietnam. Débordée par le nombre d'arrestations, la police n'avait pas assez de cars pour embarquer les manifestants, et a fini pas réquisitionner les bus municipaux. Dans toute la Californie des actions de protestation ont été menées. Même à Los Angeles, fait rare, les protestataires, très nombreux, ont bloqué la circulation et n'ont pas hésité à résister aux policiers. Vendredi à Frisco, les militants ont remis ça. Moins nombreux, et seules 60 personnes ont été interpellées par la police. » Libération - 22 mars 2003
|
Contributions autour de la guerre en Irak parues dans nos revues précédentes:Communisme N°43 (mai 1996)A propos de la lutte de classe en IrakNotes additionnelles à propos de l'insurrection de mars 1991 en Irak Nationalisme et islamisme contre le prolétariat Communisme N°38 (avril 1993)Action directe et internationalisme! A propos d'une affiche internationaleCommunisme N°36 (juin 1992)Irak: prolétariat contre nationalismeCommunisme N°34 (septembre 1991)Défaitisme révolutionnaire en IrakCommunisme N°33 (mai 1991)Guerre ou révolutionLe Communiste N°27 (juillet 1988)Massacre à Halabja!Le Communiste N°20 (août 1984)Iran/Irak: guerre de classe contre guerre impérialisteLe Communiste N°14 (juillet 1982)Manifeste rédigé en Iran/IrakLe Communiste N°3 (septembre 1979)Kurdistan: le piège de la «libération nationale»Le Communiste N°2 (Juillet 1979)Iran: les régimes se succèdent, l'oppression demeure |
Vous avez dit chair à canon ?A la différence de ce qui s'est passé au Vietnam, l'armée des Etats-Unis à l'oeuvre aujourd'hui en Irak est une armée de métier composée de soldats qui ont «fait le choix» de se battre. Un choix tout relatif évidemment puisque directement déterminé, pour la majorité de ceux qui s'enrôlent, par leur condition sociale. Les recruteurs de chair à canon des 4 coins de la planète savent depuis toujours qu'un prolétaire affamé et sans perspective sera plus enclin à accepter les gratifications que la patrie réserve à ceux qui la servent militairement. Une solde, un bout de terrain, une bourse d'étude, une carte de séjour ou une poignée de dollars...: les possibilités de coopter les «pauvres» à la défense de la nation sont quasiment infinies.Bien conscient de tout cela, pour sa campagne de recrutement, le Pentagone a donc décidé de cibler particulièrement les prolétaires «latinos» en général et «mexicains» en particulier *. Il s'agit d'une communauté principalement composée d'hommes en âge de se battre et dont la population est en croissance permanente et rapide aux Etats-Unis. Mais la raison principale de ce ciblage particulier est que ces prolétaires disposent de moyens de vie très faibles et qu'ils n'ont que peu ou pas de perspectives de travail ou d'études. C'est aussi simple et cynique que cela. Ainsi, l'objectif déclaré du Pentagone est de doubler le pourcentage de soldats «latinos» présents dans l'armée américaine. Des statistiques récentes démontrent que les «latinos» sont déjà aujourd'hui utilisés dans les opérations de combat les plus dangereuses, et ce de manière disproportionnée par rapport à leur nombre au sein de l'armée. Alors qu'ils ne composent encore actuellement qu'environ 10% de l'ensemble des forces armées US, leur présence dans des actions de guerre monte à 17,7%. En Irak, le premier GI mort n'était pas citoyen américain, mais guatemaltèque: José Gutierrez. Ce sont ces soldats qui devraient donc constituer les premières lignes de feu de l'armée nord-américaine et servir de chair à canon pour les guerres présentes et futures. Cependant, ces perspectives de recrutement incluent également plusieurs dizaines de milliers de prolétaires entrés illégalement aux Etats-Unis à qui l'on promet la citoyenneté américaine immédiate s'ils s'enrôlent. Comparé aux 5 années normalement prévues pour l'obtention de la fameuse «carte verte», ce délai est alléchant. On chiffre donc à près de 37.000 le nombre de prolétaires «latinos», actuellement enrôlés dans l'armée américaine. Mais c'est loin d'être suffisant, le besoin de chair à canon est sans limites et les sergents-recruteurs nord-américains ont désormais traversé la frontière mexicaine à la recherche de jeunes prolétaires ayant abandonné l'école et qui cherchent à obtenir des papiers et la résidence aux Etats-Unis. Les généraux jugent «éminement positif» le désir de nombreux prolétaires au Mexique d'obtenir la nationalité nord-américaine et n'hésitent donc pas à les embrigader en échange de la promesse d'une carte d'identité toute neuve. Cet intérêt pour la chair à canon «latino, chicano,...» est évidemment aussi alimenté par l'assurance que l'annonce de la disparition sur le front d'un citoyen aux origines non américaines n'aura qu'un faible impact sur «l'opinion publique» nord-américaine. Les militaires nomment cette stratégie d'enrôlement ciblé «Recrutement de la Pauvreté». Cette stratégie est à l'oeuvre partout où se concentre un prolétariat particulièrement démuni, tant à l'intérieur des Etats-Unis qu'en dehors de ces frontières. Aux Etats-Unis, les chiens de guerre entament leur boulot de recrutement dès l'école primaire et ils vantent les avantages d'être militaire tout au long des études, y compris, évidemment, dans les universités. Cela a mené différentes associations à se créer pour résister à ces pratiques. Le Mouvement américain contre le recrutement (anti-RTOC) en est à sa 5ème grève contre l'enrôlement et contre la guerre, et l'organisation Student not soldiers a lancé une campagne contre la présence de l'armée à l'école. Au Mexique, ce mouvement de résistance a pris une tournure très matérielle: à Tijuana, à plusieurs reprises, des recruteurs nord-américains venus de San Diego, et soutenus par quelques complices mexicains diffusant de la pub appelant à s'enrôler dans l'armée US, ont été purement et simplement foutus dehors des écoles à coup de pieds au cul. Un exemple à suivre! * Pour nous il est clair que les prolétaires n'ont pas de patrie. Et si nous reprenons ici les termes «latinos» ou «chicanos» c'est uniquement pour ne pas alourdir le texte en répètant systématiquement qu'il s'agit de prolétaires originaires du Mexique, de Porto Rico, ou d'ailleurs. |
Comme déjà dénoncé dans la première partie de ce texte «A propos des luttes prolétariennes en Argentine», paru dans Communisme N°54, toutes les théories dominantes à ce sujet ont concentré leur force pour nous présenter le mouvement prolétarien comme divisé en composantes sociologiques: le lumpenprolétariat, la «classe moyenne», les étudiants, les ouvriers, les épargnants, les assemblées de quartiers Une manière exemplaire de préparer le terrain pour que le prolétariat reste en dehors de l'histoire et pouvoir ainsi liquider le sujet de la révolution et son projet révolutionnaire. Un terrain parfait pour alors parler de «nationalisations», de «privatisations», d'assemblées constituantes, de gestions et d'autogestions, d'actions civiques et pacifiques, de plans pour les épargnants, de changements gouvernementaux ou syndicaux, d'économie alternative et autres inventions locales... Si la lutte n'est pas une lutte du prolétariat contre le capital, parler de révolution sociale n'a plus aucun sens.
On réécrit donc l'histoire et on prétend que les piquets, les «saqueos» et les violentes luttes contre les appareils de la bourgeoisie sont l'uvre désespérée du «lumpenprolétariat», de «marginaux», de «chômeurs», on attribue le mouvement contre le corralito, les cacerolazos, voire les assemblées unitaires qui se développèrent dans la Capitale Fédérale 1 , à l'action des «classes moyennes» ou de la «petite bourgeoisie». Et même les «ouvriers» des usines occupées se sont vus marginalisés, grâce à une théorie fumeuse, prétendant qu'ils auraient été noyés dans une révolte interclassiste.
En guise de lumineux exemple, nous reproduisons un texte de l'autoproclamé «Courant Communiste Internationaliste» 2 qui, comme vous pourrez le constater dans le texte mis en évidence plus bas, illustre parfaitement cette manipulation idéologique bourgeoise.
«Dans les mobilisations sociales qui ont eu lieu en Argentine, nous pouvons distinguer trois composantes:
Premièrement, les assauts contre les supermarchés menés essentiellement par des marginaux, la population lumpenisée ainsi que par les jeunes chômeurs.
Ces mouvements ont été férocement réprimés par la police, les vigiles privés et les commerçants eux-mêmes. (...)
La seconde composante a été «le mouvement des cacerolas (casseroles)».
Cette composante a été essentiellement incarnée par les «classes moyennes», exaspérées par le mauvais coup porté par la séquestration et la dévaluation de leur épargne, ce qu'on appelle corralito. La situation de ces couches est désespérée: «Chez nous, la pauvreté s'allie à un chômage élevé; à cette pauvreté s'ajoutent les 'nouveaux pauvres' qui y tombent, anciens membres de la classe moyenne, à cause d'une mobilité sociale déclinante, à l'inverse de l'émigration argentine florissante des débuts du 20ème siècle.» Les employés du secteur public, les retraités, certains secteurs du prolétariat industriel reçoivent, comme la petite bourgeoisie, le coup de poignard que constitue le corralito: leurs maigres économies, acquises grâce à l'effort de toute une vie, se trouvent pratiquement réduites à néant; ces compléments à des pensions de misère, se sont volatilisés. Cependant, aucune de ces caractéristiques n'apporte un caractère de classe au mouvement des cacerolas, et ce dernier reste une révolte populaire interclassiste, dominée par les prises de positions nationalistes et «ultra-démocratiques».
La troisième composante est formée par toute une série de luttes ouvrières.
Il s'agit notamment des grèves d'enseignants dans la grande majorité des 23 provinces d'Argentine, du mouvement combatif des cheminots au niveau national, de la grève de l'hôpital Ramos Mejias dans la Capitale Fédérale ou de la lutte de l'usine Bruckmann dans le Grand Buenos Aires, au cours de laquelle ont eu lieu des affrontements tant avec la police en uniforme qu'avec la police syndicale, de la lutte des employés de banque, de nombreuses mobilisations de chômeurs qui, depuis deux ans, ont fait des marches à travers le pays tout entier (les fameux piqueteros).
Les révolutionnaires ne peuvent évidemment que saluer l'énorme combativité dont a fait preuve la classe ouvrière en Argentine. Mais, comme nous l'avons toujours affirmé, la combativité, aussi forte soit-elle, n'est pas le seul et principal critère permettant d'avoir une vision claire du rapport de forces entre les deux classes fondamentales de la société: la bourgeoisie et le prolétariat. La première question a laquelle nous devons répondre est la suivante: ces luttes ouvrières qui ont explosé aux quatre coins du pays et dans de nombreux secteurs, se sont-elles inscrites dans une dynamique pouvant déboucher sur un mouvement uni de toute la classe ouvrière, un mouvement massif capable de briser les contre-feux mis en place par la bourgeoisie (notamment ses forces d'opposition démocratiques et ses syndicats)? A cette question, la réalité des faits nous oblige à répondre clairement: non. (...) Et c'est justement parce que ces grèves ouvrières sont restées éparpillées, et n'ont pu déboucher sur un gigantesque mouvement unifié de toute la classe ouvrière que le prolétariat en Argentine n'a pas été en mesure de se porter à la tête du mouvement de protestation sociale et d'entraîner dans son sillage, derrière ses propres méthodes de lutte, l'ensemble des couches non-exploiteuses. Au contraire, du fait de son incapacité à se porter aux avant-postes du mouvement, ses luttes ont été noyées, diluées et polluées par la révolte sans perspective des autres couches sociales qui, bien qu'elles soient elles-mêmes victimes de l'effondrement de l'économie argentine, n'ont aucun avenir historique. (...)
Contrairement à sa vision photographique et empiriste, ce n'est pas le prolétariat qui a entraîné les étudiants, les jeunes, des parties importantes de la petite bourgeoisie, mais c'est précisément l'inverse. C'est la révolte désespérée, confuse et chaotique d'un ensemble de couches populaires qui a submergé et dilué la classe ouvrière. Un examen sommaire des prises de position, des revendications et du type de mobilisation des assemblées populaires de quartier qui ont proliféré dans le Grand Buenos Aires et se sont étendues à tout le pays, le montre dans toute sa crudité. Que demande l'appel à manifester du cacerolazo mondial des 2 et 3 février 2002, appel qui a trouvé un écho auprès de vastes secteurs politisés, dans plus de vingt villes de quatre continents? Ceci: «Cacerolazo global, nous sommes tous l'Argentine, tout le monde dans la rue, à New York, Porto Alegre, Barcelone, Toronto, Montréal - (ajoute ta ville et ton pays). Que tous s'en aillent! FMI, Banque mondiale, Alca, multinationales voleuses, gouvernements/politiques corrompus! Qu'il n'en reste pas un! Vive l'assemblée populaire! Debout le peuple argentin!» Ce «programme», malgré toute la colère qu'il exprime contre «les politiques», est celui que ces derniers défendent tous les jours, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, car les gouvernements «ultra-libéraux» eux-mêmes savent porter des coups «critiques» à l'ultra-libéralisme, aux multinationales, à la corruption, etc.
D'autre part, ce mouvement de protestation «populaire» a été très fortement marqué par le nationalisme le plus extrême et réactionnaire. (...)
Du fait de son caractère interclassiste, ce mouvement populaire et sans perspective ne pouvait rien faire d'autre que de préconiser les mêmes solutions réactionnaires qui ont conduit à la situation tragique dans laquelle a plongé la population, et dont les partis politiques, les syndicats, l'Église, etc.- c'est-à-dire les forces capitalistes contre lequel ce mouvement voulait lutter - ont la bouche pleine. Mais cette aspiration à la répétition de la situation antérieure, cette recherche de la poésie du passé est une confirmation très éloquente de son caractère de révolte sociale impuissante et sans avenir. (...)
L'Argentine montre avec clarté ce danger potentiel: la paralysie générale de l'économie et les convulsions importantes de l'appareil politique bourgeois n'ont pas été utilisées par le prolétariat pour s'ériger en tant que force sociale autonome, pour lutter pour ses propres objectifs et gagner à travers cela les autres couches de la société. Submergé par un mouvement interclassiste, typique de la décomposition de la société bourgeoise, le prolétariat s'est trouvé entraîné dans une révolte stérile et sans avenir.»
Et comme toujours, la «démonstration» du CCI 3 consiste en une énumération sociologique de différentes composantes de la société bourgeoise, où les différents types de protestations se voient idéologiquement séparés (niant ainsi leur unité pratique et le processus d'unification réelle qui s'est produit dans la lutte autour des secteurs les plus combatifs du prolétariat), et qui aboutit à la dénonciation de tout ce que le mouvement pourrait contenir d'idéologies bourgeoises et en priorité du nationalisme. Auraient-ils déjà vus, ces distributeurs de bons points, une «révolution prolétarienne» exempte d'idéologies bourgeoises, d'idéologies nationalistes?! L'idéalisation d'une classe ouvrière pure (sans lumpenprolétariat, ni ouvriers des pays périphériques, ni pilleurs), l'idéalisation de l'autonomie prolétarienne (comprise non pas comme un processus qui s'affirme dans la lutte, mais comme un «devoir être») et d'une révolution prolétarienne sans idéologie bourgeoise, les amènent à non seulement nier idéologiquement le mouvement réel d'affirmation du prolétariat, mais contribue à la désorientation et à la division du prolétariat. Et en totale cohérence avec une telle conception, le CCI termine dès lors par cette docte conclusion, digne de Plekhanov («il n'avait qu'à ne pas prendre les armes»): cette révolte est «stérile et sans avenir»!
On ne peut trouver d'opposition plus évidente (tant au niveau local que national ou international) que celle qui existe entre, d'une part, toutes les idéologies et forces qui divisent le prolétariat idéologiquement et pratiquement et, d'autre part, l'action réelle du prolétariat tendant à s'affirmer comme classe et comme parti.
Comme nous l'avions déjà signalé dans la première partie de l'article (Communisme N°54), c'est précisément dans l'action directe que le prolétariat s'est unifié (en occupant la rue, par les assemblées, les piquets, les saqueos, les escraches, en s'attaquant aux centres de répression et aux centres économiques du système), en dépassant les divisions et en prônant la participation de tous dans la lutte: ouvriers et employés, travailleurs et chômeurs, enfants, jeunes et vieux, habitants des campagnes, des villes, des quartiers ou des «villas miserias»4 . Et nous le réaffirmons encore, c'est dans sa pratique que le prolétariat a dépassé les revendications catégorielles, a remis de plus en plus en question les syndicats et les partis et, parallèlement à cela, a cherché à s'organiser en assemblées territoriales, ce qui exprime toujours un saut de qualité dans le mouvement (voir à ce propos «Auto-organisation de la classe: piquets et assemblées», Communisme N°54, pp. 9 à 17, ainsi que le tableau reproduisant la thèse N°15). Dans ce processus, le prolétariat s'est affirmé comme classe en occupant la rue, en attaquant la propriété privée qui les affame, et les appareils d'Etat qui la protègent.
Précisons encore que les travailleurs qui ont occupé et occupent toujours des usines (en 2003, plus de 100 entreprises étaient toujours occupées) ont eu la lucidité de saisir le saut de qualité existant entre l'usine et la rue, les piquets d'usines et le blocage des routes, les assemblées d'usines et les assemblées territoriales. En guise d'exemple, citons les prolétaires de la Cerámica Zanon qui, depuis 1996-97, passent des piquets d'usines aux blocages de routes pour s'opposer à la distribution des marchandises et tendent à s'unifier aux piquets et assemblées d'autres franges du prolétariat (en particulier le Mouvement des Travailleurs de Neuquèn). Le même phénomène a pu être observé dans la Capitale Fédérale avec les travailleurs en lutte de l'usine Brukmann qui, par leur participation aux assemblées de quartiers, ont favorisé une plus grande unification avec d'autres secteurs du prolétariat, pour pouvoir résister et affronter ensemble les violentes tentatives d'expulsion des forces répressives. L'énorme pression idéologique visant à les enfermer dans le gestionnisme voir texte antérieur- rendra difficile sans doute le maintien à long terme de cette position conquise dans la lutte mais cela n'empêchera pas les prolétaires des usines occupées de devenir des éléments dynamisateurs dans les assemblées de quartiers, les manifestations, les escraches : ce sont précisément ces usines occupées qui, bien souvent, vont servir de lieux de réunion.
Toutes les idéologies bourgeoises vont s'efforcer de minimiser, de falsifier, de nier, ce processus d'unification évoquant une espèce d'unité interclassiste, allant même jusqu'à parler de conciliation entre petite bourgeoisie et prolétariat. Tout cela pour nier le fait que, dans la pratique, il ne s'agissait pas d'une manifestation pacifique, citoyenne, démocratique, politiciste, comme le souhaitaient ardemment tous les secteurs partisans de cette conciliation, de cette canalisation, tous les organisateurs de manifestations civiques, mais, qu'au contraire, les secteurs décisifs du prolétariat, déjà présents dans la rue, avaient réussi à entraîner le mouvement vers un débordement de tous les appareils d'Etat. Ni les mots d'ordre appelant à la modération, ni les cacerolazos pacifiques dont les médias ont fait la propagande, ni les piquets refusant «le blocage total des routes et les cagoules», ni les marches moutonnières organisées par les partis et les syndicats, n'ont été les déterminants du mouvement. C'est, à l'inverse, le mouvement lui-même qui, jaillissant des quartiers, des piquets en faveur «d'un blocage total», des escraches, des assemblées, des grèves et occupations d'usines, a mis à l'avant-garde ce saut de qualité, par l'occupation de plus en plus massive et organisée des rues, par l'associationnisme prolétarien et avec des mots d'ordre de plus en plus généraux contre toutes les structures de l'Etat.
Et tandis que le prolétariat dans ce processus de lutte et d'affirmation classiste, générait lui-même une critique à nombre de ses propres mots d'ordre et que, parallèlement, des militants d'avant-garde dénonçaient le nationalisme, le démocratisme, le gestionnisme et/ou le politicisme, autrement dit, un ensemble d'idéologies et de drapeaux contre-révolutionnaires présents dans le mouvement (ce qui constitue l'une des invariances historiques de tout grand mouvement prolétarien), tous les appareils nationaux et internationaux de diffusion et de contrôle de l'information, de gauche comme de droite, assénaient leur propagande et mettaient l'accent sur les idéologies nationalistes, gestionnistes, politicistes, Tout fut ainsi mis en uvre contre l'unification du prolétariat en Argentine et dans le monde: diffusion de chants nationalistes et péronistes, bastonnades et pressions, attaque armée, froidement planifiée par les appareils centraux de l'Etat à l'encontre des secteurs les plus organisés des piqueteros, soutien des positions gestionnistes de tel ou tel groupe piquetero en voyage à travers l'Europe pour fortifier les discours du fameux sous-commandant Marcos, projets et approbations de lois répressives, en particulier contre les piquets et les escraches, redorage du blason de l'alternative démocratico-électorale, propagande en faveur des groupes argentins les plus gestionnistes, commise par d'immondes réformistes connus de longue date tel Tony Negri, tentative pour rendre crédible le nouveau président argentin, en le présentant comme un gauchiste anti-impérialiste, publicité pour un cacerolisme pacifiste, pour des piquets non-violents, voire même des piquets refusant de couper le trafic, volonté de mettre en opposition les piquets d'un côté et les cacerolazos de l'autre, les quartiers entre eux, allant même jusqu'à s'évertuer à vouloir opposer les piqueteros entre eux. La bourgeoisie, d'où qu'elle soit, n'aspire qu'à une seule chose: dormir tranquille. Pour elle, les prolétaires du monde entier n'existent pas, ils n'agissent pas en tant que tels et ne doivent pas être informés des actions de leurs frères de classe. Pour elle encore, seule compte l'opinion publique, qui doit rabâcher, à n'en plus finir, qu'en Argentine il n'y a eu qu'une lutte interclassiste, petite-bourgeoise, lumpenisée mais oui, vous savez bien, ces fameux désespérés de la faim de ce qu'on appelle le «tiers-monde».
Et comme ce fut le cas pour d'autres luttes révolutionnaires, ainsi s'établit un véritable cordon sanitaire, isolant le prolétariat, qui vit et lutte dans ce pays. Le conseil adressé alors aux «véritables prolétaires» ne peut être plus clair: surtout ne pas participer à la lutte, surtout ne pas se laisser entraîner par les couches lumpenisées qui en appellent à l'action directe. Et s'il était encore nécessaire d'enfoncer le clou, non seulement il y a les dizaines de morts, fruit du terrorisme d'Etat, mais aussi la position présentant le mouvement comme «stérile et sans avenir», comme aime à le répéter la contre-révolution.
Ou, toujours dans le même objectif, liquidateur et source de confusion, on assimile dans un même mouvement ce qui, en réalité, est totalement opposé: la lutte prolétarienne et les forces de l'Etat, la lutte des piquets et la gestion capitaliste de l'Etat.
Certains vont prétendre que nous exagérons, qu'il est vraiment grossier d'assimiler les prolétaires en lutte, paralysant la reproduction du capital, avec les gestionnaires de cette reproduction du capital au service de l'Etat («les piqueteros argentins et le brésilien Lula»), et ajouteront que seul un Pinochet ou un Reagan (pour qui tout le monde est terroriste et/ou communiste) peut être capable d'un amalgame à ce point absurde et brutal. Et cependant, une personnalité de gauche aussi connue que Tony Negri, n'hésite pas à le faire allègrement et sans vergogne, au nom de son propre simplisme réformiste, qui réduit tout en une opposition entre le multiple et l'unilatéral, comme le démontre la perle de la bourgeoisie suivante:
| Perle de la bourgeoisie
«Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années en Amérique Latine. Je sais seulement que ce continent est en train de développer son activité dans une sorte de laboratoire extrême et efficace. Quoi qu'il en soit, et aussi subjectivement qu'on puisse le penser, la distance qui existe entre les piqueteros argentins et le brésilien Lula s'avère être minime: le laboratoire d'Amérique Latine se dresse de manière efficace contre l'unilatéralisme du capitalisme nord-américain global». «La révolte des piqueteros» - Tony Negri |
Ce mélange de méthodes directement répressives et de manuvres idéologiques liquidatrices du mouvement, acquiert une puissance toute particulière lorsque la terreur de l'Etat se combine aux idéologies qui soutiennent que les morts et les blessés de la lutte de classe auraient été causés par des luttes intestines entre lumpenprolétaires qui se seraient entre-déchirés.
La clé de voûte de toute cette construction bourgeoise est sans aucun doute la disqualification de l'action révolutionnaire du prolétariat, qui, en opposition ouverte avec la société marchande, généralisa les expropriations, la récupération de ce dont il avait besoin immédiatement pour sa survie. Ces actions sont ensuite transformées, métamorphosées, réduites à ne représenter que des actes primitifs, perpétrés par des marginaux et par le lumpenprolétariat, s'attaquant véritablement à n'importe quoi et sans aucun critère. Opérons un bref retour sur ce qu'en dit le CCI: «(...) les assauts contre les supermarchés menés essentiellement par des marginaux, la population lumpenisée ainsi que par les jeunes chômeurs... Dans de nombreux cas, ils ont dégénéré en cambriolages d'habitations dans les quartiers pauvres ou en saccages de bureaux, de magasins, etc. La principale conséquence de cette 'première composante' du mouvement social, est qu'elle a conduit à de tragiques affrontements entre les travailleurs eux-mêmes comme l'illustre l'affrontement sanglant entre les piqueteros qui voulaient emporter des aliments et les employés du Marché central de Buenos Aires le 11 janvier.
Pour le CCI, les manifestations de violence au sein de la classe ouvrière (qui sont ici une illustration des méthodes propres aux couches lumpénisées du prolétariat) ne sont nullement une expression de sa force, mais au contraire de sa faiblesse. Ces affrontements violents entre différentes parties de la classe ouvrière constituent évidemment une entrave à son unité et à sa solidarité et ne peuvent que servir les intérêts de la classe dominante».
Nous pourrions rétorquer que lors de tout processus d'attaques sociales à la propriété privée, il y a de la violence, que dans tous les cas historiques où le prolétariat a donné ce saut de qualité dans lequel s'affirment ses intérêts contre la loi de la valeur et le taux de profit, il a dû affronter les défenseurs de la propriété privée, et que ces défenseurs (police ou milices privées), ont été recrutés au sein du prolétariat par la bourgeoisie. On pourrait dire qu'en ce sens, tout processus de remise en question de l'ordre bourgeois implique des niveaux de violence entre, d'une part, ceux qui sont en faveur de la révolution et, d'autre part, ceux qui défendent l'ordre établi, que dans tous les cas, la majorité de ceux qui subissent cette violence est issue du prolétariat (il n'existe malheureusement pas d'exemple de mouvement s'attaquant exclusivement aux généraux, bourgeois, politiciens tandis que ces derniers recrutent toujours leurs corps de police ou paramilitaires parmi les prolétaires). On pourrait encore ajouter que dans tout processus révolutionnaire, la social-démocratie utilise cet argument de la «non-violence entre ouvriers» pour défendre l'ordre social et, par exemple, défendre les décisions démocratiques des ouvriers (comme cela s'est produit lors de la révolution russe, qui a impliqué une rupture violente au sein de toutes les structures formelles des ouvriers, tant dans les soviets, que dans les partis soi-disant ouvriers). Mais s'engouffrer dans une telle brèche, nous amènerait à régresser à un niveau que la vague de lutte en Argentine a dépassé, et ce depuis le début. Comme nous l'écrivions dans la première partie de ce texte: «Evidemment, il y eut des affrontements entre les pilleurs et certains commerçants, ce dont les médias bourgeois de propagande se sont emparés pour dénigrer le mouvement prolétarien en disant qu'il y avait des pillages entre quartiers. Cependant, ce problème que nous analysions lors des 'saqueos' de 1989 en Argentine est dépassé par la lutte actuelle. Dans l'article publié alors 5 , nous disions: 'C'est à ce moment-là qu'est montée une véritable opération de contre-information partout circulent des rumeurs, rapidement intégrées par les 'pilleurs', comme quoi tel quartier se prépare à attaquer tel autre et qu'il faut se défendre, etc., et aussi incroyable que cela puisse paraître, ce mensonge est pris au sérieux par une grande partie des protagonistes de ces événements'. A la fin de l'année 2001 et au début 2002, les fossoyeurs de la réalité ressortent leur vieille histoire, mais cette fois les prolétaires ne tomberont pas dans le panneau. Plusieurs journalistes sont 'escrachés' par le mouvement. Ni ces agents constitutifs de l'Etat, ni les politiciens, ni les bourreaux, ni les entrepreneurs ne peuvent sortir de chez eux sans escorte. Une terreur froide les envahit, le fantôme de ceux qu'ils croyaient morts et enterrés leur crache au visage».
Le fait qu'un groupe prétendant parler au nom de la révolution prolétarienne, rabâche cette thèse de l'affrontement entre personnes issues du lumpenprolétariat, définit parfaitement de quel côté de la barricade il se situe (au-delà de l'ignorance pédante que peut refléter le fait que ceux qui produisent de telles élucubrations se positionnent explicitement en tant que spectateur extérieur et méprisant). Et c'est pire encore si l'on tient compte du fait que cette fameuse thèse est l'argument par excellence de la répression, utilisé depuis toujours par les appareils d'oppression de l'Etat, lorsqu'il leur faut se justifier publiquement.
Il nous est facile de le vérifier au regard, par exemple, du formidable coup répressif opéré à l'encontre du mouvement piquetero, le 26 juin 2002: deux camarades assassinés, plus d'une trentaine de blessés par armes de guerre, des centaines de camarades torturés Ce jour-là, les forces de police et les forces paramilitaires de la bourgeoisie ont tiré, tué, exécuté sélectivement les militants organisateurs du mouvement piquetero, comme le démontre formellement et indiscutablement le livre du MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados) Anibal Verón «Darío y Maxi, dignitad piquetera», qui a pour sous-titre: «El gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda».
Voici ce qu'on peut y lire: «En ce qui concerne le coup de feu sur Darío (Santillán), il n'y a rien d'autre à comprendre si ce n'est qu'ils ont cherché à le tuer. En plus des coups de feu tirés dans tout Avellaneda, ils sont entrés dans la gare [où Darío fut fusillé dans le dos NDR] avec comme objectif de s'assurer qu'en ressortiraient des piqueteros morts, et de pouvoir expliquer ensuite 'qu'ils s'étaient entre-tués'. Exactement les mêmes paroles qui, sans aucune concertation, ont commencé à retentir, à ce moment même, dans les dépêches en provenance de la Maison du Gouvernement (page 66)».
Comme le souligne ce livre, les appareils centraux de l'Etat avaient minutieusement préparé la répression, ainsi que sa parfaite «justification», en prétendant que des piqueteros s'étaient entre-tués. Le 18 juin, quelques jours à peine avant les événements, une réunion présidée par Atanasof, chef du cabinet de Duhalde, est décrite comme suit par les journalistes: «Le gouvernement national, la justice et les forces de sécurité ont aujourd'hui avancé dans la définition des directives à respecter par les juges, les magistrats et les corps répressifs, en vue de prévenir et de disperser toute protestation, comme celles des piquets ou toute autre action visant à interrompre le trafic des voies stratégiques, ont informé les sources officielles Durant ces rencontres, on a débattu de l'attitude de la Gendarmerie Nationale, de la Préfecture Navale et de la Police Fédérale, ainsi que de la couverture judiciaire de leurs actes par les juges et magistrats fédéraux lors des prochaines actions des piqueteros, qui préoccupent tant le gouvernement. Les conclusions doivent être arrêtées avant ce jeudi, journée choisie par les groupes de piqueteros pour interrompre le trafic des accès stratégiques de la Capitale Fédérale, encerclant virtuellement la métropole» (Agence Infosic).
Et Atanasof, président officiel de cette mémorable réunion, où se prépare ouvertement l'action répressive par la coordination de toutes les forces de répression (le 26 juin sera le jour de la première action réellement centralisée de toutes les forces de répression de la Capitale Fédérale et de la périphérie 6 ), va dicter aux juges et magistrats les décisions à prendre (exemplaire démonstration, si c'était encore nécessaire, de la réalité de la célèbre, idyllique, et si démocratique «division des pouvoirs»!), leur imposant même de donner une couverture aux forces répressives. Et c'est ce même Atanasof qui, sans aucun scrupule, le jour d'après, tiendra une conférence de presse, dans laquelle il va soutenir, par avance, la thèse macabre certifiant que ce sont des pauvres qui s'affrontent entre eux. Il poursuivra ensuite en expliquant que «les réunions tenues entre les fonctionnaires et les forces de sécurité ont pour but d'établir un mécanisme de coordination qui nous permette de protéger le droit des personnes à se déplacer (c'est comme pour le droit au travail et autres droits démocratiques, à chaque fois qu'on les applique, le résultat est le terrorisme contre le prolétariat -NDR) (page 84)» et insistera sur le fait qu'il faut «privilégier le droit de circuler plus que n'importe quel autre droit humain» (ce ne doit certainement pas relever du hasard si, tout à coup, alors que se déroule le mouvement piquetero en Argentine, ce «droit humain»-là devient le droit le plus important!) et expliquera encore que «dans le chaos, seul gagne le chaos», pour enfin terminer sa déclaration, en affirmant à propos des événements, qu'il s'agit «d'une sorte de guerre des uns contre les autres».
Et il est vrai que, des exécutants directs aux hautes sphères du gouvernement, tous vont reprendre en chur cette interprétation des massacres: le lumpenprolétariat s'entre-tue, c'est la «guerre de tous contre tous». Le Commissaire Fanchiotti, à la tête des opérations répressives, va confirmer cette thèse, en mentant ouvertement: «A la gare, où nous ne sommes jamais entrés(...) Nous n'avions sur nous que des gaz et des balles en caoutchouc.». Par la suite, il va donner une explication, avec luxe de détails fantaisistes sur les forces à ses ordres, les présentant comme de véritables brigades volant au secours de la pauvre population terrassée par des malfaiteurs en armes: «les personnes à l'intérieur de la gare nous appelaient au secours. Un groupe assez important était entré et tirait sur un des trains qui passaient. Les gens avec lesquels nous avons pu entrer en contact et établir le dialogue ont dit qu'on avait tiré sur un train, qu'il y avait des coups de feu à l'intérieurIl ne restait que quelques groupes, alors nous avons lancé des gaz. Une fois les gaz à l'intérieur, nous avons dû agir et sommes parvenus à secourir un tas de gens qui nous réclamaient de l'aide: il y avait là des femmes et des enfants, des femmes enceintes, d'autres personnes allongées au sol et nous avons été obligés de les faire sortir par le côté Pavón pour éviter qu'un malheur n'arrive».
Vu ce qu'il nous raconte, il est évident que ni ce salaud, ni ses commanditaires, ni les journalistes qui reproduisirent cette version à n'en plus finir, ne savent alors que toute la scène a été filmée et photographiée dans la gare et que l'on voit Fanchiotti, tirant avec son revolver sur Darío. Mais dès le 27, même le Clarin va publier une photo où l'on reconnaît Maxi et, près de lui, encore debout, le visage assez flou de Darío, et juste à leurs côtés, se distinguent très nettement le Commissaire Fanchiotti et ses subalternes, le caporal Quevedo et les agents Acosta et Colman, pointant leurs armes sur eux (page 93). D'autres photos viendront plus tard confirmer clairement la présence de ces quatre sinistres personnages dans un lieu où ils déclarent n'être jamais entrés et où «s'entre-tuaient des piqueteros», pointant Darío de leurs armes, juste avant que ce dernier ne s'écroule au sol.
Mais avant que ces faits ne soient connus, en tout début d'après-midi, «aucun membre du gouvernement ne voulut répondre aux appels de la presse. Ce n'est qu'après avoir écouté les deux conférences de presse de Fanchiotti et s'être mis d'accord sur la version à donner, qu'il devint inutile d'insister. Dès 16 heures, les membres du cabinet national eux-mêmes téléphonèrent à des journalistes de confiance et aux rédactions des principaux journaux du pays. Tout ce remue-ménage avait pour objectif de renforcer la théorie 'des piqueteros s'entre-tuant', mais cette fois, la version provenait de la bouche même des 'hautes sphères du gouvernement'... Dès la réunion du cabinet, tous s'efforcèrent de transmettre ce message en béton: 'Les balles qui avaient tué les piqueteros provenaient des piqueteros eux-mêmes' comme l'affirma Matzkin. Le gouvernement diffusa donc le même discours que ceux qui avaient pressé sur la gâchette» (page 90 et 91).
C'est de cette manière que le prolétariat protège sa force et sa perspective contre tout type de disqualification et de répression des éléments les plus décidés à s'opposer à la propriété privée. Quoi de plus logique, en effet, dans tout processus d'affirmation révolutionnaire du prolétariat, que ce soient les éléments les plus désespérés par la situation qu'ils subissent sous le capitalisme, qui assument le plus ouvertement les attaques contre la propriété privée. L'opposition générale entre êtres humains et propriété privée, déterminant toute la vie des prolétaires, revêt ses formes les plus antagoniques au sein de couches particulières du prolétariat qui, bien des fois, indiquent le chemin à suivre au reste du prolétariat, assumant avant les autres, ou plus ouvertement, l'action révolutionnaire décidée. La disqualification de ces couches, parce que ce sont celles qui s'attaquent particulièrement à la propriété privée, est sans aucun doute une forme cachée ou ouverte de défense de la propriété privée et de l'Etat.
Une partie importante de ces éléments, que la social-démocratie qualifie de lumpenprolétariat, de bandits, de canailles ou de brigands..., participe de façon décisive à tout grand processus révolutionnaire. Ainsi, l'insurrection d'octobre 1917, en Russie, n'aurait pu être possible sans l'action conspiratrice de certains éléments, que les partisans du gouvernement Kerenski considéraient comme faisant partie du lumpenprolétariat. N'oublions pas non plus que la social-démocratie et la ligne officielle de Moscou ont qualifié de lumpenprolétariat ceux qui, en réalité, constituaient l'avant-garde de la révolution en Allemagne. Max Holz et ses camarades furent épinglés comme lumpen, ainsi que les insurgés de 1918. Même le prolétariat, regroupé autour du Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne (KAPD), fut déprécié par des ouvriers hautement qualifiés et syndicalisés, qui leur reprochaient de n'être, dans une grande majorité, que des ouvriers non qualifiés et des chômeurs. Cette constante se retrouve dans d'autres grands mouvements révolutionnaires, comme au Mexique au début du 20ème siècle, en Espagne dans les années 30, en Hongrie en 1919 et dans l'Argentine des années 1919-1921. Dans tous ces exemples, la social-démocratie, au nom des «ouvriers conscients», a qualifié de lumpenprolétariat, des secteurs qui étaient, en réalité, à la tête du mouvement révolutionnaire.
Il est vrai que Marx et Engels, à l'inverse de Bakounine ou d'autres communistes du passé, n'ont pas eu conscience de la puissance révolutionnaire de ces secteurs du prolétariat, ont souvent fait référence, en terme péjoratif, au «lumpenprolétariat». Mais contrairement à ce qui se passe en Argentine, où ce sont ceux qui s'attaquent à la propriété privée et aux appareils de l'Etat qui se voient ainsi disqualifiés, lorsque Marx fait référence au «lumpenprolétariat» il parle de secteurs mobilisés par le bonapartisme pour la défense de l'Etat et de la propriété privée. Jamais Marx n'a utilisé ce terme pour désigner ceux qui s'attaquent à la propriété privée, ni discréditer ceux qui volent, pillent, attaquent et terrorisent le capital. Au contraire, dans ses travaux, comme dans ceux d'Engels, le prolétariat est toujours défini en opposition générale à la propriété privée et les vols, les pillages, les attaques individuelles (ou collectives) de propriétés et/ou de propriétaires privés sont considérés comme faisant partie de la guerre du prolétariat contre le capital. Et au travers de cette falsification de ce qu'est le lumpenprolétariat, nous pouvons aussi constater de quelle manière s'est constituée la religion d'Etat qu'on appelle «marxisme», et que Marx, à l'époque, dénonçait.
En Argentine, comme nous l'avons dit précédemment, cette théorie sur le lumpenprolétariat, sur les marginaux, n'a pas fonctionné et n'a été utilisée que par les agents directs de l'Etat. En réalité, ce discours n'a pas pu fonctionner pour la bonne et simple raison que la propriété privée, dans son entièreté, est apparue violemment pour ce qu'elle est réellement: source de famine pour des franges toujours plus grandes du prolétariat. Car les grandes masses prolétariennes ont assumé, dans la pratique, des actions contre la propriété privée ou s'en sont senties partie prenante. Et parce que cette lutte a assumé la forme d'un affrontement ouvert contre la propriété privée concentrée, c'est-à-dire les corps de police et les forces paramilitaires de l'Etat capitaliste.
Cependant, cette conception répugnante selon laquelle la partie la plus touchée du prolétariat appartiendrait à une autre classe sociale ou aurait des intérêts différents de ceux du prolétariat, pèse lourdement dans la balance. Bien des fois, la bourgeoisie parvient à isoler et disqualifier certains secteurs, particulièrement en période de paix sociale. C'est ce qui se passe aujourd'hui-même dans bon nombre de pays, où les pillages restent encore marginaux, et ne coïncident ni dans le temps ni dans l'espace, et où la majorité du prolétariat n'assume pas encore ouvertement cette opposition de peur de la répression, à cause des idéologies dominantes (légalisme, religions, illusions), ou à cause du mépris idéologique envers les plus pauvres qu'eux. Parce qu'en dernière instance, la bourgeoisie parvient encore à convaincre la majorité des prolétaires que le système de la propriété privée est l'unique système possible et parce que le très relatif meilleur niveau de vie de ces prolétaires, comparé à ceux qui n'ont rien, permet à ce système de maintenir cette division du prolétariat.
En réalité, dénigrer les pillages et/ou les piquets en Argentine, en les attribuant au lumpenprolétariat, poursuit précisément cet objectif de l'Etat: diviser le prolétariat. Même si, localement, elle n'a pas eu le succès escompté, cette idéologie cherche à isoler les prolétaires en Argentine du reste de leurs frères de classe dans le monde. Pour cette raison, les moyens de désinformation publique ont partout présenté les pillages en Argentine comme un produit particulier, propre à ce pays, comme de simples révoltes de la faim. Ce qui est visé ainsi, c'est que le téléspectateur du monde entier, cet idiot utile, ne se sente en rien concerné par ces problèmes, qu'il ne perçoive en aucun cas que cette «racaille» est en train de se battre contre la société qui l'exploite et l'opprime lui-aussi. Et cela marche du tonnerre: le téléspectateur ne se sent même plus prolétaire, mais consommateur, citoyen et, en tant que tel, il ne peut reconnaître son frère dans cette lointaine lutte; il n'y voit que des désespérés, des gens dépourvus de tout, des marginaux.
Ce qui est également visé, c'est d'éviter toute contagion des prolétaires du reste du monde. Ils ne doivent surtout pas voir dans la révolte en Argentine le chemin à suivre, par la généralisation des méthodes de lutte comme les assemblées, les piquets, les escraches, les pillages, l'occupation de la rue,... Il faut qu'ils considèrent tout cela comme une réminiscence du passé. En 1917 aussi, la social-démocratie d'Europe Occidentale, tel le CCI aujourd'hui et d'autres groupes issus de cette ligne historique, en parfaite cohérence programmatique avec elle, a également nié l'existence d'une lutte prolétarienne en Russie. Tous les événements qui se sont déroulés dans ce pays, ont été vus comme quelque chose appartenant au passé, «fruit du retard typiquement russe» et du peu de poids qu'avait, selon elle, le prolétariat dans ce pays, composé de paysans et de lumpenprolétaires. Ce qui explique la grande frayeur qui s'est emparée d'elle en 1917!
En effet, en falsifiant les événements et en déformant les concepts, on a attribué aux «classes moyennes» la responsabilité des assemblées, des cacerolazos, d'un bon nombre de manifestations violentes, et même le rôle principal dans la rue durant ces journées décisives. De plus, à l'inverse de la fable mensongère concernant le lumpen prolétariat, uniquement colportée par les agents de l'Etat, la bourgeoisie est parvenue à ce que cette théorie soit répétée et propagée par le mouvement lui-même, y compris en Argentine. Ainsi, il s'est trouvé des piqueteros faisant partie des assemblées les plus combatives, telle que la Coordinadora Anibal Verón, allant jusqu'à soutenir que les manifestations du 19 décembre était l'uvre des classes moyennes, à laquelle ils se seraient pliés, à contrecur.
Comment la bourgeoisie est-elle parvenue à convaincre les piqueteros, ou les quelques ouvriers d'usines qui existent encore en Argentine, que la composition des assemblées de la Capitale Fédérale était petite-bourgeoise? Comment est-il possible qu'une ville entière soit composée de petits-bourgeois?
Il est encore plus difficile de comprendre un tel miracle si nous prenons comme exemple la composition-type d'une assemblée: une dizaine de jeunes des deux sexes qui ne sont jamais parvenus à trouver du travail, trois jeunes à l'emploi précaire, deux étudiants, l'institutrice du quartier, deux chômeurs ex-employés de banque, un autre ex-ouvrier, trois fonctionnaires publics, le boulanger et la boulangère du coin, un livreur de pizzas, deux infirmières, un professeur de philosophie, un autre de mathématique, deux caissières de grand magasin, trois ou quatre vendeuses, un jeune gars avec en poche son diplôme d'avocat tout frais, une femme de ménage, une psychologue, deux soubrettes qui travaillent dans un hôtel, un guitariste, un peintre, un plombier et un tas d'autres personnes qui bossent de temps en temps, selon «ce qui vient»7 .
Seule la puissante phase de terrorisme ouvert de l'Etat, subie par les camarades de ce pays et la rupture historique avec le programme de la révolution, phénomène mondial, peut avoir provoqué une telle inconscience de classe: le prolétaire ne se considère même plus comme prolétaire. Ceci est aujourd'hui valable dans le monde entier et constitue, comme on le voit, le plus grand obstacle à notre propre organisation en classe, en force internationale.
Ce n'est pas ici le lieu pour discuter conceptuellement des termes «petite bourgeoisie» ou «classe moyenne». Nous ne désirons pas non plus convaincre le «milieu» qui s'autoproclame marxiste, en Argentine et ailleurs, de l'absurdité qui consiste à qualifier tout ce monde et même la Capitale Fédérale de «classe moyenne». Nous dirons simplement que la classe qui a le plus intérêt à gonfler réellement ou idéologiquement un ensemble de secteurs sociaux intermédiaires, c'est évidemment la bourgeoisie. Depuis toujours, la contre-révolution a tenu à conférer à la petite bourgeoisie une force qu'elle n'avait ni ne peut avoir. Ainsi, durant le 20ème siècle, quasi tous les événements importants dans le monde ont été attribué à la petite bourgeoisie. On a prétendu que le démocratisme était petit-bourgeois, que le fascisme était un produit des classes moyennes, que la lutte nationaliste était petite-bourgeoise, que le stalinisme était du bureaucratisme petit-bourgeois, que le réformisme était petit-bourgeois, etc. En réalité, la démocratie est l'essence même de la dictature du capital et fascisme, nationalisme, réformisme, stalinisme constituent des formes ou des aspects particuliers de cette dictature. Ils représentent différentes expressions des intérêts de la bourgeoisie et les forces sociales qui y correspondent sont, sans aucune exception, des forces du capital. Mais on a aussi prêté à la petite bourgeoisie l'impatience révolutionnaire, le radicalisme social, la lutte directe et violente, le rejet du parlementarisme et du frontisme, la conspiration, etc. alors qu'il s'agit en général d'expressions de recherche, d'affirmation et de luttes du prolétariat dans son difficile chemin de réaffirmation en tant que force historique. Des phénomènes plus complexes, où bien des fois la bourgeoisie canalise la force prolétarienne et la transforme en lutte inter-bourgeoise, se sont vus catalogués de phénomènes petits-bourgeois. Ainsi, les mouvements guérilleros ont été épinglés en tant que produits de la petite bourgeoisie, alors qu'en de nombreuses occasions, il s'agissait de tentatives prolétariennes de lutte, même si, dans leur majorité, elles ont fini par être récupérées et/ou dirigées par des forces bourgeoises et conduites vers le militarisme (appareil contre appareil), le nationalisme et le réformisme armé. Cette occultation sert à cacher la contradiction réelle entre la lutte prolétarienne et son encadrement et sa liquidation par les forces bourgeoises populistes, nationalistes. Plus encore, la majorité des partis «communistes», trotskystes, et nombre de ceux qui s'auto-désignent libertaires... ont théorisé qu'en général la violence minoritaire, le terrorisme contre les propriétaires privés serait un produit de l'»impatience» de la petite bourgeoisie. Comme si, en plus de tout, le prolétariat devrait être patient!
Dans tous ces cas, la petite bourgeoisie est gonflée artificiellement et on lui attribue une force sociale qu'elle n'a ni ne peut avoir. En effet, la petite bourgeoisie, parce qu'elle n'a pas de projet social propre, n'est capable d'engendrer que de mouvements partiaux et oscillants entre les deux classes antagoniques déterminantes qui, pour cette raison même, se révèlent être peu importants. Dans les périodes où le prolétariat vise à transformer une crise sociale ouverte en crise révolutionnaire, ces mouvements se brisent et les secteurs prolétarisés par la crise tendent à s'aligner du côté du prolétariat révolutionnaire et à participer à ce mouvement, tandis que d'autres secteurs, effrayés par la révolution, ont tendance à s'aligner sur la réaction. En dehors de ces moments, les fameuses «couches moyennes» jouent un rôle de tampon intermédiaire qui sert de protection au capital, tout comme lui sert de protection, l'idéologie qui vise à gonfler le rôle de ces couches et réduit le prolétariat à l'ouvrier industriel. Mais dans un cas comme dans l'autre, que ce soit pour assurer la paix sociale ou pour affronter le prolétariat insurgé, ce qui a le plus de poids et sert le plus au capital, ce ne sont pas ces si «télé-visiblement» fameux petits-bourgeois, mais bien ce que pensent et font les «prolétaires», dominés par les idées de leurs exploiteurs. Ainsi, ce n'est pas grâce aux idées de la petite bourgeoisie que la démocratie avance ou que s'impose un vote démocratique contre l'action décidée de minorités prolétariennes (dans les assemblées, soviets, usines occupées, shoras, conseils, etc.), c'est grâce au fait que la démocratie de la société marchande parvient à se réimposer et que, par conséquent, l'idéologie bourgeoise de la démocratie domine «les prolétaires». La démocratie n'est pas seulement une idéologie ou une simple mystification bourgeoise pour les prolétaires. Elle est reproduite dans les rapports sociaux capitalistes elles-mêmes: ce substitut, ou si l'on veut, ce consolateur de communauté qu'est la démocratie 8 , continuera à séparer tout en unifiant fictivement, jusqu'à ce que la lutte prolétarienne fasse éclater les relations marchandes qui lui donnent vie. L'essentiel n'est pas la question de la petite bourgeoisie, mais le rapport de force: la reproduction du capital et sa négation révolutionnaire. C'est pour cela qu'il est absurde de parler de trois, quatre ou cinq classes, alors qu'en dernière instance, les projets viables ne sont que deux: le capitalisme et le communisme.
La gigantesque inflation idéologique autour du mythe de la petite bourgeoisie cherche précisément à cacher cette opposition générale. La bourgeoisie s'en sert, non seulement pour diviser et leurrer le prolétariat quant à ses forces, mais aussi pour dénaturer sa recherche d'une issue révolutionnaire, son programme historique.
La théorie des classes moyennes (comme celle qui prétend que marginaux et lumpenprolétariat forment une autre classe ou oscillent entre les classes) provient, au fond, des intellectuels bourgeois (universités, partis politiques de droite comme de gauche, syndicats) et est martelée à n'en plus finir au prolétariat (tous les médias utilisent cette théorie comme un fait advenu). C'est à cela que sert la fameuse théorie kautskyste/léniniste de l'idéologie apportée de l'extérieur au prolétariat par des intellectuels bourgeois. Aujourd'hui encore, ces mêmes intellectuels bourgeois arrivent de l'extérieur, et lui disent : «Tu n'existes plus en tant que classe, ta classe a de moins en moins d'importance». Partout dans le monde, des livres sont écrits en guise «d'adieu au prolétariat». Et effectivement, si les chômeurs ne sont plus considérés comme des prolétaires, si on prétend que les travailleurs des services sont des petits-bourgeois, si on dit la même chose à propos des enseignants, des petits indépendants des villes, des banlieues et des campagnes (qui, dans leur grande majorité, sont des salariés, à peine dissimulés), de la caissière du supermarché ou de la vendeuse de magasin, alors toutes les théories sur la disparition du prolétariat seraient réelles en Argentine, puisque, tout le monde le sait, les travailleurs du secteur industriel sont de moins en moins nombreux. Mais la même chose peut également être soutenue dans tous les pays du monde, car, depuis des décennies, on constate une augmentation relative du fameux secteur des services face au secteur industriel (ce phénomène s'est d'abord produit dans les pays du continent américain, avant d'arriver dans les pays européens, à cause de la vétusté d'une industrie qui n'a pas été détruite, durant ce qu'on appelé la seconde guerre mondiale). Si la relative diminution du nombre de travailleurs industriels par rapport aux travailleurs des services (publics et privés), aux emplois précaires et aux chômeurs réduisait effectivement le prolétariat, la bourgeoisie serait alors parvenue à réaliser son rêve historique: éliminer progressivement son ennemi de toujours, le ramener à son expression minimum et réduire progressivement les contradictions sociales.
Bien que dans la réalité, il y ait plus de travailleurs dans les services (publics et privés) que dans l'industrie, ou plus d'emplois précaires et de chômeurs que jamais dans l'histoire, cela ne diminue en rien les contradictions du capital. Bien au contraire, elles n'en sont toutes que plus aiguisées (car cela traduit aussi une violente manifestation des difficultés du capital dans sa folle course à la valorisation) et il est logique que la théorie de la diminution du prolétariat continue à prospérer puisqu'elle constitue la clé de la domination bourgeoise, tout comme il est logique qu'elle continue à constituer la quintessence de toutes les sciences sociales bourgeoises.
Rien de plus logique dès lors que d' «expliquer» ce qui s'est passé en Argentine en fonction de classes moyennes et du lumpenprolétariat : cela permet d'affirmer la théorie de la disparition historique du prolétariat. Et il est tout aussi logique que nous, prolétaires, recevions cette négation idéologique comme une agression, une répression de notre être et que nous la replacions dans le cadre historique qui lui correspond, à savoir, avec l'ensemble des idéologies qui, depuis toujours, théorisent que le capitalisme conduit à une société de moins en moins contradictoire, de moins en moins antagonique. C'est bien là la vieille théorie de la suppression progressive des contradictions mortelles du capitalisme, qu'on appelle aujourd'hui post-moderne et qui théorise la fin de l'histoire. En réalité, il s'agit du manifeste historique de la bourgeoisie en pleine catastrophe sociale.
Mais malheureusement, nous ne pouvons pas prétendre qu'en tant qu'idéologie, cette théorie ne fonctionne pas. Dans des périodes de paix sociale, elle marche à merveille (toutes les théories bourgeoises et en particulier les sciences sociales, tirent leurs conclusions théoriques, en toute logique, de l'idéalisation de ces moments): le prolétariat ne manifeste pas sa force en tant que classe, tout semble co-exister paisiblement sur l'air du «chacun se démerde comme il peut», et les protestations de chaque catégorie sociale sont totalement séparées les unes des autres. La théorie du prolétariat part (en toute logique) non du monde idéal de la conciliation des classes, mais de la rupture sociale et plus précisément de la révolution communiste, du processus de destruction totale de cette société, contenu en elle. C'est pour cela que le prolétariat ne se reconnaît pas dans telle ou telle catégorie sociale (les révolutionnaires n'ont aucun intérêt à faire de l'économie ou de la sociologie, leur intérêt se situe dans la destruction de l'économie et de la société bourgeoise), ni dans l'une ou l'autre couche de travailleurs; il se reconnaît en tant que classe 9 , dans sa contradiction avec le monde marchand, dans sa lutte, dans sa constitution en force. Les classes ne se définissent pas en soi, sociologiquement, pour agir ensuite; elles se définissent dans leur pratique, dans leur opposition, dans la lutte.
Nous ne voyons aucun intérêt à expliquer ici pourquoi la maîtresse d'école, le boulanger du coin, l' étudiant, le chômeur, l'employé de la banque, la caissière de supermarché, l' «exclus», la femme de ménage,... sont des prolétaires (ils ne le sont d'ailleurs pas en soi, mais dans leur opposition à la propriété privée -ils sont privés de la propriété des moyens de production- qui les pousse à s'associer et à lutter contre l'ordre établi). Au risque de nous répéter une fois de plus, reprécisons que les communistes ne considèrent pas comme prolétaire, quiconque réalise une activité productive déterminée, à l'image des organisations de la gauche bourgeoise, mais bien celui qui vit privé de la propriété des moyens de production et qui, pour survivre, est contraint de trouver des acheteurs pour sa force de travail ou/et alors, d'exproprier la propriété privée qui le condamne à crever de faim. Nous ne considérons en rien le prolétariat comme une classe sociologique de cette société. C'est, au contraire, la classe qui se constitue elle-même, au fur et à mesure qu'elle assume son opposition vitale à la propriété privée des moyens de production, c'est elle qui développe cet antagonisme jusqu'à se constituer en force sociale destructrice de la société bourgeoise. C'est pourquoi, pendant que les sociologues, les économistes, main dans la main avec les syndicats et les partis du capital, théorisent la disparition progressive de l'antagonisme social et du prolétariat, nous affirmons pour notre part l'intensification de toutes les contradictions du capital et la prolétarisation d'une masse toujours croissante d'êtres humains, entraînés dans un inéluctable processus d'exacerbation de la misère relative. Concrètement, l'augmentation du nombre de chômeurs, du travail précaire, des «emplois poubelles» ou des pseudo-employés financés par le gouvernement ou les Ong, par rapport au nombre de travailleurs considérés comme industriellement rentables, ne diminue pas le nombre de prolétaires, mais met plutôt en évidence l'absurdité du monde du travail, le fait que ce système social est de plus en plus antagonique aux nécessités humaines. Mais en plus, en Argentine, comme dans bon nombre de pays, l'augmentation de la misère sociale de la masse des exclus met à nu le fait qu'un ensemble de couches sociales, aveuglé par l'illusion de la petite propriété juridique, sont en réalité des prolétaires déguisés, puisque quelle que soit l'illusion dont ils se bercent, leur supposée propriété n'est que formelle. La propriété réelle revient au capital financier et/ou aux grandes sociétés. Ainsi des centaines de milliers de pseudo-commerçants, de pseudo-indépendants de la ville et de la campagne, travaillent en réalité pour un patron ou une société anonyme, même si le rapport salarié est juridiquement caché, pour éviter à la bourgeoisie de payer les cotisations sociales et obliger l'ouvrier à assurer lui-même le maintien de moyens de production et de sa force de travail. Le progrès en Argentine, comme ailleurs, c'est que de plus en plus de patrons ne contractualisent de nouveaux commissionnaires, garçons de café, livreurs de pizzas, etc., que si ceux-ci payent eux-mêmes leurs cotisations en tant qu'indépendants! Il reste à ajouter que les statistiques et la sociologie classent ensuite ces travailleurs comme «les nouvelles classes moyennes urbaines»!
Il est vrai que si nous considérons le mouvement en Argentine tel que le décrivent les médias (et non au travers des éléments de force qui le déterminèrent, comme souligné dans notre article antérieur), nous pouvons constater que se sont côtoyés, dans certaines assemblées ou cacerolazos, autant de bourgeois en déchéance que de petits propriétaires en faillite. Et bien entendu, ces secteurs peuvent influencer le mouvement et ont, de fait, poussé le mouvement dans le sens légaliste, citoyen, démocratique, en visant ainsi à ce qu'il ne rompe pas la légalité bourgeoise, ne s'attaque pas à la propriété privée. Mais la prolétarisation réelle de petits et moyens propriétaires, ainsi que la force de la politique autonome du prolétariat (dans les piquets, les escraches, les pillages,) a fait que bon nombre d'entre eux se sont senti attirés par le mouvement et que la rencontre dans la rue a permis la réaffirmation et la généralisation de l'attaque à la société capitaliste et non la défense de «leur» propriété privée. Il est tout aussi vrai que certains bourgeois et petits-bourgeois ont participé à des cacerolazos, malgré leur dégoût séculaire pour «ces sales nègres qui coupent le trafic», qu'on en a vu se spécialiser dans des cacerolazos pacifiques ou exclusivement organisés par des petits commerçants. Cette conception, qui s'affronte bien entendu à la rupture prolétarienne (comme nous le verrons dans le chapitre suivant), tente d'isoler, d'expulser et de réprimer la généralisation de l'action directe qui, dans la pratique, s'oppose à l'ordre bourgeois. Nous réitérons, à ce propos, ce que nous avons déjà dit dans la première partie du texte, totalement à contre-courant de ce qui se dit habituellement. Le problème ne se situe pas dans la participation de petits-bourgeois au mouvement, il réside dans l'idéologie bourgeoise, drainée par les prolétaires eux-mêmes, dans leur méconnaissance de leur programme de classe. Et nous affirmons (réaffirmons et confirmons), totalement à contre-courant, que les classes moyennes ou petites-bourgeoises n'ont joué aucun rôle décisif dans le mouvement de 2001/2002 en Argentine. Ils ne peuvent d'ailleurs pas le faire! Le cas argentin confirme l'impuissance sociale des classes moyennes et l'irrémédiable tendance à la polarisation mondiale entre défenseurs de l'ordre et prolétariat révolutionnaire.
Le mépris que nous portons à la petite bourgeoisie, quant à sa capacité sociale, ne signifie absolument pas que la mentalité «petite-bourgeoise» (en réalité bourgeoise) n'a eu aucun poids lors de toutes ces manifestations et que le légalisme, le démocratisme, la citoyenneté furent dépassés. Bien au contraire, comme dans tout grand mouvement prolétarien, le nationalisme a revêtu un poids contre-révolutionnaire fort puissant, et le légalisme, le gestionnisme, le politicisme ont été et continuent d'être de puissantes idéologies bourgeoises présentes dans le mouvement. Mais il serait absurde de s'imaginer que l'ouvrier d'usine, ce véritable héros idéal du militant de la gauche bourgeoise (autrement dit, «le prolétaire» selon la définition social-démocrate, staliniste, trotskyste et libertaire), se soit subitement libéré de ces idéologies bourgeoises. Les petits drapeaux argentins et même les maillots de l'équipe nationale de football émaillaient les rues de tous les quartiers, pas seulement celles des quartiers considérés par nos ennemis comme appartenant à la «classe moyenne», mais également celles des quartiers ouvriers, des bidonvilles, des banlieues, des villages et des villes de province. Il en va de même concernant les illusions présentes sur les solutions politiques ou l'économie alternative. Contrairement au mythe de la gauche bourgeoise, l'extraction de classe n'a jamais constitué une garantie politique: les armées et les forces répressives du monde entier sont constituées d'ouvriers soumis au pouvoir central bourgeois. Plus encore, au 20ème siècle, ce sont les ouvriers des grandes usines, parfaitement organisés par l'Etat en syndicats et en partis, qui ont constitué les forces de maintien de l'ordre bourgeois, de défense du travail et de l'économie nationale (comme en Russie, sous le stalinisme, ou sous le fascisme, le nazisme, ou durant la politique des grands travaux aux Etats-Unis ou encore sous le péronisme, le castrisme,), véritables objets de manipulation de l'Etat, contre tout type de protestation. A tel point que, pour obtenir un poste de travail dans une usine, il fallait et faut encore, aujourd'hui, dans de nombreux pays, posséder sa carte de parti ou de syndicat, garantie de notre soumission. Le terrorisme d'Etat, maintenu à grande échelle, essence même de la démocratie, a besoin, pour se développer, de l'adhésion aux discours dominants des grands, moyens et petits-bourgeois, mais aussi de celle de nombreux ouvriers, organisés dans des partis ou des syndicats. Et précisément en Argentine, le terrorisme d'Etat s'est consolidé et développé contre les minorités actives du prolétariat des années 1960-1970, sur base du silence complice de tous les bénéficiaires de ce régime (grands, moyens et petits-bourgeois), mais également de larges secteurs ouvriers, malgré une baisse sensible de leur pouvoir d'achat (le vandorisme comme puissance ouvrière syndicalisée 10 c'est-à-dire transformée en force d'Etat- a joué un rôle prépondérant dans la répression historique du prolétariat révolutionnaire): non seulement le nombre de syndiqués n'a pas diminué, mais il n'a fait qu'augmenter durant la pire période de terrorisme d'Etat. L'idée selon laquelle l'ouvrier travailleur, parce qu'il provient de l'usine, serait plus proche du soleil de la vérité, et que le «prolétaire», par le simple fait de l'être, lutterait en faveur des intérêts de la révolution sociale, ne constitue rien d'autre qu'une vulgaire apologie, à peine dissimulée, de ce dont le capital a besoin pour se valoriser: le travail. N'oublions pas que, si pour la social-démocratie être prolétaire est une sorte d'honneur, pour le prolétariat, être travailleur productif est un véritable malheur. Le prolétariat n'est pas la réalisation de l'être humain, mais bien sa perte totale.
Il est donc complètement absurde d'attribuer à la petite bourgeoisie la force du mouvement, ses faiblesses ou même ses drapeaux et mots d'ordre, le plus souvent ouvertement bourgeois, comme le drapeau argentin. Ce qui a été décisif, c'est l'opposition de toujours entre bourgeois et prolétaires, entre d'une part, les défenseurs de l'ordre et de l'Etat et, d'autre part, ceux qui savent qu'ils n'ont rien d'autre à perdre que leurs chaînes, organisent des assemblées, des escraches, des pillages et s'attaquent aux centres de répression et d'administration du capital et de l'Etat et frappent aussi sur des casseroles !
Cette tentative bourgeoise pour canaliser, dans le cadre de l'Etat, les événements qui se déroulent dans la rue et que ne parviennent pas à enrayer les forces politiques traditionnelles (partis, syndicats, Ong,), relève de l'abc de toute domination de classe. Etant donné le discrédit absolu des appareils centraux de l'Etat (et des forces politiques classiques d'opposition et de canalisation), et la crise généralisée, des habituelles formes de délégation et de représentation, cette sortie massive dans la rue était, par conséquent, inévitable. La bourgeoise, incapable de stopper le mouvement, a dès lors tout fait pour empêcher que la rupture avec la démocratie ne soit totale, et faire en sorte qu'un brin de «civilité», de respect des règles du jeu démocratique soient encore présents dans le comportement d'une bonne partie de ceux qui occupaient la rue. Tout ce qui participe habituellement à la fabrication de l'opinion publique s'est alors mis en branle, plaçant sous les feux des projecteurs l'apologie d'une forme particulièrement civilisée de protestation: le cacerolazo citoyen et pacifique, seule «protestation» admissible, forme par excellence de légalisation des manifestations, en opposition totale au mouvement du prolétariat qui assumait de plus en plus la lutte violente. La télévision mit l'accent sur la participation de célébrités de la classe dominante et du monde du spectacle, manifestant, comme de bons et braves citoyens, leur petite casserole à la main. On ne pouvait rêver de meilleur complément à la campagne généralisée, orchestrée en vue de diviser le mouvement en différentes couches sociologiques, de liquider l'unification prolétarienne: appuyer la propagande opposant piquets et cacerolazos et attribuer à la fameuse «classe moyenne» un rôle prépondérant dans le mouvement. La gauche bourgeoise a, de son côté, contribué à cette opération, en reprenant la légende selon laquelle le mouvement des cacerolas était né à l'époque d'Allende, en tant qu'expression «de droite». Ils furent malheureusement peu nombreux en Argentine à élever la voix pour affirmer que le gouvernement d'Allende était un gouvernement bourgeois qui avait affamé et réprimé le prolétariat, et ils furent moins nombreux encore à se souvenir qu'attribuer l'apparition de ce genre de manifestations aux années '70 au Chili constitue un énorme mensonge (il suffit de regarder les cacerolazos des prolétaires prisonniers un peu partout dans le monde). Pourtant cette campagne de division a pénétré le mouvement. Ainsi, des groupes de piqueteros, impliqués dans les affrontements de rue de décembre, ont souligné n'avoir pris la «casserole» qu'à partir du 19 décembre et s'être pliés à la manifestation, sans aucune conviction, car ils la considéraient dominée par la classe moyenne.
En réalité, il n'y eut pas plus de petits-bourgeois, agissant en tant que tel dans le mouvement, que de cacerolazos purs, si ce n'est ceux artificiellement créés de toutes pièces et gonflés par les médias, en vue de tout embrouiller. Cette image de l'honnête petit-épargnant, bien habillé et dégoulinant de gentillesse, victime du corralito, apparaissant à la télévision, armé de sa petite casserole, sans aucune intention de briser des vitres ou de faire des escraches, représente le protagoniste par excellence du cacerolazo, porté aux nues par les médias, mais qui n'existe que pour la télévision. Les médias, et en particulier le groupe Clarin, vont atteindre des sommets en exploitant «la mort du premier cacerolero », en novembre 2002 : en réalité, il s'agissait d'un pauvre homme qui, devant l'impossibilité de retirer les 100.000 dollars qu'il avait épargnés (corralito), s'écroula au sol, victime d'un infarctus.
Le désaveu des prolétaires les plus combatifs pour ce genre de gentil petit citoyen est parfaitement logique, ce qu'illustrent ces formules fleuries: «caceroleros las que me cuelgan», que l'on peut traduire par «caceroleros, de mes deux!».
Donc, mis à part cette image médiatique, élaborée de toutes pièces et spectaculairement gonflée, il n'existe pas de cacerolazo pur. Un peu partout, les mouvements des cacerolas font inséparablement partie de la mobilisation prolétarienne, de l'activité organisée des assemblées, de l'activité plus ou moins spontanée, mais toujours organisée à un niveau minoritaire, qui s'est développée dans les différents quartiers, au même titre que les jets de pierres, les cocktails molotovs, les escraches, les blocages des routes, les manifestations,
Cela ne veut pas dire que la bourgeoisie (non seulement l'un ou l'autre bourgeois venu s'encanailler dans une assemblée, mais aussi les différentes forces politiques de l'Etat) n'a pas tenté de séparer par tous les moyens possibles le bon grain de l'ivraie, le bon citoyen de ce «sale nègre qui coupe le trafic», «l'honnête petit-épargnant » de cette tête crépue et hirsute, sale et fainéante, et qui plus est, «allergique au travail». Mais elle a surtout insisté pour marquer clairement l'opposition entre la bonne manifestation, représentée par le cacerolero légaliste qui s'effraie à l'idée d'employer la force, et celle où l'on canarde les banques de pierres, coupe le trafic et/ou pratique des escraches. Mais à part quelques rares exceptions, ressassées à n'en plus finir par les médias, la bourgeoisie n'est jamais parvenue à ce que les mouvements des cacerolas fonctionnent par les voies légales et prévues par l'Etat. Les pompiers sociaux en tout genre n'ont pas réussi à faire des cacerolazos ce petit spectacle gentillet dont rêvait la bourgeoisie : partout, le prolétariat a rompu les canaux prévus et affirmé sa violence de classe.
Poursuivons encore par quelques extraits, tirés d'un article assez représentatif de la lutte de la bourgeoisie pour canaliser les cacerolazos, qui met nos propos en évidence. Cet article dont le titre est «La non-violence est une force», publié le 27 janvier 2002 et signé par un certain Homero F., a été reproduit sur de nombreux sites Internet, traitant de ce thème (voir à ce propos, Caceroleando.fateback.com). Voici ce qu'on peut y lire: «Il ne fait aucun doute que le sujet le plus récurrent de ces jours derniers concernant les manifestations est celui des incidents qu'elles produisent. Dans le programme télévisé 'Au-delà des Nouvelles', il a été fait référence à une étude indiquant que plus une manifestation se déroule de façon pacifique, plus grande est son efficacité : nous devons dès lors nous demander à qui profite la violence. Le 25 de ce mois, on a observé que la police réprimait spontanément les 'caceroleros' qui rentraient chez eux, suite au déluge qui s'est abattu sur la Capitale Fédérale et le Grand Buenos Aires (personne ne peut se permettre de tomber malade par les temps qui courent). J'ai entendu aujourd'hui, sur Cronica TV, les déclarations des officiers hospitalisés suite aux agressions subies lors du 'Cacerolazo' national. Ils déclarent avoir vu des hommes, les sacs remplis de bouteilles et de pierres, les distribuant aux agresseurs. Ce que chacun se demande alors, c'est pourquoi n'a-t-on pas emprisonné ces personnes et évité ainsi les accidents? La réponse est toute simple, parce que cela ne les arrange pas. Il est préférable de laisser ces infiltrés, faire de la provocation, pour ensuite réprimer l'ensemble des manifestants, rendre opaque l'expression populaire et faire en sorte qu'il y ait moins de gens la prochaine fois, en leur inculquant la peur. On peut donc dire que nous avons affaire à des terroristes. Le jour où nous parviendrons à faire un 'cacerolazo' sans pierres ni cocktails molotovs, sans gaz ni balles en caoutchouc, nous parviendrons à ce que la fois suivante, les gens n'aient plus peur et participent à la manifestation, et, ainsi de suite, jusqu'à réussir à ce qu'y participent des centaines de milliers de personnes.»
Comme on peut le constater, ce qui préoccupe le plus le bonhomme, ce ne sont pas tant les cacerolazos et les manifestations en général, dans cette Argentine prise de convulsions, suite à la crise et la lutte violente du prolétariat, mais c'est précisément la lutte elle-même. Notez bien que sa grande préoccupation, c'est de parvenir un jour à un mouvement de cacerolas pur, dans lequel il n'y aurait ni pierres ni cocktails molotovs On peut également souligner que ses critères de vérité sont ceux de la télévision. Il est dès lors logique que, contre la rupture prolétarienne et pour parvenir à réaliser cet impossible rêve d'un cacerolazo dénué de toute rage prolétarienne, il propose de collaborer avec la police et/ou de former une police dans chaque assemblée, et/ou encore de collaborer à l'uvre policière qu'assume la télévision. En bon citoyen, il a son propre flic dans la tête.
«Compte tenu de tout cela, notre préoccupation principale doit être celle de freiner les violents. Les formes pour y parvenir n'ont rien d'excentrique, on peut créer des commissions de sécurité des Assemblées, qui ont comme but de signaler les agitateurs, de façon à ce que la police puisse les arrêter et, s'ils n'y arrivent pas, ces commissions seront chargées de leur retirer pierres, bouteilles, etc. et/ou de les montrer à la télévision. Bien entendu, ceci n'a rien de démocratique et équivaut à se faire soi-même justice, mais, si les autorités ne font rien, il ne nous reste pas d'autre remède que celui d'agir pour notre propre sécurité. En y réfléchissant bien, ce serait agir en légitime défense.
Une autre chose qu'il est possible de faire pour éviter toute violence future, c'est de nous organiser. Il est nécessaire que nous laissions la spontanéité de côté pour commencer à penser à et à débattre de ce que nous voulons construire avec nos voisins. Si nous laissons s'accumuler la colère, nous allons devenir fous et faire des choses insensées. Nous ne pouvons plus permettre de laisser couler le sang. Si nous parvenons à nous contrôler nous-mêmes, nous pourrons reconquérir le pays».
Comme on le voit, ni le terrorisme d'Etat, la télévision, les partis politiques, ni les mouchards en tout genre, ne sont parvenus à faire du cacerolazo, cette manifestation citoyenne rêvée, à l'image de la classe moyenne, qu'ils se sont évertués à créer. Mais cette tentative de récupération/liquidation de la lutte prolétarienne concernant les cacerolazos n'est pas un phénomène isolé. On a tenté de faire exactement de même avec les piquets. Dans le chapitre suivant, nous nous pencherons sur les formes qu'ont revêtu les tentatives de liquider l'autonomie du prolétariat, notamment en ce qui concerne les piquets. Ce qui mettra d'autant plus en évidence que le débat ne se situe pas entre marginaux et classe moyenne, comme on a voulu nous le faire croire, mais relève plutôt de cette vieille contradiction entre la puissance de la lutte prolétarienne contre l'Etat et les formes que prend sa récupération.
«Pour ce que j'en sais, il y a à l'intérieur du mouvement un nombre incalculable de groupes et/ou de fractions qui adhèrent idéologiquement à des partis ou à des organisations démocratico-parlementaristes.
Lire à ce propos le livre intitulé: 'Le who is who des groupes PIQUETEROS', dont est issue la liste suivante, à laquelle j'ajoute quelques commentaires :
Raul CASTEX : Dirigeant combatif des retraités, deux années de prison pour pillage, membre du P.O. (Parti Ouvrier)
D'ELIA : du C.C.C (Courant Classiste et Combatif). Dirigeant du parti le plus grand et le plus massif 3 millions et ½ d'adhérents. Structure à prédominance péroniste. D'Elia fait partie du système et appelle à la création d'un Front.
De GENNARO : du CCC-CTA (Courant Classiste et Combatif-Centrale des Travailleurs argentins). En dehors du système. Ne formule aucun appel à quoi que ce soit. Est dirigeant d'un syndicat formel/parallèle (de fait, c'est un front : la CTA). Se revendique du péronisme de centre-gauche. (Surnommés «les poussins», car toujours vêtus de jaune).
Marta MAFFEI : CTRA (Centrale des Travailleurs Révolutionnaires Argentins). En faveur de «la grève solidaire». Dirigeante d'un syndicat formelpéroniste mais respecté. Elle est fille d'un anarchiste... N'importe qui peut secréter un furoncle!
Marta GARRIO : Ex-députée radicale, fondatrice de l'ARI, en tête de liste aux élections. Milite pour un autre 20 décembre !»
Polo OBRERO (P.O) : Groupe appartenant, comme son sigle l'indique, au P.O (Parti Ouvrier) (Surnommés «les colombes», car tous vêtus de blanc).
MOUVEMENT NATIONAL de LIBERATION : correspond à l'ex-PC et brasse beaucoup d'argent.
MOUVEMENT de la PATRIE LIBRE : l'autre ligne du PC. Se fait appeler le «mouvement CHAVISTA» (Chavez).
El MATE : constitué d'ex-ERP (Armée Révolutionnaire du Peuple), d'ex-PRT (Parti Révolutionnaire des Travailleurs), d'ex-MAS (Mouvement pour le Socialisme). Petit groupe, principalement trotskyste. Prêts à la bagarre, ils sont proches du :
GROUPE ANIBAL VERON : ceux-là sont effectivement des chômeurs sans partis. Leur nom provient d'un martyr de Salta, bien qu'on dénombre déjà plus de trois morts dans leur rang (cf. le massacre du pont Avellaneda).
ZAMORA : le seul homme politique que les piqueteros laissent passer, le seul également qui puisse aller dans la rue et voyager en métro. Ex-député du MAS et deuxième sur les listes électorales.
Groupe MARTA RODRIGUEZ : son dirigeant se nomme Dirispeche FERNANDEZ, appartenant au Groupe QUEBRACHO, ex-Montonero. Ex-SIDE (Service Secrets de l'Etat). Nationaliste. Ne participe pas aux élections.
AGRUPACION SIDE : connus comme infiltrés camouflés ou agents provocateurs
'Los PIQUE-TRUCHOS' ou encore 'les autopisteros' : agents au service de la direction péroniste, payés 30$ + le repas + 1 «pétard», pour agir à la demande, opérant de faux pillages.
MOUVEMENT INDEPENDANT : JEUNESSE ET CHOMEURS : pour l'instant, toujours pas clair.
MOUVEMENT des CHOMEURS 'TERESA VIT' : péroniste de centre-gauche.
La liste continue car il manque encore :
'IL PERRO SANTILLAN' (Le chien Santillán): un gars très intéressant, mais un peu en retrait ces derniers temps.
On ne peut laisser en dehors le groupe
H.I.J.O.S. : (Fils en faveur de l'Identité et de la Justice contre l'Oubli et le Silence), présents habituellement, sans aucun drapeaux.
MOUVEMENT de TERRE et de LIBERATION : un groupe similaire au «mouvement sans terre» du Brésil».
Notre camarade poursuit ses commentaires sur notre texte précédent, en se penchant sur le chapitre concerné aux pillages. Voici ce qu'il en dit:
«On ne peut être que d'accord avec cette évaluation, mais il est choquant que le thème des SAQUEOS TRUCHOS 11 (faux pillages) ne soit pas abordé. Le fait de les ignorer ne doit tout de même pas nous faire oublier leur existence et leur importance politique. Qui a été à l'initiative de ces 'faux pillages' et pourquoi? La réponse est double: 1) l'appareil Péroniste ; 2) le S.I.D.E.
Les premiers, car ce sont les seuls qui puissent capitaliser à leur bénéfice ce soulèvement prolétarien (de fait, Duhalde, le candidat qui avait perdu les élections, a pris le pouvoir). C'est maintenant Menem qui, avec la même tactique, essaye de déboulonner le siège sur lequel est assis son opposant. Pour les seconds, inutile de vous expliquer leur implication».
Nous reproduisons ici notre réponse:
«Il semblerait qu'à notre affirmation 'en rupture avec les partis parlementaires', tu cites, pour marquer ton opposition, une série de groupes et/ou de fractions qui correspondent idéologiquement à des partis ou organisations démocrates parlementaires, et qui contrôleraient tout le mouvement. L'énumération est intéressante et particulièrement utile pour tous ceux qui ne vivent pas en Argentine, c'est pourquoi nous allons la publier. Mais toute opposition entre ce que nous affirmons dans la revue et ce que tu dis à ce propos doit être rejetée.
En effet, nous affirmions alors, et continuons d'affirmer, que la pratique du mouvement piquetero, l'action directe qui consiste à paralyser l'économie marchande qui affame l'espèce humaine, est totalement antagonique à la pratique des partis parlementaires. Cette opposition est généralement indépendante du fait qu'un grand nombre de participants (certainement la grande majorité) ont des idéologies bourgeoises, social-démocrates, croient aux partis, aux parlements, à l'autogestion ou encore au contrôle ouvrier.
Dans notre texte, nous affirmons cette rupture pratique entre le mouvement social, le communisme, agissant en tant que force sociale de remise en question de tout l'ordre bourgeois et la pratique de tous ces partis et forces de l'Etat. Bien évidemment, cette rupture est relative. Elle s'est cristallisée pendant les années de développement du mouvement piquetero et les escraches, et a atteint son apogée en décembre 2001 et dans les mois qui suivirent, et que depuis 2002, malgré des hauts et des bas, elle est train de dépérir Ce qui nous intéresse, c'est de souligner qu'au plus fort de la rupture, toutes ces organisations se sont révélées incapables de contrôler, d'endiguer, de manipuler, le mouvement piquetero. Il est impossible de prévoir si ce mouvement poursuivra son processus de déchéance, s'il sera de plus en plus récupéré et manipulé par les forces de l'Etat (comme tu le décris) ou si, au contraire, il réémergera avec plus de force et d'autonomie que jamais face à l'Etat. Puisque nous sommes en lutte pour cette dernière proposition, nous insistons, dans nos publications, sur la rupture d'avec tous les partis parlementaires, sans que cela nous empêche de reconnaître que cette rupture ne peut se maintenir que dans la lutte, et que si on abandonne la rue (et la paralysie de la reproduction de la société marchande grâce à laquelle le mouvement s'est fait connaître dans le monde entier) pour placer nos espoirs dans le parlementarisme ou le gestionnisme, alors le mouvement prolétarien sera liquidé. La majorité des organisations que tu cites travaillent dans le sens de cette récupération, à l'aide de différentes méthodologies. L'emmerdant, camarade, c'est que le nombre de groupes en lutte contre ces récupérations est vraiment très faible: mais, nous croyons que la manière dont nous avons traité la question, en insistant sur la rupture prolétarienne vis-à-vis de ces forces de récupération, est la manière correcte, dynamique de le faire. Même si aujourd'hui, nous sommes bien obligés de reconnaître que, dans la période actuelle, les forces que tu mentionnes contrôlent de plus en plus les piquets et que, par conséquent, ces derniers ont tendance à perdre la puissance qui les caractérisaient.
C'est également pour cette raison que nous n'avons pas mentionné les faux pillages et les faux piquets. Le fait que les appareils de l'Etat truquent, de mille façons, ce qui se passe dans la rue, est une constante dans le mouvement révolutionnaire. Plus le mouvement est puissant, moins ces ruses s'affirment en force. Te souviens-tu que dans les pillages d'il y a une dizaine d'années, on ne parlait que de ces manuvres, qui s'exprimaient sous la forme de fausses informations prétendant que les gens de tel quartier s'attaquaient à tel autre, facilitant ainsi le travail de la police et des appareils d'Etat ? Te souviens-tu encore que beaucoup de nos camarades présents à Buenos Aires argumentaient alors que ce n'était que des lumpenprolétaires qui s'affrontaient à d'autres lumpenprolétaires, comme voulait le faire croire la police, et que seule une infime minorité de révolutionnaires affirmaient le caractère prolétarien de ces pillages ? Cette fois, comme la force du prolétariat a été plus générale, et l'opposition entre la propriété privée et le mouvement d'expropriation des moyens de vie beaucoup plus large, tout ce baratin n'a pas eu énormément de succès. C'est pour cela que le fait d'en avoir peu parlé ne doit pas trop te surprendre (même si on fait mention, page 6, des tentatives des médias bourgeois pour présenter les pillages comme des affrontements entre quartiers). De plus, ce fait a une relative importance dans l'action immédiate, en Argentine, l'importance que revêtent les piquets pour le prolétariat mondial ne peut être brouillée par les opérations des flics et autres appareils officiels de l'Etat. Il est évident qu'à un niveau d'analyse plus concret, plus détaillé, concernant le 'who is who sur les piquets', relever les différents cas de faux piqueteros peut revêtir une importance particulière (c'est pourquoi nous avons trouvé important de reproduire ce que tu affirmes là), notamment pour le développement de l'action camarade en dehors et contre ces tentatives de l'Etat. Notre texte n'avait pas, et ne pouvait avoir, la prétention d'entrer dans ces détails».
Il nous faut cependant ajouter qu'en plus de la terreur d'Etat ouverte à l'encontre des piquets (ce qui implique non seulement les morts et les blessés par balles, mais aussi la mise sur pied de toute une législation répressive, la prise de directives administratives directement à l'encontre des piquets et des escraches : plus de 3000 piqueteros sont soumis à des poursuites judiciaires!), on a tenté par tous les moyens possibles de les liquider, de les récupérer, de les manipuler, de les déprécier, de les rendre inefficaces, autrement dit, de leur enlever leur essence: imposer un rapport de force contre le capital. Pour cela tout est bon. Les faux piquets brûlent l'image du piquetero et laissent croire que les piquets ne sont rien d'autres que des manipulations de tel ou tel parti, voire du pouvoir lui-même. Les moyens de diffusion en arrivent à faire croire aux citoyens que les piqueteros sont un ramassis de profiteurs, payés pour bloquer les routes. Les partis et les syndicats, comme d'habitude, ont pris le train en marche (ce que nous dénoncions déjà dans le texte précédent) et tentent d'imposer des «piquets» qui ont de moins en moins de contenu réel, des «piquets» qui ne bloquent plus totalement les routes, sur lesquels il est interdit de porter une cagoule, pour ne pas effrayer le citoyen, et qui approuvent l'ensemble des mesures policières visant à identifier les piqueteros. Le bon vieux système de la carotte et du bâton, instrumentalisé par le gouvernement et administré par les syndicats, les manuvres de division, la répression s'abattant de tous côtés, l'acceptation des normes citoyennes, voilà les formes actuelles utilisées par l'Etat pour liquider la force des piquets, comme le dénoncent différents groupes de camarades.
Pour rendre explicite notre propos, nous publions encore deux citations particulièrement parlantes. La première est datée de décembre 2002 : «Un autre succès, prouvant cette avancée [répressive NDR] , c'est l'imposition par les forces d'insécurité (qui vont jusqu'à jeter dans le fleuve des enfants vivant des poubelles) de l'interdiction de pénétrer dans la Capitale Fédérale, à toute organisation piquetera qui serait armée de bâtons pour former les cordons de sécurité, porterait la cagoule ou amènerait des couteaux, pour ceux qui sont chargés de l'intendance. Le fait que les groupes acceptent ces mesures humiliantes est un état de fait qui n'était pas accepté auparavant, et par exemple, le 27/06/2002, lorsqu'ils ont essayé d'appliquer ces mêmes mesures, la massivité du mouvement les en a empêché. L'acceptation de ce type de mesures constitue une grave erreur, car ils sont en train de prouver jusqu'à quel point nous cédons dans la lutte. La répression brutale que nous subissons aujourd'hui est en relation directe avec le fait d'avoir accepté ce qui nous a été imposé»12 .
La seconde citation date de fin juin 2003 : «Nous manquerions de sincérité si nous ne reconnaissions pas qu'une des autres armes fondamentales, utilisée par le gouvernement pour calmer la tempête, ont été ces fameux 'plans en faveur des chefs de ménage (hommes et femmes)', dont l'application, signifia un accord entre le FTV-CTA et le CCC, accord par lequel ils s'engagèrent à ne pas 'faire de vagues', et une certaine tendance à la dégénérescence des secteurs les plus combatifs. Concrètement, on ne peut pas dire que ces derniers aient représenté une menace réelle pour le régime (de fait, ils ont plus été des points d'appui qu'une réelle menace), et cette tendance à la dégénérescence s'est cristallisée, par exemple, lors de la marche de soutien en faveur de l'usine Brukman, où la sécurité du Polo Obrero (organisation piquetera, dirigée par le Parti Ouvrier) a défoncé le crâne d'un militant de la trempe de Juan 'Pico' Muzzio (Démocratie Ouvrière), parce qu'elle le soupçonnait d'être un 'infiltré'. Et à cette pathétique attitude du PO, il faut encore ajouter le silence complice des autres organisations qui n'ont même pas dénoncé énergiquement cet épisode criminel»13 .
La dénonciation de ces forces et méthodes, tant au niveau argentin qu'international, tout comme les méthodes et organisations que nous avons dénoncées dans ce texte, représente une des tâches centrales pour les internationalistes du monde entier. Nos contributions, fruits de discussions camarades au niveau international, sont des armes à utiliser pour affirmer la théorie et l'action internationalistes contre l'isolement par lequel on prétend étrangler la lutte du prolétariat en Argentine.
Au moment où a été rédigé cet article (octobre 2003), le mouvement prolétarien en Argentine continuait à se débattre contre toutes les forces du capital mondial qui, en complément à la répression directe, cherchaient plus que jamais à l'isoler internationalement, à l'affaiblir programmatiquement et numériquement, à le liquider. Au-delà des flux et reflux, propres à tout mouvement similaire, il semble évident qu'on a atteint un rapport de force entre les classes tel que le prolétariat ne peut se maintenir à moyen terme sans donner un saut de qualité révolutionnaire qui, à son tour, est extrêmement dépendant du rapport de force sur le reste du continent américain et dans le monde. S'il y a bien une chose qui s'est faite chair et conscience de classe dans les mois qui ont suivi ces événements, c'est qu'il n'est plus possible de reproduire une nouvelle fois la même chose, qu'il faut aller plus loin dans la lutte contre le pouvoir. Mais sur la signification de cette lutte contre le pouvoir, les positions s'affrontent une fois de plus. En Argentine et partout ailleurs, circulent un nombre incalculable d'idéologies opposées à la révolution sociale qui, comme toujours, se parent de nouveaux atours et que nous devons dénoncer de toutes nos forces. Toutes ces idéologies contre-révolutionnaires coïncident dans l'affirmation suivante: il faut et on peut changer le monde sans détruire le pouvoir du capital, sans faire de révolution sociale. Toute contribution ou discussion à ce propos est la bienvenue car nous prévoyons de publier dès que possible un texte à ce sujet.
En guise de conclusion, nous aimerions souligner que les limites constatées dans la lutte du prolétariat en Argentine, sont identiques à celles qui existent dans le prolétariat, au niveau mondial 14 , qu'on ne peut exiger du prolétariat de ce pays qu'il donne un autre saut de qualité révolutionnaire, sans que le prolétariat du monde entier ne sorte dans la rue et affirme son existence en tant que classe internationale. La meilleure solidarité avec la lutte du prolétariat en Argentine, c'est la lutte prolétarienne dans tous les pays, contre la bourgeoisie et l'Etat.
Aujourd'hui plus que jamais, reprenons le mot d'ordre du prolétariat en Argentine à la fin des années '60 :
A la lecture de ce texte, on se rend compte combien il est difficile d'exposer les différentes étapes d'un processus de rupture avec une idéologie et une pratique contre-révolutionnaire. La description des raisons pour lesquelles il a scissionné, dans ce cas-ci d'une organisation stalinienne, oblige l'auteur à se replonger dans la façon souvent limitée et partielle dont se sont formulées ses ruptures à ce moment-là. Comme il ne s'agissait encore, somme toute, que d'un jalon sur la route vers une rupture plus fondamentale, le contenu politique de cette rupture restait souvent encombré d'énormes lambeaux de l'idéologie critiquée aujourd'hui. Comment faire alors pour expliquer, sans perdre le point de vue communiste qui est le nôtre aujourd'hui, qu'à l'ombre d'une remise en question circonstancielle du stalinisme pro-russe officiel, et derrière des critiques formulées à l'époque en jargon «marxiste-léniniste», était pourtant déjà à l'uvre la vielle taupe qui a mené ultérieurement à l'abandon de toute illusion social-démocrate ? Comment exprimer, tout en gardant le point de vue révolutionnaire, qu'une des étapes qui a mené une minorité à l'affirmation de la nécessaire organisation en dehors et contre les syndicats fut d'abord caractérisée par la critique partielle d'un manque de radicalisme des syndicats ? C'est ce que ce texte tente de faire et, s'il reste ici et là entaché des difficultés que nous venons d'évoquer, il n'en demeure pas moins un témoignage remarquable, vécu de l'intérieur, de la façon dont la social-démocratie assume sa fonction d'encadrement capitaliste des ouvriers en cherchant, comme dit l'auteur, à les faire «rentrer en politique comme on rentre en religion».
Seule une question nous pousse à rajouter quelques lignes: malgré tout son parcours et la richesse de sa critique, nous ne pouvons suivre le camarade lorsqu'il affirme que le communisme n'a jamais existé nulle part mais demeure plus que jamais notre avenir. Le communisme comme société, comme projet social abouti n'a effectivement pas existé. La révolution ne peut être que mondiale et faire croire que l'URSS bâtie sur la répression des luttes révolutionnaires des années 1917-23 et d'autres pays, ait pu être «communiste» a été la plus monstrueuse mystification mise au point par la contre-révolution pour faire en sorte que les prolétaires continuent à se sacrifier au travail, à la guerre,... pour le plus grand bien du capital. Sur cette question pas de doute, nous sommes d'accord.
Mais le communisme a historiquement existé comme mode fondamental d'existence de l'humanité, comme communauté humaine et bien que marqué des limites de l'époque, existait comme communisme primitif dans les sociétés humaines dont la vie n'était mue que par la satisfaction des besoins humains, besoin de reproduction de l'espèce, la communauté étant l'individu, l'indivisible. Avec le développement de l'échange et la survenue des sociétés de classe, l'humanité a continué à s'exprimer dans ses luttes pour retrouver la communauté perdue, pour reconquérir le communisme comme mode de vie. Le besoin de communisme est ce besoin fondamental de l'espèce humaine qui s'est exprimé depuis la dissolution des communautés primitives jusqu'à aujourd'hui au travers de toutes les luttes contre les séparations, appropriations privatives, développements de la marchandise,... faisant de l'homme lui-même un objet d'accumulation. Seules les conditions de cette lutte ont changé.
Aujourd'hui, cette lutte historique de l'humanité pour retrouver sa communauté se retrouve dans toutes les luttes de par le monde qui, même partielles, encore confuses, expriment l'antagonisme fondamental/essentiel entre besoins humains et capitalisme. Le communisme s'exprime comme mouvement de négation de l'ordre social existant. Aujourd'hui, c'est au travers des luttes comme en Algérie, Argentine, Irak et bien d'autres endroits, alors que les prolétaires brûlent les urnes, pillent les magasins, s'attaquent aux commissariats, aux banques, aux palais de justice, niant violemment la propriété privée, le règne de la marchandise, la démocratie, que la résistance historique de l'humanité contre tout ce qui la détruit continue à s'exprimer. Le communisme existe comme préfiguration aujourd'hui dans les ruptures révolutionnaires portées par ces luttes aux quatre coins du globe, portées par les militants qui tentent de s'organiser en dehors et contre toutes les structures de l'Etat, qui tentent pratiquement de se réapproprier le programme communiste. C'est dans ce cadre du communisme, comme rupture et affirmation programmatique, que nous publions ce texte.
Le communisme n'est pas un projet social pour l'au-delà, n'est pas une croyance, n'est pas un futur pour lequel nous sacrifierions nos vies présentes. Nous ne luttons pas pour le communisme comme d'autres rêvent d'un monde meilleur. Le communisme est présent comme préfiguration, dans les liens de solidarité que nous tissons au travers de la lutte de chaque instant contre ce monde de l'argent, de la concurrence, de la guerre de chacun contre tous, au travers de la lutte de chaque instant contre tout ce qui nous sépare de nos frères de classe: le travail, les religions, les frontières, Il est présent dans chaque moment d'affirmation et d'unification des forces de notre classe mais ne se réalisera pleinement qu'imposé par la dictature du prolétariat. Il est effectivement important de souligner que le communisme n'est pas présent comme affirmation positive au sein de ce système. Il s'affirme nécessairement antagoniquement à, comme négation de tout l'ordre social existant et ne pourra s'affirmer positivement comme projet social abouti, que lorsque ce monde de l'argent, de la marchandise, du travail, du capital, destructeur de l'humanité et de la planète entière, sera détruit de fond en comble par la révolution qui implique insurrection prolétarienne généralisée et dictature des besoins humains contre toute manifestation/survivance de la valeur. Ce n'est que dans ce sens, parce que nous luttons pour renverser le rapport de force et imposer la dictature du prolétariat, que nous pouvons affirmer que ce que nous faisons dès à présent est préfiguration du communisme, est mouvement communiste et qu'il n'y a pas de séparation entre ce mouvement et son aboutissement comme société. Le communisme ne peut exister comme avenir que parce qu'il est réalité présente dans nos luttes.
Par ailleurs, nous avons également inséré dans le corps du texte, et sous forme d'encadré, deux commentaires que nous ont inspiré ce témoignage, l'un à propos de l'influence de la vague de lutte 1968-73 sur l'apparition du maoïsme, l'autre sur la méthodologie religieuse propre au marxisme-léninisme.
| A l'attention de celles et de ceux de ma
génération qui se sont voulus communistes et qui, en dépit
de leurs avatars stalinien, trotskyste, marxiste-léniniste, maoïste,
libertaire... se le veulent toujours.
A l'attention aussi de tous ceux et celles qui aujourd'hui prétendent sincèrement l'être en militant dans les organisations gauchistes qui subsistent encore. Même si ce sont des vux pieux car rares sont les croyants qui remettent leur foi en cause. A l'attention encore et surtout des jeunes camarades internationalistes, éparpillés dans le monde, qui s'évertuent à centraliser les luttes prolétariennes, à reconstituer la mémoire ouvrière et à développer le programme communiste afin qu'ils puissent tirer de mon modeste engagement passé les enseignements utiles à l'approfondissement des ruptures de classe. |
Enriquez M, Les Enveloppes psychiques - 1987
Le fait que la révolution prolétarienne de 1917 en Russie n'a pu s'étendre mondialement (échec des insurrections révolutionnaires en Allemagne, en Hongrie et ailleurs) d'une part, et, d'autre part, le manque de rupture des bolcheviks avec la social-démocratie, donc avec la bourgeoisie (occupation de l'Etat et son renforcement au lieu de sa complète destruction) conduisirent à un enfermement sur soi et à des pratiques contre-révolutionnaires (construction du socialisme dans un seul pays, paix de Brest-Litovsk, maintien du salariat, dictature contre le prolétariat, massacre des Socialistes-Révolutionnaires de gauche, des makhnovistes, des insurgés de Kronstadt et de toute opposition communiste, phobie des complots, conception policière de la révolution ...).
Encerclé, le pouvoir en place ne put que renforcer ce que, de par la révolution, il était censé abolir. Il ne lui restait plus alors qu'à attribuer les échecs de l'édification du nouvel Etat aux ennemis de l'intérieur qu'il importait d'anéantir. Cette tyrannie qui se systématisa avec le stalinisme et son culte de la personnalité, relève du sacrifice expiatoire propre aux religions, qu'elles soient divines ou terrestres, héritage des sociétés agraires obscurantistes et despotiques.
En dépit de la propagande masquant la réalité et contribuant à maintenir des générations de prolétaires dans leurs illusions et dans une fidélité inconditionnelle à la «patrie du socialisme», la société soviétique demeurait fondamentalement une société capitaliste concurrente de celles de l'Ouest, contrainte au protectionnisme (maintien de la loi de la valeur, propriété des moyens de production centralisée au niveau de l'Etat avec ses usufruitiers privilégiés, gestion bureaucratisée de la production...). La formulation «capitalisme d'Etat» ne me paraît pas adéquate. En effet le capital a besoin de l'Etat pour assurer sa permanence et sa cohésion , c'est-à-dire de tout son appareil administratif, répressif, socio-politique et culturel. Mais l'Etat ne peut être que capitaliste puisque la société communiste en est précisément l'abolition. Il convient cependant d'apporter les nuances nécessaires pour caractériser les différences d'organisation du capital de part et d'autre de l'ex - «rideau de fer».1
D'état-major de la révolution mondiale ratée, l'URSS devenait le centre impérialiste au service des ambitions duquel l'IC et ses sections se muaient en serviles agents d'exécution, chargés de justifier tous les tournants «opportunistes de droite ou de gauche» d'un soi-disant mouvement communiste international, ses alliances sans principe, son prétendu radicalisme classiste (fronts populaires, Espagne 1936-39, pacte germano-soviétique, participation antifasciste à la boucherie de 1939-45...).
Cette dégénérescence, déjà en germe au départ via notamment l'application des 21 conditions de la IIIème Internationale, gangrena tous ces partis se revendiquant du communisme, achevant de les transformer en sectes social-démocrates radicales au service d'une soi-disant patrie du socialisme, alors que le propre du prolétariat et donc des communistes est de n'avoir aucune patrie! Le tournant antifasciste leur fournit l'occasion de sortir de leur isolement en se mettant aussi au service de l'économie de leur pays respectif. Les P C 2 ouvrirent ainsi largement leur porte aux démocrates bourgeois et c'est par antifascisme, et non par conviction communiste, que ceux-ci rejoignirent les sections nationales de la IIIème internationale.
Après la théorie et la pratique contre-révolutionnaires du socialisme dans un seul pays, celles de l'antifascisme complétait la liquidation de toute praxis communiste. En prônant par le frontisme l'alliance du prolétariat avec des fractions du capital contre d'autres (antifascisme contre fascisme), les P C lui firent perdre non seulement son autonomie de classe mais contribuèrent, au bénéficie du capital, à sa liquidation physique massive en l'entraînant à participer à la boucherie impérialiste de 1939-45. Derrière les apparences d'une lutte «du bien contre le mal», fascisme et antifascisme sont en réalité pour le prolétariat les deux mâchoires du même piège dans lequel la gauche du capital tente encore aujourd'hui de le faire tomber.
Au début des années 1960, lesquelles sont qualifiées par la bourgeoisie de «golden sixties», c'est-à-dire le haut de la phase de valorisation après celle de dévalorisation des années 1939-45, la social-démocratie de droite et de gauche a perdu tout vernis de radicalité.
Les luttes qui se produiront au cours de cette décade, après ce que les milieux militants appelaient la «grande grève de 60-61» en Belgique (notamment celle du bassin minier en Flandre), et les affrontements qui, en Afrique et en Asie, ébranlèrent le pouvoir colonial (même si ces mouvements sont récupérés, contrôlés par la bourgeoisie à travers la conquête de l'indépendance nationale) nécessiteront le renforcement de l'encadrement de toute tentative de rupture de classe. Il est vrai que la lutte de prolétaires contre la misère, l'exploitation et l'oppression peut se voir confisquée par et au profit de fractions bourgeoises. Mais si des prolétaires s'engagent pour ce faire dans une lutte de libération nationale, ils se font soldats contre le prolétariat et contre leurs intérêts de classe. On sait où les sirènes du national-socialisme ont conduit des ouvriers d'Allemagne.
Ainsi naîtront, dans le contexte belge, sur la gauche du Parti Socialiste, les éphémères UGS (Union de la Gauche Socialiste) et le PWT (Parti Wallon des Travailleurs), et sur celle du PCB , la scission grippiste.
Quant à la mise au pinacle de l'image du Che et de l' «héroïsation» de sa mort, quant aux manifestations massives et violentes de soutien aux luttes de libération nationales du Vietnam, où toutes organisations gauchistes confondues, on gueulait «Ho-Ho-Hochi-Minh-Che-Che-Guevara», elles serviront d'exutoire à une contestation galopante mais canalisée du système.
La dénonciation dans les années 1960 du révisionnisme 3 au sein du pseudo mouvement communiste international, en pleine désagrégation, par les oppositionnels marxistes-léninistes, répond dans un cadre spécifique aux mêmes objectifs.
Sans doute s'agissait-il, pour une tendance plus radicale à l'intérieur des PC, de rompre avec une ligne nationale-réformiste trop ouvertement de collaboration de classe. En réalité, cela correspondait aux divergences au niveau international. La majorité du camp dit socialiste (l'URSS et ses créatures, les démocraties populaires) mettait davantage l'accent sur une collaboration avec l'autre camp impérialiste (les USA et ses alliés) que sur leur rivalité. La Chine et ses alliés (l'Albanie et, au début la Corée et le Vietnam du nord ainsi que Cuba) dont les régimes «nouveaux» étaient le produit non classiste d'une lutte de libération nationale, avaient au contraire besoin pour affermir leur indépendance nationale, de dénoncer l'agressivité de l'autre bloc, et donc, au sein de leur propre camp, de contester la suprématie soviétique.
Il s'agissait bien là de rivalités inter-impérialistes dont le prolétariat faisait les frais, mais dont la remontée des luttes était la cause.
Le stalinisme comme tel est sans doute défait aujourd'hui mais des pans entiers de son idéologie et de son mode d'organisation (alliance de classe, nationalisme, antifascisme, centralisme démocratique, syndicalisme...) marquent toujours l'extrême-gauche, qu'elle se réclame ou non du stalinisme.
En se faisant le défenseur de la démocratie contre le fascisme, c'est-à-dire de la gauche du capital contre sa droite, l'extrême gauche (néo-stalinienne, trotskyste, maoïste, castriste...) soutient, en réalité, sous ses apparences les plus libérales, la dictature du capital (défense des «droits de l'homme», des «libertés démocratiques», du parlementarisme) qu'elle prétend vouloir abolir et neutralise par là même le prolétariat dans des alliances avec certains secteurs de la bourgeoisie (luttes de libération nationale, frontisme).
Il est intéressant de noter que certains marxistes-léninistes actuels, comme les néo-staliniens du Parti du Travail de Belgique (PTB) par exemple (dont les fondateurs formés dans le giron jésuitique du catholicisme et/ou issus de la bonne bourgeoisie se sentirent naturellement attirés par la mystique maoïste) qui, avant la chute du mur de Berlin, dénonçaient le révisionnisme, la restauration du capitalisme dans les prétendus pays socialistes (y compris Cuba mais pas l'Albanie, ni la Roumanie, ni la Corée et la Chine) comme colonies du «social-impérialisme soviétique» et de son régime «social- fasciste» (depuis Kroutchev !), se font aujourd'hui les nostalgiques défenseurs de leurs réalisations «socialistes» et de leurs dirigeants «communistes» qu'ils avaient dénoncés comme fantoches de Moscou.
Mais il demeure que, quelles que furent les divergences entre révisionnistes, marxistes-léninistes et/ou maoïstes, aucune de ces fractions n'a érigé en principe l'antiparlementarisme, l'antisyndicalisme, l'antifrontisme, même si certaines dénonçaient peu ou prou le crétinisme parlementaire, la trahison des syndicats, voire même certains aspects du stalinisme, et n'acceptaient que les alliances qu'elles prétendaient diriger.
La dictature de la bourgeoisie, c'est fondamentalement la dictature de la valeur, que cette dictature se manifeste de façon plus ou moins répressive, en fonction des besoins de valorisation du capital et de la résistance que lui oppose le prolétariat. La démocratie, c'est la dictature du capital, qu'elle se présente sous un régime libéral, social-démocrate ou anti-démocratique, c'est-à-dire fasciste, voire socialiste ou populaire. Pour perpétuer son rapport social, elle a besoin de la liberté d'entreprendre et d'exploiter, de l'égalité contractuelle et de la concurrence entre acheteurs et vendeurs de la force de travail ainsi que de ce faux humanisme qu'est la fraternité marchande propre à notre société fondée sur le fric.
C'est pourquoi, historiquement, la démocratie prendra son plein essor avec celui de la bourgeoisie, c'est-à-dire avec l'achèvement de la rupture d'avec l'Ancien Régime, libérant l'individu de ses anciennes dépendances et entraves pour celles du salariat, à savoir, la liberté individuelle de vendre sa force de travail ou de crever.
La fonction actuelle de la démocratie est de garantir le pouvoir aux gestionnaires du capital les plus aptes à assurer la pérennité du développement de la valeur, qu'ils soient de droite, de gauche ou de leur extrême.
Ce texte n'a aucune prétention historique. Il est le résultat d'une réflexion actuelle sur mon expérience militante, à partir de ma pratique et de la relecture de mes notes personnelles et des documents des différents groupes en ma possession.
Les lignes qui suivent vont simplement tenter, modestement, à travers un parcours individuel, non seulement de comprendre les raisons de l'engagement dans les rangs staliniens et d'en faire le bilan, mais surtout de montrer qu'en dépit de nos limites et faiblesses individuelles, savamment entretenues par le capital, son arsenal idéologique et matériel de récupération, le renoncement n'est pas une fatalité. Pour sortir de la barbarie, nous sommes contraints d'abolir radicalement et sans détour l'ordre des choses existant, même si l'âge aidant, on renonce à l'activisme et à appartenir à une organisation.
Le communisme n'a jamais existé nulle part mais demeure plus que jamais notre avenir.
Pourquoi ? Pourquoi s'engage-t-on d'ailleurs et pourquoi à l'extrême-gauche? Rien ne m'y amenait de par mon éducation ou mon milieu familial. Quant au contexte de l'époque, caractérisé par 30 ans de contre-révolution et 13 ans de revalorisation du capital depuis la fin de la guerre 1939-1945, rien qui puisse me conduire à une pratique prolétarienne et à une conscience révolutionnaire. Il y eut certes ce besoin d'autonomie, d'indépendance qui ne pouvait se concrétiser qu'en prenant le contre-pied du milieu social à l'esprit petit-bourgeois, sans perspective, bien intégré, qui fut mon terreau. Nourri d'une culture scolaire humaniste classique, la provocation non conformiste s'affirmera d'abord par le rejet de la croyance en «Dieu» pour prendre ensuite les couleurs de l'existentialisme sartrien. Cependant, comme bon nombre d'adolescents, je me suis senti attiré vers des positions extrêmes, vers des idées fortes. Je fusenthousiasmé par la pureté héroïque, le don de soi, percevant cette énergie, cette vitalité aussi dans la figure du guerrier fasciste de «Gilles» du roman de Drieu la Rochelle, mais la trouvant bien plus convaincante dans la cause du héros bolchevik de la Révolution d'Octobre, Pavel Kortchaguine, par la lecture de son autobiographie «Et l'acier fut trempé».
Mon engagement résulte donc d'une émotion, en apparence littéraire. Mais en réalité cette émotion traduisait sans doute confusément une profonde aspiration à un monde nouveau que je croyais être idéalement incarné par l'URSS de Staline. Cette approche trouva confirmation au contact de lycéens sympathisant d'un parti se proclamant communiste et pro-soviétique mais plus particulièrement auprès du fils d'un partisan adhérant de ce parti, partisan exécuté par les nazis. Comment à ce niveau de connaissance ne pas identifier stalinisme et communisme ainsi que les organisations staliniennes comme représentantes formelles du Parti Historique du prolétariat au sens où l'entendait Marx ?
Cette démarche ne répond pourtant pas à mon questionnement initial: quels sont les facteurs qui déterminent un individu, outre l'influence de son entourage, à prendre parti ?
Avoir été affectivement perturbé et matériellement touché, à l'âge de 15 ans par la mort de mon père, peut-il en être, même partiellement, la motivation profonde? Gardons-nous de toute explication exclusivement d'ordre psychanalytique en dehors d'une interprétation de classe. Tout épanouissant que puisse être le milieu familial, il n'est jamais qu'une des expressions institutionnalisées fondées sur la propriété privée, il ne peut donc rester imperméable aux agressions, au mal-vivre d'une société d'exploitation, d'aliénation. Sans nier la difficulté de faire la part entre ce qu'il y a de conditionné, de réflexif (voire d'inné?) dans nos comportements et ce qui résulte d'une prise de position à la suite d'un choix, d'une expérience... , dans quelle mesure notre nature humaine, aussi marquée puisse-t-elle être par les valeurs marchandes du capital, ne nous détermine pas, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins consciemment ou non, à réaliser notre humanité, à devoir parcourir l'arc historique qui va du communisme primitif au communisme à venir, pas en tant que fait déjà advenu mais comme potentialité?
Pour conclure cet aspect des choses, je dirais en paraphrasant Hegel que mon engagement représentait la victoire de la pulsion de la «nature humaine contre ce qui constituait la négation franche, absolue, totale de cette nature»: ma situation dans la vie.
A défaut de réponse satisfaisante au «pourquoi»,
je me limiterai à décrire le suivi d'un engagement, qui intuitif
au départ mais justifié «rationnellement» par
la suite, conditionnera mon existence, en dépit des doutes et des
illusions, et à en situer les ruptures successives.
Ce 1er mai, marchant côte à côte avec ceux et celles qui défilaient sous la bannière que je croyais être celle de la révolution sociale, cette présence me communiqua une impression de force telle qu'un individu peut éprouver quand il s'identifie au collectif, en l'occurrence à une classe, sans avoir nécessairement conscience de son appartenance. Pour l'anecdote, regardant, avant de le rejoindre, passer le cortège, un chaland m'apostropha en me chuchotant: «méfiez-vous, ce sont des communistes!» Ce à quoi, méprisant, je répliquai: «comment peut-on craindre les siens?» J'ignorais encore que, sous ce vocable de «communiste», se cachait la réalité théorique et pratique d'une fraction de la social-démocratie, qui avait de plus perdu sa radicalité d'antan.
Le PCB et ses organisations étaient marqués à l'époque par le patriotisme antifasciste, la foi en l'URSS, considérée comme la patrie du socialisme, et le parlementarisme. A mes yeux et à mon niveau de connaissance, être communiste et le déclarer, c'était provoquer et rompre avec le conformisme ambiant, remplacer le capitalisme par une société nouvelle, égalitaire, en mettant la classe ouvrière au pouvoir, l'URSS ayant tracé la voie, auréolée de surcroît par son rôle déterminant dans la défaite du nazisme. Autrement dit: antifascisme, antiracisme, progrès et humanisme se confondaient avec communisme qu'édifiaient les démocraties populaires des pays dits socialistes.
Tout en reconnaissant des «erreurs» dues à l'inexpérience et à l'hostilité des démocraties bourgeoises (ce qui est un pléonasme), léninisme et stalinisme étaient présentés comme l'application concrète de la révolution socialiste à la situation particulière de la Russie mais devant servir toutefois de référence et de guide pour les autres pays en conjuguant le but à atteindre (le communisme ) avec des moyens réalistes (indépendance nationale, frontisme, parlementarisme, nationalisations ...). Au nom de sa puissante efficacité, la voie stalinienne écartait toute autre tendance (trotskyste ou socialiste de gauche) à prétendre représenter le prolétariat dans sa lutte pour le socialisme d'abord et le communisme ensuite.
Je pris rapidement conscience de mon ignorance théorique (difficile à combler parallèlement à des études universitaires pour lesquelles j'étais mal préparé), de ma difficulté à prendre la parole en réunion, en comparaison avec une série de militants intellectuellement doués ou ayant baigné dans un climat politique depuis toujours. Cela m'amenait à faire preuve de suivisme en fonction du brio des prises de position des uns ou des autres, pas toujours capable d'y voir clair avec ma propre tête.
C'est dans ces conditions que j'appris qu'avec quelques nouveaux adhérents, j'étais manipulé par des trotskystes infiltrés dans nos rangs. J'assistai à leur «procès» et à leur exclusion, témoin de cet acharnement à condamner en collant des étiquettes infamantes sans réellement se soucier du bien-fondé ou non des positions en présence. C'est à cette occasion que le parti, pour nous «former», nous envoya le vétéran Coenen. Initialement issu des rangs de l'organisation communiste de War Van Overstraeten, laquelle fusionna après quelques résistances avec le groupe réformiste de Jacquemotte venu de la gauche du Parti Ouvrier Belge, F. Coenen, d'abord oppositionnel, se rallia au stalinisme après un séjour à Moscou 4.
Pendant cette période, mon militantisme relevait plus du folklore estudiantin et du dilettantisme en dépit de participations aux manifestations de soutien aux luttes de libération nationale des peuple algérien et congolais. Solidarité anticolonialiste qui nous semblait aller de soi, abc de quiconque se revendiquait du socialisme et du communisme. Il en allait de même des autres positions du PCB que je vais tenter de synthétiser au travers de mon expérience étudiante.
Si au sortir de la boucherie intercapitaliste de 1939-1945, le PCB évoquait encore, dans son enthousiasme tricolore et colonial «notre Congo», les luttes anti-impérialistes, en plein essor, reçurent en fin de compte son soutien au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ainsi que les déclarations du parti belge en faveur d'un Congo indépendant furent considérées comme partie intégrante de la lutte générale du prolétariat contre l'impérialisme. Le prolétariat belge devant être solidaire du peuple congolais que ce dernier choisisse le socialisme ou pas! Bel exemple de frontisme interclassiste.
Cette position est la mise en pratique de la théorie opportuniste léniniste sur la question nationale et coloniale ainsi que celle développée dans «Impérialisme stade suprême du capitalisme». La conséquence étant la dissolution de l'autonomie du prolétariat, de son programme et de son organisation par la revendication de réformes partielles, minimalistes en front commun avec des fractions de la bourgeoisie.
Comme d'autres formations, une fois expulsées les positions révolutionnaires initiales, le PCB est resté majoritairement fidèle à Moscou, en dépit de l'involution du centre de la révolution mondiale, depuis l'échec de son extension, en état-major de la contre-révolution. Ce parti a épousé tous les tournants politiques de l'URSS, sans pour autant tout à fait se départir d'un sens national qui trouvera à s'épanouir dans la résistance antifasciste.
Niant le caractère impérialiste de la guerre 1939-1945, le parti belge est devenu partie prenante d'un camp impérialiste contre un autre dont l'issue n'a fait que maintenir et renforcer la domination du capital sur le prolétariat. En engageant ce dernier à lutter pour la libération nationale et pour la démocratie contre le fascisme, il détournait le prolétariat de son objectif révolutionnaire par une mystification qui fait encore recette de nos jours: l'antifascisme!
C'est précisément parce que sa fondation n'a pas été le résultat d'une rupture totale avec tout radicalisme réformiste (fusion d'un groupe communiste avec un groupe social-démocrate de gauche) qu'il développera, à l'instar des partis «frères», dans un contexte de reflux de la révolution, des positions en opposition avec le défaitisme révolutionnaire et l'internationalisme. Partagés entre deux patriotismes (leur servilité à la soi-disant patrie socialiste soviétique et leur attachement national) tous ces PC passeront successivement de l'antifascisme (Espagne 1936, Munich 1938) au défaitisme non révolutionnaire, au pacifisme et à une neutralité vis-à-vis de l'Allemagne hitlérienne (pacte germano-soviétique 1939-40) pour devenir, après le 21 juin 1941, le fer de lance de la défense de leurs deux patries contre l'occupant.
C'est pourtant ce même nationalisme, invoqué pour libérer la patrie de l'occupant étranger, qui conduisit le PCF par exemple à ne pas se solidariser officiellement avec les indépendantistes algériens ou indochinois menant le même type de guerre, avec la même idéologie stalinienne pour les partisans d'Ho-Chi-Minh, et à consentir que d'anciens maquisards et des militants de leur propre parti revêtent l'uniforme pour aller les combattre. Voilà un bel exemple de sacrifices de prolos dans l'intérêt du capital et de sa valorisation.
Dans ce contexte, dont l'analyse classiste m'échappait totalement à l'époque, c'est comme allant de soi qu'il convenait de s'opposer au militarisme allemand, à la remontée du fascisme, aux expériences atomiques... pour la défense de la paix, sans concevoir que la paix et la guerre sont les deux facettes de l'exploitation du prolétariat par le capital.
Notre analyse soit-disant marxiste était que le monde se divisait en deux blocs antagonistes: le camp socialiste et le camp impérialiste de forces militaires égales. Cette égalité les obligeait à négocier et à passer de la guerre froide à une compétition pacifique qui devait assurer la victoire au système économique le plus capable de garantir la paix, la liberté et la prospérité au monde. Il ne faisait aucun doute pour nous que ce défi ne pouvait être remporté que par le «communisme», donc grâce aux succès remportés par l'URSS, avec Staline hier dans l'industrialisation du pays et la victoire sur le fascisme, aujourd'hui (c'est-à-dire, début des années 60 ) avec N. Kroutchev censé conduire l'URSS socialiste dans la phase supérieure du communisme! Peuples de tous les pays, réjouissez-vous, les camarades soviétiques tracent la voie de votre bonheur!
A ce propos et avant de creuser les implications de cette coexistence pacifique entre systèmes socio-économiques soi-disant opposés, je dirai quelques mots sur le 20ème congrès du PCUS qui, outre la «déstalinisation» et son prétendu passage au communisme, relevait sa conception du travail à ce stade: «... le travail et la discipline ne seront plus une corvée pour se transformer en véritable activité créatrice, en une source de joie.»
Les commentaires et les interprétations donnés à cette phrase dans la publication des «Etudiants Communistes» à cette époque, loin de considérer que le communisme ne libère pas le travail de son aspect aliénant ni ne le rend attrayant, pas plus qu'il n'en fait un agrément mais, au contraire, en assure la suppression par le développement des forces productives et l'abondance qui en résulte afin de laisser toute la place à la créativité individuelle et collective, ces commentaires faisaient du travail sous le communisme le premier besoin de l'homme, valeur propre au communisme. Le travail devenait ainsi «le meilleur obstacle à une société d'abondance dégénérant en société d'anarchie et de paresse» (sic).
Cette ligne politique au service de l'URSS impliquait de facto de renoncer ouvertement à toute lutte «classe contre classe»5. Cette renonciation qui n'a plus rien de tactique ni de stratégique est à l'origine de la scission du soi-disant mouvement communiste international sur laquelle je reviendrai ultérieurement.
Il faudra la dite «grande grève» de 1960-61 pour rappeler cette vérité fondamentale que la lutte de classe ne connaît aucun répit et fait fi des ambitions des partisans d'extrême-gauche du capital, de même que la paix sociale demeure toujours la guerre du capital contre le prolétariat.
En l'occurrence la mention «extrême-gauche» n'est même plus guère d'application au PCB dont le bureau politique au cours de cette grève préconisait comme riposte à l'offensive du capital des démarches et des conversations avec des mandataires de la majorité, qualifiant d' «ultra gauchistes» les propositions de marche sur Bruxelles et d'abandon de l'outil, pourtant approuvées par des centaines de milliers de travailleurs. Il alla même jusqu'à se désolidariser des grévistes dont la colère s'était traduite par les dégâts causés à la nouvelle gare des Guillemins à Liège.
Comme l'écrivait très sérieusement l'un des dirigeants du PCB à l'automne 1959, la solution aux problèmes posés par la question coloniale, la paix et la situation matérielle de la classe ouvrière exigeaient «la transformation profonde de la politique gouvernementale .»
Sur le plan social le parti se préoccupe à l'époque de la situation dans le Borinage, de la crise charbonnière et des fermetures. Une série de grèves partielles vont précéder celle générale de 1960-61.
Relevons à ce propos quelques phrases éclairantes que livre «le parti» à ses partisans lors de la fête du «Drapeau rouge» en 1959 et qui pourraient être celles de n'importe quel social-démocrate ou libéral actuel: «Le relèvement général du niveau de vie, la protection contre les licenciements et les fermetures, la sécurité d'existence, la sauvegarde des richesses économiques du pays (sic) et l'adaptation de l'appareil de production du pays aux nécessités nouvelles (sic), sont les impératifs qui se dégagent des actions ouvrières multiples qui se développent depuis des mois .»
Et c'est dans la même veine qu'on peut lire dans le périodique «EN AVANT», organisation étudiante du parti, à propos des enseignements politiques de la grève de 1960-61: «Dans les limites des possibilités offertes par la démocratie bourgeoise, l'action des masses rend nécessaire de s'orienter vers des solutions nouvelles et audacieuses (sic) pour résoudre les problèmes économiques et sociaux de la Belgique, la structure économique belge doit être transformée. Au lendemain de cette grande grève, pour faire un pas décisif dans la voie vers le socialisme et saper les positions clés du capital financier, le mouvement ouvrier peut exiger le droit de participer activement à la gestion de l'économie.»
Après avoir établi «clairement [que] ce qui est en cause [ce] n'est pas le principe de l'Etat belge mais le problème de l'appropriation de son armature (sic)» (Memorandum sur le «Mouvement populaire wallon» 1961 - Jean Terfve), le PCB se déclare partisan du fédéralisme comme «le moyen d'assurer à la Belgique une existence plus stable, plus équilibrée, au sein de laquelle les monopoles n'auront plus la possibilité d'utiliser à leur profit les oppositions à caractère national qu'avive la forme unitaire actuelle de l'Etat belge .» ( Projet de thèse 44 , 14ème congrès, 1963 ).
On ne peut plus limpidement confirmer ouvertement son renoncementà ce qui fonde le communisme: l'abolition de l'Etat, ni faire preuve de plus de naïveté (ou de mauvaise foi ) quant aux métamorphoses possibles du capital.
Quand par la voix de son secrétaire national (1961) le PCB se considère comme la gauche «dans le mouvement ouvrier de masses constitué par les organisations de l'action commune socialiste» (FGTB-mutuelles-coopératives ), susceptible de s'opposer à «l'idéologie capitularde de la social-démocratie qui a submergé le mouvement ouvrier», il révèle non seulement son degré d'intégration dans le système mais surtout son rôle de fossoyeur de la révolution puisqu'il mise sur l'attrait du communisme comme seule alternative au capitalisme pour mieux fourvoyer le combat prolétarien.
De 1962 à 1965, des problèmes personnels me firent prendre des distances avec le militantisme et c'est en spectateur que je suivis les péripéties de la scission de l'internationale stalinienne et ses implications en Belgique, me limitant à prendre connaissance des thèses en présence pour finalement faire miennes celles des Albanais et des Chinois et m'engager dans l'aventure grippiste avec les yeux fixés pour un certain temps sur Tirana et Pékin.
Ce qui m'amena à faire ce choix fut d'une part des positions théoriques qui me semblaient renouer avec les principes de la Révolution d'Octobre (marxisme-léninisme contre révisionnisme ), et, d'autre part, le radicalisme organisationnel et programmatique des oppositionnels par rapport au plat et mou réformisme des Kroutchéviens.
Les années qui suivirent me convaincront que derrière le radicalisme, les appels à la lutte de classe contre toute coexistence pacifique, ce n'était que vaine tentative de repeindre en rouge la façade, mais il fallu encore surmonter d'autres scissions plus gauchistes à la suite de la «grande révolution culturelle prolétarienne chinoise» et de mai 1968: après le grippisme ce fut le maoïsme. Mais avant d'en arriver là, j'essaierai de montrer en quoi la scission grippiste et son PCB bis d'avec le révisionnisme kroutchévien à la sauce belge, ne fut que formellement organisationnelle tout en renouant avec un stalinisme pur et dur .
La minorité, tout en partageant l'analyse du rapport de force au profit du camp «socialiste», dénonçait comme trahison du marxisme-léninisme, les stratégies et tactiques qui en découlaient. Elle en attribuait la cause au changement de cap depuis 1953 (mort de Staline) et sa dénonciation au 20ème congrès par Kroutchev et les siens. S'alignant sur les positions du PC chinois et du Parti du Travail d'Albanie, les dissidents considéraient que le camp impérialiste n'était qu'un «tigre de papier», un «colosse aux pieds d'argile», fort en apparence mais faible en réalité à l'inverse du prolétariat et des forces révolutionnaires. Il ne pouvait donc être question pour ces inconditionnels du marxisme-léninisme de coexister pacifiquement avec l'ennemi de classe au détriment de «l' internationalisme prolétarien» dont ils prétendaient se revendiquer, ennemi de classe qu'il fallait mépriser au point de vue stratégique mais dont il fallait tenir pleinement compte du point de vue tactique. S'ils refusaient formellement de composer avec l'impérialisme et de renoncer à la dictature du prolétariat (en réalité contre le prolétariat), ils ne faisaient, là où ils n'étaient pas au pouvoir, en tant que concurrents électoraux des majoritaires, que radicaliser un combat se situant sur le même terrain: défense de la démocratie, parlementarisme, antifascisme, étapisme et frontisme.
Notons cependant ce qu'écrivait en 1964 Jacques Grippa, secrétaire du C. C. du PCB «pro-chinois» dans «Théories et pratiques des révisionnistes modernes» (Ed. Pékin - 1965) en dénonçant leur légalisme sans être en mesure lui-même d'aller audelà dans la clarification de l'essence de la démocratie comme dictature du capital: «...le capital emploie et emploiera une double technique: d'une part la «démocratique», «authentique», «véritable»; d'autre part la répression, la terreur contre-révolutionnaire poussées éventuellement à leur forme la plus sanglante, le fascisme.»
Grippa se range, en effet, à la position de Lénine sur la démocratie: «De même qu'il est impossible de concevoir un socialisme victorieux qui ne réaliserait pas la démocratie intégrale, de même le prolétariat ne peut se préparer à la victoire sur la bourgeoisie s'il ne mène pas une lutte générale, systématique et révolutionnaire pour la démocratie (...) La domination du capital financier, comme celle du capital en général, ne saurait être éliminée par quelque transformation que ce soit dans le domaine de la démocratie politique (...).Mais cette domination du capital financier n'abolit nullement l'importance de la démocratie politique en tant que forme libre, plus large et plus claire de l'oppression de classe et de la lutte des classes.» (Lénine - Oeuvres complètes, T.22, pp.156-157).
Sur le plan interne, la scission grippiste stigmatisa les erreurs et les trahisons des révisionnistes lors de la grève de 1960-61: alors qu'un million de prolétaires avaient arrêté le travail, le PCB avait préconisé l'organisation de délégations vers les parlementaires et estimé aventuriste et ultra-gauchiste l'idée d'une marche sur Bruxelles.
De même, les scissionnistes opposaient aux thèses révisionnistes de la transformation par étapes de la société capitaliste en société socialiste par la réalisation d'une série de réformes de structure, la conception suivante: «La nationalisation socialiste est l'uvre de la révolution socialiste, dans les conditions crées par le pouvoir de la classe ouvrière et de ses alliés, dans les conditions de la dictature du prolétariat. La nationalisation socialiste réalise «l' expropriation des exploiteurs»; par elle les moyens de production deviennent la propriété du peuple entier.» (Marxisme-Léninisme ou révisionnisme, J. Grippa - 1963). Ainsi l'économie capitaliste sera remplacée par l'économie socialiste!
Derrière ce radicalisme de façade et de réalisation du socialisme dans un seul pays, on est loin du programme communiste comme abolition de la valeur se valorisant à l'échelle mondiale.
Partisan de la paix sociale et du pacifisme bêlant, le PCB perdait toute crédibilité révolutionnaire et se voyait contesté sur sa gauche par un PCB bis prônant une phraséologie gauchisante et un activisme forcené, à point tombé pour fourvoyer le prolétariat dans de nouvelles impasses. Incapable de rupture classiste, attribuant, en bon disciple de Staline, ses échecs à des comploteurs anti-parti , «se renforçant en s' épurant», traitant ses exclus de flics-gangsters-fascistes-provocateurs-agents de la C.I.A.-opportunistes-trotskystes-nationalistes-chauvins, ce parti finira à la poubelle de l'histoire .
Que ce soit lors de la scission de 1963 ou de celles qui suivirent, nombreux furent les militants animés d'une volonté révolutionnaire de rompre avec des organisations qui n'avaient de communiste que le nom, pour reconstruire un parti prolétarien. A défaut d'entamer un processus de remise en cause des théories et pratiques du passé, les divergences et oppositions internes ne pouvaient que dégénérer en règlement de comptes. Outre le fait que les insultes et injures se substituaient aux clarifications, les défauts et faiblesses individuelles, ignorés chez les inconditionnels, étaient dénoncés chez les contestataires comme la cause de leur «trahison». La ligne de démarcation était la fidélité au Parti (et donc synonyme de promotion). Pour les uns, cela signifiait soumission à l'organisation en tant que telle, à sa direction, voire à son dirigeant bien aimé national ou international. Pour les autres, c'était la sacro-sainte ligne idéologico-politique que l'organisation se devait d'avoir.
Nous critiquions l'absence de démocratie au sein du parti, considéré comme une fin en soi extérieur au prolétariat («le parti a toujours raison» même contre le prolétariat ) et non comme un moyen au service du peuple. C'était la conception que nous avions à l'époque: le parti comme outil pour apporter à la classe la conscience et la connaissance de la science marxiste-léniniste. Mais n'est-ce pas en définitive la même chose exprimée différemment, sans rapport avec celle qui me fut difficile à assimiler, à savoir: la tendance historique du prolétariat à s'organiser en classe donc en parti ? Certains (dont la majorité des étudiants et des jeunes), estimèrent que la notion de «Parti» avait été galvaudée par des erreurs de ligne politique et des méthodes de direction incorrectes dont ils essayèrent de trouver les causes en remontant dans l'histoire du PCB, notamment à partir de 1943 (date de la capitulation politique de la direction du PCB devant les nazis après son arrestation par ses derniers) et de ses prises de position dans les années d'après-guerre (participation gouvernementale...). Refusant la dénomination de «parti» pour celle de «mouvement», c'est à partir de cette forme d'organisation plus modeste que cette tendance voulait constituer l'avant-garde en enrichissant la pratique marxiste-léniniste par la pensée Mao-Tsé-Toung! D'où leur appellation de «maos-spontex». Ils seront, avec d'autres jeunes, à l'origine d'U.U.U. (Union-Universités-Usines ) et de «La Parole au Peuple». Je partageais cette nécessité de réexaminer l'histoire du parti mais tout en le continuant et à la condition d'opérer un profond mouvement de rectification. A cette condition, je pris parti pour l'aile «partidaire» (le PCB (M-L) qui deviendra le PCMLB et s'unifiera fin 70 avec LC(M-L), les tentatives d'unification avec AMADA ayant avortées ), composée de la majorité des vétérans et des dirigeants du moment qui ne respectèrent pas leur engagement et firent du «grippisme» sans Grippa. Mais le nouvel enthousiasme suscité par la «Grande Révolution Culturelle Prolétarienne Chinoise» fut encore renforcé par les événements de mai 68 qui virent affluer de nouvelles générations de militants.
La prolifération des groupes gauchistes fin 60 et dans les années 70 résulte, comme approché plus haut, du manque de radicalité des syndicats et des partis dits ouvriers, de leur insuffisante capacité, ainsi que de celle de leurs scissions, à encadrer la montée des luttes qui se radicalisaient. La fin des «golden sixties» et le début de la récession réactivèrent les luttes ouvrières : les grèves sauvages des mineurs du Limbourg, celles des dockers d'Anvers et de Gand, des métallos de Michelin, de Citroën, de Clabecq.
Ce rôle d'encadrement sera donc joué par l'extrême-gauche qui, cherchant à gagner à elle des délégués syndicaux combatifs pour développer un syndicalisme de base, compensera sa faiblesse organisationnelle, due à sa groupusculisation, par un radicalisme verbal, voire un activisme agressif, mais aussi par une réactivation de l'idéologie antifasciste, en recourrant au culte de la résistance antinazie. En France par exemple, par la voie de Dominique Grange, on se proclamait, en chantant, les «nouveaux partisans, franc-tireurs de la guerre de classe», célébrant ainsi les positions du réformisme armé.
Je n'analyserai pas dans le détail les nombreux groupes qui, tantôt en rivalité, tantôt en recherche d'unité, marquèrent ces années de «rêves et de poudre» depuis leur «irrésistible ascension» jusqu'au reflux du «prurit révolutionnaire», et de l'échec de la théorie frontiste des «Trois Mondes» à l'origine de la scission sino-albanaise et de leurs inconditionnels respectifs.
En gros, tous les courants se réclamant du marxisme-léninisme et du maoïsme, quelles que furent les dénominations qu' ils s'attribuèrent les uns aux autres (néos-révisionnistes, spontanéistes, anarcho-syndicalistes, intellectuels petit-bourgeois ...) ou leurs divergences quant à la conception du parti, de l'histoire du mouvement ouvrier..., peuvent tous être peu ou prou qualifiés de staliniens, se revendiquant de la 3ème internationale. Leur radicalisme verbal et leur activisme violent résulte d'une impatience à changer les choses et de l'enthousiasme suscité par la «Grande Révolution Culturelle Prolétarienne Chinoise» et mai 68.
Les affrontements en Chine nous apparaissaient comme un nouvel Octobre dans les conditions du socialisme pour éviter, via l'appel aux masses, la dégénérescence bureaucratique du parti et, par voie de conséquence, la restauration du capitalisme comme en URSS et dans ses vassalités, et permettre ainsi un bond qualitatif vers le «communisme». On vit même des trotskystes saluer la «Grande Révolution Culturelle Prolétarienne Chinoise» au début. De plus, des militants trotskystes et maoïstes manifestèrent côte à côte leur soutien au FNL vietnamien, unis pour condamner le pacifisme bêlant du PC orthodoxe et autres réformistes.
Ce qui unissait sans doute ces jeunes révoltés que nous étions, c'étaient les aspects anti-autoritaires contre des organisations sclérosées qui se substituaient aux masses et à leurs besoins, ainsi que l'impérieuse nécessité d'abolir le capitalisme. Aveuglés et séduits par des mots d'ordre tels que «feu sur le quartier général de la bourgeoisie au sein du parti», l'on se refusait de voir que le Staline chinois manipulait les révolutionnaires, opposés en groupes rivaux de gardes rouges, pour liquider ses adversaires et concurrents sur sa droite comme sur sa gauche.
Bien qu'à l'époque j'étais convaincu que Mao contribuait au développement du marxisme-léninisme (que j'assimilais alors à la démarche révolutionnaire), je considérais déjà cependant qu'en Belgique se placer sous l'autorité de sa pensée ne pouvait se limiter à citer partout et à tout bout de champ ses oeuvres, comme cela se faisait, pour pallier notre incapacité à renouer avec l'invariance du communisme, mais qu'il fallait en tirer les enseignements utiles à notre lutte. De même je m'inquiétais, derrière les formulations à la chinoise, du manque de rigueur marxiste-léniniste de certains articles de Pékin Information. Ainsi par exemple, pour les prétendus matérialistes que nous étions, cela nous faisait dresser les cheveux sur la tête (qu'on avait finalement perdue) que d'accepter que la guérison de malades en Chine soit due au remède miracle de la pensée Mao Tsé Toung (cf. Pékin Information N°51 - 1967).
Ce n'est qu'au fil du temps que les illusions se dissipèrent, notamment avec des lectures comme Le Tigre de Papier 6 et Révo. Cul. dans la Chine pop. 7 qui contribuèrent à démystifier l'aventure maoïste et sa mystique.
Entretemps, les critiques que j'adressais à la presse et aux méthodes de mon organisation qui se parjurait en rejetant toute rectification qu'elle avait prônée, furent vaines et me valurent suspicion et dénigrement de la direction d'un parti qui perdait le peu de crédibilité acquise lors de la conférence de La Louvière en 1967. Fin 1968, je claquais la porte pour cependant encore pendant de nombreuses années papillonner dans le milieu marxiste-léniniste à la recherche du groupe dont les positions autoriseraient la reconstruction du parti du prolétariat.
Ce qui précède explique, sans doute partiellement, le rejet ou la critique des organisations existantes et l'éclosion des groupes gauchistes, groupes dont l'incapacité à se réapproprier des positions de classe constitua pour la bourgeoisie une nouvelle occasion de renforcer sa domination.
Remarquons que le reflux de l'après mai 68 et la mise au pas en Chine signifieront le déclin du gauchisme à travers la fuite en avant de l'aventure du réformisme armé, qualifié par la bourgeoisie de «terrorisme» pour masquer sa propre terreur.
Seul le PTB (ex AMADA-TPO) se maintiendra au prix d'un opportunisme à tout vent, après avoir phagocyté les résidus marxistes-léninistes et s'être servi des organisations de masse comme courroies de transmission pour ses ambitions politiques.Quant à sa participation aux élections, ce groupe pratiquait déjà à l'époque le racolage sur ses listes, et à l'aide de n'importe qui, pour avoir le plus grand nombre de candidats et rafler des voix qu'il alla même jusqu'à qualifier de communistes!
Tous ces groupes gauchistes (les deux PCMLB, AMADA-TPO-PTB, et aussi AC, UCMLB, la Parole Au Peuple, OC, L'ETINCELLE, LC, PCR, CCB....) se caractériseront par un suivisme des positions chinoises et/ou albanaises. Tous, critiques ou pas de la période stalinienne, se revendiquent de la 3ème internationale, même si certains (UCMLB et AMADA) vont jusqu'à nier l'existence d'un parti communiste en Belgique avant leur propre apparition. Mettons en avant, dans le désordre chronologique, quelques unes de ces positions:
* condamnation des deux superpuissances se partageant le monde et surtout de l' URSS, la plus agressive des deux, d'où l'invention chinoise de la théorie des Trois Mondes (alliance du «tiers monde» et des pays européens contre les deux superpuissances ) qui sera l'une des causes du schisme sino-albanais
* le dit «Tiers Monde» est en ébullition et les luttes de libération nationales ouvrent la voie à la révolution socialiste
* la lutte de classe contre une «démocratie en voie de fascisation» doit se radicaliser
* défense de l'indépendance nationale et de la démocratie, antifascisme
* il faut se lier à la classe ouvrière et s'implanter dans les usines («prolétarisation» des intellectuels et des étudiants par «l'établissement»)
* sur la question syndicale, coexisteront des positions visant à créer une opposition révolutionnaire dans les syndicats ou d'y intervenir sans chercher à les récupérer ou encore de proposer de pratiquer un syndicalisme révolutionnaire dans ou en dehors des syndicats jaunes. Quant au PTB, lorsqu'il s'intitulait à ses débuts AMADA-TPO, il se présentait comme l'organisation des comités de lutte, représentant alors les délégués syndicaux sous l'aspect de cochons porteurs de brassards FGTB-CSC, considérant les appareils syndicaux comme intégrés à l'Etat. Cette position anti-syndicale fut rejetée par la suite comme «ultra gauchiste» et les comités de lutte taxés d' «anarchistes». Il vise aujourd'hui à régénérer l'appareil syndical en soutenant les délégués «combatifs» et les «bons» permanents.
* participation conditionnelle aux élections, mais pas de refus de principe
A propos des prétentions social-nationales de la Chine et de l'Albanie, voire de leur chauvinisme ultranational (par exemple, défense de leurs intérêts nationaux au détriment de ceux du prolétariat mondial et de ses luttes locales partielles), il ne faut pas s'étonner si elles trouvèrent quelques échos de sympathie à l'extrême droite, parmi les adeptes «rouge-brun» d'un national-socialisme révolutionnaire, d'où les qualificatifs de nouveaux nationaux-bolcheviks ou nazis-maos. A telle enseigne qu'il y eut même quelques tentatives d' infiltration de groupes marxistes-léninistes par ces néo-nazis 8.
Le credo des marxistes-léninistes était : faire une analyse concrète de la situation concrète pour déterminer la ligne. Et voilà la porte ouverte pour justifier tous les tournants opportunistes et nier les principes invariants du communisme : abolition du capital, donc du salariat et de la démocratie; internationalisme et défaitisme révolutionnaire contre tout nationalisme et toute défense nationale; dictature du prolétariat contre la valeur; contre l'Etat sous toutes ses formes.
Des organisations comme l'UCMLB ou le PCMLB tentent de masquer leur anticommunisme lorsqu'elles prétendent concilier l'autonomie du prolétariat contre la bourgeoisie avec un front pour l'indépendance nationale contre les deux superpuissances. AMADA (devenu PTB en 1979 et qui se prétend le nouveau parti communiste de masse) quant à lui ne se donnait même plus cette peine. En 1976, dans le cadre de l'alliance contre les USA et surtout contre l'URSS, il appelait au renforcement de la défense nationale par l'armement général des ouvriers et des travailleurs ainsi qu'à la dissolution de la gendarmerie, tout en menant parallèlement la lutte contre la bourgeoisie pour une démocratie populaire (la dictature démocratique populaire étant une étape préalable à la dictature du prolétariat!). Pour AMADA, les facteurs de guerre dominaient, et pas ceux en faveur de la révolution. Au cours de cette étape de «démocratie populaire», les entreprises de la «Belgique patriotique» ne devaient pas être expropriées afin de concentrer tous les coups contre le social-impérialisme russe! Comme diversion anticommuniste, qui dit mieux ?
Je crois ne pas exagérer dans la lecture «psychologique» de la formation de ses chefs en attribuant le don des dirigeants d'AMADA -PTB pour les virages politiques à 180 sans auto-critique, à la formation acquise dans les collèges et universités catholiques où ils ont intégré avec profit le sens de l'adaptation aux contingences et celui du prosélytisme.
Il demeure que ce que toutes ces organisations ont en commun, quelles que fussent leurs dénominations ou leurs divergences, ce sont les changements de ligne politique selon l'opportunité du contexte et, surtout, en fonction de leur alignement sur l'un ou l'autre parti père du moment.
Pour les marxistes-léninistes, le socialisme est en réalité une étape transitoire où la dictature du prolétariat n'abolit ni le salariat ni l'Etat, mais renforce l'appareil de ce dernier qui est l'enjeu du pouvoir. Autrement dit, le communisme est remis aux calendes grecques. Il n'est jamais question d'abolir la valeur d'échange, ni dans le socialisme, ni dans le communisme.
Pour les marxistes-léninistes, seules les contradictions interimpérialistes mènent à la guerre; ils ne conçoivent pas que tous les Etats capitalistes sont impérialistes et que fondamentalement l'impérialisme comme «stade suprême» du capitalisme ne change rien à la contradiction entre bourgeoisie et prolétariat, une contradiction qu'ils qualifient de «principale», les contradictions «secondaires» justifiant leurs alliances opportunistes et leur abandon de fait de la lutte du prolétariat pour le communisme. Quand la bourgeoisie fait la guerre, elle détruit sa surproduction et les forces de travail excédentaires du temps de «paix» sont contraintes de contester le système pour survivre et s'émanciper (valorisation et dévalorisation du capital étant les deux aspects du développement de la valeur).
Le «stade impérialiste» met donc, en pratique, au rancart la contradiction soi-disant principale entre prolétariat et bourgeoisie, dont la liquidation doit être l'exclusive implication des «communistes».
Les marxistes-léninistes ont une conception sociologique de la classe ouvrière : seuls les éléments qui sont à l'origine de la production matérielle sont considérés comme en faisant partie. Les petits employés constituent un semi-prolétariat; la petite bourgeoisie et les intellectuels sont des alliés possibles.
Pour le communisme au contraire, le prolétariat se compose de couches différentes de salariés qui sont contraints de vendre leur force de travail, produisent de la plus-value ou contribuent à la réaliser, mais qui ne se réalisent en tant que prolétariat qu'au travers de leur lutte pour leur émancipation.
Quant à leur fonctionnement interne, tous ces groupes gauchistes se réfèreront au centralisme démocratique : soumission servile à la ligne et à la hiérarchie de l'organisation et, en cas de divergence et de refus d'autocritique, l'exclusion comme traître, renégat et ennemi de classe, à moins de prendre les devants en quittant l'organisation. Pas de remise en cause ni d'analyse des erreurs, subjectivisme et triomphalisme, malveillance et esprit d'inquisition. Le parti qui a toujours raison est conçu comme une organisation extérieure à la classe (qui doit donc s'y lier ) pour lui apporter la connaissance et lui montrer la voie de la révolution car elle est incapable de dépasser son spontanéisme et ses revendications «immédiates». Le militant est un soldat de type religieux qui doit faire preuve de volontarisme; en tant qu'individu il ne s'appartient plus et devient un rouage de l'organisation qui privilégie l'activisme à la formation. L'insuffisance de cette dernière justifiant à chaque fois les insuccès et les déviations de la ligne toujours juste, elle. Bref, un bon camarade est un camarade fidèle et dévoué. Amen !
Que ce soit avec Jacques Grippa ou avec Fernand Lefèvbre, les dirigeants respectifs du PCB bis et du PCMLB illustreront leur conception du centralisme démocratique en méprisant eux-mêmes ces consignes face à leurs propres troupes, voire en s'autorisant à communiquer des informations internes au parti à des éléments extérieurs à celui-ci, alors qu'elles seront tues aux membres de l'organisation. Il y a gros à parier que le gourou du PTB, Ludo Martens, ait des pratiques similaires.
Quelques considérations encore avant de clore cette période dont je suis sorti avec une dépression aussi profonde que le furent mon euphorie et mon enthousiasme.
La première a trait à la formation politique. Pratiquement nulle, à mon entrée à l'UNEC, j'y reçus quelques notions de base. La scission de 1963 m'a contraint à la lecture de documents en provenance des camps soviétique et chinois, en plus de la lecture régulière de l'hebdomadaire grippiste La Voix du peuple, l'activisme laissant peu de place à l'étude. A part l'existence du trotskysme, j'ignorais évidemment tout de la gauche communiste. Ce qui me fascinait à l'époque, c'était l'histoire des luttes antifascistes (Espagne, 40-45), ensuite l'histoire du parti en Belgique (quasi pas d'écrits ) et en France, mais aussi celle de l'Albanie pour sa lutte de libération nationale et sa construction du socialisme comme «forteresse encerclée par le capitalisme».
Avec le mouvement maoïste, mon intérêt engloba aussi l'expérience chinoise. Outre la lecture de la presse de mon organisation à laquelle je collaborais épisodiquement, je lisais de façon assidue des «classiques» du marxisme-léninisme : Lénine, Staline, Mao, Enver Hoxha et, bien sûr, le «Manifeste du Parti Communiste», «Salaires, Prix et Profits», «L'Impérialisme, Stade suprême du Capitalisme», «L'Etat et la Révolution», et bien entendu, «Le Gauchisme, Maladie infantile du Communisme», plus quelques autres ouvrages d'ordre didactique sur la dialectique et la philosophie matérialiste (Les Lois fondamentales de l'économie capitaliste de Baby ou encore Principes élémentaires de philosophie de Georges Politzer) etc.
En fait, bien plus tard, à la suite de nombreuses lectures et de rencontres dues au hasard des circonstances qui me sortirent et de la déprime et de la résignation (tout reniement étant exclu), je pris conscience que mon militantisme était sous-tendu par une réflexion idéologique qui reposait sur une compréhension défigurée des écrits de Marx. Je faisais mienne une interprétation vulgaire, réduisant, par ignorance de l'ensemble de sa démarche, le caractère unitaire de son oeuvre, pour les besoins de sa présentation, à une simple science historique, à une théorie sociologique ou encore à une doctrine «économique». Cette absence de vision globale justifiant, par des citations de ses écrits, des stratégies et tactiques contre-révolutionnaires, alors qu'il en allait d'une totalité subversive.
Si je creuse quelque peu ce type d'engagement, je dois constater qu'en tentant de prendre le contre-pied de l'égoïsme et de la mesquinerie terre à terre petite bourgeoise, j'épousais une conception d'ordre religieux, expiatoire. Militer pour la cause signifiait l'oubli de soi, l'effacement de sa subjectivité au nom de l'émancipation collective et d'abstractions (classe, parti, prolétariat) sans comprendre leur interaction dialectique, puisqu'il s'agissait de conquérir l'épanouissement de chacun afin de réaliser celui de tous. Faire éclore en chacun de nous son humanité aliénée, libérer notre vie des entraves à son plein épanouissement implique évidemment l'abolition du capitalisme. Mais ce que je veux dire, c'est que la société n'est jamais que la représentation des relations humaines, de la même façon que l'homme est l'abstraction des êtres vivants. J'entends par là que l'Homme avec un grand «H», au sens des «droits de l'homme», n'est qu'une fiction qui fait abstraction des êtres vivants (les hommes) appartenant à des classes antagoniques (bourgeoisie-prolétariat) se concurrençant (travailleurs-chômeurs)... Ce sont ces derniers qui comptent et d'eux qu'il faut partir.
Paraphrasant le philosophe Michel Henry, je dirais qu'à l'instar de la matière et de l'esprit, homme et société ne s'opposent pas comme deux termes en soi opposés, mais ne s'opposent que dans l'unité d'une même essence, dans l'unité de l'abstraction. Ces deux termes sont distincts et forment pourtant une unité. A l'époque, ma réflexion était guidée par des concepts sociaux et économiques en tant que catégories abstraites, alors qu'elle aurait dû l'être par les individus vivants, leur pratique sociale et leurs intérêts communs. C'est pourquoi l'intérêt pour l'autre, son écoute n'avait d'importance réelle que dans la mesure où il était susceptible de partager la même finalité. S'organiser impliquait «le sacrifice de l'individu à la cause transcendante du socialisme» (Alain Bihr). Rien à voir (ni l'un ni l'autre d'ailleurs ...) avec la lutte pour l'associationnisme prolétarien. Je passais de l'activisme empirique à son contraire, l'intellectualisme, au lieu de m'élever du concret vers l'abstrait, du particulier vers le général.
Le stalinisme se justifiait au nom du réalisme et de l'efficacité alors qu'il piétinait notre subjectivité, notre irrationnel dans ce qu'il apporte d'intuitif et d'imaginaire. Privilégier la raison à l'intuition procède d'une démarche réductrice, car la pensée comme moyen d'expression de notre humanité est à la fois manifestation rationnelle et intuitive. Intellect et sensibilité sont identiques dans leur essence. En effet, nous ne connaissons pas la réalité objective extérieure par ce qu'elle se reflèterait telle quelle, mécaniquement dans notre cerveau, mais à la suite d'un processus de construction à partir de nos perceptions. Pour en arriver là, il a fallu rompre avec le Lénine philosophe et son «empiriocriticisme», ce que la lecture des écrits de la gauche communiste et plus particulièrement d' A. Pannekoeck 9 me permit de faire. Disons à ce propos que les textes de la gauche communiste n'étaient aucunement mis à l'index mais étaient simplement ignorés, inexistants. La contre-révolution bourgeoise (de droite ou de gauche) est d'une redoutable efficacité.
J'étais donc entré en politique comme d'autres entrent en religion. Mes emblèmes étaient le marteau et la faucille comme le glaive et le crucifix étaient les armes des croisés et des missionnaires. Je croyais voir dans les régimes capitalistes fortement étatisés des pays de l'Est, un stade socialiste, préparatoire à l'édification du projet communiste. Nous étions, non pas les compagnons de K. Marx, mais ceux de Hegel et de Ludwig Feuerbach. Je me replongeai donc dans les écrits de Charlie, mais abordai aussi ceux de W. Reich, et du «camarade vitamine» M.Bakounine, le premier interprété par les staliniens et les deux autres vilipendés et méprisés.
Quant à ma motivation et à mon implication, pas très forte chez les révisionnistes (rien n'y poussait d'ailleurs), elle le fut beaucoup plus avec les grippistes qui étaient les militants les plus dynamiques, ceux qui avaient scissionné et dont le passé de dirigeants, de partisans armés, de vétérans du parti m'en imposait, me subjuguait. L'organisation grippiste avait développé un très fort sentiment d'appartenance et de réelle solidarité dans le combat quotidien et face à la répression, mais le rejet était du même acabit : tout ou rien. Je n'ai plus retrouvé cette atmosphère dans les deux organisations gauchistes ultérieures. Trop peu attentifs à la sécurité, négligeant la famille, l'autre n'avait d'intérêt que dans le mesure où il pouvait servir la cause. Notre analyse qui se voulait être une analyse concrète de la réalité concrète, n'était en réalité qu'un calquage de nos préjugés idéologiques sur celle-ci. Il m'est actuellement clair que si, à la suite de circonstances historiques différentes, nous avions dû participer au pouvoir, soit nous aurions, comme tous les staliniens, collaboré à la répression, soit nous aurions été liquidés pour opposition à la ligne. Je n'ai heureusement connu que l'esprit de coterie, la méfiance pour manque d'esprit servile ou divergences d'opinion, préférant claquer la porte lorsque le dialogue devenait impossible plutôt que de consentir à des auto-critiques bidons ou tenter de constituer des fractions vouées à la liquidation. Dans une organisation pseudo-communiste ou qui dégénère, on se soumet ou on se démet, c'est l'enseignement que j'en tire. D'où ma méfiance pour tout ce qui est parti formel.
Par rapport au révisionnisme kroutchévien et au radicalisme grippiste, ce que le maoïsme et mai 68 ont apporté pour renforcer notre motivation militante et notre enthousiasme activiste, c'est le fait qu'ici, il ne s'agissait plus simplement d'améliorer les conditions matérielles de la classe ouvrière, de «révolutionner» le système en restant dans la logique de l'économie marchande, mais bien de créer un homme nouveau dans un monde nouveau. Hélas, pour ce faire, en toute bonne foi, nous avons persisté dans des impasses sans lendemains.
Il m'a fallu faire le bilan pour comprendre que ce n'était pas sur le but à atteindre que je m'étais trompé, mais sur les moyens d'y parvenir. Ce qui m'aida beaucoup, c'est le retour sur l'histoire du mouvement communiste et également la lecture d'itinéraires individuels de militants qui rompirent avec le stalinisme mais qui, au mieux, retournaient au bercail réformiste, et dont la marche arrière m'angoissait, me faisant entrevoir qu'il n'y avait pas d'autre issue. Dans ce cas, plutôt aller cultiver mon jardin que de suivre le même chemin !
Comme signalé plus haut, le hasard des rencontres, me fit faire un pas qualitatif en me permettant de prendre connaissance d'expériences telles que celles de Ciliga, Valtin, Makhno, de la gauche communiste ( KAPD, etc.), mais aussi d'étudier les positions de l'ultra-gauche, les ruptures de classe au sein de l'anarchisme, tellement disqualifiées à droite comme à gauche, bref de reconstruire une mémoire ouvrière obscurcie par 40 ans de contre-révolution. Le processus de la connaissance est long et les ruptures classistes sont pénibles, comme toute véritable remise en cause. On en guérit, on en sort consolidé, mais les cicatrices demeurent. Je viens de parler de «hasard», mais j'aurais pu parler, comme au début de ce travail, de «déterminisme», car quels que soient les errements, la réalité du capital et de sa société de merde est là pour raviver notre haine de classe.
Je vais cependant tenter de creuser quelque peu les difficultés rencontrées dans ce processus de ruptures, surtout après avoir quitté le territoire du stalino-gauchisme, lorsque je cherchais mon chemin dans une sorte de no man's land mental.
Prendre ses distances avec la militance gauchiste était une opération salutaire même si cela faisait mal par rapport à l'énergie perdue. Mais surmonter le vide qui risquait de s'installer était beaucoup plus préoccupant. Quant à déconstruire les restes de l'idéologie merdique que j' avais encore sous le calot, c'était angoissant: peur de jeter l'enfant avec l'eau sale, peur du vide.
Comment en effet faire mien que Mao, Hodja, Staline ou Hitler, c'était en fin de compte bonnet blanc et blanc bonnet? Comment reconnaître, sans me sentir insulté, que j'avais rejoint objectivement les rangs d'un fascisme rouge?
Il fallait d'abord quitter le terrain de l'émotionnel, me libérer du passé et me «ressourcer» en quelque sorte. Ce toilettage fut d'autant moins net qu'il me fallut me tremper d'abord dans les eaux troubles de ce que d'aucuns appellent le milieu révolutionnaire.
Pour aller à l'essentiel et par souci de clarté et de synthèse, j'énumèrerai ci-dessous ce avec quoi il me fallait rompre pour retrouver le fil rouge et développer les positions de classe.
1. La conception léniniste du parti: substitutionnisme et séparation entre organisation politique et économique de la classe.
2. L'euro-centrisme: surestimation des luttes ouvrières revendicatives et de la capacité révolutionnaire du prolétariat des pays occidentaux et, parallèlement, la sous-estimation du prolétariat des «pays périphériques du capitalisme» soi-disant incapable «d'ouvrir la dynamique de la révolution mondiale». (Cf. Révolution Internationale N°45 CCI -1986)
3. La théorie de la décadence du capitalisme, théorie selon laquelle le capitalisme dans sa phase ascendante permettait la lutte ouvrière pour des réformes dans le cadre du système et rendait possible au sein du mouvement ouvrier l'existence de courants «ni vraiment bourgeois, ni vraiment révolutionnaires» (Cf. Révolution internationale N°44 CCI -1986). Porte ouverte à la justification des alliances interclassistes au détriment de l'autonomie du prolétariat. A contrario, et toujours selon cette théorie, depuis que le capitalisme est entré en décadence «l'obtention de réformes et de succès immédiats, sans lutte pour la révolution, n'existe plus». En réalité, avec cette conception on cherche à donner un fondement à plusieurs prétentions réformistes. Il s'agit d'abord de donner corps à l'opinion selon laquelle la bourgeoisie a pu un moment être un facteur de progrès pour le prolétariat lui-même et que, par conséquent, ce dernier pouvait lui être associé (à la défense nationale, par exemple : Révolution internationale N°49, 77, 78 CCI 1987 et 1994). Il s'agit ensuite, de justifier la prétention du réformisme à être un facteur d' «évolution pacifique», alors que la paix entre les Etats ne signifie jamais que le capital arrête sa guerre contre le prolétariat. Enfin, il s'agit d'avaliser l'idée que la social-démocratie, qui a bâillonné organisationnellement le mouvement ouvrier, a seulement trahi les intérêts du prolétariat, et qu'en conséquence, en dépit de l'expérience historique du prolétariat, il était juste de tenter la reconquête de ce même parti social-démocrate «traître», par un travail oppositionnel de fraction. Cette théorie réfute de fait l'invariance du programme communiste.
4. Une conception idéaliste du prolétariat qui conduit des groupes comme le CCI à considérer des manifestations violentes, spontanées, telles que le pillage de magasins (que ce soit à Amsterdam en 1848 ou en Argentine il y a peu) comme «le fait d'un véritable lumpen prolétariat dont les actions désespérées étaient étrangères à un prolétariat devenu conscient et organisé» (Cf. Révolution internationale N°45 CCI -1986). Cet idéalisme explique sans doute le fait qu'ils ne saisissent pas en quoi la lutte de classe traverse toutes les composantes sociales, qu'il s'agisse du lumpen prolétariat, de la paysannerie ou de l'anarchie. C'est dans la pratique que l'on voit qui est sur des positions de classe. C'est toujours cette même position centriste qui est à l'origine de l'aveuglement quant à la révolte prolétarienne en Irak car «la classe ouvrière y est minoritaire, noyée dans une population agricole ou semi-marginalisée dans les bidonvilles» (Révolution internationale N°65 CCI -1991) et ne peut donc être qualifiée que «d'insurrection des populations chiites du sud de l'Irak» (R.I. 71 - 1992).
5. L'anti-anarchisme et le pro-radicalisme social-démocrate. Décadentisme, idéalisme, gauchisme réformiste amènent aussi ce type d'organisation à prendre non seulement pour argent comptant les erreurs du camp «marxiste» de la 1ère Internationale mais à condamner unilatéralement les «bakouninistes» comme des agents provocateurs au service de la bourgeoisie (R.I.85-1996). Cela pue la répression lénino-stalinienne. Il en va de même de la condamnation globale, selon l'enseignement d'Engels, des «ultra-radicaux», c'est-à-dire des anti-social-démocrates d'hier et d'aujourd'hui et, en contrepartie, l'approbation des concessions faites par les opportunistes réformistes social-démocrates de la 2ème Internationale, voire par leurs successeurs centristes spartakistes et KPDistes sans doute. Et cela au motif qu'elles ne sont pas dépourvues de «critiques authentiques qui doivent être faites aux pratiques et aux théories des partis socialistes» de l'époque puisqu'elles «viennent de l'intérieur du mouvement ouvrier», ce qui ne peut être le cas des «hyper-ultra radicaux anarchistes à la GCI ou WILDCAT». (R.I.84-1996).
6. La sous-estimation de l'internationalisme prolétarien et de la révolution mondiale: par exemple, l'affirmation selon laquelle la paix de Brest-Litovsk était un «pas en arrière» justifié, alors que la vague révolutionnaire se répandait encore et que, comme les faits l'ont démontré en Russie, en Allemagne (mars 1920 dans la Ruhr) et plus tard en Espagne, le prolétariat est certain de perdre quand il perd l'initiative et renonce à l'offensive.
7. La position vis-à-vis de l'Etat. La reconnaissance de la nécessité d'un Etat pendant la période de transition, distinct de la dictature du prolétariat, alors que seule celle-ci est de nature à abolir non seulement le salariat mais tout Etat afin d'empêcher tout retour en arrière. La révolution sociale n'est pas un putsch, mais la réalisation en marche de l'émancipation de l'humanité par celle du prolétariat, il n'y a aucune raison de rétablir l'Etat, comme corps bureaucratique coupé de la vie, répressif, sous peine de rééditer, à une autre échelle, ce qui s'est passé avec l'URSS.
8. Le concept «travail». Enchaîner l'homme au travail relève d'une conception sacrificielle et religieuse, propre à la social-démocratie et au gauchisme. La revendication de son abolition (que concrétise toujours plus le développement des technologies et la croissance des forces productives) est considérée comme «typique de la petite bourgeoisie qui se désintègre et des éléments déclassés» (R.I. 86 -1996). Quand on se revendique du communisme et des apports subversifs de Marx, on devrait savoir que la Gemeinwesen met fin à la division travail-loisir pour son dépassement par l'unique activité humaine.
9. L'incompréhension du fait que la démocratie, qu'elle soit libérale ou totalitaire, manifeste dans tous les cas de figure, la dictature du capital.
En conclusion, si dans un premier temps le dit milieu révolutionnaire me permit de découvrir des aspects de l'histoire du mouvement ouvrier occultés par mon passé (comme d'ailleurs mais à un autre niveau, les thèses situationnistes et celles de certains groupes qualifiés de «modernistes» vinrent enrichir ma réflexion critique), l'analyse et la discussion me révéla que derrière son interprétation tendancieuse du mouvement ouvrier, plus particulièrement de la révolution allemande, ce milieu véhiculait, au nom de la continuité, toutes les scories héritées de la vieille social-démocratie, le rendant incapable d'une rupture radicale salutaire, et entretenait de la sorte la confusion dans les rangs de la révolution.
Force m'est de reconnaître que la question syndicale fut une sorte de dernier bastion de mes conceptions marxistes-léninistes, du fait que le syndicalisme était à la fois mon terrain militant et celui assurant mon gagne-pain. Bien que convaincu de l'intégration des structures syndicales dans le système capitaliste et du clientélisme de nombre de ses militants, je restais encore un certain temps persuadé qu'il fallait affronter cette réalité pour la transformer de l'intérieur, car c'était là que se trouvaient les travailleurs un tant soi peu organisés, et qu'au travers des luttes revendicatives, certains pourraient être gagnés à la révolution. Contre les syndicats, oui, en dehors, oui, mais aussi en dedans, pensais-je, sous peine d'isolement, de marginalisation. Or toute l'expérience historique du prolétariat montre à l'évidence qu'on ne révolutionne pas une organisation bourgeoise de l'intérieur : on se soumet (survie oblige, la tentation kamikaze ou le style crucifié, non merci...) ou on se démet (si on en a les moyens ou la force). En outre, je partageais cette conception léniniste faisant des syndicats des lieux d'organisations des seules luttes économiques et revendicatives, de simples courroies de transmission du parti qui apporte, lui, la science de la conquête du pouvoir, conception réformiste entérinant la séparation de la lutte économique et politique.
D'autre part, pour survivre professionnellement, j'avais été contraint d'investir syndicalement à 100% et devenir dans les faits un permanent syndical d'entreprise. Ma façon d'être (refus de la soumission servile, esprit critique...) renforcée par des prises de position gauchistes me valurent à la fois l'hostilité patronale et celle des bonzes syndicaux, aux yeux desquels je servais toutefois de caution de gauche bien utile à perpétuer l'image d'un syndicalisme «agent de transformation de la société et soucieux de satisfaire les justes revendications des travailleurs».
Ce dernier «carré» finit lui aussi par tomber.
Creusons un tant soit peu cette approche critique qui se développa avec le temps.
Il ne peut être contesté à l'analyse que syndicats et syndicalisme se sont révélés être dans la pratique et dès leur origine des organisations destinées à vider de leur être classiste les premières associations ouvrières (que je ne nomme pas «syndicats» pour éviter toute confusion de genre) en lutte contre le capital et à les encadrer sous la bannière du réformisme, en dépit d'éphémères velléités contestatrices du système. Telle est en tout cas la situation pour la Belgique, puisque la naissance d'associations stables de lutte de classe y est plus tardive qu'ailleurs et que la «Commission Syndicale» de 1898 est une création du POB à majorité réformiste.
Le syndicalisme et ses structures font actuellement, et depuis belle lurette, partie de l'appareil d'Etat. A ce titre il a une double fonction:
1 une fonction de flic, afin de détourner par la dissuasion ou par la répression (chantage, menaces, exclusion) le prolétariat de sa nécessaire autonomie d'action révolutionnaire
2 une fonction de gestionnaire de l'économie capitaliste par l'obtention de réformes qui sous prétexte de transformer la société dans un sens progressiste, ne font que pérenniser le système d'exploitation et d'aliénation en le faisant accepter par le prolétariat.
Son rôle fondamental est donc de négocier la vente de la force de travail, pas de l'abolir.
Dans ces conditions, toute position visant peu ou prou à faire pression sur l'appareil pour le radicaliser ou le récupérer, toute attitude visant à pousser les délégués combatifs contre leurs bonzes (et donc à forger la fiction d'un syndicalisme de base efficace et susceptible de vaincre la bureaucratie), ne peut que perpétuer des illusions, isoler, neutraliser et liquider les éléments subversifs.
Quant à l'explication léniniste justifiant qu'il faut militer là où sont les masses, elle considère erronément que ces dernières sont un potentiel révolutionnaire en soi. En réalité, les masses de syndiqués, même celles des délégués, se caractérisent aujourd'hui par le suivisme et le clientélisme. Et ce sont ces caractéristiques syndicales qui pèsent de tout leur poids sur les luttes ou les réactions de classe qui éclatent ici et là, et qui précisément, si elles ne se libèrent pas du syndicalisme, finissent isolées, sans lendemain ou s'engouffrent naïvement dans la légalité. Les fameuses masses, prises dans les filets du syndicalisme, ne font dans ce cas que perpétuer la lobotomisation de la mémoire ouvrière entreprise par les réformistes, empêchant toute conquête d'une autonomie de classe.
Alors, basta de la prétention à conquérir des masses qui se soumettent à des structures dont la nature est de les désorganiser et de tuer en elles toute manifestation subversive. Basta de cette compassion pleurnichant que malgré tout, face aux agressions patronales, les syndicats demeurent le dernier rempart des travailleurs. Le syndicalisme réconforte les travailleurs, oui, à l'instar de la religion qui console les pauvres ! Dépouillé de tout apparat, les syndicalistes sont bien obligés d'avouer à la fin que leur fonction se borne à convaincre des prolétaires que pour éviter de se faire entuber à sec, il est impératif de négocier de plein gré un complément de vaseline !
En définitive, la réalité du bon délégué se résume à être, volens nolens, une sorte d'assistant social relativement protégé et le syndiqué, un assuré social assisté dont la cotisation donne droits à des services.
Que conclure à présent sinon qu'il ne suffit pas d'être lucide et d'acquérir un certain niveau de rupture, ni de se satisfaire de ne pas s'être fait bouffer par tous ceux qui faillirent «foutre ma révolte au tombeau» (merci Renaud !), ni de condamner ce monde plus dégueulasse que jamais, ou encore de rester persuadé, même si ce n'est pas pour après-demain, qu'il ne dépend que du genre humain de sortir de son inhumanité.
Encore faut-il mettre sa pratique sociale en accord avec son acquis théorique sous peine de régresser.
Encore faut-il trouver en soi la force de surmonter le poids du système et la méfiance à l'égard de toute communauté de lutte, méfiance, voire rejet, intériorisé par une trop longue expérience militante négative.
Mais cette indispensable force n'est pas du volontarisme, elle ne peut surgir et se nourrir qu'au travers des luttes à venir, des luttes que nous imposent immanquablement la terreur marchande et ses larbins, des luttes que nous serons contraints de mener si nous voulons (sur)vivre.
Ruptures et lutte de classeAu-delà des antagonismes interimpérialistes et des luttes de tendances que ceux-ci provoquent au sein des organisations staliniennes, il est important de souligner que les ruptures à l'intérieur de ces partis sont également déterminées, à cette époque, par la lutte de classe qui se développe et s'intensifie un peu partout dans le monde. En effet, à la fin des années 1960, les courants en rupture avec la ligne de Moscou rencontrent à l'extérieur des P«C» de réelles tentatives prolétariennes d'affronter l'Etat; elles se gonfleront de ces forces, s'enfleront de ces mouvements qui critiquent pratiquement la collaboration de classe, jusqu'à provoquer d'importantes scissions au sein des partis staliniens, des scissions qui, bien que partiellement déterminées par l'agitation sociale croissante, ne renonceront malheureusement pas, sur le plan programmatique, au «marxisme-léninisme». Dès lors, plutôt que de se rallier aux forces révolutionnaires qui émergent spontanément des luttes sociales à la fin des années '60, ces noyaux auront pour fonction d'en récupérer les objectifs et le programme, et de substituer leur propre direction à celle -sans doute trop faible et confuse- que tentent de se donner les mouvements épars du prolétariat. |
Le marxisme-léninisme: infaillible comme la bibleL'absence de principes programmatiques est la caractéristique fondamentale du léninisme. Tout est justifié par la sacro-sainte tactique, ce qui rend pratiquement impossible toute discussion sur la moindre des incohérences de son «programme». A l'image des curés qui assurent très tautologiquement que l'existence de Dieu se découvre dans la Foi en son existence, le credo marxiste-léniniste propose le suivi docile des zigzags politiques de Sa Très Sainte Organisation et la répétition bête des explications de ses incompréhensibles changements de cap, comme moyen d'accéder à la Foi léniniste. La justification tactique tient dès lors lieu de programme, le sport favori des marxistes-léninistes consistant à produire ces kilomètres d'explications politiques incohérentes auxquelles ils nous ont habitués, une littérature aussi poussive que massive expliquant tout et son contraire. Les staliniens, par exemple, peuvent très bien avoir dénoncé les fascistes un jour, puis s'être alliés à ceux-ci le lendemain et s'en démarquer à nouveau un peu plus tard, tout cela sera rapidement justifié par la science des «choix tactiques». De même, les social-démocrates présentés hier comme de redoutables «social-fascistes» avec lesquels on ne peut pactiser, se transformeront juste après en autant de respectables partenaires avec lesquels construire le Front Populaire. Inutile d'essayer de convaincre un stalinien qu'il défend l'exact contraire de ce qu'il prétendait la veille, il vous vantera le génie des dispositions tactiques de son organisation, capable de changer de «ligne politique selon l'opportunité du contexte». C'est infaillible comme la Bible!Une intéressante manière d'observer (et de dénoncer) cette méthode est de discuter de Lénine lui-même (où de tout autre «héros prolétarien» embaumé par le marxisme-léninisme). Du point de vue du communisme, l'appel défaitiste révolutionnaire de Lénine à «retourner les fusils contre ses officiers» en 1916 se situe dans le camp de la lutte historique du prolétariat contre toutes les patries, tandis que son refus de continuer la guerre révolutionnaire en 1918 et les accords qu'il signe avec les généraux allemands expriment bel et bien une position historique de la contre-révolution. C'est bien le même Lénine qui a pris ces positions, mais elles sont programmatiquement tout aussi antagoniques que le fait de défendre ou non l'exploitation capitaliste. Pour les léninistes par contre, défaitisme révolutionnaire ou action patriotique, le tout est sanctifié dans «l'intelligence géniale des intuitions tactiques» de Lénine. Plus globalement, les appels prolétariens à transformer la guerre impérialiste en guerre révolutionnaire sont ainsi assimilés sans complexe à la signature d'une paix séparée avec l'Allemagne, à la NEP, à la militarisation du travail, à la répression des révolutionnaires d'Ukraine ou de Kronstadt, bref à toutes les actions que Lénine a menées à l'encontre du prolétariat pour reconstruire l'Etat capitaliste en Russie. Plutôt que d'affirmer qu'il s'agit dans un cas d'une position de classe et, dans tous les autres, de positions tout simplement contre-révolutionnaires, le marxisme-léninisme justifiera l'ensemble des positions de Lénine comme fruit de son «génie tactique». Plus l'antagonisme entre révolution et contre-révolution s'exprimera dans la distance séparant une prise de position d'une autre, plus les marxistes-léninistes salueront «son incroyable habileté à changer de tactique au moment juste». La tautologie des méthodes d'explication religieuses est décidément sans faille. Plus marginalement, et parce que toute religion trouve sa religion contraire, il est encore à remarquer que l'anti-léninisme vulgaire défendra quant à lui «l'exact opposé» des marxistes-léninistes, c'est-à-dire la même chose d'un point de vue méthodologique. Pour poursuivre avec l'exemple de la personne Lénine, même lorsque ce dernier défendra exceptionnellement une position communiste, en appelant à l'insurrection ou en formulant la nécessité de détruire l'Etat par exemple, les anti-léninistes invalideront celle-ci en prenant comme point de départ le présupposé religieux inverse: puisque Lénine en est arrivé à occuper l'Etat et à défendre le développement capitaliste, les bonnes positions qu'il a pu prendre auparavant ne peuvent être que des tromperies contre-révolutionnaires visant à cacher son véritable dessein: développer le capitalisme en Russie. Les anti-léninistes produisent la même religion méthodologique autour de la question de «la tactique». Eux aussi définissent les changements de position de Lénine comme la manifestation d'une conduite bien cohérente et ficellent ses modifications programmatiques successives dans une action logique et décidée, construite du début à la fin par un génie de la manuvre. La seule chose qui les différencie de leurs alter ego léninistes est qu'ils voient en Lénine le génie du mal, là où les marxistes-léninistes en ont fait un génie du bien. Mais ni les uns ni les autres ne sont capables de définir la ligne de démarcation séparant politiquement les projets sociaux respectifs du prolétariat et de la bourgeoisie. Aveuglés par l'image de Lénine, ils parviennent encore moins à définir, qui du prolétariat ou de la bourgeoisie se trouve derrière telle ou telle position ponctuelle formulée au cours de l'affrontement entre forces révolutionnaires et contre-révolutionnaires. |
ANNEXEAfin de permettre aux lecteurs de s'orienter dans la foison des groupes et groupuscules cités, à la fois semblables et différents, je renvoie ci-dessous à une très partielle et subjective description. Entre parenthèses et en italique, le nom du journal suit l'intitulé de l'organisation décrite.PCB - Parti Communiste de Belgique (Le Drapeau Rouge) : fusion en 1921 du groupe communiste de War Van Overstraeten (sur les positions de la gauche communiste) et du groupe social-démocrate de gauche (Les Amis de l'Exploité) de Jacquemotte, sous l'impulsion de la IIIème Internationale, et cela, malgré le refus initial des vrais communistes de Belgique. PCB - Parti Communiste de Belgique (La Voie du Peuple) : scission grippiste d'avec le révisionnisme du PCB précédent - en décembre 1963, Grippa, son animateur principal, déclare reconstituer le parti à l'échelle nationale sur la base du marxisme-léninisme. PCB(ML) - Parti Communiste de Belgique (Marxiste-Léniniste) (L'Exploité) : scission avec le PCB (Voie du Peuple) anti-grippiste et maoïste qui a lieu en juin 1967, sous l'impulsion des dirigeants de la Fédération de Charleroi. Groupe ouvriériste taxé d'anarchiste. PC(ML)B - Parti Communiste (Marxiste-Léniniste) de Belgique (Clarté): scission maoïste et anti-grippiste de la majorité des militants en octobre 1967 et reconstitué en parti après la conférence de La Louvière en novembre 1967, sous la dénomination PCMLB. Qualifié par d'autres groupes gauchistes, comme le groupe de L'Exploité avec lequel il se réunifiera en février 1974, de néo-révisionniste pour son arrivisme, sa ligne opportuniste et subjectiviste. Connaîtra des scissions : le groupe dit des «Jeunes» en 1968 ; Ouvrier en Colère (OC) ou Groupe de libération de la classe ouvrière en 1971 et dissous en 1972; PCR(ML) en 1976; la quasi totalité de sa fédération de Bruxelles en 1980, des militants de Liège, puis de ceux de Charleroi avec le POB (Le Prolétarien), mais d'autres groupes le rejoindront aussi: le Mouvement Communiste Borain (MCB), scission en 1968 du PCB (Drapeau Rouge); de Garde Rouge (GR) de Liège en 1972; de LC(ML) fin 1978. AC - Action Communiste: groupe né en 1971, issu de mai 1968. Issu et sorti du trotskysme pour rejoindre le marxisme-léninisme. Critique à l'égard de Staline et du révisionnisme stalinien. Se dissout en 1975 pour son incapacité à approfondir son analyse de classe et à être autre chose qu'une secte composant l'extrême-gauche. UUU - Usines-Universités-Union : en 1968-1971, regroupe des étudiants de l' Université Libre de Bruxelles et des militants maoïstes du groupe dit des «Jeunes» ayant rompu avec le PCMLB (Clarté). PAP - La Parole au Peuple: groupe issu en 1972 d'une scission d'UUU. Anarcho-maoïste, populiste. Critique du stalinisme. Anti-syndicats, pour la construction d'une autonomie ouvrière à travers l'action directe et pour une nouvelle gauche syndicale ouvrière. Qualifié de mao-spontex pour leur méfiance à l'égard de toute organisation s'auto-proclamant «Parti». Disparaît après son auto-critique en 1976. UC(ML)B - Union des Communistes (Marxistes-Léninistes) de Belgique : organisation issue en 1972 de la fusion de deux autres groupes, Tout le Pouvoir aux Travailleurs (TPT) en 1970, issu lui-même d'UUU et de d'UR (Comité Joseph Staline pour l'Unité Rouge) en 1969. En rivalité avec AMADA pour le brevet du meilleur élève marxiste-léniniste. Dogmatique, sectaire et «théoriciste». Sa phobie des complots le pousse à des provocations et à des pratiques fascisantes qui le conduiront à son éclatement en 1976. LC (ML) - Lutte Communiste (Marxiste-Léniniste) : groupe issu du mouvement étudiant de Liège en 1972, se démarque d'UC(ML)B et d'AMADA par sa démarche plus critique, analytique et qui refuse l'éclectisme d'AMADA, c'est-à-dire la méthode qui «consiste à prendre dans la théorie et dans l'histoire ce qui colle avec ses thèses, en laissant de côté ce qui les dérange». Son libéralisme dans le style de travail, sa faiblesse organisationnelle, son dilettantisme seront des facteurs de désagrégation du groupe. Lors de son unification avec le PCMLB en décembre 1978, la plupart de ses militants l'auront quitté. PCR(ML) - Parti Communiste révolutionnaire (Marxiste-Léniniste) (L'Exploité) : scission en juillet 1976 du PCMLB dont il critique l'absence interne de démocratie de la part des dirigeants et l'adhésion à la théorie chinoise des «Trois mondes». Le PCR(ML) s'aligne sur les thèses albanaises. Rapprochement avec le CCB(NDR). CCB - Comité Communiste de Belgique (Nouveau Drapeau Rouge): groupe issu en 1976 de dissidents fondateurs de l'UCMLB et d'ex-membres de LC(ML). Braqué sur la «Question nationale». Rapprochement avec le PCR(ML) sur base du rejet de la «Théorie des trois Mondes» et de l'adhésion aux thèses albanaises. AMADA-TPO (Alle Macht aan de Arbeiders - Tout le Pouvoir aux Ouvriers): groupe issu en 1970 du mouvement étudiant nationaliste de Louvain de 1966. Donneur de leçon dogmatique: pour ce groupe, la théorie révolutionnaire ne peut être apportée que de l'extérieur de la classe ouvrière. Electoraliste et opportuniste (change de ligne politique comme de chemise). Eclectique (cf. plus haut). Pour AMADA-TPO, tous les partis communistes existant en Belgique n'ont jamais été que de faux partis communistes qui ont trahi la classe ouvrière, le «communisme» commence avec eux; mépris et phagocytage des organisations de masse ne servant qu'à son propre renforcement. A connu une scission organisée en 1971 (De Vonck - L'Etincelle). De nombreux départs et entrées (dont celles de militants provenant d'autres organisations marxistes-léninistes, autour du noyau dirigeant des débuts. Change de nom en 1979 et existe toujours sous le nom de PTB Parti du Travail de Belgique. Tout un programme! |