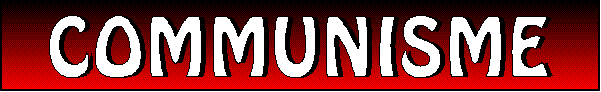
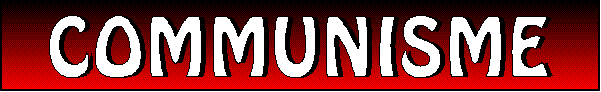
Pour notre part, nous appelons les prolétaires
du monde entier à faire œuvre de mémoire et à se mobiliser
autour de la seule alternative à la guerre impérialiste,
à savoir sa transformation en guerre sociale contre le capital.
Nous présentons ici le tract que
nous avons commencé à diffuser internationalement et qui
appelle chaque prolétaire à refuser la croisade pour la défense
de la civilisation et du monde actuel dans laquelle on essaye de nous
jeter.
Comme toujours nous appelons les parias
de ce système à s’affronter à ce qui nous attaque
le plus directement : la généralisation du terrorisme
capitaliste, la guerre qui se développe contre nous, prolétaires,
sur les cinq continents.
Camarade, n’hésite pas à reproduire tout ou partie de ce tract, il est l’expression d’une classe qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre condition de salariée et par là, toute classe, toute exploitation.
CONTRE LA GUERRE IMPERIALISTE
NOTRE UNIQUE ALTERNATIVE
GUERRE CONTRE LE CAPITAL
Prolétaire, souviens-toi que pour maintenir l'ordre social, l'armée américaine, dans son rôle de gendarme international, a déclenché la guerre contre l'Irak en 1991.Prolétaire, souviens-toi que nos frères de classe en Irak ont répondu par la guerre contre leur propre bourgeoisie:
Prolétaire, souviens-toi que, face à cette lutte, les deux ennemis "irréductibles" se sont unis pour massacrer nos frères insurgés.En rompant les rangs... En retournant leurs armes contre leurs propres officiers... Par L'INSURRECTION! Prolétaire, n'oublies pas que, contre ta lutte, la bourgeoisie est toujours unie!
Dès aujourd'hui, opposons à l'union de la bourgeoisie,
Ceux qui hier étaient d'accord pour imposer l'embargo, tuant plus d'1 million et demi de prolétaires, t'appellent maintenant à manifester pour la paix: l'union grandissante du prolétariat
Comme pour nos frères en Irak, notre ennemi est notre propre bourgeoisie! NI GUERRE, NI PAIX! REVOLUTION SOCIALE!
Prolétaire, seule ta soumission rend les massacres possibles. NI SADDAM, NI BUSH, NI CHIRAC, NI BEN LADEN, NI FISCHER, ... !
Empêchons la guerre par notre action directe!
Organisons-nous en dehors et contre toutes les solidarités nationales
Provoquons la défaite de notre propre camp
L'ennemi est dans notre propre pays!
Refusons tous les sacrifices!
Contre la dictature de l'économie,
Camarade, n'hésite pas à reproduire tout ou partie de ce tract, il est l'expression d'une classe qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre condition de salariée. Imposons la dictature de nos besoins!
Groupe Communiste Internationaliste (GCI)
BP 54 - Saint-Gilles (BRU) 3 - 1060 Bruxelles - Belgique - icgcikg@yahoo.com
Le cas de l’Argentine n’est pas fondamentalement différent de celui des autres pays. Le développement catastrophique du capital et la réponse prolétarienne aux conditions misérables que ce dernier impose ne varient pas énormément d’un pays d’Amérique à l’autre, d’une région du monde à une autre. La différence régionale, nationale,... quelle que soit sa force, ne constitue jamais, nulle part, le centre de l’histoire. Au contraire, aujourd’hui, étant donné l’accélération de la catastrophe capitaliste, la crise économique passe d’un pays à l’autre, se généralise par continents entiers; elle fait chanceler la stabilité du système et pousse le prolétariat vers la seule alternative possible: l’assumation toujours plus précise de son programme historique. Les luttes prolétariennes aussi se multiplient et semblent passer d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre. On assiste à une concentration dans le temps et à une intensification des luttes qui pourrait indiquer l’ouverture d’une phase différente dans la lutte de classes, une phase où le rapport de force commencerait enfin à changer.
A la liquidation des luttes prolétariennes des années 1960 et 1970 succéda une période de disparition presque totale des luttes pendant les années 1980. Ensuite, les années 1990 virent réapparaître des luttes naissantes et isolées mais fortes et qui, depuis le début de cette décennie, semblent se concrétiser par des ruptures pratiques et programmatiques, processus dans lequel le prolétariat prend conscience de son appartenance de classe et de sa force potentielle. Les illusions bourgeoises que portaient également les prolétaires à propos de la disparition du prolétariat et de la fin présumée de la crise, volent en éclats.
Le capital, et plus concrètement la fraction impérialiste dominante actuelle, semble avoir une confiance inébranlable dans sa puissance, dans sa force; cette fraction semble à ce point persuadée de la fin historique du prolétariat... qu’elle s’offre le luxe de prévoir les conflits sociaux dans les différentes régions du monde (conflits produits le plus souvent directement par les politiques impérialistes) et de les utiliser non seulement comme moyen de répression contre le prolétariat mais aussi comme arme de la domination interbourgeoise. Cependant, son arrogance lui explose en pleine figure lorsque le prolétariat, contraint par la dégradation de ses conditions d’existence, refuse les carottes que le système démocratique agite sous son nez et réapparaît violemment sur la scène de l’histoire en occupant la rue et en affrontant de façon déterminée le capital et l’Etat.
Pendant tout le mois de décembre et particulièrement les 18, 19, 20 et 21, les affirmations de la force prolétarienne se multiplièrent: réappropriation généralisée des moyens de vie, par l’attaque de la bourgeoisie et de son Etat.
Début décembre, commence la lutte contre les supermarchés,
on réclame des moyens de survie... A partir du 18, aux quatre coins
d’Argentine, le prolétariat
- assaille supermarchés, camions de livraison, commerces, banques,
usines,...
- partage des marchandises expropriées entre les prolétaires
et l’approvisionne les cantines «populaires» avec le produit
des récupérations,
- prend d’assaut et incendie des immeubles emblématiques de
l’Etat, telle la Casa Rosada (siège du gouvernement) et du capital
financier et multinational: attaques de banques, de fast-foods,…
- s’affronte à la police et autres corps de choc de l’Etat telles
les bandes de voyous mercenaires péronistes et ce, particulièrement
le jour où, alternative de droite à la présidence
social-démocrate éclair de Rodriguez Sáa, Duhalde
prend place à la tête du gouvernement,
- organise des Cacerolazos (vacarme provoqué en frappant sur
des casseroles), manifestations, marches et autres protestations massives
devant les portes des institutions «prestigieuses» de l’Etat,
comme les bâtiments du gouvernement, le parlement et le tribunal
suprême,
- organise des barrages routiers, suivant la pratique habituelle du
mouvement piquetero (1).
L’aspect le plus significatif de cette action prolétarienne réside dans sa généralisation et sa concentration dans le temps. Nous allons maintenant aborder certains éléments de cette affirmation prolétarienne et, ensuite, nous insisterons sur les faiblesses que recèle encore notre mouvement en Argentine.
Bien entendu, ce point de vue occulte plus de choses qu’il n’en révèle. D’abord, et c’est le plus évident, on recherche des causes et des explications locales telle la corruption de la classe politique. Mais, ceci contredit l’explication elle-même parce que si c’était vrai, le même phénomène se produirait partout et surtout en Europe ou aux Etats-Unis où la corruption généralisée est irréfutable. Autre explication qui n’a guère plus de succès en Amérique Latine mais qui marche un peu mieux dans le reste du monde: la pauvreté et le manque de développement. Mais il s’agit d’une évidente grossièreté pour un pays qui fut non seulement l’un des plus industrialisés mais aussi le grenier et l’hacienda du monde entier. Enfin, on tente d’imputer la faute au Fond Monétaire International et à l’impérialisme yankee, ce qui a certainement plus de succès vu la propagande de la gauche en ce sens.
Ce que toutes ces explications dissimulent en fait, c’est que la contradiction que vivent les prolétaires en Argentine ne se situe pas vis-à-vis de tel ou tel gouvernement, tel ou tel impérialisme mais qu’il s’agit de l’opposition vitale et irréversible entre l’être humain et le monde de la marchandise. Ces explications cachent le fait que tant l’affamement généralisé (au sens de privation de l’être humain de tout, pas seulement de nourriture) du prolétariat en Argentine que son attaque au monde de la propriété privée ne sont que des manifestations supplémentaires de la catastrophe capitaliste, de l’incapacité totale de la société marchande à satisfaire le prolétariat et confirment notre affirmation de toujours: Mai la merce sfamerá l’uomo (« jamais la marchandise ne rassasiera l’homme »). La marchandise ne pourra jamais éliminer la faim, elle ne pourra jamais résoudre les problèmes vitaux de l’humanité; c’est pourquoi, la société marchande est condamnée à périr. On veut camoufler que, quoi que fassent les réformistes de tous bords, ce monde de la propriété privée, de la marchandise et de l’argent est contraint d’affamer toujours plus de gens sur la planète. On tente de masquer le fait que l’attaque à la propriété privée, comme réponse impérieuse du prolétariat en Argentine, a exactement les mêmes racines et va dans la même direction que la lutte du prolétariat en Algérie, en Uruguay, au Paraguay, en Equateur, en Colombie, en Indonésie,.... Et, pour finir, nous voudrions hurler, à contre-courant de toute cette fange, que la contradiction entre vie humaine et monde de la marchandise qui explose de toutes parts et se concrétise dans les saqueos généralisés en Argentine est aussi celle qui s’incarne dans la chair de plus de deux millions d’être humains qui survivent dans les prisons aux Etats-Unis (a). Cette contradiction continuera à s’aggraver, inéluctablement, jusqu’à la destruction de la société marchande généralisée.
Oui, bien sûr, aujourd’hui en Argentine il y a la faim, mais cette faim n’est pas due au manque de développement ou à une politique impérialiste en particulier, elle est un produit du développement, c’est une faim produite par le développement nécessairement chaotique du capital mondial. Et si, bien sûr, ce capitalisme d’aujourd’hui est plus «sauvage» (3), meurtrier pour l’humanité, ce n’est pas la faute de tel grand manitou ou de tel politicien corrompu, c’est parce que la crise généralisée de la valorisation du capital se heurte toujours plus aux besoins de l’espèce humaine.
Oui, bien sûr les prolétaires ont pillé pour pouvoir se nourrir; ils n’avaient pas d’autre solution! Et cela, le discours paternaliste des médias n’a pas manqué de le souligner. Mais la cible des expropriations fut bien plus large que la nourriture car la privation dont nous sommes l’objet ne se réduit pas à celle-ci. Par ailleurs, les prolétaires n’ont pas uniquement attaqué les dépôts, les supermarchés, les usines, les camions,.. pour s’approprier de quoi vivre, ils ont assumé ouvertement une attaque bien plus globale contre la bourgeoisie parce qu’ils ressentent dans leurs tripes que c’est l’Etat capitaliste dans son ensemble qui les affame. Cela aussi a été systématiquement occulté: si on ne pouvait dissimuler que le prolétariat résistait à la faim (jusque là, la révolte prolétarienne pouvait être présentée comme une «simple» révolte de la faim dans un pays du tiers monde, comme ils disent), on pouvait au moins cacher qu’il s’agissait d’une affirmation générale de la classe qui non seulement s’appropriait tout ce qu’elle pouvait (ce qui est bien plus large que la nourriture) mais qui détruisait physiquement les symboles de cette société basée sur la propriété privée. En effet, il ne s’agit plus uniquement de manger aujourd’hui, il s’agit d’affirmer la puissance de classe contre le monde de la privation généralisée. Il était et est indispensable non seulement de se nourrir mais aussi d’affirmer la vie, sentir le besoin d’être ensemble, sentir la joie que procure sa propre force, faire la fête avec ce qu’on a exproprié et pleurer ceux qui sont tombés ou, mieux encore, transformer la tristesse pour nos frères tombés dans la lutte en rage et en force révolutionnaires. Dans les rues d’Argentine, le prolétariat commence à se reconnaître comme tel, la camaraderie ressurgit, l’individualisme recule; dans la rue, la communauté de lutte renaît.
Oui, nous sommes allés chercher l’argent et tout ce qu’il était possible de prendre dans les entreprises, les banques,... mais le sens profond de ces actes allait bien au-delà des faits: c’était une attaque généralisée contre ce monde de l’argent, de la propriété privée, des banques et de l’Etat, contre ce monde qui est une insulte à la vie humaine. Il s’agissait non seulement d’exproprier mais aussi d’affirmer la puissance révolutionnaire, c’est-à-dire la puissance de destruction d’une société qui détruit l’être humain. Et cela s’est produit en Argentine mais également dans un nombre croissant de pays, ces deux dernières années.
En plus du pillage des supermarchés, les saqueos et les attaques de banque et de distributeurs de billetsfurent massifs. Certains groupes d’action allèrent même jusqu’à amener les distributeurs de billets sur les places des quartiers! Evidemment il y eut des affrontements entre les pilleurs et certains commerçants, ce dont les médias bourgeois de propagande se sont emparés pour dénigrer le mouvement prolétarien en disant qu’il y avait des pillages entre quartiers. Cependant, ce problème que nous analysions lors des saqueos de 1989 en Argentine est dépassé par la lutte actuelle (c). Dans l’article que nous publiions alors, nous disions: «C’est à ce moment-là qu’est montée une véritable opération de contre-information... partout circulent des rumeurs rapidement intégrées par les «pilleurs» comme quoi tel quartier se prépare à attaquer tel autre et qu’il faut se défendre, etc. et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce mensonge est pris au sérieux par une grande partie des protagonistes de ces événements». A la fin de l’année 2001 et au début 2002, les fossoyeurs de la réalité ressortent leur vieille histoire, mais cette fois les prolétaires ne tomberont pas dans le panneau. Plusieurs journalistes sont escrachés par le mouvement. Ni ces agents constitutifs de l’Etat, ni les politiciens, ni les bourreaux, ni les entrepreneurs ne peuvent sortir de chez eux sans escorte. Une terreur froide les envahit, le fantôme de ceux qu’ils croyaient morts et enterrés leur crache à la figure.
Pratiques d'affirmation prolétarienneLa catastrophe du capitalisme se concrétise dans l’aggravation des conditions de vie du prolétariat. Contre cela, s’affirment des pratiques contre la propriété privée, l’Etat, la répression,... Assauts, attaques, occupations de bâtiments (jets de pierres, incendies, prises et destructions,...), expropriations de marchandises («saqueos»), terres, maisons, bâtiments du gouvernement, palais de justice, sièges régionaux du gouvernement ou du gouvernement régional, bâtiments ministériels, mairies, hôtels de ville, commissariats, chaînes de télévision, radios, journaux, universités, centres d’enseignement secondaire.... Prises et pillages d’usines... Marches et manifestations, «cacerolazos», mots d’ordre prolétariens.... Barrages de routes, de ponts et d’accès, parfois pendant de longues périodes.... Blocage des transports, grèves, radicalisations des mobilisations convoquées par les réformistes dont l’intention est de récupérer les luttes... Affrontements à tous les corps de répression (différents types de polices, unités de l’armée, corps de choc de l’Etat en civil). L’ «escrache» (b), dénonciation publique des cadres du capital chargés de la répression, s’étend comme pratique prolétarienne généralisée: hommes politiques, bourreaux, policiers, juges, grands entrepreneurs et journalistes sont la cible habituelle de ces «escraches». Face aux élections: généralisation de l’abstentionnisme, du vote nul, développement de pratiques d’intimidation et rejet général des élections, des collèges électoraux (comme en Kabylie, en Algérie en 2002!), des partis politiques,... Association, organisation, réunion, expression, coordination des prolétaires partout...Là où la lutte se développe le plus, particulièrement au Mexique, en Equateur, en Bolivie, en Algérie, au Paraguay,... comme en Argentine, les prolétaires s’organisent territorialement par quartiers ou localités, articulant les efforts de façon coordonnée, généralement sans dépendre de partis ou de syndicats -et souvent ils s’organisent ouvertement contre ces derniers. |
L’Etat argentin aussi pensait qu’il ne s’agissait que d’un problème purement alimentaire et eut recourt au vieil expédient de la charité. Au début des pillages de décembre 2001, comme lors du Cordobazo (1969/70) et comme en 1989, l’Etat fit oeuvre de bienfaisance et organisa la distribution caritative de vivres. La réponse des prolétaires ne se fit pas attendre. Ces lamentables miettes ne trompèrent personne. C’est à coups de pierre et par une augmentation du nombre de pillages que la rage prolétarienne répondit à la manœuvre répugnante par laquelle la bourgeoisie espérait mettre un terme au mouvement. Une fois de plus, la poudre sortit du fusil par la culasse et lui explosa en pleine figure. C’est ainsi que mi-décembre 2001, pas un seul recoin du pays ne fut épargné par les pillages, attaques de bâtiments, occupations de maisons, piquets ou barrages de routes...
On tente de nous présenter la misère comme étant simplement la misère et on nous cache le caractère subversif et révolutionnaire que contient la misère, la lutte contre la misère; on occulte le fait que l’affirmation du prolétariat en lutte en Argentine va bien au-delà des simples pillages de la faim qu’on nous montre. En effet, dans la rue, l’attaque généralisée contre la propriété privée et l’Etat est ouvertement assumée, la force destructrice de cette société basée sur la propriété privée s’affirme de façon naissante.
Autre aspect décisif de cette affirmation: la revendication ouverte de la continuité historique de la lutte actuelle avec la lutte révolutionnaire du passé. Malgré la puissante répression qui s’est abattue sur le prolétariat dans cette région pendant des décennies, les combattants prolétariens actuels revendiquent et, dans une certaine mesure, assument le passé de la lutte de notre classe, affirmant des éléments importants de leur conscience de classe. Des mots d’ordre et des chants prolétariens font sans cesse référence aux luttes de 1989, au Cordobazo et à la Semaine Sanglante de 1919. Les mouvements historiques de notre classe que la terreur d’Etat croyait pouvoir enterrer à jamais sont revendiqués et reprennent vie dans des consignes telles «Qué cagazo, qué cagazo, echamos a De la Rua los hijos del Cordobazo!» (Quel effroi, quel effroi, les enfants du Cordobazo ont fait tomber De la Rua!)
La rupture avec les partis politiques et les syndicats traditionnels s’est affirmée pendant toute la période mentionnée dans ce texte. Manifestations, action directe, occupation de la rue ou de bâtiments... se font sans l’assentiment de partis et des syndicats qui, en général, se plient à certaines de ces actions pour ne pas être totalement dépassés. Mais les drapeaux des partis politiques ne sont pas admis dans les manifestations (pas même ceux de HIJOS) et les syndicalistes ne peuvent assister aux assemblées qu’à titre personnel. Suivant le mot d’ordre général du mouvement de décembre («Que se vayan, que se vayan todos, que no quede ni uno solo», c’est-à-dire «Qu’ils s’en aillent, qu’ils s’en aillent tous, qu’il n’en reste plus un seul») les prolétaires exigent et obtiennent la démission de «leurs» présidents: De la Rua, Rodríguez Sáa... Ils expriment ainsi leur dégoût et leur rejet du système électoral, de tous les partis politiques... du gouvernement. Lors des élections, le vote majoritaire sera le vote dit «vote de la colère » ou « vote de la rage», unvote non valide, à annuler. Des groupes de prolétaires impriment des bulletins électoraux sur le mode du pamphlet avec pour légende «Aucun parti. Je ne vote pour personne. Vote de la rage». La généralisation de cette pratique contre les élections que les prolétaires en Argentine affirment au même moment que leurs frères en Algérie (d) (sans le savoir, parfois) est une affirmation supplémentaire de la rupture prolétarienne avec les différentes institutions de l’Etat capitaliste et en particulier avec les principaux partis et syndicats, rupture qui va continuer à se produire tout au long de cette période.
La pratique de l’escrache que le prolétariat a développé en Argentine (e) et qu’il utilisait jusqu’ici systématiquement contre les bourreaux, s’est élargie contre les politiciens, les entrepreneurs, les journalistes, les juges,... Depuis plus d’un an, l’extension des escraches visant tous les personnages de l’Etat est générale . Députés, ministres et ex-ministres, juges, personnages importants de la finance, journalistes,... personne n’y échappe. La peur augmente dans les quartiers bourgeois et dans les demeures des responsables du gouvernement, de la répression, des finances, des journaux,... de même que chez les députés du parlement ou au palais de justice, dans les rédactions, les casernes et les chaires des églises. Chacun d’eux tremble à l’idée de sortir de chez soi, d’être reconnu. Voici quelques exemples de personnages considérés comme représentatifs du spectre socio-politique escrachés depuis décembre (4): De la Rua, Anibal Ibarra (ex-membre du gouvernement), le chef de la CGT dissidente Hugo Moyano, le président de l’association des industriels Ignaicon Mendigueren, Raúl Alfonsín (ex-président argentin) ou Angel Rozas.
«La situation est très mauvaise. Ils peuvent aller jusqu’à lyncher un homme politique» déclare un évêque à la presse. Les appels à la formation d’un front d’unité populaire (peu importe son nom, front uni par la base ou par la direction ou contre les corrompus,...) lancés par différents politicailleurs ou syndicalistes de service sont rejetés par la pratique du prolétariat dans la rue.
Les escraches contre les chefs syndicaux et les chefs des syndicats alternatifs sont le complément des consignes chantées dans la rue et confirment l’importance de la rupture du prolétariat avec les syndicats: «¿Adónde está, Adónde está la burocracia sindical?» et «¿Adónde está, que no se ve, esa famosa CGT?» (Où est-elle, où est-elle la bureaucratie syndicale?» et «Où est-elle, on ne la voit pas, la fameuse CGT?»).
Les partis politiques et leurs représentants sont, quant à eux, à tel point brûlés qu’ils ne savent plus que faire. Duhalde lui-même reconnaîtra avec chagrin cette réalité dans une interview au journal Clarin (24/03/02): «Le consensus social, personne ne l’a, malheureusement. Lisez les sondages, aucun dirigeant n’a plus de 10%. Le discrédit est épouvantable, mais il faut continuer...»
En réalité, c’est la masse toujours croissante de prolétaires sans emploi qui permet au capital de détériorer les conditions de vie et de travail du reste du prolétariat. Aujourd’hui, on gagne moins et on travaille plus intensément et un plus grand nombre d’heures que jamais auparavant. Tout le monde sait que l’archétype du pays qui attirait les ouvriers européens en quête d’un meilleur salaire a été réduit à néant. Il ne reste rien non plus de ces limitations de la journée de travail à six heures que certains secteurs du prolétariat avaient réussi à imposer dans la région. Par exemple, l’horaire maximum des travailleurs du métro de Buenos Aires (obtenu lors des luttes de 1948) qui était de six heures par jour, fut augmenté, en 1994, à huit heures, ce qui déclencha d’intenses luttes qui aujourd’hui encore se poursuivent. La liquidation de postes de travail, l’offre excessive de bras et le terrorisme d’Etat généralisé pendant des décennies ont permis au capital d’accroître brutalement le taux d’exploitation, d’augmenter de façon générale la misère du prolétariat dans sa globalité. Pendant ces années et, exception faite de la réapparition soudaine des saqueos de 1989, le prolétariat semblait avoir cessé d’exister, il n’y avait plus que des travailleurs soumis et incapables de répondre. Pire, les éléments historiques de solidarité de classe, la camaraderie au travail, l’entraide et l’amitié dans les quartiers et la profonde haine envers tout ce qui venait de l’Etat, qui avaient caractérisé le prolétariat dans les années 1960 et 1970, étaient profondément cassés. De nombreux camarades signalaient la rupture généralisée de ce tissu social de camaraderie et le succès indiscutable, accompagné de la terreur d’Etat, du «débrouille-toi comme tu peux», de l’individualisme, de ce modèle capitaliste que Menem représente si bien. Les théories sur la disparition du prolétariat se propageaient sans entrave en Argentine jusqu’à ce que la violente réaffirmation actuelle les frappe de plein fouet. L’affirmation prolétarienne en Argentine n’aurait pas été possible sans le développement du mouvement piquetero, fer de lance de l’associationnisme prolétarien durant ces cinq dernières années.
La théorisation social-démocrate, à la mode dans toute la société mais qui est particulièrement propagée par les staliniens et les trotskistes recyclés en «libertaires», affirme qu’avec les usines disparaissent les prolétaires et avec eux, le prolétariat comme sujet historique: on ne peut déjà plus paralyser la production comme avant. Mais le prolétariat, c’est bien plus que l’ouvrier productif et la production capitaliste, c’est bien plus que la production immédiate d’objets industriels. Les piquets en Argentine, la paralysation de camions, de routes, d’autoroutes et leur extension à d’autres pays ont montré au monde entier que le prolétariat comme sujet historique n’était pas mort et que le transport constituait le talon d’Achille du capital dans sa phase actuelle.
La vieille tendance à rendre le travail de plus en plus collectif se concrétise dans le fait que chaque produit est le résultat d’un nombre toujours croissant de tâches techniques provenant de différents endroits et donc d’un nombre toujours croissant de transports. La division généralisée du travail, ajoutée à l’absence de tout plan d’ensemble qui fait que la seule autorité reconnue soit la compétitivité (5) conduit à ce que le plus petit produit contienne un nombre incalculable de kilomètres de transport et montre toute l’irrationalité du système. Ainsi, par exemple, certaines études montrent qu’un produit aussi simple qu’un yaourt dont le petit pot ne contient que du lait, un ferment et éventuellement du sucre et des fruits, un yaourt donc, parcourt quelques 8.000 kilomètres avant d’arriver sur notre table si on tient compte du trajet effectué par chacun des sous-produits entre chaque lieu de transformation. Pour fabriquer un simple «pot de yaourt en verre, en plastique, en aluminium ou en papier, différentes unités productives entrent en jeu, dans le dernier cas par exemple, la production de la pâte se fait dans une région, celle du carton dans une autre, l’impression dans une troisième et le collage de l’étiquette ailleurs encore» (6).
Dans ce processus que nos ennemis appellent mondialisation ou globalisation (et qui pour nous n’est autre que l’affirmation de ce despotisme irrationnel de la division du travail dans laquelle le caractère de plus en plus collectif du travail exprime son antagonisme avec l’appropriation privative), le prolétariat serait liquidé parce que, selon eux, les usines auraient de moins en moins d’importance relative. Les chômeurs, les «femmes au foyer», les enfants, les vieux, les gens du quartier seraient réduits par ce processus à une impuissance sociale totale et à la nullité politique absolue parce que, toujours selon nos ennemis, ils ne pourraient développer aucune action de force. Ce serait donc la fin de tout questionnement social et, pour beaucoup, la fin de l’histoire! Mais tout comme ils n’ont pas compris le b a ba des tendances inhérentes au capitalisme, ils n’ont pas non plus prévu le b a ba de la lutte prolétarienne: l’occupation de la rue, l’associationnisme territorial, un rapport de force basé sur la menace de la paralysation de l’économie bourgeoise. Les piquets, c’est exactement cela.
Le piquet, ce n’est pas nouveau, et le barrage routier n’est pas une invention argentine. Les piqueteros se situent dans la trajectoire historique du prolétariat international qui, pour assurer l’efficacité d’une grève, organise des piquets afin d’empêcher les jaunes de venir travailler. Les piqueteros assument ouvertement cette trajectoire qui jouit d’une sympathie et du respect de tous ceux qui luttent contre les patrons et l’Etat. Les «personnes», celles dont il était dit qu’elles ne pouvaient même pas donner leur opinion, se constituent en classe opposée à tout l’ordre établi: les exclus (ainsi sont-ils catalogués) qui n’ont ni voix ni vote au sein du système émergent comme force prolétarienne contre ce dernier. En Argentine, le développement de cette force de classe s’est révélé si puissant que même les prolétaires qui avaient encore un boulot et qui occupaient «leur» lieu de travail sont sortis du cadre de l’usine et ont rejoint leurs frères de classe (généralement considérés comme plus «faibles» mais à l’avant-garde car n’ayant pas d’emploi) dans la rue.
Ces dernières années, toute grande lutte est coordonnée et articulée autour des piquets, des assemblées et des structures de coordination des piqueteros. Le prolétariat affirme ainsi son organisation comme classe autonome, occupant la rue et s’organisant par quartier, c’est-à-dire territorialement, ce qui a toujours représenté un pas qualitatif dans le mouvement (f). Même la catégorisation inclus/exclus imposée par les forces du capital ne parvient pas à maintenir la division.
Les piquets commencent à se développer à la fin du gouvernement Menem, à partir du Santiagueñazo en 1994. Leur force vient d’abord du fait de s’être organisés hors de toutes les institutions politiques et sociales du pays: partis, syndicats, ONGs, églises,... La pratique des piquets qui barrent les routes, interrompant la circulation des marchandises (y compris de la force de travail) et donc de la production et de la reproduction du capital, se révèle immédiatement plus puissante que la grève dans une seule entreprise, parce qu’elle paralyse non pas un capital particulier mais un grand nombre de capitaux, avec une tendance à paralyser le capital national et pourquoi pas, ensuite, international. La paralysation de la production comme action de force prolétarienne affecte directement le marché national et d’outremer.
Le «fenómeno piquetero» commence à l’intérieur du pays (Cutral-Có et Plaza Huincul à Neuquen) et s’étend à travers le pays jusqu’à paralyser toutes les grandes villes, y compris Buenos Aires. Cette pratique prend force à mesure que d’autres exclus commencent à percevoir cette lutte comme la leur. Lorsque, ailleurs, des prolétaires, avec ou sans travail font de même, ils constatent que, pour la première fois de leur vie, ils sont écoutés. Dans ce processus de constitution en force, les prolétaires sentent dans leur propre chair la frontière qui les sépare des défenseurs du monde de la propriété privée. Le fait que la barricade n’ait que deux côtés se vit dans la rue. En même temps, on rompt non seulement avec la peur d’agir contre le capitalisme mais aussi avec les pratiques individualistes, avec le chacun pour soi, la concurrence entre travailleurs, entre chômeurs, avec le fait de couillonner son voisin, avec l’arrivisme. Les vieilles pratiques de solidarité de classe ressurgissent de leurs cendres et rompent avec l’individualisme régnant. Se redéveloppe un processus organisatif basé sur les assemblées de quartiers où les protagonistes se reconnaissent pour ce qu’ils sont tout en identifiant, en même temps, leurs ennemis. Dans les piquets et l’action directe renaissent l’amour et la camaraderie, dans le pillage d’un supermarché et la fête de quartier qui s’ensuit s’affirment des éléments de fraternité et d’humanité que les plus jeunes n’ont jamais connus.
Le barrage des routes est bien évidemment illégal. Les prolétaires qui assument cet acte le savent et ce fait même ancre cette action en dehors et contre les forces et les institutions bourgeoises. Pour les syndicats, les partis et autres institutions qui cherchent à encadrer le prolétariat, il s’agit d’une «grève ou action sauvage» qui, c’est un comble, s’impose par surprise, se généralise et les laisse complètement paralysés. Plus encore, tout délégué syndical ou politique est terrorisé à l’idée de devoir se déplacer, de sortir dans la rue et de se trouver coincé par un piquet parce qu’il court le risque d’être identifié et escraché. Il est donc tout à fait logique que les piquets aient été réprimés et que, pour résister et se développer, ils aient dû devenir de plus en plus organisés et puissants. Ainsi, lorsque la répression et les affrontements se généralisèrent, on créa des structures organisatives, de sécurité, d’action et des réseaux de communication et de soutien plus large que le quartier pour agir efficacement. Donc, si pour le piquet, le barrage routier est la méthode de lutte principale, l’action du piquetero ne se limite pas à cela: au contraire, il faut toujours plus d’organisation permanente, d’assemblées, de réunions quotidiennes, de coordination et de centralisation de cette action directe d’affrontement au capital et à l’Etat. Des minorités organisées, des groupes d’action et d’autodéfense, de groupes de soutien,... se sont dès lors développés dans chaque quartier et ils ont eu une importance décisive dans l’affirmation prolétarienne qui a précédé l’explosion de décembre 2001: en août de cette année là, plus de 100.000 prolétaires organisés en piquets avaient réussi à paralyser plus de 300 routes du pays!
Malgré la répression et les tentatives de récupération, le mouvement a continué à s’affirmer avant et après décembre 2001. Le nombre de «piqueteros» morts en 2001 et celui plus élevé encore pour l’année 2002, les centaines de blessés, les milliers d’arrestations ne sont pas parvenus à freiner le mouvement, au contraire, cela lui a fait comprendre que l’organisation, la sécurité et la préparation à l’affrontement sont fondamentaux et que les tendances légalistes qui, bien sûr, existent en son sein sont totalement antagoniques aux intérêts prolétariens.
Il est clair que ces organisations territoriales de prolétaires, bien que structurées en dehors et contre la majorité des institutions, ne sont pas exemptes de faiblesses et d’idéologies bourgeoises (comme tout conseil ouvrier ou soviet) sur lesquelles s’érige un ensemble de tendances qui cherche à liquider l’autonomie du mouvement, à l’institutionnaliser et qui, en dernière instance, l’entraîne vers sa propre mort.
Ceci nous amène à parler des faiblesses et contradictions qui se manifestent dans le mouvement. Ainsi lors de la «Première Rencontre Nationale des Piqueteros», conçue comme instance d’affirmation, de coordination et de développement prolétarien, un ensemble de manoeuvres et de tentatives d’institutionnalisation se produisirent. Par exemple, contre toute prévision des organisateurs, un groupe de députés nationaux se présentèrent et tentèrent de faire un discours. Cependant, rejetés par la quasi totalité des 2.000 délégués piqueteros présents, ils ne purent dire un mot. De la même façon, Hugo Moyano, secrétaire de la CGT dissidente, fut hué et on ne le laissa pas parler, même lorsqu’il tenta de saluer le congrès. Le rejet des partis politiques et des syndicats fut général tout au long du congrès.
Cependant, ce congrès pendant lequel sera mis sur pied un plan de lutte signifiant l’intensification des barrages routiers pour le mois à venir va être l’objet d’une tentative de contrôle de la part d’une tendance qui cherche à institutionnaliser le mouvement. Au sein de cette tendance se retrouvent, la CTA (Centrale des Travailleurs Argentins) à laquelle adhère l’importante Fédération de Terre et Logement, le CCC (Courant Classiste et Combatif) et le Pôle Ouvrier-Parti Ouvrier. Mélange de différentes idéologies politicistes et gauchistes (populisme radical, trotskisme, maoïsme) cette tendance cherche, dans sa pratique, à officialiser le mouvement piquetero, à en faire un interlocuteur valable, avec des représentants permanents et des formulations de revendications claires auquel l’Etat puisse répondre («liberté pour les combattants sociaux prisonniers, Planes Trabajar (7) et fin des politiques de conciliation neolibérales») ce qui mènent les tenants de cette tendance à accepter un ensemble de conditions qui dénaturalisent la force du mouvement et tend à sa liquidation. Après cette première rencontre, les représentants de cette tendance, nommés représentants officiels du mouvement, annoncent dans une conférence de presse que, désormais, les barrages se feront «sans cagoule» et «sans barrages totaux des routes» ce qui, ajouté au caractère limité et «raisonnable» des revendications, représente évidemment un coup brutal contre ce que le prolétariat avait affirmé dans sa pratique. Mais, malgré cette politique liquidatrice (de l’Etat, des dirigeants et forces qui collaborent pour imposer l’ordre) qui, par son politicisme et son légalisme, désorganise et affaiblit le mouvement, des masses de piqueteros ignorent ces consignes, rompent avec la légalité qu’on veut leur imposer et refusent d’abandonner leurs méthodes de lutte: l’utilisation de la cagoule (élément que le mouvement avait affirmé comme aspect élémentaire de sécurité et de défense), le barrage total des routes et même la prise d’agences bancaires, de sièges du gouvernement continueront à se développer.
Durant ces mois décisifs de 2001, le capital poursuit l’application de mesures qui augmentent violemment la misère absolue et relative du prolétariat argentin dans son ensemble jusqu’à ce que se produise le «corralito», véritable expropriation des épargnes au bénéfice du capital bancaire national et international (8). Les assemblées et les piquets qui étaient déjà monnaie courante dans les provinces et le grand Buenos Aires, se généralisent à tous les quartiers de la capitale. Les assemblées de quartier, les cacerolazos, les escraches et les manifestations violentes contre les banques et les bâtiments publics de la capitale marquent un grand pas qualitatif qui mènera à des affrontements massifs, à la tentative de la part de l’Etat d’imposer l’état de siège, à la chute de plusieurs présidents. Le fait que des secteurs bourgeois et petits-bourgeois sont touchés par les mesures gouvernementales sera mis à profit par tous les partis bourgeois pour semer la confusion et tenter de liquider le caractère classiste du mouvement. Les gauchistes de tout bord diront que ce sont les petits-bourgeois qui sont dans la rue et des groupes qui se disent libertaires et/ou trotskistes en viendront à qualifier le moment le plus fort du mouvement de petit-bourgeois. Les théoriciens du pouvoir populaire, du fédéralisme, du «libertaire» et de la démocratie directe affirmeront publiquement que «la majorité de la population de la ville de Buenos Aires, berceau du phénomène en question (les assemblées de quartiers) appartient à la classe moyenne» (9) et malgré qu’ils ne puissent faire autrement que de reconnaître la coïncidence objective entre les assemblées de quartiers (qui, comme nous l’avons vu ont été la forme de base de l’organisation des piqueteros) et les piqueteros, ils feront tout pour accentuer les différences et attribuer des programmes réformistes à ce mouvement: «Une espèce de rapprochement commence à se dessiner entre le mouvement des assemblées et le mouvement piquetero qui est d’une autre extraction socio-économique et possède plus d’années de lutte et de résistance au modèle néolibéral tout en ne résistant pas au capitalisme dans sa globalité ». (10)
Cette interprétation des classes moyennes et du fait que le mouvement pourrait avoir des objectifs différents de la lutte contre le capitalisme est répercutée et diffusée internationalement pour «expliquer» la généralisation du mouvement à toute la ville de Buenos Aires: «avant c’étaient les chômeurs, maintenant, ce sont les classes moyennes» récitent en chœur des centaines de publications de gauche comme de droite de par le monde.
Toutes ces idéologies, qui nient le prolétariat comme sujet unique s’affirmant sur base du seul projet révolutionnaire possible - la destruction de la société capitaliste - appliquent la sociologie bourgeoise à deux sous qui divise le «peuple argentin» selon des critères statistiques et structuralistes. Il est clair que les quartiers du Grand Buenos Aires possèdent un nombre de marginaux, de chômeurs et d’exclus supérieur à celui de la Capitale Fédérale (la partie plus centrale de la ville délimitée par l’avenue General Paz); il est certain que le «corralito» n’a affecté qu’une minorité de prolétaires parce que la majorité n’avait pas d’économie en banque. Mais de là à considérer que ceux qui possèdent un compte en banque ou qui habitent dans les quartiers de la capitale sont des petits-bourgeois, il y a un abîme que seules les organisations ouvertement au service du maintien de l’ordre actuel peuvent franchir aussi allègrement. Le prolétariat n’est pas une classe sociologique qu’on peut comptabiliser dans des statistiques ou mesurer sur base d’indices de pauvreté absolue ou de marginalité. Le prolétariat est une force vive en opposition pratique et vitale à la propriété privée qui renaît dans sa révolte contre l’Etat, qui développe des piquets, organise des assemblées, descend dans les rues de tout le pays pour affronter les flics, les patrons, les syndicalistes, les politiciens,... Ayant compris la vieille manœuvre de ses ennemis pour le diviser, le prolétariat s’est emparé de la rue au cris de «Piquete y cacerola, la lucha es una sola!»
Dans les faits, il n’y a jamais eu de différence entre assemblées et piquets. Au contraire, l’organisation des piqueteros utilise aussi les assemblées de quartier comme base organisative (quoique pas uniquement car la préparation des actions exige, pour des raisons de sécurité, des structures plus fermées, restreintes). La différence entre piquets et assemblées vient du fait qu’en décembre 2001 ces dernières apparaissent également dans les quartiers de la capitale, alors qu’avant cette date, on n’en trouvait que dans le Grand Buenos Aires. C’est à ce moment-là que s’enclenche une dynamique telle que dès que quelqu’un entend résonner un «cacerolazo» au coin de la rue, il s’y joint, ainsi que tous ceux qui jusque là n’étaient que de simples voisins anonymes. C’est pour cela que les manifestations et les concentrations deviennent si nombreuses, si massives. La force des assemblées, c’est de rompre la sectorisation. On s’y réunit entre voisins pour tout organiser, de la survie quotidienne à la lutte. C’est ce qui fait qu’y participent chômeurs, travailleurs, pensionnés, étudiants, jeunes, vieux,... de chaque quartier. Les conditions elles-mêmes se chargent de démentir les catégories dans lesquelles la sociologie et les idéologues divisent le prolétariat. La situation de chacun est précaire, celui qui hier se considérait comme un travailleur sait qu’il danse sur une corde raide. Les assemblées agissent solidairement avec les travailleurs en lutte et avec les piqueteros; certaines tentent d’organiser des organes de coordination entre les ouvriers des usines occupées et les piqueteros du quartier. Souvent, les assemblées occupent des locaux et parviennent à maintenir cette occupation en les utilisant pour se réunir, s’organiser, se divertir, échanger des informations, discuter des problèmes et des perspectives politiques et, en ce sens, constituent une affirmation de la communauté de lutte contre l’Etat.
Comme c’est le cas pour tout phénomène faisant preuve d’une massivité aussi grande, après la rébellion généralisée de décembre 2001, simultanément à l’affaiblissement de la dynamique du cacerolazo, les assemblées perdent de leur force. Ceci dit, il faut souligner que, dans de nombreux quartiers, des structures organisatives se maintiennent, et qu’il y a des tentatives de coordination d’assemblées de quartier telle, par exemple, l’assemblée interquartiers de Centenario. Dominée (il ne pouvait en être autrement) par l’idéologie de l’horizontalité et de l’antidirection, cette dernière s’est en fait révélée incapable de prendre une décision et s’est trouvée paralysée par le bureaucratisme. C’est pourquoi elle s’est affaiblie en tant que point de référence.
Le fonctionnement et les objectifs des assemblées sont différents selon les quartiers. Nombreuses sont celles qui, comme ce fut le cas de multiples soviets en Russie, ne sont rien de plus qu’une forme d’assistance, quasi mutualiste, nécessaire pour organiser la survie dans ce système de merde. Mais d’autres, en plus d’affirmer la solidarité et l’action directe afin d’obtenir les moyens nécessaires à la survie (ce qui comprend un grand nombre d’actes de force et de lutte, actes illégaux comme se raccorder clandestinement aux services publics, à l’eau, au gaz, à l’électricité coupés pour défaut de payement), vont bien plus loin et posent explicitement l’unité du prolétariat et la lutte contre l’Etat. Même le journal La Nación a vu la similitude et comparé les assemblées aux «sombres et funestes soviets» en Russie.
Ce qui est certain, c’est que la généralisation du phénomène des assemblées a été et reste d’une importance telle que leur composition sociale ne pouvait être qu’hétérogène et embrasser, sociologiquement parlant, des secteurs de la petite-bourgeoisie et de la bourgeoisie en cours de prolétarisation. Mais cela a été et restera une constante de l’associationnisme prolétarien qui s’organise pour affronter la catastrophe que le capital implique. Toutes les couches de la société touchées par la détérioration violente des conditions de vie auront tendance à se joindre aux associations prolétariennes qui se posent comme seule alternative au capitalisme et à agir de façon suiviste vis-à-vis d’elles. Ce phénomène, comme tel, ne pose aucun problème à la révolution. Au contraire, si le prolétariat agit comme classe, comme force historique autonome affirmant son propre projet social, ces couches en processus de prolétarisation auront, en fonction de ce processus, à se plier à la lutte prolétarienne. C’est la seule alternative qu’elles aient pour affronter le capital et, par ailleurs, c’est seulement avec le prolétariat qu’elles peuvent affirmer un projet social alternatif. De son côté, le prolétariat affirme ainsi sa tendance historique à assumer les intérêts de toute l’humanité, tendance qui inclut, il ne faut pas l’oublier, son auto-dissolution comme classe. C’est pourquoi, il est logique que les assemblées aient suivi les piqueteros, coordonnant leurs actions avec les leurs, imitant leurs méthodes. Le danger ne vient pas de la présence d’individus bourgeois ou petits-bourgeois dans les associations prolétariennes mais de la pratique contradictoire de ces assemblées, de la lutte interne qui s’y déroule, du programme politique et social de ces associations qui, souvent, est étranger au prolétariat. En effet, même si l’on expulsait réellement toutes les personnes sociologiquement bourgeoises ou petites-bourgeoises (ce qui n’aurait aucun sens), la bourgeoisie continuerait à être présente. Si aujourd’hui, nous devons dire que la bourgeoisie est présente dans les assemblées de Buenos Aires c’est du fait des positions existantes en leur sein; si aujourd’hui on peut parler de bourgeois ou d’agents de la bourgeoisie dans les assemblées ce n’est pas parce que telle personne ou telle autre appartient à la «classe moyenne» mais bien souvent par les positions bourgeoises assumées pratiquement. En ce sens, ce qui, aujourd’hui encore, pèse le plus contre l’autonomie prolétarienne demeure ce que beaucoup de ces prolétaires font et pensent. Parce que, que cela nous plaise ou non, l’idéologie de la classe dominante continue d’être l’idéologie dominante, y compris parmi les prolétaires, et pas seulement à Buenos Aires, pas seulement en Argentine, mais dans le monde entier. Autrement, comment expliquer que cet associationnisme classiste brandisse des drapeaux totalement étrangers au prolétariat, comment expliquer qu’il dresse de répugnants symboles patriotiques, qu’il chante l’hymne national argentin et que le seul drapeau autorisé soit le drapeau national?
Thèse d'orientation programmatique n°15 - GCIEn ce sens, il est indubitable qu’il existe des secteurs du prolétariat importants stratégiquement, du fait de leur capacité à paralyser les centres décisifs d’accumulation du capital (pôle d’accumulation capitaliste, grandes industries, mines, transports, communications, etc.) Ces secteurs ne sont pas nécessairement toujours les plus décidés, ni ceux qui garantissent (le plus) la généralisation de la révolution. Il existe également d’autres secteurs comme les «sans-travail» et, en général ou particulièrement, les jeunes prolétaires qui n’ont pas encore trouvé (ou qui savent qu’ils ne trouveront pas) d’acheteur de leur force de travail (secteurs camouflés de nombreuses fois sous la dénomination aclassiste de «jeunes», «d’étudiants» ou de «lycéens»). Ces secteurs peuvent jouer un rôle décisif dans le fait de donner un saut de qualité du mouvement. Le développement de la révolution communiste implique toujours la rupture d’avec le cadre borné de l’entreprise par la descente dans et l’occupation de la rue, par la généralisation effective de la lutte, par le passage à l’associationnisme territorial contre lequel la bourgeoisie ne peut plus offrir de réformes ni partielles, ni catégorielles et qui pose forcément la question générale du pouvoir de la société. Mais cette formidable énergie révolutionnaire ne constitue une force dans le sens historique du terme, que si elle s’organise en parti centralisé (sans cela, cette énergie sera dilapidée, balayée, voire même retournée par la contre-révolution). Mais ce mouvement ne peut se constituer en parti centralisé sans affirmer un programme intégralement communiste et sans se doter d’une direction pleinement révolutionnaire. Et, à leur tour, programme et direction communistes ne sont pas le résultat immédiat du mouvement, même si celui-ci est vaste et puissant, mais bien le résultat de toute l’expérience antérieure accumulée et transformée en force vive, en organe de direction du parti et de la révolution par une longue et dure lutte historique; consciente et volontaire, assurée par les fractions communistes. |
Au cours de ce processus d’affirmation comme classe, le prolétariat se dote de structures massives d’association comme les assemblées de quartier. Celles-ci, à leur tour, ont été précédées, rendues possibles et engendrées par des structures ayant une plus grande permanence et une plus grande organisation: celles des piqueteros telles que décrites ci-dessus et d’autres structures qui, depuis des années, luttent contre l’impunité des bourreaux et des assassins de l’Etat argentin (Mères de la Place de Mai, Hijos,...), celles des associations de travailleurs en lutte (usines occupées) ou celui du mouvement des pensionnés. La corrélation entre les différents types de structures, la continuité relative de certaines d’entre elles et les formes d’action directe qu’elles ont adoptées ont permis cette affirmation de l’autonomie du prolétariat en Argentine et constituent un exemple qui tend à s’étendre à l’Amérique et au monde: piquets, escraches, pillage organisé et organisation du quartier autour d’une énorme marmite afin que tous aient à manger chaque jour,… Cependant, ce mouvement comporte d’énormes limites et faiblesses qu’il est indispensable de clarifier.
Quelle est la direction du mouvement? Quels sont les programmes, les drapeaux, les forces politiques qui impriment la direction à cette force prolétarienne? La première chose qui frappe à ce sujet, c’est le déphasage entre la force exprimée par le prolétariat et l’absence d’objectif explicite, entre l’autonomie manifestée dans la rue et le peu d’incidence de positions clairement révolutionnaires qui crient haut et fort que la seule solution est la destruction de la société marchande et de l’Etat. Il est clair que ce déphasage est mondial, comme nous l’avons déjà constaté maintes fois mais dans le développement du mouvement actuel en Argentine il nous semble plus grand encore.
Le manque de direction révolutionnaire est évident. Direction non pas dans le sens de suivre tel ou tel individu. Au contraire. C’est le manque de direction révolutionnaire réelle qui fait que l’on est suiviste de tel ou tel chef populaire. Direction, donc, dans le sens historique d’assumer ouvertement ce que le mouvement contient déjà. L’affirmation que le prolétariat effectue pratiquement en s’opposant ouvertement à la société marchande et à l’Etat ne parvient pas à se structurer en consignes clairement révolutionnaires pour la destruction du capitalisme.
Tout au contraire, il y a très peu de consignes réellement radicales, c’est-à-dire allant à la racine de tous les problèmes: la société marchande. Très peu de groupes ou de militants expriment la tendance historique révolutionnaire vers la nécessaire et indispensable destruction des fondements de cette société. Nous sommes donc forcés de constater que, dans cette région, la rupture historique du prolétariat avec son passé de lutte est profonde. C’est comme si les positions prolétariennes de toujours brillaient par leur absence. Ce qui prédomine dans le mouvement du prolétariat, en fait, ce sont des directions politicistes/gestionnistes qui s’opposent pratiquement à une issue révolutionnaire: les uns essayant de pousser le mouvement vers l’institutionnalisation, la négociation avec l’Etat, le réformisme politique en général (le plus souvent en dressant le vieux drapeau bourgeois de l’Assemblée Constituante) et/ou vers le néosyndicalisme; les autres poussant le mouvement vers l’autogestion, l’entreprise alternative, le soi-disant contre-pouvoir et la démocratie directe. Ces deux politiques s’opposent à l’insurrection, à la dictature révolutionnaire du prolétariat pour abolir le travail salarié qui est non pas une possibilité parmi d’autres mais l’unique issue possible.
L’absence de groupes révolutionnaires, de minorités poussant ouvertement le mouvement vers la révolution sociale a pesé lourd dans les moments décisifs de décembre 2001. La crise de la classe dominante était totale, le prolétariat imprima sa violence de classe même contre l’état de siège ce qui précipita tous les changements au sein du pouvoir bourgeois. Mais dans cette situation de pouvoir social, le prolétariat resta paralysé comme s’il n’avait pas de projet révolutionnaire, ce qui revint à laisser l’initiative à la bourgeoisie. Celle-ci, tout en ne sachant trop que faire, elle non plus, savait au moins changer de tête pour que tout reste tel quel.
Nous ne sommes pas en train de dire que les conditions d’une victoire révolutionnaire étaient réunies, ce qui serait utopique sans préparation sociale à perspective insurrectionnelle. Ce que nous disons c’est que les conditions étaient au moins réunies pour imposer un rapport de force qui corresponde à cette extraordinaire consigne mise en avant par le prolétariat: «Que se vayan todos, que no quede uno solo» («Qu’ils s’en aillent tous, qu’il n’en reste plus un seul»). Des conditions qui auraient pu empêcher que la bourgeoisie reconstitue aussi aisément sa domination, qui auraient permis de garder le rapport de force conquis dans la rue et d’empêcher que la bourgeoisie reprenne l’initiative de la réorganisation politique et finisse par imposer n’importe qui, tel Duhalde qui figurait pourtant en tête de la liste de ceux qui, toujours selon le même mot d’ordre, devaient s’en aller.
Aucune des organisations et des publications qui avaient du poids dans le mouvement n’a donné de consignes aux perspectives révolutionnaires, aucune n’a placé au centre de sa pratique la véritable révolution sociale. Aucune des positions ouvertement révolutionnaires existantes n’est parvenue à s’affirmer comme force sociale afin que la nécessité de l’insurrection et de la destruction violente de l’ensemble de la société marchande soient vues pour ce qu’elles sont: l’unique alternative. A part quelques camarades tout à fait isolés, personne n’a dénoncé les fausses solutions et expectatives suscitées par le gestionnisme évident dans lequel, parallèlement à la solution bourgeoise de la crise, les assemblées et une grande partie du mouvement piquetero sont tombés.
L’idéologie dominante, celle de la classe dominante, présente dans tout le mouvement, en a profondément limité la force. Au début de ce texte nous signalions comme élément positif le fait que le mouvement ait interdit la participation de tout type d’institutions dans ses actions et démonstrations de force, qu’aucun syndicat, parti ou autre institution n’ait pu venir avec ses drapeaux, nous devons ajouter maintenant un élément extrêmement négatif: le seul drapeau autorisé fut le drapeau argentin. Et, malheureusement, il ne s’agit pas d’un simple drapeau, il ne s’agit pas d’un petit détail de l’histoire. La présence de ce drapeau est le reflet d’un manque évident de rupture avec le nationalisme, avec le patriotisme, avec le populisme, avec le péronisme,...
Même parmi les protagonistes les plus décidés du mouvement, certains parlaient de la ruine de «notre économie» de la «recherche d’une issue pour le pays», d’autres affirmaient que les politiciens «sont des vendeurs-de-patrie» (11), comme s’il s’agissait d’un problème de nation et pas de classe, comme si c’était uniquement l’Argentine qui sombrait et pas la société marchande toute entière. L’«anti-impérialisme» conçu comme affirmation nationale de l’argentinisme anti-yankee a joué le même rôle bourgeois: lutter pour la liquidation de l’autonomie du prolétariat. Et il y a plus, en différentes occasions et dans de nombreuses manifestations, ce n’est pas contre la patrie ou pour l’internationalisme prolétarien que les chants s’élevaient, c’était (trotskistes en tête) l’hymne national qu’on entonnait. Voilà qui dénote une brutale rupture avec la trajectoire internationaliste du prolétariat dans la région tant lors des luttes de la vague 1968-1973 que lors de celles de la vague 1917-1923 ou lors des luttes du 19ème siècle.
Des dénonciations et des ruptures se sont bien sûr également exprimées. Nous reprenons ici, à titre d’exemple quelques lignes parues sur internet et qui s’insurgent contre le populisme, le péronisme, les Montoneros et autres genres de nationalisme.
Quelques extraits parus sur le site d’Indymedia et signés BurritoCette terminologie est stalino-péroniste, elle est utilisée indistinctement par le populisme de droite comme de gauche. Les anarchistes ne différencient pas l’oligarchie des bourgeois que vous ne nommez pas. Les anarchistes dénoncent tous les capitalistes. Est ce que par hasard vous l’auriez oublié? Ou y aurait-il des différences entre eux?Les anarchistes ne dénoncent pas les «entreguistas» (ceux qui vendent la patrie aux étrangers, à l’impérialisme, au FMI,…) mais bien les moutons, les ouvriers séduits par le patron. «Entreguista» a une autre connotation; ce terme est associé au populisme. Vous ne vous en êtes pas rendu compte? Et pour finir «vendeurs-de-patrie»: je me sens mal à l’idée de devoir expliquer cette absurdité et, pour comble, à quelqu’un qui se dit anarchiste. Les ouvriers n’ont pas de patrie: où qu’ils aillent, ils continueront d’être des ouvriers/exploités et ils ne peuvent défendre ce qui ne leur appartient pas. Le capitaliste s’installe là où il tire des profits; par conséquent, le capital n’a pas de patrie et la lutte contre lui non plus: cela c’est l’internationalisme, une valeur précieuse de l’anarchisme. Vendeurs-de-patrie? Vendre quelque chose qui n’a de valeur ni pour les uns ni pour les autres est un contresens. Messieurs, vous qui vous dites anarchistes! De plus, être patriote c’est être assassin! 26 décembre 2001
Cette fois, je ne vais pas répondre à ta «conception»
de l’anarchisme. Tu as déjà tout dit dans la première
note avec les termes vendeurs-de-patrie, oligarchie,... Tes dernières
opinions confirment la gravité et la crise de la pensée sociale
la plus élémentaire, et le gaspillage discursif de cette
farce philo-péroniste qui se dit anarchiste; en disant «ce
peuple qui lutte et meurt dans la rue comme le firent 25.000 Montoneros».
[…] Pour ton information, les Montoneros ont été méprisés même par Perón «à cause de ces stupides imberbes qui croient avoir plus de droits que ceux qui ont lutté pendant vingt ans dans le mouvement syndical» - 1974. Tu as oublié que Firmenich12 et toute cette clique dénonça, moucharda et aujourd’hui se la coule douce? Si tu crois qu’il y a des valeurs positives dans le sentiment populaire à l’égard d’Evita et de la vierge Marie et que cette fusion réveille des réactions anti-impérialistes pourquoi n’entres tu pas au PJ ou, pour être plus révolutionnaire, au PCR et pourquoi ne cesses-tu pas de t’appeler anarchiste? Quel est l’objectif, maintenant? Tenter de s’infiltrer une fois de plus auprès des Mères, déguisé en anarchiste? Vous n’avez pas honte? C’est ce que faisaient des types comme Astiz. Comment pouvez-vous être tombés si bas? » |
Nous désirons également souligner le fait que, par endroits, grâce à des camarades, un anti-hymne argentin, une vieille chanson qui oppose à tous les chants patriotiques la lutte à mort contre le capitalisme, l’anarchie (13), réapparaît et que, cette chanson, les militants prolétariens de la FORA communiste l’ont chantée pendant de nombreuses années.
Hymne non-nationalContre le patriotique hymne national argentin que la bourgeoisie a tout intérêt à ce que les ouvriers continuent à chanter car, ce faisant, ils font l’éloge de leur propre exploitation, ressurgit cet hymne internationaliste à la révolution sociale et à l’anarchie. Composé par des prolétaires au début du 20ème siècle (sur le même air que l’autre) cet hymne internationaliste a été chanté lors des grandes luttes et manifestations prolétariennes de l’époque. En voici la traduction française:Vive, vive l’anarchie!
Ecoutez mortels le cri sacré
L’ouvrier qui souffre proclame
La gloire des nouveaux martyrs
Aux pleurs de l’enfant qui crie:
«Guerre à mort» crient les ouvriers
D’un pôle à l’autre résonne ce cri
|
Cependant la prépondérance idéologique du populisme continue à peser sur le mouvement et ce qui prédomine est, sans aucun doute, cet hymne à la patrie, à la soumission du prolétariat qu’est l’hymne national. Il est vraiment désolant que sur le plan de la continuité historique, on évoque le Cordobazo, la «semaine tragique» de 1919 (nous préférons l’appeler semaine insurrectionnelle) mais que, dans la pratique, on continue à tellement peu affirmer l’internationalisme prolétarien, l’antipatriotisme qui a constitué l’alpha et l’oméga de la lutte historique du prolétariat tant au 19ème qu’au 20ème siècle. Le prolétariat qui vit actuellement en Argentine est originaire de dizaines de pays différents et dans tous les mouvements de lutte importants, il s’est ouvertement affronté au nationalisme argentin, à l’argentinisme et à ses valeurs. Par contre, ceux qui ont le plus affirmé l’idée de patrie en Argentine, les bourgeois et leurs exécutants, les militaires (y compris Perón), sont ceux qui réalisèrent les plus grands massacres de l’histoire. Les escadrons de la mort, les bandes de voyous des syndicats et autres organisations para-policières ont des antécédents historiques indiscutables dans la Ligue Patriotique Argentine (14).
| «Le mois passé, on a fêté trois fêtes
patriotiques! Il y a eu profusion de drapeaux, cocardes, fêtes nocturnes,
bals, soûleries,... Cela semble incroyable que dans nos rangs il
y ait des camarades qui appuient si sottement ces fêtes! Adieu drapeau
rouge brandi le premier mai!... Qui sont les promoteurs de ces fêtes?
Quelques commerçants qui achètent et vendent des produits
partout dans le monde en concurrence avec ceux de leur patrie et pour qui,
de fait, la patrie c’est le profit commercial. Un banquier qui spécule
dans toutes les bourses du monde, qui se livre à l’agiotage sur
toutes les places boursières, de fait, sa patrie c’est l’argent.
Un fermier qui emploie des ouvriers de n’importe quelle nationalité
(ceux qui lui coûtent le moins cher et qui travaillent le plus) de
fait, leurs compatriotes sont les bêtes de somme les plus rentables
et les moins chers...
Quand comprendrons-nous, nous prolétaires, qui n’avons ni terre, ni bien, ni rien de matériel qui nous retienne en un lieu plutôt qu’en un autre, que l’idée confuse de patrie n’a pour nous aucun intérêt? Quand nous rendrons-nous compte, nous les bêtes de somme, que la patrie est parfaitement conforme à et est fomentée par les privilèges de la caste bourgeoise?» Fédération Ouvrière de Rio Gallegos (1921) |
En plus du populisme et du nationalisme toujours présents qui constituent des forces contre la révolution, il faut également signaler d’autres idéologies complémentaires, comme les tendances à légaliser le mouvement, à officialiser ses représentants, à formuler des revendications positives au sein du capitalisme et clairement entendables par les fractions bourgeoises au pouvoir, en fin de compte, à transformer cette force prolétarienne qui s’exprime dans la rue en une force institutionnalisée et intégrée par l’intermédiaire de ses représentants comme institution d’Etat. Font partie de cette tendance contre-révolutionnaire toutes les tentatives pour transformer le mouvement piquetero et d’assemblées en nouveaux syndicats mais aussi, celles qui cherchent à en faire une forme d’appui à l’action politique de parti, y compris l’action électorale et, en particulier, celles qui arborent la consigne de la gauche bourgeoise d’«Assemblée Constituante». Il est très important de dénoncer cette option bourgeoise (comme le font les Juventudes Libertarias en Bolivie) parce que cette consigne a déjà joué son rôle néfaste en bien des endroits et à bien des époques et parce que, aujourd’hui même, cela se reproduit non seulement en Argentine mais dans d’autres pays de la région.
Il ne faut pas oublier que tous ces points (nationalisme, populisme, argentinisme «anti-impérialiste», institutionnalisation, assemblée constituante,...) bien que ce soient des idéologies au sein du mouvement du prolétariat, représentent les intérêts de la bourgeoisie. Ce sont des expressions, des consignes et des directives qui constituent objectivement un frein à et un dévoiement de ce que le prolétariat a pratiquement affirmé de plus important: son opposition pratique, ouverte et irrémédiable à la propriété privée et à l’Etat.
La Constituante: pirouette réformistePartout on parle de l’assemblée constituante; téteurs de mamelles, profiteurs et opportunistes disent qu’elle résoudra tous nos problèmes; on déverse une propagande mystificatrice qui cache les réels problèmes, au jour le jour, de la libération de la classe travailleuse du joug patronal capitaliste. Ce qui est sûr c’est que le monde est divisé en deux classes: la classe des exploiteurs (bourgeoisie) et la classe des exploités (prolétariat). Le régime économique, le capitalisme, fonctionne sur base de l’obtention du plus grand profit possible; pour cela, les bourgeois exploitent le prolétariat avec pour unique fin d’obtenir un profit supérieur. L’Etat est la structure qui a pour objectif la protection des intérêts de la classe dominante et le maintien des rapports de domination dans lesquels les capitalistes vivent du travail non payé au prolétariat. C’est pourquoi les intérêts de ces classes sont totalement opposés. Par conséquent, croire qu’un espace de dialogue entre les deux classes permettrait d’en finir avec l’exploitation et l’oppression est une niaiserie! C’est impossible! Les bourgeois cesseraient d’être riches et cela, comme ça, de leur plein gré, cela ne se passera jamais. Alors pourquoi tant de vacarme, ici, il y a anguille sous roche... La vérité, c’est que l’on prétend changer le champ de bataille, des usines, des champs et de la rue en pompeuses assemblées où les enfarinés du syndicalisme réformiste et les petits docteurs de la bourgeoisie, tous laquais du capital/Etat, parlent au nom des travailleurs à ceux qui ont toujours désiré avoir des exploités pour en tirer profit. On prétend substituer à la lutte de classe réelle, violente dans les rues, les braillements des délégués constitutionnalistes. Les capitalistes veulent avoir des assemblées, des parlements qui abrutissent le prolétariat de l’idée que ses problèmes puissent être résolus au sein des institutions bourgeoises. L’appel à une assemblée consistante dévie les travailleurs de leurs véritables moyens de lutte, elle les dupe en prétendant que la transformation de la société peut être réalisée sur les bases de la société capitaliste. Elle alimente la passivité des masses qui se fient à la capacité des chefs. Elle sème la confusion à un moment où la lutte se cimente en un mouvement direct des masses. Si le prolétariat renonce à ses objectifs, affirmant ceux de ses oppresseurs, il se nie comme classe, il s’exclut en tant que (la seule chose qu’il puisse être) force antagonique à l’ordre existant en se dissolvant dans le citoyen. Monter sur le char de la constituante, c’est légitimer la dictature du capital, c’est-à-dire la démocratie qui, voilée sous des formules trompeuses de libertés politiques et de garanties démocratiques fictives, sert de cheval de Troie pour amadouer le prolétariat et river les chaînes de l’esclavage.Juventudes Libertarias, 16 juin 2002 |
Dans un contexte de chaos généralisé comme en Argentine où la situation matérielle est chaque jour plus insupportable pour un nombre croissant de personnes, la nécessité de survivre pousse tout le monde à s’arranger de mille façons: pillages, occupations de locaux et/ou d’usines, récupérations, combines en tout genre, artisanats, trafics, falsifications, changes,... Personne et nous moins que quiconque, ne pourra juger ou condamner ces procédés de survie, de lutte contre la faim que notre classe invente pour affronter les conditions que lui impose la société marchande. Dans la gestion immédiate de la survie et sous la dictature du capital, tout ce qui se fait contre la loi de la propriété privée et l’Etat bourgeois est fondé, légitime et, que les protagonistes en soient conscients ou non, exprime l’opposition totale et irrémédiable entre les besoins humains et la société basée sur la propriété privée.
Le problème surgit quand des mécanismes de survie dont l’occupation nécessaire de moyens de production réalisée dans la lutte prolétarienne sont idéalisés comme s’ils constituaient une solution de rechange à la société actuelle, comme s’ils pouvaient opérer un changement social sans la nécessaire rupture révolutionnaire, comme si on pouvait «communiser» le monde sans détruire despotiquement la société marchande. L’illusion d’améliorer peu à peu une société qu’il faut détruire joue un rôle contre-révolutionnaire important, quelle que soit la façon dont elle s’exprime. Dans les moments de crise sociale et politique, ces idéologies ont pour fonction de paralyser le potentiel révolutionnaire du prolétariat et empêchent l’insurrection. Plusieurs fois dans l’histoire, l’idéologie gestionniste anti-insurrectionnelle a transformé les occupations d’usines et des moyens de production en général en «contrôle ouvrier», «autogestion», «collectivisation», «socialisation»,... et autres innombrables dénominations qui ont toutes comme point commun de faire l’apologie de l’abandon de la lutte contre l’Etat au profit du travail et de la gestion productive. C’est ce qui s’est passé en Espagne avec les collectivisations en 1936-1939. La perte de perspective révolutionnaire du prolétariat qui en résulte se transforme invariablement en force contre-révolutionnaire et se conclut par la liquidation politique et physique du prolétariat organisé. En effet, pour la bourgeoisie, dans des circonstances de crise politique et sociale profonde où l’insurrection est à l’ordre du jour, il est extrêmement positif que, plutôt que d’attaquer son pouvoir social et politique, le prolétariat investisse toute son énergie dans la production et la gestion économique; non seulement parce que la bourgeoisie peut dès lors se réorganiser pour liquider le prolétariat ensuite mais aussi parce que le capital lui-même est maintenu en bon état de fonctionnement par un prolétariat qui croit qu’il produit pour ses propres intérêts. Comme la bourgeoisie sait parfaitement tout cela, il est normal que toutes les pseudo-alternatives qui se sont développées en Argentine et que nous pourrions résumer par la recherche d’une autre gestion ou d’autres formes d’échanges sans détruire le capital, aient été idéalisées et propagées par des secteurs bourgeois dans le monde entier. Ainsi le modèle gestionniste que le sous-commandant Marcos avait remis à la mode il y a quelques années et qui souffrait d’usure notoire reprend un nouvel essor au niveau international grâce à l’exemple argentin et à la publicité faite par les secteurs bourgeois alternativistes.
Echange des produits, échange de travail, commerce alternatif,... Face au désapprovisionnement des commerces et au manque d’argent, beaucoup de familles ouvrières se sont intégrées dans un réseau de troc ou d’échange de produits. En Argentine, il y a plus de trois millions de personnes qui utilisent occasionnellement ou régulièrement ce procédé. Pour les raisons que nous invoquions plus haut, il est normal que cette soi-disant alternative soit l’objet de louanges de la part des progressistes du monde entier. Chaque produit est évalué en «créditos». Le «crédito» équivaut à la moitié d’un peso. On échange aussi des services sur le plan du travail: j’arrange les vélos, tu répares les frigos... Il est clair que pour beaucoup, ce système permet de trouver des choses moins chères ou d’obtenir ce dont ils ont besoin en échange de quelques petits travaux. La supercherie, c’est qu’en Argentine aussi on a imaginé et fait la propagande de cela comme s’il s’agissait d’un projet social différent alors qu’en réalité cet échange généralisé tend irrémédiablement vers la loi de la valeur qui existe dans toute la société bourgeoise. C’est-à-dire qu’indépendamment des illusions qui peuvent naître au sein du prolétariat, sur ce marché toutes les lois du capitalisme tendent nécessairement à se vérifier. Ces lois sont fondamentalement contenues dans l’échange marchand lui-même, y compris sous sa forme la plus simple, le troc. L’échange d’un objet, d’un service, d’un travail,... contre un autre ne peut se réaliser que sur la base du travail qui s’objectivise en lui et ce rapport d’échange contient dans son développement toute la barbarie de la société actuelle, comme (il faut le rappeler) le démontra Marx contre Proudhon. Toute illusion sur le fait que cet «échange alternatif» puisse être différent du capitalisme ou qu’au moins il développerait des rapports «moins inhumains» joue un rôle réactionnaire. En Argentine, on constate déjà que le prix en «créditos» de la plupart des produits est supérieur à celui qui existe dans les commerces, que cette unité de compte se dévalue également, que dans ce commerce soi-disant alternatif se développent déjà toutes sortes d’escroqueries, de maffias, que les grands mangent les petits, etc. Malgré cela, l’idéologie qui défend que grâce à ce commerce alternatif et à la production alternative on peut changer la société continue de peser.
Le même problème se pose lors des prises d’usines et de ce qu’on appelle l’autogestion. Prendre une usine est un acte qui signifie s’affronter au patron et attaquer la propriété privée. La généralisation de ce processus est un bon point de départ pour opposer la force prolétarienne à la force de la bourgeoisie coalisée. Quand, en plus, on expulse les patrons, quand on utilise les outils de travail (souvent en en changeant l’usage et la destination) pour produire les objets nécessaires à la subsistance et/ou quand on met ces outils de production au service du mouvement, quand on occupe des usines d’aliments, d’objets utiles, des imprimeries, des journaux comme cela s’est passé dans certains cas à Buenos Aires et dans certaines capitales de provinces), on affirme son opposition à toute la société bourgeoise. Mais si les prolétaires se convertissent en gestionnaires de ces entreprises (toutes coopératives horizontales et équitables qu’elles soient), certains finiront nécessairement par soutenir le capital et l’Etat parce que l’existence de cette entreprise dépend obligatoirement de sa rentabilité et celle-ci du taux d’exploitation. Le capital et l’Etat, loin de s’affaiblir du fait que ces entreprises soient «contrôlées par les ouvriers» ou «collectivisées» se renforce encore plus, vu que la lutte cesse d’être une lutte pourla destruction du travail salarié et de la société marchande et que l’énergie révolutionnaire est canalisée vers la production et l’échange de marchandises. Même dans le cas extrême où la propriété privée juridique cesse d’exister, les rapports sociaux entre les entreprises collectivisées continuent à être des rapports marchands et toutes les lois de la société capitaliste continuent à régir les rapports entre les hommes. Pour abolir la propriété privée réellement et pas formellement et/ou juridiquement, il faut abolir également la gestion d’entreprise et l’entreprise elle-même. Sans cela, la société continuera à décider quoi produire et qui le produira en fonction du marché, c’est-à-dire des lois du capitalisme. La décision autonome de chaque unité productive qui fait que la production ne «devient sociale» qu’a posteriori, par l’intermédiaire du marché et de ses lois (en opposition aux besoins de l’humanité) est la clé du capitalisme. Seule la destruction de cette autonomie et de cette indifférence de chaque unité productive et la soumission de toutes les unités aux impératifs humains rendra la production directement sociale (destruction de la dictature de la loi de la valeur) et fera de la société une association libre de producteurs associés, base de la communauté humaine.
Chaque fois qu’on occupe un lieu et qu’on commence à travailler se pose cette alternative entre généralisation et approfondissement de la lutte ou paralysation de celle-ci sur base de l’illusion productiviste, gestionniste. Durant le processus d’affirmation du prolétariat de 2001-2002, il y eut plusieurs cas importants d’entreprises occupées et réouvertes par les ouvriers en lutte où cette alternative s’est posée.
Citons quelques exemples d’occupations qui se distinguent par leur radicalité: Zanón (à Neuquén qui, alors que nous mettions cet article sous presse en espagnol –novembre 2002- en était à son dixième mois d’occupation), Bruckman (à Buenos Aires) Perfil,.... Il y a aussi des cas où l’occupation et la mise en fonctionnement de l’usine est directement une mesure de lutte, d’affirmation de la camaraderie. A Azul, après l’occupation, les travailleurs ont réussi à réouvrir une usine de céramiques et à faire réintégrer les camarades licenciés. A Fricader (Rio Negro) on impose la coopérative après la fermeture du chantier. A Chilavert (Buenos Aires) les travailleurs impriment un livre nécessaire au mouvement des assemblées.
Pourtant, s’il y a des occupations qui affirment le mouvement, dans bien des cas les occupations d’usines et le fait qu’on y travaille de façon «autogérée» s’articulent et se confondent avec les projets de commerce alternatif entre groupes et marchés «parallèles» ou de troc. Dans chaque usine, l’illusion qu’il s’agit d’une solution entraîne les ouvriers à se contenter de ces alternatives partielles qui poussent à l’isolement et qui, dans les faits, s’opposent à la seule solution : la généralisation de la lutte, l’organisation contre le capital et l’Etat.
Un cas similaire s’est produit avec le mouvement des piqueteros et les «triomphes immédiats». Couper les routes et imposer un «Planes Trabajar» est un acte de classe dans la mesure où on arrache au capital des allocations qui permettent de subsister. Mais ce résultat est éphémère et tend à être liquidé par l’évolution économique elle-même. Ce qui reste, en fait, c’est l’organisation et la solidarité croissante de ce mouvement social. Dans la mesure où les alternatives bourgeoises sont de moins en moins capables de résoudre les problèmes immédiats des gens, le mouvement se généralise et on ne peut plus l’enfermer comme si ce n’était qu’un mouvement purement économique. Toute lutte prolétarienne réelle même si elle se déclenche du fait de besoins immédiats, tend nécessairement à s’opposer à tout le fonctionnement du capital et de l’Etat, comme cela se passe pour le mouvement piquetero. Le développement de ce dernier le pousse à la généralisation et, comme on l’a vu, à s’unifier avec le reste des luttes prolétariennes qui, à leur tour, tendent vers une solution unique: l’insurrection, la révolution sociale. Contre cela, en Argentine comme dans le reste du monde, un ensemble d’alternatives gestionnistes, basées sur l’illusion d’une économie alternative, et qui s’opposent explicitement à cette seule solution possible qu’est l’insurrection prolétarienne, sont devenues à la mode.
Dans les discussions, tant dans les assemblées que dans le mouvement piquetero, nous constatons avec grande inquiétude le poids croissant de cette idéologie que nous devons combattre. A titre d’exemple, prenons l’idéologie qui s’exprime publiquement au nom du Movimiento de los Trabajadores Desocupados - MTD Solano (Mouvement des Travailleurs Sans-Emploi du quartier de Solano) travailleurs qui ont impulsé la Coordination Anibal Verón, idéologie reproduite par Situaciones dans différentes brochures. Il ne s’agit pas ici de rabaisser la lutte menée par les camarades, par les piqueteros de ce quartier qui, par ailleurs, sont depuis des années à l’avant-garde du combat contre les forces répressives de l’Etat, il s’agit de combattre l’idéologie gestionniste qui s’exprime en leur nom et qui les entraîne vers une voie sans issue.
«L’expérience du MTD-Solano a sa singularité. Ses fondateurs travaillaient dans la chapelle de la zone jusqu’au moment où il furent délogés par l’évêque Novak. Ensuite, ils commencèrent à organiser le MTD Teresa Rodríguez... Avec le temps, ils commencèrent à administrer leurs propres projets (Planes Trabajar). Et très rapidement ils fondèrent des commissions et des ateliers de formation politique, de boulangerie, de forge, une pharmacie pour le mouvement, etc.» (g)
L’on peut considérer logique, comme nous le disions plus haut, qu’on lutte pour imposer ces «Planes Trabajar» dans la mesure où on arrache quelque chose au capitalisme sur base d’un rapport de force, mais les porte-parole du MTD-Solano en viennent à idéaliser les résultats des entreprises productives développées dans ces conditions. Ces entreprises et les rapports sociaux qui en découlent sont totalement idéalisés, au point de prétendre que l’exploitation y serait abolie peu à peu: «Ce qui est très clair pour nous c’est que nous voulons abolir l’exploitation, seulement l’exploitation ne s’annule pas à partir d’une idée mais d’un processus et progressivement. Je n’oublie jamais ce qu’a dit une camarade lorsque nous étions dans l’atelier d’éducation populaire et que nous travaillions le thème de l’identité. Elle a dit: ‘Ici je suis redevenue moi-même par rapport au travail. Parce que maintenant je suis une travailleuse, même si je ne reçois pas d’allocation: je suis une travailleuse et pas une exploitée’.
Toute l’idéologie des porte-parole du MTD-Solano va dans le sens de cette apologie de la gestion immédiate, du changement graduel et d’une économie prétendument alternative comme synonyme de changement social: «Nous tentons de travailler sur l’idée d’une économie parallèle... nous tentons de concevoir des projets productifs qui ne soient pas PYMES, qui aient d’autres caractéristiques, où les relations de travail changent, où l’essentiel ne soit pas la marchandise, l’échange de la force de travail contre de l’argent; c’est un projet très vaste.» C’est-à-dire que l’on nous vend comme une nouveauté cette vieille idée proudhonienne, réformiste de l’établissement de rapports sociaux non capitalistes sans l’indispensable destruction révolutionnaire de ce qui existe en réalité: la dictature du capital. Cette idéologie d’une soi-disant «solidarité transcendant l’individualisme» basée sur les entreprises productives est évidemment tout à fait utopique. Si l’on ne détruit pas la dictature de la valeur on ne peut dépasser l’individualisme. Lorsque le prolétariat descend dans la rue pour en découdre, cette idéologie fait office de barrière contre la révolution sociale.
On peut dire la même chose de tous les discours sur l’horizontalité, sur la décision de la base, sur l’incessante discussion des critères, sur la multiplicité, sur le fait que tous décident et/ou sur la démocratie directe, alors que ce qui se décide, en fait, c’est de produire pour le marché: «Ce que nous faisons c’est réviser constamment les accords... Parce que nous avançons toujours sur base d’accords: quand on descend dans la rue, quand on constitue un groupe de travail ou une zone du mouvement... Ce qui nous a grandement facilité la tâche, c’est qu’on n’a commencé aucun groupe sans avoir d’abord soumis les critères à la discussion, ils ont toujours été définis par l’ensemble du mouvement. Par exemple, dans les entreprises productives il faut d’abord se former et fixer des critères de production pour ensuite produire et vendre à l’extérieur.» Comme si on pouvait rompre avec la structure de domination capitaliste sans remettre en question la dictature de ce marché, la dictature de la valeur!
C’est sur ce terrain et sur cette base que les discours s’opposant à la prise du pouvoir par le prolétariat prennent toute leur dimension contre-révolutionnaire: «Nous serions un peu fous si nous cherchions à créer une organisation populaire de base, pour le changement social, en fonction d’une lutte pour arracher le pouvoir politique au capitalisme... cela ne nous intéresse pas de prendre le pouvoir politique, (ce qui nous intéresse c’est de) commencer à vivre comme nous en avons si souvent rêvé. Et cela c’est maintenant: nous n’allons pas devoir attendre une révolution.» Comme on peut le constater, on nage dans le gestionnisme et l’immédiatisme le plus grossier, en opposition à la révolution sociale. Comme si on pouvait «vivre comme on en a toujours rêvé» en plein capitalisme et sous la terreur de l’Etat! Ce dont il faut se rendre compte, c’est que ce que disent ici les porte-parole du MTD-Solano ce n’est pas seulement qu’ils sont contre la prise du pouvoir politique, ce avec quoi nous pourrions être d’accord parce que, pour nous, il ne s’agit pas de prendre l’Etat bourgeois mais de le détruire; ce qu’ils disent c’est qu’ils sont contre la révolution, contre la liquidation du pouvoir du capital qui n’est évidemment pas que politique. En effet, la clé de voûte de ce plan c’est «organiser l’économie alternative» sans détruire la société marchande. Comme s’il pouvait y avoir une autre économie, une autre société, en plein capitalisme! Ils oublient juste un détail: c’est que cette économie soi-disant alternative est soumise à la dictature du capital: dictature de la loi de la valeur, dictature de l’Etat bourgeois.
A ce sujet, il faut mentionner que c’est le Coletivo Situaciones (au travers de ses textes et de ses interviews des porte-parole de MTD Solano) qui a fait le plus de propagande pour cette position gestionniste tellement puissante dans le monde entier et qui, répétons-le, dans un mouvement comme celui du prolétariat en Argentine joue un rôle contre-révolutionnaire, en lui donnant une conception plus globale, plus philosophique. Ce collectif est un mélange idéologique de stalinisme, de populisme, de proudhonnisme. Ou, plus précisément, un mélange de manque de ruptures avec le nationalisme et avec le populisme sous toutes ses formes (péronisme radical, guevarisme, castrisme ou inspiré du modèle actuel des Tupamaros uruguayens -aujourd’hui parlementaires et défendant le Frente Amplio- ou encore celui du sous-commandant Marcos) mais qui utilise le langage à la mode de la gauche alternative. Situaciones s’est spécialisé dans cette apologie de la gestion contre toute remise en question révolutionnaire. Il est pour le moins symptomatique que dans son apologie de la gestion contre ceux qui luttent pour la révolution sociale, le Coletivo Situaciones soit obligé de paraphraser la vieille phraséologie léniniste, puis stalinienne, contre les révolutionnaires: «La politique sans gestion est le nouvel infantilisme de la gauche» (h).
Cette citation apologétique du léninisme contre les positions révolutionnaires (15) suffit à mettre en évidence qu’en dépit de ce que les auteurs de Situaciones ont pu lire concernant les situationnistes ou émanant directement de ces derniers, ils n’ont rien de commun avec ces camarades. Rappelons que dans Situaciones, la lutte pour la dictature du prolétariat, qui est l’un des points programmatiques les plus clairement démarcatoires chez les situationnistes, brille ici par son absence. La terminologie spectaculaire de Situaciones (qui va jusqu’à parler d’«usine spectaculaire»!) prétend utiliser formellement une continuité mais elle le fait si mal qu’elle révèle à chaque instant sa non rupture fondamentale avec le populisme et le stalinisme. Ainsi, ils n’hésitent pas à parler de «la recherche d’une production non capitaliste. Une nouvelle productivité pour les sujets, pour les militants, pour la pensée, pour les liens, pour l’économie et les représentations qui -comment ne pas le mentionner? - constituent essentiellement nos vies.» (i )
Dans le cadre de la lutte contre cette idéologie bourgeoise, nous voudrions reproduire ici quelques extraits d’un feuillet publié à l’origine en italien et intitulé: «Ai ferri corti» et traduit, publié et diffusé en décembre 2001 par des camarades en Argentine.
Indépendamment des désaccords que nous avons avec ses auteurs, ce document critique d’un point de vue révolutionnaire le gestionnisme tel que l’exprime Situaciones et d’autres groupes. Voici quelques extraits qui se situent sur une ligne de dénonciation identique à la nôtre: «Les exploités n’ont rien à autogérer à l’exception de leur propre négation comme exploité. Ce n’est qu’ainsi qu’avec eux disparaîtront leurs maîtres, leurs guides, leurs apologistes pomponnés des plus diverses manières... Curieusement ceux qui considèrent l’insurrection comme une tragique erreur (ou également, selon les goûts, comme un irréalisable rêve romantique) parlent beaucoup d’action sociale et d’espaces de liberté pour expérimenter... Beaucoup de libertaires pensent que le changement de la société peut et doit avoir lieu graduellement, sans rupture brutale. C’est pourquoi ils parlent de «sphères publiques non étatiques» où élaborer des idées nouvelles, de nouvelles pratiques. Laissant de côté les aspects décidément comiques de la question (où n’y a-t-il pas d’Etat? comment le mettre entre parenthèses?) ce qu’on peut noter c’est que le référent idéal de ces discours reste la méthode autogestionnaire et fédéraliste expérimentée par les subversifs à certains moments de l’histoire (la Commune de Paris, l’Espagne révolutionnaire, la Commune de Budapest, etc.). Le petit détail qu’on néglige cependant c’est que la possibilité de se parler et de changer la réalité, les rebelles l’ont prise avec les armes. En définitive, on oublie une broutille: l’insurrection».
Les gestionnistes «oublient» aussi que, y compris dans les cas cités plus haut, l’insurrection ne faisait que commencer, que l’Etat bourgeois n’avait pas été détruit, que le gestionnisme, loin de permettre une avancée révolutionnaire, permit la restructuration du capital et de l’Etat contre le processus révolutionnaire naissant. Ils «oublient» que, dans tous ces exemples historiques, le gestionnisme, en dévoyant l’énergie révolutionnaire dans l’autogestion, ouvrit la voie à la répression qui s’abattit ensuite!
Pour en finir avec le gestionnisme, il nous faut insister sur sa constante complémentarité avec le politicisme. Si les uns nient la lutte contre le pouvoir capitaliste et appellent à la gestion tandis que les autres appellent à l’institutionnalisation du mouvement au sein du pouvoir de l’Etat, soulignons que tous s’opposent à l’insurrection et à la destruction violente du capitalisme et de la société marchande. Les deux conceptions agissent comme si le fondement dictatorial de la société capitaliste, la dictature de la valeur contre l’être humain, n’existait pas. Elles désirent toutes deux démocratiser la société bourgeoise, l’une politiquement, l’autre économiquement («démocratie directe»); aucune ne rompt avec la dictature sociale que cette démocratie implique.
En ce sens, elles sont d’une complémentarité parfaite, dans les deux cas on cherche des solutions au sein du capitalisme et on s’oppose à la lutte pour la dictature du prolétariat pour abolir le salariat, la marchandise.
Aujourd’hui en Argentine, où le prolétariat s’oppose objectivement à toute la société marchande, à tous les partis, à tous les syndicats; où personne ne croit au prochain président, ni aux parlements, ni aux élections; où le rejet de tous les pouvoirs est général, ceux qui sont en train de sauver l’ordre social sont, en fait, ceux qui parlent d’assemblées constituantes mais aussi ceux qui cherchent des solutions dans la gestion économique laissant intactes les bases de cette société (la société marchande et l’autonomie des unités privées de décision, l’entreprise,…). Confrontés à la catastrophe économique, sociale et politique du monde capitaliste dans son ensemble qui s’abat sur le prolétariat en Argentine, les gestionnistes et les politicistes révèlent leur véritable nature: de fausses alternatives indispensables pour empêcher la remise en question de la société actuelle, pour empêcher d’en détruire les fondements.
Dans son article intitulé «Le mouvement des sans-emploi en Argentine» (j), James Petras se réfère à la généralisation du piquet et dit: «Le succès précoce des barrages routiers par les travailleurs au chômage dans les villes fantômes de Neuquen en 1996 s’est répandu dans tout le pays. Les barrages routiers sont devenus la tactique généralisée de groupes exploités et marginaux dans toute l’Amérique Latine. En Bolivie, plusieurs milliers de paysans et de communautés indigènes ont coupé les routes en demandant des crédits, des infrastructures, la liberté de cultiver la coca, l’augmentation des dépenses en matière de santé et d’éducation. En Equateur également, on proteste par de massifs barrages routiers contre la dollarisation de l’économie, le manque d’investissements publics dans les régions montagneuses, etc. En Colombie, au Brésil, au Paraguay, les barrages routiers, les marches et les occupations de terres associent demandes immédiates et exigence de politiques redistributives, la fin du néolibéralisme et des payements de la dette.» Laissant de côté les objectifs partiels que Petras attribue à ce mouvement (qui, pour nous, reflète plus l’idéologie réformiste de Petras que la force du mouvement), il nous semble que cette citation donne des éléments sur sa généralisation, au moins concernant les six premiers mois de l’année 2001. Ensuite, il y eut non seulement de nouveaux barrages routiers dans presque tous les pays mentionnés par Petras, mais également dans d’autres pays de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du Nord.
Les escraches aussi se sont généralisés. Non seulement en Argentine et dans les pays limitrophes comme le Chili et l’Uruguay, mais également aux Etats-Unis (escrache de Bush en Pennsylvanie en juillet 2002 au cri de «Bush terroriste», comme aux Philippines quelques semaines plus tôt), au Brésil, en Espagne, en Italie (même si dans ces deux pays, pour le moment, seuls des bourreaux argentins ont été escrachés).
Face à la catastrophe capitaliste qui se concrétise de jour en jour, il s’agit là de signes évidents de la reprise de la lutte prolétarienne dans de nombreux pays. Dans le processus d’affirmation prolétarienne le piquet, l’escrache, l’organisation en assemblées territoriales deviennent des armes puissantes. La généralisation de ces méthodes et structures organisatives à d’autres pays, le fait que l’exemple du prolétariat en Argentine commence à être connu et assumé sont des éléments vraiment encourageants et pourraient indiquer un changement quant aux caractéristiques des luttes actuelles, tant en ce qui concerne la durée de cet associationnisme prolétarien naissant que sur le plan du rapport de force qui pourrait commencer à changer si piquets et escraches se généralisent à d’autres continents.
Les idéologies contre-révolutionnaires que nous devrons affronter seront toujours les mêmes, quels que soient les costumes sous lesquels elles se travestissent: le politicisme et le gestionnisme. L’imposante catastrophe que vit le capital et qui frappe l’humanité continuera à s’aggraver et brûlera sur son passage toutes les fausses pistes jusqu’à ce que le prolétariat affirme sa révolution en détruisant pour toujours la société marchande.
|
a. «Etats-Unis: Prisons et libertés dans le meilleur des
mondes» in Communisme n°50 -juin 2000-
b. «Chili-Argentine: Contre l’impunité des bourreaux et
des assassins» in Communisme n°50 - juin 2000.
c. «Argentine: pillages contre la faim!» in Communisme
n°29 - octobre 1989.
d. Voir notre article «Algérie: il n’y aura pas d’élection
même si on doit tout brûler» in Communisme n°53 -
novembre 2002.
e. Voir «Chili-Argentine: Contre l’impunité des bourreaux
et des assassins » in Communisme n°50 - juin 2000
f. Voir Thèses d’orientation programmatique du GCI, thèse
n°15.
g. Les différentes citations des porte-parole de Solano sont
extraites de Situaciones n°4, MTD-Solano.
h. Situaciones n°2, article intitulé «La militance
du contre-pouvoir».
i. Idem
j. Publié dans Pensamiento libre n°39-40.
Mais, pour abattre le capitalisme, il est indispensable que la partie de cette société qui en compose l’être exploité et qui se manifeste comme la contradiction vivante à la tyrannie économique se constitue en une seule classe révolutionnaire face à la bourgeoisie, en un seul parti structurant sa force au-delà de toute religion, de toute idéologie, de toute nationalité.
L’internationalisme est la réponse prolétarienne aux efforts entrepris par les concurrents capitalistes pour souder les exploités à l’économie nationale et les faire s’entre-tuer en les alignant derrière leurs drapeaux respectifs: nations, régions, fronts de libération nationale, pays socialistes, fronts anti-impérialistes, peuples opprimés... La clé pour sortir des contradictions dans lesquelles le capitalisme tente d’isoler le prolétariat par paquets, de le diviser par Etats, réside dans le rejet absolu de tout embrigadement dans un camp national. Les exploités du monde entier n’ont aucun intérêt en commun avec ceux qui les exploitent et rien dans les contradictions interimpérialistes ne peut enrayer l’aggravation, à quelque niveau que ce soit, de leur situation d’exploités, rien dans les rapports de forces interbourgeois ne peut relativiser leur intérêt à combattre sans relâche la classe capitaliste.
Pour attacher le prolétariat aux valeurs patriotiques, la bourgeoisie a systématiquement recours à des artifices idéologiques sensés rendre plus consistante la fiction nationale qu’elle vend à ceux qu’elle domine. La recherche universitaire bourgeoise invente des origines pré-historiques à la nation, trouve des premiers habitants et les transforme très vite en un peuple dont on essaye de définir une soi-disant communauté de langue, de culture et de religion. Une fois ces racines définies, l’historien transforme alors des aspects de lutte de classe en luttes de «libération», brandit des héros locaux «morts pour la patrie», sanctifie les souffrances de prétendus martyrs et le tour est joué: une nation est née. L’histoire des «constitutions nationales» est ainsi jalonnée de toutes sortes de légendes visant à justifier la mystification nationale, à construire une unité ayant pour seule fonction de couvrir idéologiquement le capital constitué en Etat et permettre au capitalisme de disposer d’un prolétariat docile, domestiqué, acceptant sa condition au nom de l’union fictive existant entre lui et ceux qui l’exploitent.
Et au jeu des légendes, plus les idéologues nationalistes réussissent à présenter leur création patriotique sous les traits d’une petite victime opprimée (en clamant haut et fort les vexations imposées par un quelconque puissant rival), plus les agents capitalistes parviennent à figer les contradictions sociales dans la légende de l’idéologie nationale et à constituer autour de la dite nation opprimée un puissant consensus national. «L’oppression d’un peuple» est l’incontournable porte d’entrée empruntée par les capitalistes locaux pour commettre leurs crimes et faire tomber le prolétariat dans le piège de la défense nationale.
Dans la réalité, il n’y a ni «nations opprimées», ni «nations opprimantes»: il n’y a que des contradictions capitalistes, voilées par autant de fractions bourgeoises qui, toutes, s’efforcent d’éclipser l’exploitation derrière la fiction nationale.
Comme toute fiction, la nation devient néanmoins une force bien réelle et matérielle lorsqu’elle parvient à faire embrasser et défendre son immonde drapeau par l’ensemble de la société civile, exploités compris, dans une sorte de mariage entre prolétaires et bourgeois, une sordide union qui permet à ces derniers d’envoyer les premiers se faire massacrer au nom de la défense de la patrie. L’union patriotique est assurément la matérialisation la plus importante de l’idéologie nationale, elle est déterminante pour le déclenchement des guerres capitalistes.
Quelle que soit la puissance matérielle de cette fiction nationale, dans tous les cas, il faut rappeler que l’exploité reste concrètement soumis au flicage, aux impôts, à la répression, à la crétinisation, au travail, à l’extorsion de plus value,... et cela, qu’il soit coincé dans la patrie n°1 ou dans la patrie n°2. Le prolétariat n’a pas de patrie. Son intérêt réside dans l’unification de ses forces au-delà des frontières, en dehors du terrain mis en place par les différentes fractions bourgeoises pour livrer leurs batailles capitalistes. La victoire du projet communiste que la classe révolutionnaire porte en ses flancs dépend directement de sa capacité à s’imposer comme parti international, comme force apatride, a-nationale. Cette vérité que martèlent les révolutionnaires depuis qu’existe le salariat est plus actuelle que jamais et la difficulté à imposer cette perspective conduit à des situations toujours plus dramatiques.
Ce qui se passe actuellement au Proche-Orient est un épouvantable exemple de l’invariable et putride unité que constitue le capitalisme et la guerre et des difficultés qu’éprouve le prolétariat à retrouver le chemin, forcément internationaliste, de la lutte pour abolir les classes. Mais les violentes contradictions que charrie pareille situation de guerre généralisée condamnent les prolétaires des camps en présence à chercher d’autres voies que celles dans lesquelles on essaye de les enfermer. Ces voies conduisent à la lutte directe contre «son» exploiteur, à la lutte contre «sa propre» bourgeoisie, au refus de tirer sur des frères de classe, à la construction de réseaux permettant aux soldats des deux camps de déserter, à l’organisation d’une résistance face à «ses propres» officiers, à «son propre» Etat, au refus de toute guerre, bref à l’organisation du défaitisme révolutionnaire.
Nous voudrions souligner ici quelques exemples allant dans ce sens et les placer dans une perspective historique en republiant, à la fin de ces quelques notes, un tract internationaliste rédigé en yiddish et diffusé par quelques militants révolutionnaires au beau milieu de la dite deuxième guerre mondiale, au moment-même où la polarisation fascisme/antifascisme cherchait à empêcher toute unité prolétarienne. Ces révolutionnaires refusaient que l’antifascisme et la publicité des seuls forfaits des bourreaux fascistes conduisent à l’union entre prolétaires juifs et bourgeois juifs. Nous avons fait suivre ce tract de quelques notes historiques à propos de leurs auteurs.
Pour rassurer l’idiot télévisé, l’empêcher d’agir et être bien certain qu’il ira bosser le lendemain sans rouspéter, on complète l’information par des reportages sur les efforts de paix, sur l’envoi d’émissaires spéciaux, sur le vote de résolutions, on fait intervenir des prix Nobel, on montre des parlementaires étrangers, des pacifistes européens aux check-points israéliens, bref on rassure tout un chacun: des personnes «autorisées» s’occupent de l’affaire et font tout leur possible pour la résoudre. Ce qui permet sans doute au citoyen d’accepter de regarder les mêmes sanglantes images le lendemain soir sans ressentir le besoin de réagir.
Quant aux prolétaires qui se poseraient malgré tout quelques questions, on les tranquillise en les assurant de leur incapacité à modifier le cours des choses. Pour les contraindre à l’indifférence face à ce que subissent leurs frères de classe au Proche-Orient, on les submerge d’explications qui ramènent méthodiquement toute réflexion sur cette guerre à une question de nations rivales ou de conflits religieux séculaires et inextricables. A gauche comme à droite, on entend dire que la seule solution serait la création d’un Etat palestinien qui coexisterait pacifiquement aux côtés de son voisin, l’Etat d’Israël. Le maximum dont soit capable la pensée démocratique s’arrête logiquement à la conception de nouvelles frontières, à l’organisation de meilleures polices, à l’aménagement des conditions d’exploitation qui résulteront du nouveau rapport de forces entre Etats.
Etat palestinien, nation israélienne, religions juives et musulmanes... c’est dans ce cercle de feu que l’idéologie dominante cherche à enfermer toute tentative d’intelligence du conflit, poussant inévitablement -et c’est l’intérêt de la bourgeoisie- à une polarisation, à une démarcation entre ceux qui défendent «les israéliens» et ceux qui défendent «les palestiniens».
Jamais n’émerge la plus infime référence à l’existence d’intérêts sociaux opposés, à l’appartenance à des classes sociales différentes. Jamais on ne mentionne qu’entre un haut responsable politique et un soldat, entre un marchand de canon et un chômeur, entre un banquier palestinien et un gamin de Gaza qui jette des pierres, par exemple, existe un antagonisme aussi profond que celui qui oppose le prédateur à la proie qu’il ambitionne. Pour les médias, les classes sociales, c’est un monde qui n’existe tout simplement pas. Les journalistes ignorent volontairement tout ce qui peut séparer le jeune réserviste israélien catapulté sur le front du général de carrière qui l’y a envoyé. Peu importe si le premier est chômeur et l’autre gros actionnaire, pour les défenseurs de l’ordre il s’agit d’enfoncer dans la tête de tous ceux qui les écoutent qu’ils sont d’abord et avant tout des israéliens, des juifs. Tout comme les jeunes étudiantes qui se font sauter, ceinturées d’explosifs, dans un bus sont associées à titre de palestiniennes, en tant que musulmanes, aux mollahs planqués qui les ont convaincues que le martyr est un «don d’Allah» et le plus court moyen d’accéder au paradis.
La puissante réalité démocratique sollicite de façon permanente l’idéologie et pénètre méthodiquement l’espace social jusque dans ses derniers recoins pour assimiler à tous les niveaux le prolétaire à «son» Etat, pour le noyer dans une fausse communauté nationale et le dissoudre dans le peuple. La notion de peuple palestinien autant que celle de peuple israélien étouffe toute contradiction de classe. Elle matérialise l’égalité du monde de la marchandise, un monde dans lequel n’existent ni riches ni pauvres, ni banquiers ni réfugiés, ni propriétaires terriens ni ouvriers agricoles mais où seul règne l’intérêt commun à défendre un même Etat.
La puissance de la bourgeoisie pourrait précisément se mesurer, outre sa prétention à nier son adversaire prolétarien, à sa capacité à dissimuler sa propre existence comme classe. C’est pour cette raison, et de façon très complémentaire, que l’idéologie dominante évite de faire la publicité des accords que passent les bourgeois entre eux lorsqu’ils sont censés se livrer une guerre. Ainsi, en ce qui concerne le Proche Orient, il n’y a pas de raison de troubler la solidité du scénario basé sur des «ennemis nationaux irréconciliables». Pas question de montrer les coulisses bourgeoises de cette imposture, des coulisses faites de grandes accolades commerciales, financières et économiques entre «juifs» et «musulmans» sensés pourtant appartenir à des camps opposés. Le flot informatif évacue presque systématiquement ce qui pourrait désigner d’une quelconque manière l’existence de ces intérêts communs liant, indépendamment de leur nationalité, les capitalistes israéliens aux capitalistes palestiniens.
«Boire la mer à Gaza», Amira HassLes chromes des limousines garées devant les immeubles flambant neufs et les luxueux hôtels de Gaza-ville ont fait courir bien des rumeurs, tant est violent le contraste entre leur spectaculaire et soudain surgissement et la détérioration générale de l’économie.Dès l’installation de l’Autorité palestinienne, ses dirigeants passèrent une série d’importants accords de monopole avec des compagnies israéliennes. Les deux premiers furent conclus avec la société Nesher, qui acquit ainsi l’exclusivité de la fourniture de ciment dans tous les territoires administrés par l’Autorité, et avec Dor Energy, qui a le monopole de l’essence, du fuel et du gaz domestique. Non seulement ces transactions violaient le principe de la libre concurrence auquel l’Autorité se déclarait attachée, mais elle éliminait du circuit des centaines de détaillants, d’importateurs et de transporteurs palestiniens, qui vendaient jusque-là ces produits dans les territoires occupés. Les consommateurs étaient eux-aussi affectés par ces accords car les prix montaient alors même que l’Autorité avait des réductions sur les produits. Des accords monopolistes du même type furent passés avec des firmes israéliennes pour la viande surgelée, la farine, la peinture et le bois, dont la commercialisation a été confiée à une poignée d’agents palestiniens. Toutes ces gigantesques transactions furent menées par l’intermédiaire d’Al-Bahr, une société palestinienne montée juste après l’établissement de l’Autorité et qui fonctionne dans une zone opaque, mi-privée, mi-gouvernementale. D’après des sources multiples et dignes de foi, les propriétaires anonymes d’Al-Bahr sont des personnages de haut rang dans l’exécutif palestinien et les services de sécurité, qui ont la haute main sur toutes les négociations politiques. Ils disposent évidemment de permis spéciaux pour VIP qui leur évitent les problèmes de confinement auxquels sont soumis les autres hommes d’affaires. Al-Bahr a monté des filiales, chacune aux mains d’une douzaine de businessmen locaux, qui sont chargés de la distribution des marchandises dans tout le territoire sous administration palestinienne. (...) Al-Bahr et la Company for Commercial Services détiennent donc une part importante de l’industrie des communications et de l’informatique dans les territoires soumis à l’Autorité. Des responsables de l’Autorité ou des membres de leur famille ont des participations dans ces sociétés où ils se trouvent impliqués de toutes sortes de manières. (...) En dehors même des profits personnels, l’Autorité, en éliminant la concurrence, s’assure des rentrées importantes, un meilleur contrôle de la répartition des profits et la possibilité de fixer les prix. Aux points de passage de la frontière, les policiers de la Sécurité palestinienne veillent aux intérêts de l’Autorité en s’assurant que les chargements n’entrent pas en concurrence avec les marchandises sous contrôle des monopoles. Il existe même une unité spéciale, la Sécurité économique, chargée de vérifier les marchandises et les transporteurs. (...) Une très grande partie -pour ne pas dire la totalité- des profits engendrés par ces transactions ne parvient jamais jusqu’aux caisses du Trésor et n’apparaît pas dans la colonne des recettes du budget. Nombreux sont ceux qui pensent qu’une bonne partie de l’argent est dérivée vers des comptes bancaires en Israël... Extrait de «Boire la mer à Gaza» (Ch.12), Amira Hass, ED. La fabrique, 1996. |
Par exemple, lorsque l’Autorité palestinienne s’installa à Gaza, les journalistes prirent bien garde de ne pas troubler le bruit de fond de l’information et ne firent pas la moindre allusion aux importants accords de monopole immédiatement signés par les dirigeants palestiniens avec des compagnies israéliennes. Ils ne dirent pas un mot des gigantesques transactions passées avec des firmes israéliennes et qui permirent à toute une série de personnages de haut rang appartenant à l’exécutif palestinien de s’enrichir extrêmement rapidement. Des personnalités palestiniennes qui, rentabilité oblige, s’empressèrent d’aller placer leurs dividendes sur des comptes bancaires... dans l’Etat d’Israël. De cela, les journaux parlèrent très peu, car cela ne rentre pas dans les schémas que leur imposent l’idéologie dominante. Israéliens ou palestiniens, la réalité montre que les capitalistes n’ont d’autre patrie que celles du profit et qu’ils n’ont aucun problème, d’un côté comme de l’autre de la frontière, à exploiter leurs compatriotes tout en signant des accords entre eux. Mais ce constat fait basculer l’information dans le domaine de la lutte de classe et dévoile la fonction essentielle que joue le patriotisme dans l’organisation sociale capitaliste: effacer les contours de l’antagonisme social. Cette affirmation ne risque donc pas de sortir de la bouche de ces chiens de garde de l’ordre social que constitue la majorité des journalistes.
Face à la situation chaotique qui prévaut dans cette région et face à l’impressionnant barrage idéologique mis en place pour maintenir cette situation, nous voulons rappeler par ces quelques lignes que seule la reprise par le prolétariat de son chemin de classe peut mettre un terme à la guerre (au Proche-Orient et partout ailleurs) et que cette route passe forcément par la rupture nette et définitive avec les unions nationales que chaque Etat s’efforce de forger. Les ruptures opérées par le prolétariat en Palestine et la détermination avec laquelle il continue à affronter le terrorisme bourgeois constituent un pas important dans cette direction.
C’est face à ces conditions extrêmes d’exploitation, face à cette répression particulièrement violente (nécessaire pour maintenir ces conditions) que se soulève sans relâche le prolétariat en Palestine. Contre l’armée israélienne d’abord, l’ennemi qui lui fait directement face, l’ennemi qui détruit les maisons, humilie les prolétaires, assassine quotidiennement, mais également contre l’Etat et la police palestinienne, contre toutes les forces s’opposant à sa révolte.
Dans ce court texte dont le but est de souligner quelques actions se situant dans la perspective d’une réponse internationaliste et défaitiste révolutionnaire à la guerre, nous n’allons pas reprendre l’histoire des multiples luttes qui jalonnent la combativité prolétarienne en Palestine, particulièrement depuis l’établissement d’un Etat palestinien officiel. Au-delà de la résistance permanente aux agressions des flics et soldats israéliens, mentionnons pourtant rapidement les violents affrontements avec la police palestinienne, les attaques de prison, les libérations de prisonniers dénoncés comme terroristes par les deux Etats, israélien et palestinien, les attaques de commissariat, les soulèvements généralisés dans différentes zones, etc., autant d’exemples d’une pratique qui refuse de tenir compte des frontières, des drapeaux, des intérêts de la nation locale.
Déclenchée alors même que l’Etat d’Israël et l’OLP avaient mis en place, d’un commun accord, le nouvel Etat palestinien, la dernière vague de soulèvements dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et ailleurs est particulièrement significative. Elle atteste d’une énorme rupture avec la pacification sociale entreprise par l’Etat palestinien, ses chefs, sa police tortionnaire. Depuis la décision internationale d’officialiser l’existence de l’Etat local palestinien, les Intifadas (1) qui se sont succédé dans les dits territoires occupés ont montré à quel point le prolétariat de la région était peu enclin à accepter la «nouvelle» réalité que la classe dirigeante entendait lui imposer.
Ainsi, ce n’est pas sans broncher que les prolétaires entassés dans la bande de Gaza ont vu le nouvel Etat palestinien mettre en place toute une série de mesures favorisant les riches marchands, les banquiers et autres OLP «trois étoiles» qui pouvaient soudainement s’enrichir plus rapidement encore. Soutien aux représentants des grands clans fortunés, attribution de postes ministériels aux grands propriétaires fonciers, apparition d’une caste de fonctionnaires palestiniens bien logés, bien payés et roulant dans des voitures neuves,..., il s’est tout d’abord passé en Palestine ce qui s’est passé en Europe de l’Est lorsque le mur est tombé: les bourgeois se sont faits plus visibles et la misère est devenue plus criante. En toute logique capitaliste, l’argent des subventions devait servir à «stimuler l’initiative et l’investissement privé», ce qui signifiait concrètement favoriser les entrepreneurs palestiniens (tels les muwâttanîn, les riches familles de souche gaziote et tous ceux qui avaient réussi à accumuler du capital pendant l’occupation) et encourager financièrement l’établissement des hommes d’affaires palestiniens de la diaspora souhaitant investir en compagnie d’autres capitalistes étrangers. De même, les dons internationaux et les crédits de construction ont essentiellement servi à bâtir de hautes tours dans le centre de Gaza où un appartement coûte entre 45 000 et 60 000 dollars, beaucoup moins toutefois que les appartements de luxe où logent les hauts responsables de l’Autorité palestinienne (2).
Bien peu de raisons de fêter le nouvel Etat palestinien donc, pour les réfugiés, les ouvriers, les chômeurs de Cisjordanie et de Gaza car, comme ils ont pu le constater amèrement, l’espace dont ils disposent n’est pas seulement déterminé par l’existence des grillages électriques israéliens protégeant les colons, mais également par les limites que lui impose le besoin de développement des capitalistes palestiniens. C’est le constat qu’en fait une journaliste, à propos du peu de place dont disposent les réfugiés à Gaza: «Le camp de Khân Younis ne peut se développer, même provisoirement vers l’ouest, à cause des colonies qui le bordent. Le camp de Shâti’ avait un peu de marge au nord. L’Autorité palestinienne a choisi d’attribuer ces précieuses terres gouvernementales à un projet privé de construction d’un hôtel de luxe.» Quoi de plus parlant que cet espace laissé aux réfugiés, pour illustrer la façon dont le prolétariat n’entre en ligne de compte dans aucun des plans d’expansion capitalistes, qu’ils soient israéliens ou palestiniens? «Pourquoi les plages nous restent-elles fermées», s’interroge encore un réfugié palestinien en 1996, «la mer est le seul endroit où il soit possible d’oublier un peu. Ici, on construit un hôtel, là, un club d’officiers et entre les deux, il y a le cabinet d’Arafat. Et au sud comme au nord, les colonies juives.» Les prolétaires qui derrière les drapeaux de la «libération nationale palestinienne» pensaient se battre pour un morceau de terre en sont pour leurs frais: la seule patrie que leur ait concédée le nouvel Etat palestinien se situe entre les fils électriques des colonies juives et le béton des hôtels de luxe palestiniens.
Un autre exemple de l’intérêt porté par l’Etat palestinien à ses «compatriotes» prolétaires est le silence dont il fit preuve, lors de la négociation des accords de paix, à propos de la question des 11000 prolétaires de Palestine emprisonnés par l’Etat d’Israël. Dans un premier temps, la question des prisonniers fut purement et simplement «oubliée». A la suite d’une série de manifestations de protestation, on nota ce point dans l’accord du Caire de 1994, mais rien ne fut fait pour accélérer un règlement de la question. Hisham Abdel Razeq, le responsable palestinien des négociations sur la question des prisonniers exprime sa déception: «Je n’ai aucune explication valable à leur (aux prisonniers - NDR) donner sur les raisons pour lesquelles ils sont encore en prison (...) Ils ont l’impression d’avoir été abandonnés sur le champ de bataille par leurs chefs. Les prisonniers n’avaient jamais imaginé qu’un jour viendrait où des ministres palestiniens viendraient les voir en prison (a).»
Concrètement, pour le prolétariat, l’établissement d’un nouvel Etat national impliqua clairement une dégradation de ses conditions d’existence, déjà misérables. En 1996, le taux de chômage avait augmenté de 8,2 pour cent en six mois, pour atteindre 39,2 pour cent. Tandis qu’en 1995, les habitants de Gaza qui avaient la chance d’avoir un emploi dans la bande de Gaza ont vu leur salaire chuter de 9,6 pour cent et ceux qui travaillaient en Israël de 16 pour cent (b). Pendant ce temps par contre, la classe capitaliste s’enrichissait sur base d’accords passés avec différentes entreprises israéliennes.
Mais il n’y eut pas que les marchands qui prirent des ailes avec les accords d’Oslo, l’Etat palestinien s’attacha également au développement de sa police. Il est normal que l’espoir d’une expansion marchande capitaliste aille de pair avec l’intensification de la répression.
Nous rappelions en 1994 qu’à peine mise en place, la police palestinienne emprisonnait et torturait (c); depuis la situation n’a fait qu’empirer. Dès février 1995, pour tenir la promesse faite à Rabin de lutter contre le terrorisme, Arafat met sur pied la Cour militaire suprême pour la sécurité de l’Etat qui entreprend toute une série de procès nocturnes et expéditifs. En 1996, la Sécurité palestinienne n’hésite plus à exécuter des «activistes» et, en 1997, on décompte déjà une vingtaine de morts dans les geôles du nouvel Etat palestinien.
Les accords passés au Caire entre les Etats d’Israël et de Palestine en 1994 prévoyaient le déploiement d’une force de 9000 hommes (dont 7000 membres de l’Armée de libération de la Palestine) pour Gaza et Jéricho. A peine deux ans plus tard, la police palestinienne comptait déjà 21000 membres et ces chiffres n’ont cessé d’augmenter. La police palestinienne est rapidement devenue le principal employeur et la principale source de revenus dans la bande de Gaza. Aux forces de la Sécurité générale, du renseignement et de la défense civile prévues dans les accords se sont progressivement ajoutés la Sécurité préventive (qui s’occupe entre autre de contrôler le passage des palestiniens en Israël, un boulot qu’assumaient auparavant les seuls flics israéliens), le renseignement militaire, la garde présidentielle (la Force 17 et la Force 87 destinées aux «missions spéciales») et la police des frontières. Chaque branche de la Sécurité dispose de ses propres prisons (24 pour la seule bande de Gaza en 1996), de ses propres enquêteurs, de son propre esprit de corps. Tout habitant de Gaza peut être arrêté à plusieurs reprises par les différentes branches de la Sécurité. Des dissidents du Hamas se virent également proposer d’entrer dans la police pour y former un «département de la morale» chargé de lutter contre la prostitution, la consommation d’alcool,...; certains d’entre eux obtinrent immédiatement des grades d’officier de police et un salaire. Bref, les prolétaires n’ont pas tardé à faire remarquer qu’à Gaza, on comptait un flic pour cinquante habitants (d).
L’armée israélienne, quant à elle, n’a évidemment rien trouvé à redire à cette «violation» de l’accord du Caire. Elle espérait sincèrement que la police palestinienne, formée en partie par ses soins, puisse la relayer avec succès dans sa tâche répressive. Un exemple très caractéristique de cette heureuse collaboration entre polices fut la transmission aux flics palestiniens de la tâche consistant à filtrer l’entrée en Israël des ouvriers palestiniens au fameux checkpoint d’Erez.
«La police palestinienne fut chargée de filtrer les travailleurs par une série de barrages échelonnés jusqu’à la frontière. Même les soldats israéliens avaient dû admettre qu’il leur était très difficile de faire face aux supplications de ceux qui essayaient de passer sans permis. Il s’agissait donc d’épargner aux Israéliens ce pénible travail et de s’en décharger sur la police palestinienne. (...) Il ne fallut pas longtemps à ceux de Rafah pour plaisanter amèrement sur les sept barrages palestiniens qu’ils devaient franchir avant d’arriver au point de passage israélien (e).»
Comme toutes les forces de l’ordre du monde, la police israélienne savait parfaitement bien qu’une police locale («de proximité», comme le formule aujourd’hui l’euphémisme républicain français pour la police des banlieues) serait bien plus crédible et plus efficace qu’une armée d’occupation, qu’un flic «étranger». Mais le refus de la paix sociale dont ont témoigné les Intifadas successives a partiellement ruiné l’histoire d’amour qui unissait les polices palestiniennes et israéliennes (3). Complètement débordé, incapable de maintenir l’ordre, l’Etat palestinien n’a pas eu le choix: il fut contraint de laisser revenir son «maître», sa référence en matière de répression. L’armée israélienne intervint donc à nouveau, reprenant ponctuellement position dans les villes soi-disant autonomes, arrêtant et/ou assassinant des militants, réprimant toute expression de colère prolétarienne.
L’Etat palestinien en mal de crédibilité après tant d’années de flicage, d’emprisonnement, de torture n’avait dès lors plus d’autre choix, il lui fallait jouer une nouvelle fois la carte de l’«opposition à Israël». Les riches marchands et les politiciens palestiniens en provenance de l’étranger qui avaient à peine eu le temps de se construire un semblant de banlieue chic à Gaza, reprochèrent donc rapidement à l’Etat d’Israël la rupture des accords passés et dénoncèrent une nouvelle agression. Ensuite, pour bien s’assurer qu’en tant que capitalistes «moins-puissants-que-leurs-rivaux-israéliens», ils ne seraient pas mis dans le même sac que «l’ennemi sioniste», ils envoyèrent leurs flics et leurs soldats se mêler aux jeunes prolétaires en colère pour tirer quelques balles contre des chars israéliens, préparant ainsi l’alibi d’une nouvelle et sordide union nationale.
Pourtant, le discours anti-israélien ne parvient que très péniblement à protéger l’OLP et la direction de l’Etat palestinien de la haine de ceux qu’ils ont réprimés. Yasser Arafat a serré la main de trop de responsables politiques israéliens, il a collaboré à la mise en place d’une police locale avec son soi-disant ennemi, il a permis la répression, la torture, il a emprisonné ceux que l’Etat d’Israël demandait d’emprisonner, il a remis des prisonniers palestiniens à l’Etat d’Israël, etc.
L’Etat palestinien continue bien entendu de jouer à fond la carte de «l’ennemi israélien» pour recomposer l’union nationale interne et cacher le rôle répressif qu’il joue en duo avec l’Etat d’Israël depuis des années -il n’a pas d’alternative-, mais cela ne suffit pas et l’union patriotique à laquelle appelle l’OLP, même si elle assume sa fonction désorganisatrice parmi ceux qui se battent, reste malgré tout bien fragile face au processus d’autonomisation auquel semble prêt une bonne partie du prolétariat en Palestine.
Une des conséquences perverses de la décrédibilisation de l’OLP et de Yasser Arafat est de permettre évidemment à d’autres groupes nationalistes et religieux, tels le Hamas ou le Jihad islamique, de se renforcer en déviant, en récupérant dans ses propres filets la combativité qui s’exprime dans les «territoires occupés». Ces groupes tirent un profit énorme de la situation désespérée dans laquelle se trouvent les prolétaires palestiniens écrasés par l’énorme machine de guerre israélienne et qui se voient presque chaque jour confrontés à la perte d’un proche, d’un parent, d’un voisin. Toute la science des groupes islamistes consiste à transformer la haine du prolétariat pour la guerre qui lui est faite (et donc aussi pour son ennemi direct, ceux qui lui tirent dessus) en une répugnance meurtrière «pour les juifs» en soi. Tout comme en France en 40-45, les Francs Tireurs et Partisans et le Parti Communiste cherchèrent à réduire les marges du combat anticapitaliste au célèbre mot d’ordre patriotique «A chacun son boche!», des groupes tels le Hamas et d’autres flattent aujourd’hui le désespoir de ceux qui n’ont plus grand chose à perdre et détournent leur colère contre «les juifs», «les impies», «les athées». Ces gangs palestiniens, qu’ils soient nationalistes et/ou religieux, ont pour fonction de ramener le refus violent des conditions sociales imposées aux prolétaires en Palestine à une simple guerre nation contre nation et de transformer des victimes non consentantes de la guerre capitaliste en assassins convaincus des «ennemis de la nation».
Ceci dit, le succès des promoteurs du martyrologe est relatif. Plus d’un parent de jeune prolétaire envoyé au martyr s’est retourné contre son émissaire. Dans une émission tournée par la télévision israélienne auprès des familles de militants palestiniens emprisonnés ou tués lors d’attentats-suicides, un père et une mère s’exclament: «Que les mollahs qui ont envoyé mon fils y aillent eux-mêmes au martyr!» Cette révolte contre l’utilisation de prolétaires comme chair à canon est certainement beaucoup plus répandue que ce que nous laisse entrevoir la propagande officielle. D’autre part, toute la combativité en Palestine n’est pas récupérée par ces structures nationalistes ou religieuses; des groupes de militants continuent à se structurer de façon autonome et à échapper aux récupérations trop simplement nationalistes et antijuives. Il existe de fait une combativité générale du prolétariat qui manifeste régulièrement une volonté d’autonomie, tant face à l’Autorité palestinienne que face aux groupes islamistes. Ainsi, par exemple, récemment encore, en octobre 2002, alors que son frère avait été assassiné par la police anti-émeute palestinienne lors d’une manifestation contre Arafat, un prolétaire a voulu venger ce crime et a exécuté le responsable policier de cette unité répressive. Les flics palestiniens se sont alors lancés à sa recherche, mais ils n’ont pas réussit à le capturer pour la bonne et simple raison que les habitants du quartier où il résidait sont immédiatement intervenus pour empêcher son arrestation. Ils l’ont caché, l’ont défendu par tous les moyens, notamment en attaquant les voitures de police. L’Autorité palestinienne a immédiatement cherché à attribuer ces faits au Hamas, mais les habitants du quartier ont explicitement démenti cette accusation (f). Cette situation est loin d’être exceptionnelle. Il existe de plus en plus de situations semblables, où la nécessité d’agir en se démarquant de tous ses ennemis, pousse dans les faits le prolétariat à ne compter que sur ses seules forces.
C’est dans la multiplication de ces actions de résistance et dans l’extension de l’autonomie politique qu’elle implique, que réside sans doute la possibilité de voir se développer la réponse anticapitaliste (et donc internationaliste) qu’oppose le prolétariat aux conditions atroces auxquelles il est soumis. Une réponse basée sur la différenciation de classe et non de nation, une réponse prenant en compte l’opposition totale existant y compris dans le camp israélien entre soldats et officiers, entre ouvriers et patrons, entre prolétaires et bourgeois, une réponse qui stimule et encourage les oppositions existantes et qui pousse les prolétaires israéliens sous l’uniforme à se reconnaître dans le combat social que mènent leurs frères en Palestine et non plus dans les ordres assassins de leurs officiers. Une réponse enfin qui écarte de ses propres rangs les faux amis du prolétariat, tous ceux qui cherchent à récupérer la haine de classe et à la transformer en combat national ou religieux, pour un nouvel Etat, un nouvel espace capitaliste plus adapté à leurs besoins.
Il est évident que le chemin de l’internationalisme passe aujourd’hui en Palestine par la réponse immédiate aux humiliations et aux tortures imposées. Il ne s’agit pas d’attendre béatement que la solidarité internationaliste surgisse spontanément dans les cerveaux des soldats israéliens qui les assassinent. C’est précisément l’action directe menée par les prolétaires de Palestine à l’encontre des soldats israéliens qui leur tirent dessus, les tiennent enfermés dans les camps et les torturent qui constitue la plus puissante incitation aux soldats de l’autre camp pour qu’ils rompent avec l’union nationale et se retournent contre leurs officiers.
Sans doute, cette action directe du prolétariat prend-elle aujourd’hui encore toutes sortes de formes, plus ou moins confuses, plus ou moins ciblées. Les colons et l’armée israélienne constituent très certainement les objectifs premiers de ceux qui résistent à la terreur militaire, mais il est certain que l’état d’exaspération dans lequel est placé le prolétariat des camps face à l’assassinat systématique de ses enfants ou de ses parents exacerbe à ce point sa volonté d’atteindre l’ennemi qu’elle rend parfois plus approximative la cible visée, voire la méthode utilisée (4).
Nous voulons néanmoins souligner ici l’hypocrisie et le cynisme qui consiste à oser mettre sur le même pied d’une part, une frange de prolétaires qui tentent de résister et jettent leur désespoir dans une action plus ou moins suicidaire et d’autre part, l’ennemi de classe qui prend la forme de ces tueurs déterminés, surentraînés et parfaitement nourris, qui n’hésitent pas à tirer sur des enfants réfugiés dans les bras de leur père, à liquider des blessés transportés en ambulance, à enterrer vivant les habitants qui ont refusé d’abandonner leur maison, à tirer des missiles sur des buildings remplis de prolétaires.
Quelle dose de cynisme faut-il à la bourgeoisie internationale pour tenter de faire passer pour «terroristes» les quelques réactions du prolétariat des camps et pour «lutte antiterroriste» l’action de ces soldats qui démolissent les maisons, qui emprisonnent et torturent ou qui bombardent carrément les populations des camps de réfugiés, comme ce fut le cas encore récemment à Rafah et à Khân Younis, les zones les plus pauvres de tous les territoires palestiniens? Quelle comparaison possible avec la terreur que ces soldats font régner lorsqu’ils s’amusent à prendre pour cible les citernes d’eau placées sur les toits, à donner des coups de crosse dans les portes des maisons pour terroriser les enfants, à confisquer les papiers d’identité sous le moindre prétexte, à tabasser les prisonniers à l’aide de gros câbles électriques? Quelle comparaison possible avec la situation dans les camps où le simple déplacement d’un prolétaire d’une ville à l’autre, d’un village à l’autre est l’objet de vexations infinies? Sans parler des humiliations quotidiennes: le garde-frontière qui balance par terre l’étal de tomates d’un petit marchand, les militaires qui viennent vider leurs ordures dans les quartiers habités, les fonctionnaires qui coupent l’électricité de quartiers entiers pour l’une ou l’autre facture impayée... Les fauteurs de guerre israéliens savent pertinemment bien qu’une guerre se gagne en décourageant l’adversaire, à fortiori si celui-ci se manifeste plus sur le terrain social que national et c’est la raison pour laquelle l’armée assassine délibérément un nombre aussi important de civils, d’enfants, d’ouvriers... des crimes qu’on feint de pleurer comme bavures (5). Une étude de l’association israélo-palestinienne Physicians for Human Rights (PHR) souligne que pendant les cinq années qu’a duré la première Intifada, un enfant de moins de six ans a été atteint d’une balle dans la tête toutes les deux semaines. Et récemment, un tireur d’élite de l’armée israélienne expliquait à une journaliste que les ordres étaient de tirer sur les enfants de plus de douze ans et d’allure dangereuse (6). Peut-on sérieusement encore parler de bavure?
Quelle hypocrisie que d’invoquer «le terrorisme» pour disqualifier les rares balles prolétariennes qui, en réponse à cette terreur, atteignent parfois leur cible! Quelle sinistre comédie encore que de parler de «lutte contre le terrorisme» pour désigner les agissements des colons israéliens, organisés en véritables escadrons de la mort, qui n’hésitent pas à abattre des prolétaires désarmés, à torturer et à assassiner leurs prisonniers, tout cela sous l’oeil bienveillant et avec la bénédiction de l’armée!
En désobéissant à «leur propre» bourgeoisie, en refusant la paix sociale et les conditions de vie qui leur sont imposées, en agissant de façon autonome, les prolétaires en Palestine ouvrent le chemin du défaitisme révolutionnaire. Par leur action, ils encouragent pratiquement les prolétaires en Israël à désobéir eux aussi à leurs dirigeants, première étape rendant possible une communauté de lutte dépassant les clivages nationaux et où s’affirme la lutte contre les bourgeoisies des deux camps, contre les armées des deux bords, contre les capitalistes de tout pays.
Une nuit ordinaireNous sommes dans un petit village, en pleine nuit. Le calme règne. Seul un chien aboie, perturbé par l’approche d’un léger cliquetis. Rapidement le silence laisse place à un bruit furieux. Des blindés bloquent tous les accès au village. A coups de crosse, des soldats d’unités spéciales défoncent les portes des maisons. Les enfants pleurent, les adultes aussi sont terrorisés. Des militaires trient, classent le bétail humain. Certains des villageois sont fusillés sur place, d’autres sont arrêtés pour être torturés dans les geôles de l’Etat. Pendant ce temps, les assaillants placent de la dynamite et font sauter les maisons des familles de ceux qui sont arrêtés.Cette scène de terreur aurait pu être un pogrome en 1903 en Russie, ou la « nuit de cristal » en 1938 en Allemagne, ou se dérouler au Chili en 1973, ou encore dans un village rwandais en 1994,… Mais non, cette scène a lieu aujourd’hui, en octobre 2001 plus exactement, et s’est déroulée dans des dizaines de villages en territoire palestinien. L’agent local de cette action terroriste n’est autre que l’Etat israélien. Pour ajouter au cynisme de la situation, les militaires ont baptisé cette opération : Opération Gandhi. Ce raid n’est ni le premier, ni le dernier, c’est le pain quotidien du prolétariat dans la région. A cette terreur exercée par l’Etat israélien correspond celle imposée aux prolétaires par les groupes nationalistes et/ou islamistes palestiniens, qui ne sont pas les derniers à intimider, rançonner, voir exécuter les prolétaires récalcitrants. Que cela soit en période de paix ou de guerre, pour le prolétariat, la vie sous le Capital signifie la terreur au quotidien. |
Cette puissance militaire trouve son origine dans l’appui indéfectible que reçoit l’Etat d’Israël de la part du camp occidental et particulièrement des Etats-Unis, un appui qui concerne directement la fonction première qui lui est attribuée, à savoir la répression générale du prolétariat, non seulement en Palestine et en Israël mais dans toute cette région connue pour son agitation sociale. La fonction de gendarme attribuée à l’Etat d’Israël, chargé de fait de la répression de tout mouvement social dans la zone, permet à la bourgeoisie tant locale qu’internationale de conserver le contrôle sur les ressources pétrolières du Moyen-Orient, ressources vitales pour l’industrie internationale (8). Traduits en termes financiers, les chiffres du soutien occidental sont à l’image des enjeux impérialistes concentrés dans la région. Depuis 1984, l’aide officielle annuelle de la seule bourgeoisie étatsunienne à l’Etat israélien est de 3 milliards de dollars (40% en soutien économique et 60% en soutien militaire). Si l’on ajoute à cette somme les 2 milliards supplémentaires d’aide dite indirecte (différents programmes militaires particuliers, soutien militaire en provenance du budget de la défense, garanties non exigées,...), on arrive à une somme annuelle approximative de 5 milliards de dollars, ce qui constitue quelque chose comme le tiers du budget de l’aide extérieure américaine (9).
Mais, exception faite du soutien militaire occidental direct, sur quoi repose ce rapport de forces en faveur de l’Etat d’Israël? Il s’est construit principalement -comme dans toute guerre- sur la puissance de l’union nationale, une union qui s’étend bien au-delà des frontières de l’Etat officiel et qui, alimentée par les campagnes antiterroristes internationales, chuchote qu’«Israël a tout simplement lui aussi le droit de se défendre contre le terrorisme», un droit que lui reconnait y compris l’Etat palestinien. La lutte «contre le terrorisme» est la porte d’entrée pour la répression, un véritable permis de tuer international donné par l’ensemble des fractions qui appuient de manière permanente la répression menée par l’Etat d’Israël, plus particulièrement les USA et l’Europe.
Le soutien international au rôle répressif que l’Etat d’Israël joue dans la région rend évidemment primordiale cette union nationale, une union particulièrement organisée autour de l’armée: militarisation omniprésente, service militaire extrêmement long et valorisé, justification du rôle soi-disant protecteur de «Tsahal», construction de préjugés favorables aux soldats, économie militarisée, population militarisée,...
Cette situation hyper-militarisée est malheureusement peu remise en question par les prolétaires en Israël, et ce malgré le développement qu’a connu et que connaît encore la lutte en Palestine. De fait, les soulèvements répétés en Cisjordanie et à Gaza n’ont malheureusement pas empêché les prolétaires en Israël de se cantonner jusqu’ici dans une indifférence coupable face aux massacres qu’accomplit l’armée israélienne, et cela quand ils ne se sont pas purement et simplement alignés derrière les plans mis en place par la bourgeoisie israélienne pour écraser les intifadas successives. Il faut bien constater que, la plupart du temps, les prolétaires en Israël n’ont fait que reproduire l’idéologie de l’ennemi de classe, ce qui, dans le contexte des affrontements sociaux qui se déroulent en Palestine, est particulièrement lourd de conséquences pour leurs frères de classe.
Les justifications des actions menées par l’armée israélienne s’arment bien entendu d’idéologies diverses, selon les fractions qui les expriment: les rabbins bénissent les armes qui assassinent les palestiniens au nom de «la lutte contre le Mal», tandis que les laïcs -Shimon Pérès, prix Nobel de la Paix en tête- stigmatisent quant à eux «la lutte contre le terrorisme». Mais toutes en appellent à la «mère patrie», en fait «l’armée-mère», une armée qu’on ne nomme même plus «armée» mais qui trimbale partout son propre petit nom -«Tsahal»- comme pour se différencier des autres, comme pour signifier le caractère protecteur et bienveillant de ses tueurs.
De plus, aussi diverses soient les explications de cette guerre de destruction menée par l’Etat israélien, elles viennent toutes se cimenter dans une sorte de revendication mystique des souffrances passées du «peuple juif» comme caution indiscutable de l’action présente. Comme partout, mais plus fort encore ici, l’Etat impose la justification profonde de son existence dans un mélange d’idéologie et de religion empêchant toute contestation, toute remise en question de la version officielle des raisons qui fondent ses actions. «L’holocauste est la nouvelle religion d’Etat en Israël», déclarait une actrice israélienne juive pour expliquer la difficulté de formuler une quelconque critique à l’Etat (g). Et en effet, à l’image des justifications émises lors de la plupart des guerres menées par le camp occidental ces dernières décennies, l’Etat d’Israël légitime la terreur que l’armée sème actuellement sur son passage en renvoyant au gouffre qui séparerait ses propres crimes des atrocités commises à l’égard du prolétariat juif par le camp vaincu -l’Etat allemand, lors de la dite deuxième guerre mondiale. Ces sordides comparaisons sur l’échelle des horreurs capitalistes, outre ce qu’elles occultent (10), constituent le ciment d’un énorme consensus national où toute contestation du terrorisme d’Etat local se heurte à cet extraordinaire dogme induisant qu’aucune souffrance infligée à personne n’égalera jamais les persécutions subies par le peuple juif sous le nazisme. Un universitaire de Tel Aviv, militant contre la guerre menée par l’Etat d’Israël, dénonçait récemment le cynisme qui se cache derrière cet implacable raisonnement, dans ce qu’il décrivait comme «la logique d’Auschwitz»:
«Voilà bien la logique d’Auschwitz dans une coquille de noix. Ramallah n’est pas Auschwitz. Israël n’est pas le Troisième Reich. Nous n’avons pas de camp de la mort et nous n’avons pas massacré un tiers de la population palestinienne dans des chambres à gaz. Donc, tout ce que nous faisons est correct. Nous pouvons couvrir les territoires occupés de gaz lacrymogènes et de sang, nous pouvons tuer et blesser et torturer et menacer et déposséder, nous pouvons entourer des millions de personnes de grillages électrifiés et de tanks dans de minuscules enclaves, nous pouvons les assiéger et les bombarder quotidiennement, nous pouvons envoyer à pied les femmes enceintes à l’hôpital, et nous pouvons également tirer sur les ambulances. Car aussi longtemps que nous resterons ne fut-ce que 10 centimètres en dessous des atrocités de l’Allemagne Nazie, tout ira pour le mieux, et ne vous aventurez pas à oser une comparaison. On dit parfois que le Mieux est l’ennemi du Bien. Israël est en train de démontrer en quoi le Pire est le meilleur ami du Mal. Et un grand merci à Adolf Hitler pour avoir mis en place d’aussi insurmontables normes. (h)»
Ces notes ne partent pas explicitement du point de vue du prolétariat, mais elles ont pourtant valu à son auteur toute une série de menaces et d’intimidations. Cela témoigne de la logique de fer à laquelle se heurte notre classe face à l’Etat d’Israël lorsque la moindre critique est formulée. S’attaquer à la religion de l’Holocauste en Israël est pire que de remettre en question le dogme justifiant la démocratie en Europe de l’ouest. Quand on voit, par exemple en Occident, la manière dont est rejetée comme «poujadiste» ou «philo-fasciste» toute réaction cherchant ne fut-ce qu’à sortir du parlementarisme (11), on imagine la terreur que doit représenter pour un prolétaire en Israël une quelconque critique de la religion d’Etat locale, ce qui n’excuse évidemment pas le manque de solidarité pratique avec son frère en Palestine.
Et que dire des critiques à l’armée et de tous ceux qui cherchent à résister à l’embrigadement militaire généralisé? L’objection de conscience, particulièrement en temps de guerre, est un délit assimilé à la haute trahison (12). Même une démarche pacifiste prend ici une autre dimension. Distribuer un simple tract appelant à l’arrêt de la guerre ou s’opposant au développement des colonies, c’est risquer sa peau face aux militants du Kach ou aux colons.
L’union nationale est donc très puissante en Israël et, nous l’avons souligné, le prolétariat s’y trouve pratiquement dissous. Cela rend d’autant plus intéressantes les quelques ruptures qui se sont dessinées ces derniers temps face à l’ordre social local, des ruptures qui sont parties de soldats israéliens et qui semblent se généraliser à d’autres secteurs.
Ainsi, le 26 janvier 2002, 53 officiers et soldats de réserve de l’armée israélienne ont publiquement fait connaître leur refus de «combattre dans cette guerre pour la paix des colonies... de combattre dans les territoires occupés pour dominer, expulser, affamer et humilier un peuple entier». Cet appel a été publié dans le quotidien israélien Haaretz.
Ce n’est pas la première réaction en ce sens puisqu’en août 2001 déjà 62 étudiants avaient fait savoir leur décision de ne pas répondre à un éventuel envoi dans les territoires et cela pour des motifs politiques. Mais cette réaction-ci, rendue publique dans un journal israélien sous forme d’annonce et signée directement par des militaires en exercice, a mis au grand jour une réalité généralement soigneusement occultée.
Ainsi à l’image des 53 signataires mentionnés plus haut, plus de 400 réservistes ou soldats israéliens ont, depuis le début de la nouvelle Intifada (septembre 2000), rendu public leur refus de se battre dans les «territoires occupés» et une quarantaine d’entre eux ont été jetés en prison pour cela. Yair Hilu, 18 ans, a été récemment condamné à la prison militaire pour avoir refusé de faire son service militaire «dans cette entité violente qu’est l’armée», selon ses propres paroles. L’Etat israélien ne fait évidemment pas beaucoup la publicité de ces données (pas plus que l’Etat palestinien d’ailleurs). Il est donc difficile de connaître le nombre exact de prolétaires qui ont refusé de se battre, mais on estime -sur base des estimations de l’armée elle-même- que pour une personne qui a rendu public son refus de servir l’Etat, 8 ou 9 autres soldats expriment la même position, sans oser affronter directement leurs supérieurs. Lors de la première Intifada déjà (1987-1991), plus de 2500 soldats refusèrent clairement de se rendre en Cisjordanie et à Gaza, ce qui signifierait, sur base des calculs faits précédemment qu’ils furent environ 20.000 à refuser de partir et à affronter d’une façon ou d’une autre la répression de l’Etat.
L’armée israélienne relativise cette réalité et, malgré les témoignages et le nombre croissant de prises de position en ce sens, répète sans cesse que «le moral est bon» et que les «soldats sont motivés». Pourtant, les réactions de l’Etat ne laissent aucun doute quant à la peur de voir s’étendre le refus d’obéir. Un symptôme évident de cela est la façon dont les autorités militaires israéliennes évitent de jeter systématiquement en prison les soldats réfractaires afin de ne pas faire trop de remous autour du refus de servir. D’un autre côté, parce qu’ils affirment un refus plus général du système, ceux qui résistent trop ostensiblement à l’Etat ont droit à un traitement particulièrement humiliant devant servir d’exemple et décourager d’autres réfractaires. Autre symptôme, l’interdiction désormais faite à tout journaliste étranger au service information de l’armée israélienne de faire quel que reportage que ce soit; cette décision a été prise après que plusieurs appelés, interviewés sur les terrains de bataille mêmes, aient fait part devant les caméras de leur désarroi, de leur incompréhension des buts de cette guerre. Mais la peur de la désobéissance sociale du prolétariat prend un visage plus manifeste encore dans l’adoption, le 22 mai 2002, du plan d’austérité présenté par Sharon qui prévoit une réduction des allocations pour les familles dont les enfants n’ont pas effectué de service militaire. L’union nationale inconditionnelle autour de la guerre menée par l’Etat d’Israël est clairement l’enjeu de ces mesures particulièrement ciblées.
Il s’agit en effet d’empêcher tout soutien à ceux qui sont dénoncés comme les «saboteurs du moral de la nation». Car c’est bien là le problème de la bourgeoisie israélienne actuellement: comment empêcher que les questions posées par les prolétaires embrigadés sous l’uniforme ne se transforment en une réponse sociale et révolutionnaire de l’ensemble du prolétariat? Car aussi faibles que soient encore les réactions éparpillées des prolétaires en Israël face à la guerre, elles contiennent les germes d’une polarisation sociale pouvant transformer à terme la guerre entre les Etats israéliens et palestiniens, en un affrontement de classe, un affrontement entre d’un côté les défenseurs bourgeois de la nation et du capitalisme et, de l’autre, une classe sociale prenant conscience que la défense de la nation à laquelle on la contraint n’est qu’un prolongement des intérêts de ceux qui l’exploitent.
Pour exemplifier ces germes de polarisation sociale, il suffit de s’attarder sur ce premier appel des 53 soldats israéliens à ne plus combattre «dans les territoires occupés» et sur les réactions qu’il a suscitées. Si l’on s’arrête simplement au texte on verra qu’il contient énormément de faiblesses: les signataires y justifient les sacrifices faits dans le passé pour l’Etat d’Israël, prennent pour référence la sécurité de l’Etat, regrettent la dégradation de l’image «humaine» de Tsahal (sic!) et prétendent continuer à la servir. Mais le plus intéressant est moins ce qui y est dit que le fait en lui-même. Que dans le contexte d’une union nationale aussi compacte que celle qui règne en Israël, des soldats osent refuser les injonctions de leurs supérieurs et se mettent de la sorte aussi ouvertement en porte-à-faux avec les intérêts de leur bourgeoisie, avec tout ce que cela suppose également comme répression sociale, comme insultes, comme mépris, comme isolement de la part de la majorité des citoyens, donne un poids bien plus important à cette position à contre-courant. Il ne s’agit pas d’une réaction antimilitariste dans un contexte de paix sociale ou dans le cadre des «permissivités» de la démocratie parlementaire, il s’agit d’une rupture face à l’un des Etats nationalement les plus soudés du monde, un Etat qui joue un rôle de gendarme déterminant dans la région. Refuser de se battre pour «Tsahal», tout en dénonçant les souffrances infligées aux prolétaires de Palestine sur lesquels on est censé tirer, équivaut à s’affronter directement à toute cette cohérence politique puisée dans la mythologie du peuple martyr et armée de l’idéologie de l’antifascisme international, ciment des Etats vainqueurs et dominants depuis la Seconde guerre mondiale. C’est un affrontement peu banal.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cet appel a immédiatement vu ses auteurs (et ceux qui les ont soutenus (13)) traités de «révisionnistes», de «traîtres», de «juifs haineux d’eux-mêmes», d’«antisémites» même. Le journal qui a publié ce manifeste a lui-aussi été dénoncé et de nombreux intellectuels s’en sont immédiatement démarqués. Pour contrer les effets défaitistes de cet appel et les enthousiasmes qu’il a suscités auprès de nombreux prolétaires qui voyaient enfin écrit noir sur blanc ce qu’ils pensaient tout seuls et tout bas, l’Etat a immédiatement réagi avec son terrorisme inhérent. Le ministre de l’éducation, Limor Livnat, a demandé l’inculpation de 200 universitaires qui soutenaient ces soldats refusant de servir dans les territoires palestiniens. La presse bourgeoise et les les religieux ont appelé à soutenir le moral des militaires, à l’image du quotidien Yediot Aharonot, qui publia le 7 mai 2002 des lettres d’enfants d’écoles publiques religieuses appelant les soldats à «tuer le plus d’arabes possible», à «trouer les palestiniens avec les F-16»,... De même, le parlement israélien étudie des propositions de loi proposant notamment de punir de cinq ans d’emprisonnement «l’expression d’un soutien à une organisation terroriste» (et donc de condamner tout contact avec une organisation palestinienne quelle qu’elle soit).
Mais d’une façon ou une autre, et même s’il est trop tôt pour parler d’un mouvement se généralisant, si ce petit texte a suscité autant de réactions de la part de l’Etat, c’est bien parce qu’il révèle les brèches qui tendent à se former dans l’unité nationale. Depuis la publication de ce texte en janvier 2002, le nombre de signataires s’est élargi. Les derniers chiffres que nous possédons datent de mars 2003 et signalent 1100 signataires, parmi lesquels plus de 250 ont fini en prison. Mais au-delà de cette initiative, d’autres informations parlent de plus d’un millier de prolétaires israéliens refusant d’une manière ou d’une autre d’accomplir leur service militaire, qu’ils soient conscrits ou réservistes ou même officiers. On les appelle désormais les refuzniks et selon différentes associations, avec toute la prudence nécessaire lorsqu’on cite des chiffres, l’appui qu’ils auraient au sein de la société atteindrait aujourd’hui 25%.
D’autres initiatives publiques, du type de celle des 53 signataires ont eu lieu. Ainsi une lettre de Sergio Yahni, co-directeur de l’Alternative information center (14), envoyée le 19 mars 2002 au ministre de la défense Ben Eliezer a également eu un certain écho. Elle porte plus profondément la contradiction à l’Etat en revendiquant le refus non seulement de combattre dans les territoires occupés, mais dans l’armée israélienne sous toutes ses formes: «En tant que Juif, dit-il notamment, je suis révolté par les crimes que commet cette milice à l’encontre du peuple palestinien. C’est mon devoir en tant que Juif et en tant qu’être humain de refuser résolument de prendre part à un quelconque niveau à cette armée. Comme fils d’un peuple victime de pogromes et de destructions, je ne peux pas prendre part à votre politique malsaine. En tant qu’être humain, c’est mon devoir de refuser de participer à toute institution commettant des crimes contre l’humanité». Nous reproduisons l’intégralité de cette lettre en encadré ci-dessous.
| 19 mars 2002
Au Ministre de la Défense Ben Eliezer, Ministère de la Défense. Un officier dont vous avez la responsabilité m’a condamné aujourd’hui même à 28 jours de prison militaire à cause de mon refus de prester le service de réserve obligatoire. Je n’ai pas seulement refusé de servir dans les Territoires palestiniens occupés comme je l’ai fait ces 15 dernières années, je refuse également de servir dans l’armée israélienne sous quelque forme que ce soit. Depuis le 29 septembre 2000, l’armée israélienne a mené « une sale guerre » contre l’Autorité Palestinienne. Cette guerre sale comprend des exécutions extra-judiciaires, des assassinats de femmes et d’enfants, la destruction des infrastructures économiques et sociales de la population palestinienne, l’incendie de terrains agricoles, le déracinement des arbres. Vous avez semé la terreur et le désespoir, mais vous n’avez pas réussi à atteindre votre objectif fondamental : le peuple palestinien n’a pas renoncé à ses rêves de souveraineté et d’indépendance. Vous n’avez pas réussi non plus à apporter la sécurité à votre propre peuple, malgré toute la violence destructive de l’armée dont vous êtes responsable. A la lumière de votre large échec, nous sommes maintenant témoins d’un débat intellectuel de la pire espèce entre israéliens : une discussion autour de l’éventualité de déporter et de tuer en masse les palestiniens. L’échec de la tentative des leaders du Parti Travailliste a imposer un accord au peuple palestinien nous a entraîné dans une « sale guerre » que Palestiniens et Israéliens payent de leur vie. La violence raciste des services de sécurité israélien, qui ne voit pas des personnes, mais seulement des « terroristes » a agravé le cercle vicieux de la violence pour les Palestiniens et les Israéliens. Même les Israéliens sont victimes de cette guerre. Ils sont victimes de l’agression irresponsable et erronée de l’armée dont vous êtes responsable. Même lorsque vous avez entrepris les plus terribles attaques contre le peuple palestinien, vous n’avez pas accompli votre devoir : procurer la sécurité aux citoyens israéliens. Les tanks à Ramallah n’ont pas pu enrayer votre plus monstrueuse création: le désespoir qui éclate dans les cafés. Vous, et les officiers militaires à vos ordres, avez engendré des êtres humains dont l’humanité disparaît dans le désespoir et l’humiliation. Vous avez créé ce désespoir et vous ne pouvez plus l’arrêter. Il est clair pour moi que vous avez risqué nos vies pour que la construction illégale et immorale des colonies continue : pour Gush Etzion, Efrat et Kedumim : pour le cancer qui consume le corps social israélien. Au cours des 35 dernières années, les colonies ont transformé la société israélienne en une zone dangereuse. L’Etat israélien a semé le désespoir et la mort parmi les Israéliens et les Palestiniens. C’est pourquoi, moi je ne veux pas servir dans votre armée. Votre armée qui se nomme elle-même « Israeli Defence Force » (Force de Défense d’Israël) n’est rien de plus que le bras armé du mouvement des colonies. Cette armée n’existe pas pour apporter la sécurité aux citoyens israéliens, elle n’existe que pour garantir la poursuite du vol de la terre palestinienne. En tant que juif, les crimes que commet cette milice à l’encontre du peuple palestinien me répulsent. Il est de mon devoir comme juif et comme être humain de refuser catégoriquement de jouer quelque rôle que ce soit dans cette armée. En tant que fils d’un peuple victime de pogromes et de destruction, je refuse de jouer un rôle dans votre politique insensée. Comme être humain, il est de mon devoir de refuser de participer à toute institution qui commet des crimes contre l’humanité. Sincèrement vôtre, Sergio Yahni. |
Les références aux «crimes contre l’humanité» et à d’autres expressions fétiches de l’Etat d’Israël, utilisées de plus en plus souvent par des prolétaires juifs pour dénoncer la politique de la bourgeoisie israélienne, montrent également que la cohésion nationale construite à partir du martyr passé est de moins en moins solide. C’est aussi un signal intéressant d’érosion de l’union nationale. La nation israélienne a beau être scellée par une série de facteurs extrêmement puissants, enracinant la légende aclassiste d’un peuple juif dans une immense tragédie historico-religieuse dont la fonction est de figer toute contradiction sociale, elle ne peut cependant pas empêcher le prolétariat de se révolter contre la dégradation matérielle de ses conditions d’existence.
Nombre de ceux qui proclamaient hier leur adhésion inconditionnelle à l’Etat d’Israël sur base du mythe de la terre promise, du peuple élu, sur base des difficultés à ériger cette petite patrie au beau milieu du désert, sur base des souffrances endurées pendant la deuxième guerre mondiale,... éprouvent aujourd’hui des difficultés croissantes à justifier ainsi l’activité terroriste et assassine de l’Etat israélien. La guerre et la dégradation de la situation sociale mettent de plus en plus de prolétaires israéliens en porte-à-faux avec l’idéologie de «leur» bourgeoisie. Suppression des allocations, augmentation des taxes scolaires et des frais de santé, plans d’austérité toujours plus douloureux, espace de vie entièrement militarisé, répression de toute alternative, écart de plus en plus ostensible entre riches et pauvres, augmentation visible et spectaculaire des taux de suicide (15),... tous ces éléments du paysage national actuel conduisent inévitablement les prolétaires en Israël à envisager matériellement leur position en tant qu’exploité et non en tant que juif ou israélien. Et de ce point de vue, une fois mis de côté les mythes spécifiques sur lesquels il repose, mythes qui sont propres à chaque nation, l’Etat d’Israël révèle sa véritable nature et apparaît pour ce qu’il est: ni plus ni moins qu’un vulgaire Etat capitaliste, comme les autres. Au-delà du mythe égalitariste des «pères fondateurs de Sion» et des projets de Terre Sainte se dessine tout simplement l’exigence d’une classe dominante qui, pour assurer le bon fonctionnement du capitalisme dans la région, structure son développement autour de la recherche de profit, avec toutes les conséquences que cela implique en termes de politique intérieure et extérieure. Comme toute classe dominante, la bourgeoisie israélienne a non seulement besoin de faire régner l’ordre à l’intérieur de ses frontières pour faire fonctionner ses entreprises, mais elle doit également se donner les moyens d’assumer son expansion face à ses concurrents. C’est donc pour discipliner «son» prolétariat et permettre un développement impérialiste (tout en assurant le maintien de l’ordre capitaliste dans la région) que les exploiteurs locaux exigent une armée compacte et disciplinée, imposent la conscription obligatoire, développent un Etat fort, un Etat capable de réprimer, de s’étendre, de coloniser, de gérer des déportations, d’assumer des massacres... bref capable de commettre une série de crimes en tous points semblables à ceux dénoncés à l’encontre des juifs et qui ont précisément servi de justification à l’établissement de l’Etat d’Israël en Palestine.
Et effectivement, le besoin impérieux de conquérir des territoires force l’Etat à dévoiler la nature barbare de son être, en Israël comme partout dans le monde. Conséquence de cette situation, les officiers et les ministres sont forcés d’exposer plus clairement leurs consignes, d’affirmer explicitement leurs intentions. Le mythe de la nation-martyr en prend un coup. «Cassez-leur les os!» avait déjà dit Yitzhak Rabin au début de la première Intifada, et ses soldats ne s’en étaient pas privés. Aujourd’hui on parle purement et simplement de déporter ou de tuer massivement les prolétaires enfermés dans les camps. L’ex-général Efi Eitam, récemment nommé ministre par Sharon trouve l’idée de «transfert» politiquement «attrayante»: selon cet ancien travailliste, «peu d’arabes resteraient» en cas de guerre généralisée. Comme le souligne Sergio Yahni, «nous sommes maintenant témoins d’un débat intellectuel entre israéliens ... à propos de la possibilité de déporter ou tuer massivement les palestiniens» (i). «Nettoyage ethnique», «transfert», «déportation», «apartheid»... sont les termes, de plus en plus souvent prononcés, de la solution finale que prépare la bourgeoisie internationale à l’égard des prolétaires en Palestine. Le capitalisme demeure le capitalisme, quelle que soit sa couleur et cela jusqu’à la caricature: des officiers israéliens ont pris dernièrement l’initiative de tatouer des numéros sur les bras des palestiniens qu’ils arrêtaient.
Bref, les prolétaires israéliens écoutent sans doute d’une oreille moins crédule les fables racontées par les bourgeois israéliens pour les envoyer régulièrement, eux et leurs enfants, au front. Le prix humain qu’ils doivent payer pour défendre l’idée nationale entre de plus en plus violemment en contradiction avec l’horreur matérielle de la guerre.
Bien sûr, ces résistances ont encore actuellement bien du mal à sauter les barrières du préjugé national. On l’a vu, les réactions sont rares et se limitent encore la plupart du temps à un point de vue qui oppose la «bonne» politique à la «mauvaise» politique pour le pays. Mais, tout en ne sous-estimant pas le danger que représente l’absence d’un véritable programme révolutionnaire, nous persistons à défendre que ces illusions idéologiques sont moins importantes que les faits eux-mêmes: aujourd’hui en Israël, de jeunes prolétaires refusent d’accomplir leur service militaire et affrontent résolument le mépris social dont ils sont l’objet, des conscrits rendent publiques les raisons pour lesquelles ils ne veulent plus se battre, des soldats à la retraite lancent des appels à refuser de se rendre dans les territoires occupés, des familles entières soutiennent le choix des réservistes réfractaires malgré le poids financier que constitue la perte conséquente de tout salaire (16).
Le dégoût de la guerre prend toutes sortes de chemins, de l’objection de conscience au refus pur et simple, et au-delà de l’inévitable confusion propre à toute ébauche de résistance au capitalisme et à la guerre, la réalité est là: dans un espace aussi contrôlé idéologiquement et militairement que celui d’Israël, des prolétaires recommencent à mettre leurs intérêts élémentaires en avant -ne pas crever- et à s’organiser pour le défendre.
La lettre qu’a récemment envoyée à «son» général un jeune soldat israélien refusant de se battre, révèle plus explicitement ce point de vue de classe et l’opposition d’intérêt existant entre généraux bourgeois et prolétaires soldats. Cette lettre intitulée «Ma réponse au général» est un autre témoignage, encore timide certes, mais néanmoins très intéressant de ce processus qui, partout et à toute époque, conduit à un moment ou un autre des soldats lancés par leurs chefs sur la route de la haine du prolétaire voisin à regarder plutôt du côté des émissaires assassins, du côté des patriotes, du côté de l’autorité militaire.
Au général le convoquant en octobre dernier à «participer à des opérations militaires» dans la bande de Gaza, le réserviste Yigal Bronner répond qu’il sait que cette mission implique l’obéissance aux ordres et qu’à un moment ou un autre il se trouvera dans un tank face à un officier qui aura lui-même obéi à des ordres supérieurs et qui lui ordonnera à son tour de balancer un obus sur des Palestiniens. «Je suis l’artilleur. Je suis la petite vis d’une parfaite mécanique guerrière. Je suis le dernier et le plus petit maillon de la chaîne des commandements. Je suis censé simplement obéir aux ordres. Réduire mon existence à un stimulus-réaction. Entendre le commandant dire ‘feu!’, appuyer sur la gâchette et parachever ainsi l’ensemble du plan. Et tout faire avec la simplicité et le naturel d’un robot qui, tout au plus, ressent les secousses du tank quand l’obus est éjecté et vole vers sa cible... Mais j’ai un défaut, dit-il en paraphrasant Brecht, je suis un être humain et je peux penser... Je me vois donc dans l’obligation de désobéir à votre convocation. Je ne presserai pas sur la détente.»
Nous publions l’intégralité de cette lettre dans l’encadré ci-contre.
Pour prix de sa franchise, Yigal Bronner est condamné à 28 jours de prison, durant lesquels il est l’objet de mauvais traitements et d’humiliations incessantes. Il travaille 14 heures par jour dans les cuisines d’une caserne de jeunes conscrits, on lui interdit de parler aux autres prisonniers, ses affaires personnelles ont été confisquées, il n’a ni coussin ni couvertures pour dormir et on l’humilie en l’obligeant à porter un chapeau sur la tête toute la journée (17). Bref, comme tous ceux qu’on veut soumettre à une obéissance imbécile, il endure l’habituelle lâcheté de toutes les armées du monde, de tous les Etats du monde. Mais à l’image de ce que subissent tant d’autres prolétaires en Palestine, en Israël ou ailleurs dans le monde, ces vexations construisent les déterminations de demain, celles qui porteront les refuzniks israéliens d’aujourd’hui à se transformer en révolutionnaires internationalistes demain. Et gageons qu’à ce moment-là, ce ne sera plus seulement par des lettres que le prolétariat répondra à la violence des généraux.
Ma Réponse au Général, par Yigal BronnerGENERAL, VOTRE TANK EST UN VEHICULE TRES PUISSANT. Il rase des forêts entières et écrase des centaines de personnes. Mais il a un défaut : il a besoin d’un conducteur.Bertolt Brecht.
Cher Général,
Dans votre lettre, vous écrivez que « étant donné la guerre en cours en Judée, en Samarie et dans la Bande de Gaza, et vu les besoins militaires », je suis appelé « à participer à des opérations armées » dans la Bande de Gaza. Je vous écris pour vous informer que je n’ai pas l’intention de tenir compte de votre convocation. Pendant les années 80, Ariel Sharon a érigé des douzaines de colonies au coeur même des territoires occupés, une stratégie dont le but ultime était la soumission du peuple palestinien et l’expropriation de leurs terres. Aujourd’hui, ces colonies contrôlent pratiquement la moitié des territoires occupés et étranglent les villes et villages palestiniens tout en obstruant – quand ce n’est pas carrément en interdisant -- les déplacements de leurs habitants. Sharon est maintenant Premier ministre et s’est attelé cette dernière année à réaliser l’étape définitive d’un projet entamé il y vingt ans. En fait, Sharon a donné des ordres à son laquais, le Ministre de la Défense, et à partir de là, ils dégringolent tout le long de la chaîne des commandements. Le Chef de l’Etat Major a déclaré que les Palestiniens constituaient une menace de cancer et a donné des instructions pour les soumettre à la chimiothérapie. Le brigadier a imposé des couvre-feu pour une durée illimitée, et le colonel a ordonné la destruction des champs palestiniens. Le commandant de brigade a stationné des tanks sur les collines entre leurs maisons et a interdit aux ambulances d’évacuer leurs blessés. Le lieutenant-colonel a annoncé que les règles d’engagement étaient remplacées par un hasardeux « ouvrez le feu ! » Et le commandant du tank, à son tour, a ciblé un certain nombre de personnes et a donné l’ordre à l’artilleur de tirer un obus. Je suis l’artilleur. Je suis la petite vis d’une parfaite mécanique guerrière. Je suis le dernier et le plus petit maillon de la chaîne des commandements. Je suis censé simplement obéir aux ordres. Réduire mon existence à un stimulus-réaction. Entendre le commandant dire ‘feu!’, appuyer sur la gâchette et parachever ainsi l’ensemble du plan. Et je suis supposé faire tout cela avec la simplicité et le naturel d’un robot qui, tout au plus, ressent les secousses du tank quand l’obus est éjecté et vole vers sa cible. Mais comme l’a écrit Bertolt Brecht : Général, l’être humain est très utile. Il peut voler et il peut tuer. Mais il a un défaut. Il peut penser. Et en effet, mon général, qui que vous soyez – colonel, brigadier, chef de l’Etat-Major, ministre de la Défense, Premier ministre, ou tout cela ensemble-, je suis capable de penser. Peut-être ne puis-je pas faire grand chose de plus. J’avoue qu’en tant que soldat, je ne suis pas particulièrement doué ou courageux ; je ne suis pas un excellent tireur et mes capacités techniques sont limitées. Je ne suis pas non plus très sportif, et je n’arrive même pas à ce que mon uniforme m’aille bien. Mais je suis capable de penser. Je peux voir où vous m’emmenez. Je comprends que nous allons tuer, détruire être blessés et mourir, et que ça ne finira jamais. Je sais que « la guerre en cours » dont vous parlez se prolongera encore et encore. Je peux voir que si les « besoins militaires » nous conduisent à assiéger, à chasser, à abattre et à affamer tout un peuple, alors quelque chose dans ces « besoins » ne va pas du tout. Je me vois donc dans l’obligation de désobéir à votre convocation. Je ne presserai pas sur la détente. Je ne me fait aucune illusion, bien sûr. Vous me chasserez. Vous trouverez un autre artilleur – quelqu’un qui sera plus obéissant et plus capable que moi. Les soldats de ce type ne manquent pas. Votre tank continuera à rouler ; ce n’est pas un insecte bourdonnant comme moi qui va réussir à arrêter un tank en marche, et encore moins une colonne de tanks, et certainement pas tout ce défilé de folie. Mais une guêpe, ça peut bourdonner, irriter, exaspérer, et parfois même, mordre. Et à la fin, d’autres artilleurs, d’autres conducteurs et commandants, qui seront témoins de ces tueries insensées et de ce cycle de violence sans fin commenceront eux aussi à penser et à bourdonner. Nous sommes déjà forts de plusieurs centaines. Et à la fin du jour, notre bourdonnement se transformera en un grondement assourdissant, un grondement qui se répercutera dans vos oreilles et dans celles de vos enfants. Nos protestations seront retenues dans les livres d’histoire, pour les générations à venir. Donc, Général, avant de me chasser, peut-être que vous aussi, vous devriez penser un petit peu. Sincèrement votre, Yigal Bronner. |
C’est aussi l’enjeu des brèches qui pourraient se développer au sein de cette union nationale tellement indispensable à l’Etat d’Israël pour qu’il puisse continuer à assumer son rôle de gendarme au Proche-Orient. Les refus de servir actuels sont manifestement gênants pour l’Etat, mais pour qu’ils ne demeurent pas de simples «objections de conscience», relativement supportables et encadrables par l’Etat, ils doivent forcément s’armer d’une perspective sociale. Une perspective sociale qui ne réside pas tant dans l’extension obligatoire du nombre de refuzniks, que dans le fait de voir ces prolétaires définir ouvertement leur rejet de l’armée comme un affrontement à part entière au capitalisme, comme un affrontement non seulement aux ministres «corrompus» et aux «mauvais» généraux mais à tout le système dont ils sont produits, à «leur propre» bourgeoisie, à l’Etat dans sa totalité.
«Nous ne sommes ni israéliens...»: l’exploitation ne connaît pas de frontières, nous ne pouvons défendre les frontières qui balisent notre exploitation; nous n’avons aucun intérêt en commun avec les bourgeois qui nous exploitent et nous envoient nous battre et nous salir; nous voulons la défaite de «nos» exploiteurs, de «nos» bourgeois, de «notre pays», pour abolir toute exploitation et toute frontière...
«...ni palestiniens...»: en oeuvrant à la défaite du capitalisme là où nous nous trouvons, nous encourageons pratiquement les prolétaires de l’autre camp à poursuivre et intensifier leur lutte, nous appelons nos frères de classe soumis au camp national adverse à se reconnaître comme frères de classe, à rejoindre les rangs de ceux qu’on appelle chez nous des refuzniks, à désobéir à leurs propres officiers, à utiliser nos réseaux pour déserter, à fraterniser avec nous, à utiliser nos propres espaces pour défaire ensemble «leur» bourgeoisie...
«Nous sommes le prolétariat!» ... notre identité n’est pas nationale, elle est sociale; mais nous sommes bien plus que des ouvriers du bâtiment à Gaza ou à Tel Aviv, bien plus que des lanceurs de pierre palestiniens ou des refuzniks israéliens, bien plus que les catégories sociologiques dans lesquelles on cherche à nous enfermer,... en tant que prolétariat, nous sommes bien plus qu’une masse d’exploités, nous sommes un projet social révolutionnaire visant à abolir toute classe sociale, nous sommes le communisme.
Sans doute le prolétariat en Israël n’est-il pas encore capable de développer une pratique révolutionnaire qui s’articulerait autour d’aussi audacieuses formulations (pas plus qu’en Palestine ou dans le reste du monde aujourd’hui, d’ailleurs), mais les quelques ruptures que nous avons saluées dans ce texte, aussi isolées ou confuses soient-elles, témoignent du développement inéluctable de la contradiction aux projets morbides et barbares de l’Etat capitaliste et s’engagent sur ce chemin.
Nous l’avons souligné, la force de ces ruptures est qu’elles surgissent de l’intérieur, qu’elles s’affrontent pratiquement à leur propre armée, à leur propre Etat, à leurs propres idéologies, et cela même si la clarté programmatique fait encore dramatiquement défaut, même si les formulations sont maladroites, voire totalement inadéquates. La voie de la lutte de classe est tracée par le développement même de la catastrophe capitaliste, par l’incapacité du capitalisme à offrir autre chose qu’un accroissement de l’exploitation et des guerres, et ce sont ces déterminations qui forceront le prolétariat à se reconnaître plus ouvertement comme sujet révolutionnaire, à dépasser les contingences nationales, à prôner explicitement le défaitisme révolutionnaire et à affirmer pleinement l’abolition de l’Etat comme perspective.
Même si socialement ce n’est pas encore le cas aujourd’hui, des minorités tentent pourtant déjà, à contre-courant, de défendre certains aspects de cette perspective. C’est le cas par exemple d’un tract signé «Des Juifs contre le sionisme», tract distribué le 18 mai 2002 à Londres, lors d’une manifestation gauchiste «pour les droits des Palestiniens» dans lequel, ici aussi, des «Juifs» dénoncent les crimes de «leur» Etat, mais dans une perspective plus globale qu’ils relient à l’abolition de tout Etat:
«Le sionisme est un produit intrinsèque du nationalisme mondial, du colonialisme et de l’étatisme. Né au moment où le monde était sur le point d’être découpé et le système Etat-Nation européen consolidé, le sionisme est le complice de l’Occident et un fléau pour les palestiniens. L’alliance sioniste avec le pouvoir et la tyrannie n’en fait pas le protecteur des Juifs. Il a collaboré en permanence avec les racistes et les assassins pour poursuivre la colonisation de la Palestine. A l’opposé de cela, nous soutenons tous ceux qui cherchent à renverser ‘leurs propres’ gouvernements, ‘leurs propres’ dirigeants. Nous soutenons les luttes qui visent à défaire l’Etat et le capitalisme (...) Les fondateurs du sionisme rejettent la possibilité de vaincre l’antisémitisme à travers la lutte populaire et la révolution sociale (...) Le racisme et l’oppression dont témoigne l’Etat d’Israël n’a rien d’extraordinaire. Les trahisons historiques du sionisme n’ont rien d’exceptionnel: c’est le lot de toute forme de nationalisme. Notre anti-sionisme est basé sur l’opposition à tout Etat, à toute frontière, à toute nation; il est basé sur l’opposition aux dominants et aux exploiteurs du monde entier.
Pour une Intifada globale et pour l’abolition de toute frontière!» (18)
Face à tous ceux qui tentent de ramener nos révoltes anticapitalistes sur un terrain national, revendiquons haut et fort le drapeau des sans-patrie, la lutte des sans-grade, la perspective internationale d’une société sans classe.
Développons nos organisations sans tenir compte de nos nationalités. Cherchons au contraire à fraterniser, à prendre contact des deux côtés de la frontière et à développer des liens militants permettant aux prolétaires des deux côtés d’échapper aux officiers, aux mollah ou aux rabbins qui cherchent à les enrôler.
Développons ensemble la lutte contre «notre propre» bourgeoisie! Retournons nos armes et opposons-nous à ceux qui nous envoient nous massacrer! Développons le défaitisme révolutionnaire!
C’est dans le contexte de cette lutte sans trêve que mène le prolétariat en Palestine, dans le contexte également des premières brèches dans l’union nationale qui se produisent dans l’Etat d’Israël, que nous proposons ici en «Mémoire ouvrière» un tract datant de 1943 dans lequel des militants révolutionnaires appellent les prolétaires «juifs» à lutter contre «leur propre» bourgeoisie, rompant ainsi violemment avec l’antifascisme et le stalinisme qui cherchaient alors à désigner tout allemand comme leur ennemi. Contre cette assimilation des prolétaires à l’Etat(ou tout soldat appartenant au camp nazi) comme complice de l’Etat qui l’envoyait se battre.
«Ne croyez plus les menteurs nationalistes. Les ouvriers allemands et italiens sont comme nous des victimes, ils sont nos frères de classe», déclarent les militants des Communistes Révolutionnaires en s’adressant en yiddish aux «ouvriers juifs».
Hier, aujourd’hui, demain, face à tous ceux qui chercheront à nous diviser, à détourner nos luttes, à trouver des «différences» de situation pour mieux justifier l’appartenance à un peuple spécifique (qu’il soit «élu» ou «martyr») nous répliquerons, comme les auteurs du tract: «les capitalistes sont unis contre nous, unissons-nous contre les capitalistes!».
Ouvriers juifs, camaradesLe premier mai est le jour du prolétariat international, le jour de la fraternisation prolétarienne. La nouvelle guerre mondiale dure déjà depuis quatre années. C’est une guerre qui ne touche pas tellement les riches et ce sont les pauvres qui en sont les victimes. Vous êtes pourchassés, maltraités, exploités et exterminés.
Classe contre classe
Le capitalisme international a besoin sans arrêt de chair à canon fraîche, de main-d’oeuvre à bon marché. Les ouvriers français, allemands, polonais, italiens, tchèques et bien d’autres, sont opprimés comme nous autres juifs. En Afrique, en Amérique, en Russie, croyants ou non croyants, latins, arabes, noirs, jaunes, blancs, les travailleurs sont broyés par leurs propres oppresseurs. Partout dans le monde, l’impérialisme a enfermé les prolétaires dans un immense camp de concentration.
Combien de Juifs capitalistes sont déportés? Pas un seul. Ils ont tous quitté la France. Et les masses de prolétaires juifs crèvent, déportés dans des wagons plombés vers les camps de la mort. Beaucoup vivent dans la clandestinité sans papiers ni argent, abandonnés par les bourgeois et les bureaucrates juifs.
Classe contre classe
Pas un seul capitaliste français n’a été déporté. Pas un seul capitaliste allemand ou italien n’est tombé sur le front oriental, pas un seul capitaliste anglo-américain n’a crevé dans les déserts d’Afrique.
Tous les prolétaires sont vendus et exploités par leurs capitalistes. Tous les esclaves sont nos frères, tous les capitalistes et tous les traîtres sont nos ennemis. Plus jamais peuple contre peuple, mais, classe contre classe.
Dans l’organisation Todt, des esclaves allemands, juifs et bien d’autres doivent travailler, opprimés par les SS et surveillés parfois par des flics juifs. Les gardes-mobiles français pourchassent les ouvriers français. La Gestapo recherche des déserteurs et des réfugiés allemands. Le Guépéou fusille des communistes russes. Les polices anglaise et américaine opèrent contre les grèves en Angleterre et en Amérique.
Mais les travailleurs répondent
A Arcachon, quatre cents travailleurs allemands et mille juifs français font grève pour une meilleure alimentation. Dix Allemands et vingt-cinq Juifs ont été fusillés mais la grève continue. Les Allemands partagent la nourriture avec les Juifs car les SS ont interdit la distribution de vivres aux Juifs. Les ouvriers français et étrangers s’entendent dans la lutte contre les gendarmeries française et allemande.
Des ouvriers allemands désertent, la résistance passive s’étend dans le pays. Tous les mois, des milliers et des milliers d’hommes sont fusillés. Dans le monde entier, il y a beaucoup de grèves et de luttes. La guerre impérialiste se transforme en guerre civile contre les bourreaux capitalistes.
Travailleurs juifs, camarades, où est votre place?
Avec la bourgeoisie juive? Ils vous ont toujours détestés et trahis. Ils profitent de la guerre pendant que votre sang coule. Ils sont toujours unis avec les capitalistes non juifs.
Dans quel but les sionistes vous proposent-ils l’entente avec la bourgeoisie juive pour un «pays juif»? Aujourd’hui, Churchill, Roosevelt et Goebbels sont également pour un pays juif qui serait un nouveau camp de concentration pour les masses juives. Merci pour un tel pays juif. La question juive ne peut être résolue que par la fraternisation de tous les travailleurs, par la révolution dans le monde entier. Sans victoire de la révolution prolétarienne généralisée, les Juifs seront toujours exploités et pourchassés. Votre place est avec les prolétaires du monde entier.
Le mouvement sioniste crée des colonies, il y vient beaucoup de jeunes mais il n’y a guère de possibilité de vie pour cette jeunesse. Où va l’argent destiné à la jeunesse? La bureaucratie de la fédération UGIF usurpe toutes les responsabilités. Jeunesse juive, ne te laisse pas exploiter par les sionistes et la bureaucratie juive.
Camarades
Pensez à nos morts. Pensez à nos frères dans les camps qui attendent. Pensez à vos frères, à vos soeurs, à vos hommes et vos femmes, à vos fiancées, à vos enfants, à vos pères et mères qui sont dans les camps avec des millions de Polonais, Tchèques, Russes, Français et Allemands, déportés dans l’enfer. Ils attendent votre action pour leur libération.
Ils ont compris que c’est seulement par l’action de tous les opprimés que nous pouvons être sauvés. Nos camarades sont-ils tombés pour rien? Pouvez-vous oublier nos frères dans les camps de la mort?
N’espérez rien de Roosevelt, Churchill ou Staline! Comptez seuls sur vos propres forces, sur les prolétaires révolutionnaires de tous les pays.
Ne croyez plus les menteurs nationalistes. Les ouvriers allemands et italiens sont comme nous des victimes, ils sont nos frères de classe. Les SS sont, pour eux comme pour nous, l’ennemi principal.
Les capitalistes sont unis contre nous, unissons-nous contre eux! Nous sommes les plus forts, nous sommes les masses!
A bas la guerre impérialiste!
A bas le nationalisme!
Assez de pogromes, massacres et déportations!
Vive le 1er mai, journée de fraternisation prolétarienne internationale!
Vive la nouvelle internationale ouvrière!
En avant pour la révolution prolétarienne mondiale!
Paix! Liberté! Pain!1er mai 1943. Les Communistes révolutionnaires.
C’est dans le cadre de la réappropriation de notre passé que nous présentons ce tract signé «Les Communistes Révolutionnaires» et diffusé le 1er mai 1943, en pleine guerre, dans le sud de la France (j).
Le peu d’informations que nous possédons sur ce document et le groupe qui l’a diffusé, nous viennent de plusieurs sources:
Tout d’abord, nous avons trouvé la traduction française de ce tract dans le livre de Maurice Rajfus: «L’an prochain la révolution. Les communistes juifs immigrés dans la tourmente stalinienne. 1930-1945» (Editions Mazarine, Paris, 1985). Voici le seul commentaire de cet historien:
«Au-delà de la terminologie et des slogans calqués sur la ‘Troisième période’ de l’Internationale communiste, ce tract constitue un document remarquable car il rompt avec la confiance absolue qu’il était de rigueur d’accorder aux ‘grands alliés’ (19).»
Ensuite, nos recherches sur les traces des minorités communistes pendant cette période d’écrasement du prolétariat nous ont amenés à cerner de plus près la trajectoire historique du groupe qui a produit ce document. «Jüdische Arbeiter, Kameraden!», a été écrit, publié et diffusé par les militants organisés dans le groupe RKD, «Revolutionäre Kommunisten Deutschlands».
La filiation organisationnelle et programmatique des communistes d’Europe centrale qui va amener à la constitution des RKD est intéressante et nous allons la résumer ici.
En 1935, en Autriche, plusieurs groupes de militants des Jeunesses du KPÖ, «Kommunistische Partei Österreichs», forment une fraction qui critique de plus en plus ouvertement le parti stalinien pour rompre rapidement et se transformer en organisation autonome sous le nom de RKÖ, «Revolutionäre Kommunisten Österreichs». Les RKÖ publient, en 1936-37, l’organe Bolschewik, dont la devise est: «L’ennemi est dans notre propre pays!». Leur militance représente une référence incontestable pour de nombreux militants qui, comme eux, s’inscrivent dans un processus de rupture avec le courant trotskyste, entre autre avec le groupe des «Bolschewiki-Leninisten». De 1937 à 1938, les RKÖ, très critiques vis-à-vis du courant trotskyste, affirment leur caractère internationaliste dans la revue «Der Einzige Weg» qu’ils publient en commun avec des révolutionnaires de Suisse et de Tchécoslovaquie.
En 1938, la répression les contraint à l’exil en Europe de l’ouest. Ils se rapprochent alors des positions de la RWL, «Revolutionary Workers League» aux USA, qui, en opposition ouverte au courant trotskyste, se détermine pour le défaitisme révolutionnaire pendant la lutte de notre classe en Espagne. Ils publient alors quelques brochures, les «Juniusbriefe».
En 1939 et 1940, à Anvers, en Belgique, les RKÖ publient la revue «Der Marxist» et, en France, «Bulletin oppositionnel». Ils constituent un pôle de rupture, autour de 1941, pour un certain nombre de militants trotskistes allemands en exil. Ils prennent alors le nom de «Revolutionäre Kommunisten Deutschlands» (RKD) en lieu et place de RKÖ.
En 1941, les RKD sont principalement implantés dans le sud de la France où ils déploient une activité importante en publiant régulièrement leur presse malgré l’exil, la clandestinité et la répression: le «RK-Bulletin», de 1941 à 1943, et «Spartakus», de 1943 à 1945. Les analyses contenues dans leur presse montrent un renforcement des positions internationalistes. Outre leur presse régulière, les RKD ont diffusé, de 1942 à 1944, dix tracts internationalistes (en allemand, yiddish, français et italien), dans des conditions de danger extrême. Le numéro de «Spartakus» d’avril 1945 contient un «Appel des Communistes Révolutionnaires d’Allemagne au prolétariat allemand» dont nous donnons ici quelques forts extraits:
«N’oubliez pas que c’est le capitalisme qui a mis Hitler au pouvoir. C’est le capitalisme qui a provoqué la nouvelle guerre mondiale... Malgré leurs divergences impérialistes, les exploiteurs de tous les pays sont unis contre le ‘danger’ de la révolution prolétarienne qui, pour eux, est un danger mortel...
Les capitalistes alliés et russes volent au secours de la bourgeoisie allemande contre le prolétariat allemand. Les capitalistes russes avec Staline à leur tête, étranglent tout mouvement révolutionnaire. Ils ont précédemment liquidé chez eux les conquêtes prolétariennes et révolutionnaires d’Octobre 1917. Les communistes en Russie ont été emprisonnés et fusillés. Le prolétariat a été réduit en esclavage, comme chez nous.
Ainsi il est logique que les massacreurs de la révolution russe déportent actuellement vos pères et vos fils, vos maris et vos frères, pour les obliger aux travaux forcés. Ils interdisent à leurs propres soldats de parler avec vous, ils vous calomnient en prétendant que vous êtes des ‘nazis’ parce qu’ils craignent et veulent empêcher à tout prix la fraternisation entre ouvriers allemands et russes.
Par contre ils ont fait la paix avec une partie des capitalistes et des hobereaux allemands, avec le Maréchal nazi Von Paulus. Ils s’appuient sur les bonzes nazis et les bourreaux SS graciés par eux. Il n’y a que les prolétariats allemand et russe qui, d’après eux, auraient le devoir de se haïr et de s’entr’égorger, alors que MM. les capitalistes s’engraissent: voilà la volonté des Hitler, Staline, Churchill et Cie.
Les bourgeois anglais, américains et français n’agissent pas autrement...»
Affirmer les positions communistes consiste aussi à se démarquer de ses ennemis:
«Nous ne sommes ni social-démocrates, ni staliniens, ni trotskistes. Les questions de prestige ne nous intéressent pas. Nous sommes des communistes, des spartakistes révolutionnaires.»
En 1942, en France, se sont formés des groupes de CR, «Communistes révolutionnaires», qui, dans la revue «Fraternisation prolétarienne» en 1943 et 1944, défendent des positions similaires à celles développées par les RKD.
Malgré l’autonomie organisationnelle conservée par les deux groupes, ils ont malgré tout tenté d’unir leurs forces, voire de centraliser leur activité contre le Capital. Réunions, discussions, débats, etc., sont organisés en commun, toujours clandestinement. Ensemble, ils créent une commission internationale et publient un organe, «L’Internationale».
En 1944, l’OCR, «Organisation Communiste Révolutionnaire», est créée et publie deux organes, en commun avec les CR, «Rassemblement communiste révolutionnaire» et «Pouvoir ouvrier». Les RKD, en commun avec l’OCR, publient «Vierte Kommunistische Internationale», en 1944 et 1945. Pendant les années ‘40, il y a donc une mouvance révolutionnaire dans laquelle ces trois groupes: CR, OCR et RKD affinent leurs positions programmatiques dans la confrontation/démarcation avec les bordiguistes, les «anarchistes», les conseillistes et les trotskistes de gauche.
En 1945, la répression finit par avoir raison des militants RKD qui ont traversé les frontières, les familles politiques, la répression et le découragement pour affirmer toujours plus fort notre programme communiste.
C’est dans ce cadre et à contre-courant que ces groupes ont mené de front:
Les camarades RKD qui signent le tract appelant à la solidarité prolétarienne et au défaitisme révolutionnaire contre tous les camps bourgeois font donc partie de cette petite minorité de militants qui, de ruptures en ruptures, s’est retrouvée comme une des rares organisations militantes à affirmer le défaitisme révolutionnaire comme matérialisation vivante de l’internationalisme du prolétariat. Les militants actuels et futurs ont beaucoup à apprendre de leur activité. C’est pourquoi la republication de ce document est d’une importance majeure, et cela pour diverses raisons.
En effet, bien qu’il s’adresse à des prolétaires «juifs» qui s’expriment alors principalement en yiddish, il est l’un des rares documents qui dépasse et critique la spécificité juive. Se définir pro- ou antijuif, pro- ou antisionite, pro- ou anti-Israël... est toujours une attitude raciste, contre-révolutionnaire. C’est se soumettre à une polarisation bourgeoise. Le paragraphe suivant du tract est d’une clarté et d’une subversivité qui garde aujourd’hui encore toute sa force:
«Travailleurs juifs, camarades, où est votre place?
Avec la bourgeoisie juive? Ils vous ont toujours détestés et trahis. Ils profitent de la guerre pendant que votre sang coule. Ils sont toujours unis avec les capitalistes non juifs.»
Le prolétariat n’est ni juif, ni allemand, ni français, ni américain, ni chinois. Il est une classe mondiale aux intérêts identiques: la révolution communiste pour l’avènement d’une société humaine. Il est une classe qui subit la même exploitation perpétrée par une seule classe mondiale, la bourgeoisie. Cette bourgeoisie se décompose en mille visages... concurrents sur le marché de notre exploitation, mais fondamentalement elle a les mêmes intérêts partout: la perpétuation du capitalisme. Remettre cette réalité en avant, en 1943, est d’une force qu’il faut souligner.
Dénoncer l’idéologie du «peuple juif» est très important pour différentes raisons. L’idéologie de la persécution juive a été très structurante pendant mais surtout après la guerre, par rapport à deux axes:
Choisir de republier aujourd’hui ce tract c’est aussi participer à la défense invariante de la position historique des communistes, l’internationalisme. Ce tract se situe clairement sur notre terrain de classe de lutte contre les nations et les patries... contre le capital et toutes ses guerres. Le mot d’ordre: «Plus jamais peuple contre peuple, mais, classe contre classe», est un mot d’ordre communiste. Les staliniens l’ont détourné et utilisé pour augmenter encore la confusion au sein du prolétariat. La fraction bourgeoise stalinienne promotionnait le racisme et le nationalisme sous couvert d’antinazisme... à l’instar du poète stalinien Ilya Ehrenbourg qui bava, durant toute la guerre, d’immondes appels aux meurtres et aux viols:
«Nous ne disons plus bonjour ou bonne nuit! Le matin, nous disons: ‘Tue l’Allemand!’; et le soir: ‘Tue l’Allemand!’ (...) A bas l’Allemand! C’est la prière que t’adresse ta vieille mère (...) Brisez par la violence l’orgueil racial des femmes germaniques. Prenez-les en butin légitime. Tuez, tuez, vaillants soldats de l’Armée rouge (...)»
La réappropriation du mot d’ordre «Plus jamais peuple contre peuple, mais, classe contre classe» par ces militants RKD en 1943, n’est donc pas seulement, comme le laisse sous-entendre l’historien Rajfus, un «slogan calqué sur la ‘Troisième période’ de l’Internationale communiste», mais une expression de la lutte du prolétariat qui tente d’imposer son combat sur son terrain, l’internationalisme!
Le prolétariat a été détruit par la polarisation fasciste/antifasciste. Des dizaines de millions de prolétaires ont été enrôlés (et engloutis) dans les camps du fascisme et de l’antifascisme stalinien, social-démocrate, «anarchiste», chrétien, etc. Depuis la défaite de la révolution (vers 1923), cette polarisation a préparé la destruction massive du prolétariat, dans les années 1938-45.
Le courant RKD a tenté de perpétuer l’héritage programmatique des communistes de la vague de lutte 1917-23. Pour illustrer notre propos, nous citons un «Appel de l’Armée Insurrectionnelle», dite makhnoviste, de mai 1919. Cet appel faisait partie de la lutte intransigeante de nos camarades en Ukraine contre les pogroms juifs et pour la lutte internationaliste:
«Nous devons proclamer partout que nos ennemis sont les exploiteurs
et les oppresseurs de toutes nationalités: le fabricant russe, le
maître de forge allemand, le banquier juif, le propriétaire
foncier polonais... La bourgeoisie de tous pays et de toutes les nationalités
s’est unifiée pour une lutte acharnée contre la révolution,
contre les masses laborieuses de tout l’univers et de toutes les nationalités.»
Peter Archinoff, «Histoire du mouvement makhnoviste», 1921.
Contre cette idéologie d’ennemis principaux et secondaires, le prolétariat a mis en avant le mot d’ordre: «l’ennemi est dans notre propre pays, c’est notre propre bourgeoisie!» La position des révolutionnaires face à la guerre capitaliste est toujours la même: opposer la révolution sociale à la guerre, lutter contre «sa propre» bourgeoisie et «son propre» Etat national. Historiquement, cette position s’appelle le défaitisme révolutionnaire parce qu’elle proclame ouvertement que le prolétariat doit lutter contre l’ennemi qui lui fait face dans «son propre» pays, qu’il doit agir afin de provoquer sa défaite et que c’est seulement ainsi qu’il participe à l’unification révolutionnaire du prolétariat mondial, c’est seulement comme cela que se développe la révolution prolétarienne dans le monde (k).
Une autre position du tract nous semble poser problème, c’est le mot d’ordre final de «Paix!». De quelle paix parle-t-on? Il n’y a pas de paix en soi. La bourgeoisie impose la paix sociale par le massacre généralisé... des prolétaires et la destruction de nos forces de classe. Nous savons que la paix du capital c’est la continuation de sa guerre contre nos intérêts, nos vies mêmes, notre projet social de révolution. Pour arrêter les massacres et les déportations, le prolétariat devra intensifier sa guerre de classe, révolutionner le monde, abattre le pouvoir de l’argent et de la terreur personnifié par la bourgeoisie. Le prolétariat, face à la terreur bourgeoise, est contraint d’utiliser sa terreur de classe. Mais il lutte historiquement pour l’abolition de toute terreur, de tout Etat.
De manière générale, le mot d’ordre «pain, paix et liberté» est un mot d’ordre de la social-démocratie. Mais, si sous le mot d’ordre de «paix» se cache la bourgeoisie, des intérêts prolétariens se sont effectivement historiquement exprimés sous le mot d’ordre de «pain et liberté». Dans de nombreux pays, des luttes prolétariennes ont souvent brandi ce drapeau. Dans notre effort historique d’éclaircissement de notre programme révolutionnaire, il est primordial de se démarquer nettement de nos ennemis et d’opposer à leur démagogie politicienne et désorganisatrice, des mots d’ordre précis qui orientent notre lutte.
Une expression de l’avant-garde communiste, par ce groupe de «Communistes Révolutionnaires», loin de se décourager et d’abandonner la lutte, donne des perspectives claires à notre combat historique, qui sont toujours valables aujourd’hui. Si cette période est globalement une période de défaite et d’écrasement pour le prolétariat, nous retrouvons, au fil des ans, des traces de la lutte ultra-minoritaire des communistes.
Camarades, si vous possédez des informations complémentaires sur ce groupe et en général sur toute expression de notre lutte pendant et après la période 1939-45, faites-le nous savoir.
Contre l’amnésie dont voudrait nous frapper la bourgeoisie, participons à la réappropriation de notre mémoire de classe !
a. Cf. Boire la mer à Gaza (Ch.9), Amira Hass, Editions La fabrique
(1996).
b. Economic and Social Conditions in the West Bank and Gaza Strip,
Coordinateur général de l’ONU pour les territoires occupés
(UNSCO), Gaza, octobre 1996.
c. Cf. «Nous soulignons - Palestine: les accords de paix contre
le prolétariat» in Communisme n°41 - décembre 1994.
d. Cf. Boire la mer à Gaza (Ch.13), Amira Hass, Editions La
fabrique (1996).
e. Cf. Boire la mer à Gaza (Ch.13), Amira Hass, Ed. La fabrique
(1996).
f. Cf. Dazibao, Escenas de la lucha de clases, Edita UHP Madrid (verano
de 2002). E-mail: hpmadrid@yahoo.es
g. Cf. le film/documentaire allemand intitulé «Balagan»
(1993) réalisé autour de la pièce «Arbeit macht
frei» d’un groupe de théâtre israélien composé
d’acteurs palestiniens et israéliens.
h. Extrait de «Letter from Israël» de Ran HaCohen,
dont on peut lire différents textes en anglais sur le site qui regroupe
ses réactions (http://www.antiwar.com/hacohen/). «The Auschwitz
Logic» a été écrit en mars 2002, à l’occasion
du tollé provoqué par la comparaison qu’osa l’écrivain
portugais José Saramango entre les camps nazis et la situation dans
les territoires occupés, lorsqu’il se rendit à Ramallah dans
le cadre d’une délégation du Parlement International des
Ecrivains (International Parliement of Writers - IPW).
i. Pour des détails sur la façon dont l’idée de
«transfert» a progressé au sein des différentes
composantes de la société et des partis bourgeois israéliens,
cf. «Le cancer des colonies israéliennes» et «Ces
Israéliens qui rêvent de “transfert”» in Le Monde Diplomatique,
juin 2002 et février 2003.
j. Ce tract a été publié initialement en langue
yiddish, mais imprimé en alphabet latin. A l’occasion de la publication
de ce tract (ainsi que cette présentation), dans le deuxième
numéro de notre revue Kommunismus sorti en février 2000,
nous avions traduit en allemand la version française que nous possédions.
k. Pour un développement plus conséquent de cette question
centrale, nous renvoyons le lecteur à notre texte «Invariance
de la position des révolutionnaires face à la guerre - La
signification du défaitisme révolutionnaire», publié
dans notre revue centrale en français Communisme n°49.
Ce type d’information nous rappelle judicieusement l’impasse de la médecine dans la société bourgeoise. Le paradoxe est apparent et n’éblouira que ceux qui se font encore des illusions sur notre société. L’hôpital est une entreprise comme une autre, ici aussi la nécessité de faire des bénéfices est impérieuse. Dans cette optique marchande, les unités hospitalières concurrentielles se livrent une guerre sans merci qui les contraint à un renouvellement permanent de leurs moyens de production. Avoir un outil performant! Mais cela n’est pas suffisant. De même que l’usine, l’hôpital est soumis à la nécessité de faire des économies: sur le matériel, sur la qualité des produits (soins bâclés), augmentation de l’intensité du travail (plus de patients pour moins de soignants) et en fin de course: compression de personnel, rationalisation...
La mécanisation des soins, la confiance aveugle dans la technique qui confine à la soumission éloigne encore plus le patient du soignant. La médiation prend le pas sur la réelle communication. Le malade est toujours plus une chose inerte.
Il est de notoriété publique que l’industrie pharmaceutique, productrice de profit, est un secteur qui attire actuellement les capitaux de façon accélérée. Le pouvoir des consortiums pharmaceutiques s’accroit dans des proportions gigantesques. Tranquillisants, anxiolytiques, antidépresseurs... entretiennent surtout la bonne santé financière des gros actionnaires!
Le lien entre le monde du travail et celui de la médecine est clair: pour le patron, seul importe un prolétaire en bonne santé que la médecine est chargée de contrôler. En tant que catégorie du capital, celle-ci contient/reproduit toutes les déterminations historiques du rapport social capitaliste: dépossession, terrorisation, exploitation. Le but de la médecine est de rejeter le travailleur dans le circuit du travail. L’entrefilet qu’a laissé filtrer la bourgeoisie nous éclaire en ce que cette fonction, soigner la force de travail, la soumettre aux règles de l’entreprise, rencontre aussi (accidentellement!) une autre nécessité du capital, la tuer en tant qu’excédentaire1. « Erreurs » médicales, épidémies, vaccins2, antibiotiques, médicaments, etc., participent à la sélection naturelle... capitaliste.
C’est parce que ceux qu’on oblige à travailler ressentent dans leur corps la pression sociale, la terreur de se faire exploiter, qu’ils « tombent » malades. Ceci est une réaction tout à fait inconsciente, passive, involontaire, impersonnelle. Il n’y a pas de maladie « en soi », elle est toujours liée au mode de production qui la produit. On n’est jamais autant tombé malade dans toute l’histoire de l’humanité. Et en quantité et en « qualité ». La pollution, l’appauvrissement énergétique de nos aliments, le rythme de vie, l’insatisfaction, les médicaments, etc., font que nos organismes sont de plus en plus faibles. Nous sommes sans défenses immunitaires... devant nos patrons.
Le prolétariat encaisse les coups journaliers de l’exploitation et tourne contre lui-même l’humiliation, la concurrence, la compétition, le paraître, la soumission, la fatigue, l’inquiétude, l’énervement, etc., etc., etc., plutôt que de la tourner contre son ennemi historique, la bourgeoisie et son monde pathogène! Tant qu’il ne s’associe pas dans la lutte, ne transforme pas sa rage et sa colère en action contre ce qui la produit... il subit toutes les constituantes du capital, dont celle, la plus importante, d’être en forme pour aller bosser.
La société marchande a détruit la communauté humaine et imposé la seule communauté pouvant exister sous le capital: la fausse communauté de l’argent, la communauté fictive. Cette perte humaine de la communauté que tente de reconstituer le capital en nous proposant/imposant de multiples fausses communautés (nationales, religieuses, idéologiques, sportives, artistiques...) produit la maladie. Le prolétariat est fondamentalement malade du manque d’humanité! Il ne se guérira qu’en abolissant ce qui le rend malade, le monde de la marchandise. On ne peut réformer les soins de santé, ni améliorer notre santé dans le cadre du capitalisme.
D’un côté, le capital idolâtre notre individu, de l’autre, il nous agglutine dans une masse impersonnelle. D’un côté le mythe de l’originalité, de la personnalité, de l’autre, la foule, le stade, les métros bondés.
Moins notre classe sociale s’exprime (par la lutte), plus elle est réduite à une masse de forces de travail... conglomérat insipide de millions d’individus atomisés. C’est ce rapport-là qui rend fou le citoyen moyen. Car derrière l’individu qui se demande, angoissé, « qui suis-je? », il y a le capital qui répond, « une force de travail comme les autres ». Nous sommes interchangeables, clonés, dupliqués à l’infini. Et quand le prolétaire va chez son psy, celui-ci fait résonner l’individu libre qui a des problèmes « personnels » que lui, le psy se fait fort de soigner... Il occulte le corps social de cet individu!
Le mode de production capitaliste détermine toutes les parties du corps social, son fonctionnement et la compréhension qu’il en a. La science, c’est la réponse du capital à la connaissance que l’humanité a accumulé au cours des millénaires. Il y a une histoire de dépossession puis de destruction par la valeur de cette connaissance, riche de l’expérience sédimentée dans le temps et dont l’homme était encore, jusqu’au capitalisme achevé, le bénéficiaire.
Chacun d’entre nous appartient à une classe sociale, à un mouvement historique. Notre passé de lutte est compris dans notre présent et la résolution future des énigmes de cette société sont également comprises dans notre présent. Ainsi notre corps, semblant isolé, n’est pas que notre corps, il est une partie d’une totalité qui le subsume, le dépasse, le prolonge et que lui-même nourrit. On ne peut donc pas isoler un être de son environnement, de son passé et de son futur.
C’est à notre corps social que nous avons mal et la thérapie est connue, c’est la révolution, la réappropriation violente de nos besoins élémentaires, de notre vie sociale, toute entière tournée vers la satisfaction et non vers l’exploitation.
La presse bourgeoise parle « d’erreurs » médicales, sous-entendant que dans son fonctionnement normal, la médecine soigne, elle ne tue pas. Et tous ceux qui crèvent ou sont blessés, meurtris à cause d’actes non reconnus comme des erreurs, mais comme des réussites de la médecine moderne? Et tous ceux qui n’ont pas les moyens de se faire soigner, même dans le cadre bourgeois actuel? Si les riches peuvent se payer des soins appropriés, pour les pauvres il y a des toubibs qui voient une centaine de patients par jour3. L’usine, quoi!
Le terme « erreurs », passé au tamis de l’analyse classiste, est soudain démystifié. Pour le prolétariat en lutte contre la soumission et l’abêtissement... il ne s’agit pas d’erreur. Le capital nous exploite-t-il par erreur? Nous envoie-t-il à la guerre par erreur? Non, c’est son fonctionnement normal, c’est sa vie même qui nécessite une toujours plus grande consommation de prolétaires.
Le journaflic a-t-il voulu dire qu’une médecine réellement au service de l’humanité est possible? Que toutes les « erreurs » du système de production capitaliste sont évitables? Qu’il faut tendre au mieux, aller voter, se syndiquer, faire pression auprès des pouvoirs publics?… Probablement. La société bourgeoise parlant d’elle-même en arrive à des sommets de réification médiatique. Le mythe de l’information impartiale correspond en fin de compte à la langue de bois la plus puissante, celle qui naturalise les rapports bourgeois de production, qui occulte les classes sociales aux intérêts antagoniques, qui humanise le capital. Cette simple information sur le fonctionnement de la médecine, dans un pays donné, que la bourgeoisie voudrait innocente, nous suggère toute l’horreur du capital, à l’échelle planétaire.
En tout cas cet entrefilet reste sulfureux en ce qu’il éclaire le fait que la société de l’argent a failli, qu’elle n’est pas adaptée à l’homme, que la folie ambiante a atteint des proportions gigantesques dont la limite se précise: révolution ou destruction de cette planète. Bien sûr, le flot d’informations qui dévoilent comment « on nous traite » ne suffit pas, l’histoire de notre classe en lutte nous a enseigné que l’accomplissement de la conscience de notre exploitation, c’est la pratique pour la refuser, la combattre.
Il faut prendre cet entrefilet dans sa dimension réelle: à l’aube du troisième millénaire, quel décalage entre ce que dit la bourgeoisie d’elle-même et la réalité! La bourgeoisie a réussi à nous rendre fou: pour nous faire la guerre, elle nous parle de paix, pour nous achever, elle dit qu’elle nous soigne! Mais ce n’est pas du cynisme: les limites théoriques du monde bourgeois réfléchissant sur lui-même ne sont pas feintes. Il y a une réelle incapacité pour la bourgeoisie d’expliquer le monde et son fonctionnement. D’ailleurs, elle n’en a pas essentiellement besoin, seul lui importe de nous mystifier. Pour nous, « vie » (valorisation, développement des forces productives, santé, paix, richesse...) et mort (dévalorisation, entrave au développement des forces productives, maladie, guerre, misère...) forment le couple infernal capitaliste. L’une et l’autre s’agenouillent devant l’autel de la valeur, se promettent un monde éternel, se rejoignent dans une étreinte répugnante, procréent de multiples marchandises!
Quand la révolution se remet en marche, les prolétaires se sentent mieux, la maladie, transcendée par le bouleversement social, galvanise les énergies, donne une orientation vivante à ceux qui luttent, des objectifs enthousiasmants, une activité collective...
Quand la révolution se remet en marche, et qu’on ne supporte plus le mensonge... c’est au tour des tueurs en blouse blanche, les financiers agro-alimentaires, les ministres de la santé publique d’être soignés!