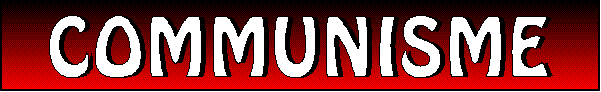
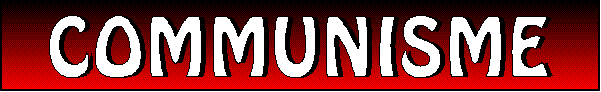
Si donc, des ouvriers avaient soudainement descendu ce salaud, si un quelconque groupe d’"incontrôlés" lui avait rendu justice alors qu’il promenait sa sale tronche dans un des quartiers de Santiago, et si mieux encore, on avait profité de l’occasion pour régler leur compte à quelques tortionnaires supplémentaires, personne n’hésiterait à faire la fête et à se féliciter d’avoir remporté ne fut-ce qu’une bataille dans cette guerre que la bourgeoisie continue à gagner.
Ce n’est pas le cas, malheureusement. En réalité, le prolétariat international est comme prostré face à un mauvais film dont les protagonistes sont tous membres de l’Etat: Pinochet tient le rôle du "méchant", tandis que les juges espagnols, les Lords anglais et les députés d’un peu partout ont tout-à-coup pris le rôle des "gentils", le rôle de ceux qu’il faudrait admirer.
Il serait donc temps de dénoncer ceux qui jouent les "bons" dans ce scénario tordu, tous ces démocrates qui de manière plus ou moins ouverte ont été complices de l’une ou l’autre forme de terrorisme d’Etat. Et dans ce cadre-là, pas un seul magistrat espagnol n’échapperait à l’accusation d’y avoir participé, à un moment ou un autre. Certainement pas en tout cas le tristement célèbre Baltazar Garzón, ce juge de l’"antiterrorisme" par excellence qui, parallèlement à ses poursuites contre Pinochet ou contre de hauts fonctionnaires socialistes espagnols pour leur sale guerre contre l’ETA, dirige également les corps spéciaux de la police politique dans leur mission de répression des militants prolétariens en lutte contre l’Etat. Ce juge autorise par exemple les longues mises au secret des prisonniers, leurs interrogatoires musclés, leurs transferts brutaux... à tel point que, un peu partout en Espagne, la bourgeoisie elle-même s’est émue de ces violations répétées des droits de l’homme les plus élémentaires, tels le droit d’expression et de presse (1). Baltazar Garzón est à n’en pas douter du même acabit que Pinochet.
Même les "Mères de la Place de Mai", connues pour leur intransigeance, ont un moment nourrit l’espoir que le célèbre Baltazar Garzón plaiderait en faveur de l’exécution des sombres personnages du terrorisme d’Etat latino-américain, mais elles ont rapidement déchanté et compris que ce juge-là aussi participait du terrorisme d’Etat espagnol et donc du terrorisme d’Etat international du capital. Elles n’ont pas hésité à le dénoncer: "Au début de la procédure entamée par Baltazar Garzón dans le jugement des "génocidaires" argentins, nous avons reçu de nombreuses dénonciations de terribles cas de tortures commises sur les prisonniers politiques espagnols, avec le consentement de l’Audience Nationale.
Pour les "Mères de la Place de Mai", en lutte depuis 21 ans contre la dictature militaire tout d’abord, puis aux prises avec les gouvernements assujettis aux Etats Unis, et subissant aujourd’hui des gouvernements composés de narcotrafiquants et d’assassins, Baltazar Garzón représentait un espoir. Nous avons cru que peut-être, quelque part dans le monde, il y avait un pays où la justice existait et où les juges étaient des personnes dignes et honnêtes.
Avec le temps, nous avons appris que Garzón prenait ses décisions conformément à des calculs politiques et non en fonction de la loi et de la justice. La libération de Scilingo (cf. son interview en encadré p.18 - NDR) fut une véritable gifle et brisa les espoirs qu’avaient les "Mères de la Place de Mai" d’obtenir justice. Nous avons compris que si ces procédés pouvaient se révéler utiles pour traquer les auteurs des génocides en Argentine, il manquait par contre une claire détermination à condamner les responsables des disparitions de nos 30.000 enfants.
Quand nous avons découvert les manipulations politiques de Garzón dans ce procès, nous avons commencé à saisir le vrai visage de la Justice Espagnole. Nous avons découvert que la torture, les viols et les exécutions faisaient partie des outils du terrorisme d’Etat ordonné d’abord par Felipe Gonzalez et maintenant par Aznar.
Les juges de l’Audience Nationale nous montrèrent leur vrai visage: celui-là même qu’avaient les juges argentins de la dictature, celui-là même qu’exhibaient les juges du nazisme." (2)
Si l’Audience Nationale en Espagne avait véritablement été autre chose qu’une institution complice du terrorisme d’Etat démocratique, n’aurait-elle pas d’abord essayé de juger ses propres tortionnaires, à commencer par les membres historiques de l’appareil policier fasciste espagnol, lequel ne fut jamais inquiété? Si elle n’avait pas été complice de l’impunité légalisée, n’aurait-elle pas jugé depuis longtemps déjà les criminels militaires franquistes qui se baladent encore tranquillement dans les rues d’Espagne? Les assassins franquistes ou argentins seraient-ils donc moins criminels que Pinochet?
Et toujours du côté des "bons", il faudrait aussi dénoncer chacun des Lords de "Sa Majesté", le rôle historique de ces criminels en toge, agents légitimes de cet impénétrable et sombre Etat corsaire. Il faudrait également clamer combien il est absurde et ridicule de prétendre juger Pinochet sans juger la police et l’armée chilienne. Il faudrait rappeler encore que, lors du massacre des prolétaires au Chili en 1973 et dans les années qui ont suivi, tout le monde savait que Pinochet n’aurait jamais pu continuer à agir sans la complicité d’autres Etats nationaux d’Amérique Latine et du reste du monde. Il faudrait souligner aussi ce que même la gauche bourgeoise a toujours dénoncé, à savoir que Pinochet n’est rien d’autre qu’un pantin dirigé par des intérêts internationaux biens plus puissants. Et pour finir, il faudrait peut-être également rappeler la participation directe d’autres forces de sécurité telles que le Pentagone ou la CIA, et d’autres entreprises multinationales telles ITT, etc. dans la préparation de cet ignoble massacre.
Afin de recrédibiliser l’Etat bourgeois mondial et pour maintenir le prolétariat prostré devant une si belle représentation, le spectacle Pinochet se devait de présenter l’homme aux lunettes noires comme l’incarnation même du mal, et pour ce faire, il ne fallait évidemment pas lui associer d’autres personnages. Tous les outils de façonnage de l’opinion publique tendent à faire oublier que, lors du coup d’Etat de Pinochet, tout le monde savait qu’au Chili, tout comme, au même moment en Argentine, en Uruguay, en Bolivie, au Brésil, au Paraguay, au Pérou,..., la répression était coordonnée par les flics de l’ensemble de ces pays ("Opération Condor") et centralement dirigée par l’Etat nord-américain (une coordination qui dura des années et qui doit très certainement exister encore). Et donc, si l’on condamne Pinochet pour avoir été le plus haut responsable du terrorisme d’Etat (alors qu’en réalité il ne s’agissait que d’une sorte de sous-gérant chilien des directives générales du capital mondial), il faudrait également (et à plus forte raison) condamner l’ensemble de l’état-major des Etats-Unis (et de plusieurs pays européens), et en particulier messieurs Ronald Reagan, Henry Kissinger, Cyrus Vance, Georges Bush ainsi que beaucoup d’autres illustres chefs d’Etat de l’époque.
Ce que l’on cherche également à faire oublier avec le spectacle Pinochet, c’est que la Démocratie Chrétienne, tant nationale (celle d’Eduardo Frei lui-même) qu’internationale, fut la grande complice des tueries orchestrées par Pinochet et compagnie. Ce qui explique, entre autre, qu’Eduardo Frei (fils) invoque aujourd’hui la souveraineté du Chili pour demander la libération de Pinochet.
On passe également sous silence l’appui économique, ainsi que l’armement et les instructeurs de police fournis pendant des années au gouvernement Pinochet par des gouvernements de gauche et de droite de la très représentative démocratie européenne. On pense par exemple aux aides du gouvernement de Margaret Thatcher (une des rares à n’avoir jamais caché sa profonde amitié pour Pinochet) ou aux offres du gouvernement socialiste d’Espagne que présidait Felipe Gonzales. Et que dire du Vatican qui, face aux massacres perpétrés par Pinochet n’a pas prononcé une seule fois la parole "humanité", mais qui aujourd’hui en appelle à la raison humanitaire pour justifier sa libération!
Les leçons prolétariennes sont encore plus rares et plus profondément enfouies dans la mémoire, lorsqu’on aborde la responsabilité directe de l’Unité Populaire et de son leader, Salvador Allende, dans l’impressionnant massacre des prolétaires au Chili. Rappelons tout de même ici que le prolétariat a tenté désespérément de prévenir de l’imminence du massacre en dénonçant précisément la répression dont il était l’objet de la part du gouvernement d’Allende. Voici ce que disait la lettre adressée par les Cordons Industriels à Allende quelques jours avant le coup d’Etat militaire: "... vous serez responsable d’avoir mené le pays non pas à la guerre civile qui est déjà en plein développement, mais au massacre froid, planifié de la classe ouvrière la plus consciente et la plus organisée d’Amérique latine; [nous vous avertissons] que ce gouvernement, porté au pouvoir et maintenu au prix de tant de sacrifices consentis par les travailleurs, les habitants des bidonvilles, les paysans, les étudiants, les intellectuels, les membres des professions libérales, portera la responsabilité historique d’avoir détruit et décapité, qui sait dans quel délai et à quel prix sanglant, non seulement le processus révolutionnaire chilien mais celui de tous les peuples latino-américains en lutte pour le socialisme." (3)
C’est avec Allende, Prats et Pinochet (par ailleurs nommé par Allende lui-même), que le gouvernement et les forces armées attaquèrent et désarmèrent systématiquement le prolétariat. En d’autres mots, c’est ce gouvernement qui détruisit l’unique rempart empêchant le déchaînement du terrorisme d’Etat réclamé à grands cris à ce moment-là, par la bourgeoisie internationale. Comme le dénonce ce même document: "... la Loi de Contrôle des Armes, nouvelle "loi maudite", qui n’a servi qu’à humilier les travailleurs avec les perquisitions pratiquées dans les industries et dans les bidonvilles, et qui fait office de répétition générale pour les secteurs séditieux des Forces Armées, en leur permettant d’étudier ainsi l’organisation et la capacité de réponse de la classe ouvrière, dans une tentative pour l’intimider et identifier ses dirigeants."
Alors que le prolétariat lançait ce message, Allende, confiant en son ami Pinochet (c’est bien parce qu’il était son ami que la bourgeoisie chilienne de gauche expliqua par la suite le coup d’Etat par l’infidélité des "généraux traîtres"), continua à avaliser les indispensables coups de mains préliminaires et le fichage que les forces répressives étaient en train de réaliser contre tout type d’organisation autonome du prolétariat.
Mais plus encore, comment oublier que le massacre perpétré
par Pinochet, grâce à l’effet de surprise produit par l’action
décidée de l’armée chilienne, fut le fruit de la propagande
vantant "la tradition démocratique et anti-coup d’Etat de l’armée
chilienne", une propagande qui sortait de la bouche d’Allende lui-même,
et basée essentiellement -outre sa propre stupidité social-démocrate-
sur la profonde imbécillité de ses conseillers et analystes,
assimilés à l’Ecole de la sociologie française, Alain
Touraine en tête? Comment oublier que chaque fois que le prolétariat
sortait dans la rue en réclamant des armes, Allende répondait
qu’il fallait rentrer chez soi, embrasser sa femme et ses enfants... et
que tout allait bien? De même, comment donc oublier que le désarmement
et le massacre du prolétariat furent perpétrés par
les forces qui exercent aujourd’hui même le pouvoir au Chili: l’axe
Démocratie Chrétienne - Parti Socialiste? Ou encore que ce
Frei est le double de son père, un vieil admirateur d’Hitler?
Perle de la bourgeoisie"En 1973, j’eus plusieurs entretiens nocturnes avec Allende chez lui. Je l’avertis, comme beaucoup d’autres l’avaient fait, qu’un coup d’Etat se préparait. Je lui montrai également les témoignages enregistrés de ceux qui confessaient les préparatifs de l’opération. Mais il me dit que j’étais trop crédule ‘Nous ne sommes pas en Espagne, dit-il, l’armée chilienne a plus de cent années de tradition démocratique’."C’est le photographe Miguel Herberg qui parle ici à la première personne. Cet extrait est tiré d’un article de Javier Cuartas publié dans le journal Nueva España le 7/12/98 et reproduit en mars 1999 dans le BICEL. |
Et quant au Pape qui s’émeut aujourd’hui pour le vieux Pinochet, on pourrait peut-être aussi lui rappeler que l’action de l’Eglise Catholique dans son ensemble, tant par son appui implicite que par sa participation active aux côtés des commandants de l’armée (cf. l’évêque Silva Henríquez), a été décisive dans la gestion des camps de concentration, dans la torture des prisonniers, la disparition et l’assassinat de milliers de combattants sociaux. Et ce non seulement au Chili, mais aussi en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, en Espagne, au Pérou, au Salvador, au Nicaragua, en Colombie, en Bolivie,...
Toute la mise en scène du spectacle Pinochet se base en fait sur les conditions très particulières que réunit ce répugnant personnage. Pinochet représente en effet, au niveau international, le dictateur par excellence. Ce qui le caractérise, ce n’est pas la fameuse violation des droits de l’homme, la torture, la disparition forcée de personnes, l’assassinat systématique de prolétaires,... tout ceci ne constitue que le plus petit commun dénominateur qu’il partage avec bien d’autres sinistres personnages aux quatre coins du globe. Sans quitter le continent, on peut déjà citer Jorge Rafael Videla, Stroesner, Gregorio Alvarez, Alberto Fujimori,... autant d’auteurs de massacres comparables. Ce qui distingue Pinochet de ses collègues, en plus de sa sale gueule toujours couverte de ses fameuses lunettes noires (un accessoire qui lui permet de remplir encore mieux la fonction de monstre que les médias lui assignent (4)), c’est de s’être imposé publiquement en liquidant ses vieux alliés (Allende et compagnie) et cela sans aucune considération pour le fonctionnement de l’ordre constitutionnel existant jusqu’alors.
Ce qui vaut à Pinochet le prestigieux honneur international d’être considéré comme plus dictateur que les autres, c’est le fait de s’être imposé à la tête du gouvernement en liquidant brutalement un courant dans lequel de larges secteurs de la bourgeoisie se reconnaissaient: la social-démocratie internationale sous sa forme socialiste, stalinienne ou trotskiste. D’autres ont tué autant si pas plus que Pinochet et consorts, mais ils se sont imposés lentement et démocratiquement, et leurs massacres furent perpétrés avec l’aval total ou partiel d’institutions démocratiques que, dans la plupart des cas, ils avaient maintenues. Sur le plan international, la bourgeoisie mondiale éprouve bien plus de difficultés à expliquer les cas de l’Argentine, du Pérou, de l’Uruguay, du Paraguay, de la Bolivie,... Ici, les dictatures apparaissent trop clairement comme le produit du développement et des nécessités des institutions démocratiques elles-mêmes: en Argentine, en Uruguay, au Pérou, c’est en pleine république parlementaire qu’on torture, qu’on séquestre et qu’on assassine. Au Chili par contre (5), la dictature s’apparente plutôt à une rupture avec ces institutions, et c’est pour cette raison que la dictature de Pinochet convient mieux au profil du modèle "négatif". On peut en effet la présenter comme opposée à la démocratie, ce qui correspond tout à fait à l’intérêt de la bourgeoisie internationale qui cherche en permanence à masquer le fait que son système démocratique n’est en réalité rien d’autre qu’une dictature, et que les institutions démocratiques, quelles qu’elles soient, prévoient toujours la guerre de classe et le terrorisme ouvert contre le prolétariat lorsque celui-ci lutte contre le pouvoir d’Etat.
A ce stade, on comprendra que si nous éprouvons un aussi profond dégoût pour le spectacle Pinochet, c’est moins pour ce qu’il montre que pour ce qu’il dissimule.
Car du point de vue le plus général, celui des contradictions de classe, qui donc tire bénéfice du spectacle Pinochet si ce n’est le capital et l’Etat qui apparaissent exempts de fautes, lavés du péché de terrorisme d’Etat, ce dernier nous étant présenté comme absolument incompatible avec la démocratie (6). Toute cette campagne de presse tend à nous montrer que ce n’est pas le capitalisme qui engendre le terrorisme d’Etat, mais les dictateurs, ceux qui ont des gueules de "méchants".
On opère de la même manière pour chaque guerre, pour chaque massacre généralisé en mettant la barbarie sur le compte de tel ou tel cinglé, de tel ou tel dictateur. On fait la caricature de Pinochet comme on a fait celle d’Hitler, de Saddam Hussein ou de Milosevic, et ensuite, au nom d’un combat contre cette personnification du mal, et sous prétexte d’imposer la paix, on extermine, on lance des bombes sur des villes entières ou sur des quartiers prolétariens, comme lors de la dite Seconde Guerre Mondiale, ou comme aujourd’hui en Irak, en ex-Yougoslavie... En fait, il s’agit systématiquement de cacher que la barbarie des guerres est le produit "naturel" de la société du capital, de l’évolution et du progrès inhérent à la société bourgeoise. Pour paraphraser des camarades qui, il y a quelques années dans "Auschwitz, ou le grand Alibi", dénonçaient la politique bourgeoise de l’antifascisme et la mise en avant d’Hitler pour occulter la barbarie démocratique, nous pouvons dire que Pinochet est aujourd’hui le grand alibi de la bourgeoisie mondiale.
- Parce que, comme Nuremberg par exemple (7), Pinochet sert d’alibi
à la barbarie généralisée du capital.
- Parce que ce tintamarre sert bien plus à cacher des choses
qu’à en révéler.
- Pour créer une polarisation interbourgeoise sur la question
de l’immunité à accorder ou non.
- Pour que ce thème soit traité dans la sphère
juridique des Etats, très loin de l’action directe.
- Pour donner à l’Etat mondial l’occasion de se présenter
comme opposé aux pratiques de terrorisme d’Etat qui lui sont cependant
essentielles.
- Pour recrédibiliser la démocratie internationale en
condamnant un dictateur insuffisamment "démocratique".
Enfin, et par dessus tout: pour démobiliser le prolétariat, l’immobiliser face au sinistre spectacle juridico-démocratique qui se déroule au sein de l’Etat en Angleterre, en Espagne, au Chili... et affirmer ainsi la politique générale de la bourgeoisie qui consiste à arracher la lutte contre l’impunité à la rue et l’amener dans les tribunaux et les parlements.
L’infaillible recette de l’Etat mondial consiste toujours à soustraire "la lutte pour les disparus et contre l’impunité" (8) au terrain de la force, de la rue et à l’amener sur le terrain formel de la justice bourgeoise, des papiers, des formulaires, des dossiers juridiques, des hommes en cravates et en toges noires. La bourgeoisie doit extraire cette question du terrain de l’affrontement de classe car, sur ce terrain-là, elle court le risque que tortionnaires et criminels de l’Etat démocratique soient jugés dans la rue. Elle doit tranquilliser la masse en lui faisant croire que les juges, les lois, les parlements, les institutions bourgeoises feront justice. De plus, tortionnaires et assassins sont, eux aussi, bien plus tranquilles lorsque la menace qui pèse sur eux émane de leurs collègues plutôt que de prolétaires. Dans le cadre de la justice institutionnelle, le pire désagrément que les criminels d’Etat risquent de rencontrer est une "prison" de luxe, semblable à celle où se trouvent actuellement certains tortionnaires argentins, ou encore une "geôle" analogue à celle où a résidé Pinochet en Angleterre avant d’être rapatrié. Comme l’ont dit récemment des prisonnières chiliennes, Pinochet n’aura jamais à souffrir aucune des humiliations que subissent ceux qui sont jetés en prison parce qu’ils luttent contre l’Etat:
"- Lui, il n’a pas été séquestré par les appareils répressifs qui nous ont arrêtés. Lui, ils ne l’ont pas torturé devant ses enfants, ils ne lui ont pas donné de décharge électrique, ils ne l’ont pas frappé, ils n’ont pas bandé ses yeux, ils n’ont pas fait pression sur lui des jours d’interrogatoires durant.
- Lui, ils ne l’ont pas mis au secret pour d’interminables jours, laissé sans défense, à ne voir personne d’autre que ses tortionnaires, livré à l’incertitude de ne pas savoir s’il sortira vivant ou mort... comme ils nous l’ont fait à nous.
- Lui, ils ne l’ont pas diabolisé dans le spectacle médiatique; c’est un pauvre vieux maintenant. Au Chili, ils ne l’ont traité ni de délinquant, ni de terroriste... comme ils nous l’ont fait à nous.
- Lui, ils ne l’ont pas reconduit en prison, mis au secret, menacé, en cherchant à l’affaiblir ou l’anéantir... comme ils l’ont fait à nous.
- Lui, ils ne l’ont mené ni devant des juges, ni devant des procureurs militaires, ils ne l’ont pas soumis à des procédures aberrantes, ils ne l’ont condamné ni aux travaux forcés à perpétuité, ni à la peine de mort, ni à 300 ans de prison,... comme ils nous l’ont fait à nous.
- Lui, personne n’osera le fusiller comme assassin, terroriste, "génocidaire"... Même si c’est cela qu’il mérite, on peut être sûr que pour l’une ou l’autre raison, il restera libre et non enfermé pour des années, comme ils nous l’ont fait à nous." (9)
Et effectivement, Pinochet a été traité comme un roi, pendant sa détention. Ils sont parvenus à un accord entre eux et ce sont les Forces Armées Chiliennes qui ont payé la note... Ce qui signifie que, paradoxe des paradoxes, même le luxueux séjour européen de Pinochet dans la somptueuse résidence britannique dont il a disposé a été payé par la plus-value extorquée au prolétariat au Chili... tandis que les prolétaires prisonniers dans ce pays continuent à être traités par la "jeune démocratie" comme ils l’étaient par Pinochet.
Aujourd’hui même, au Chili, contrairement à ce qu’on a tenté de faire croire sur la scène internationale, toutes les manifestations ne sont pas organisées pour ou contre le maintien de Pinochet en prison. Comme en témoigne la lettre citée plus haut, le prolétariat dans ce pays poursuit sa lutte contre l’impunité et de nombreux secteurs rejettent la mystification et le spectacle monté autour de Pinochet.
Dans ce contexte, l’opération "ESCRACHE" (10) en Argentine est sans aucun doute la lutte qui a remis le plus profondément en question l’impunité généralisée que l’Etat bourgeois mondial s’acharne à vouloir imposer en Amérique Latine.
Sous différentes appellations (Mères, Grands-mères,
Parents, Enfants,...) et en totale opposition à la politique des
partis et aux tentatives institutionnelles d’amnistier et d’entériner
l’impunité ("Ley de punto final", "Ley de Obediencia Debida" (11),
etc.), la lutte contre l’impunité s’est poursuivie avec une constance
exemplaire. Malgré l’âge avancé de ses militants les
plus décidés, et bien qu’il ait évidemment connu quelques
moments de faiblesse, le mouvement ne s’est pas épuisé, au
contraire, il s’est développé et a gagné de nouvelles
forces. Par ailleurs, ce qui préoccupe sans doute le plus l’Etat
en Argentine (et dans d’autres pays), c’est que de nouvelles générations
de prolétaires reprennent les vieux drapeaux du mouvement, tel le
mot d’ordre "ni oubli, ni pardon" (12) qui avait littéralement
terrorisé les criminels d’Etat à l’époque, et que
le retour actuel fait à nouveau trembler. Cette consigne acquiert
d’autant plus de force que les assassins à qui elle s’adresse la
croyaient plus ou moins éteinte et qu’ils sont bien obligés
de constater aujourd’hui que ce n’est pas le cas puisque cette directive
est maintenant prise en charge par de nouvelles générations
dans leur lutte révolutionnaire contre le capital et l’Etat.
L’imposture des jugements et des prisons pour tortionnairesJamais, l’Etat démocratique bourgeois ne liquidera ses meilleurs représentants, les militaires tortionnaires. Il les protègera éternellement. La gauche bourgeoise a systématiquement essayé de canaliser la colère prolétarienne envers les militaires dans le giron des institutions, des tribunaux. En Uruguay, le crétinisme parlementaire a été jusqu’à rassembler des signatures pour faire un référendum dont la revendication la plus radicale était le jugement des militaires!Voyons comment une des "Mères de la Place de Mai" (Evel Petrini) résume l’escroquerie que sont les décisions de la justice. "Le gouvernement constitutionnel d’Alfonsín, qui a été frapper aux portes des casernes pour que les militaires viennent sauver le pays et renversent le gouvernement constitutionnel (d’Isabel Perón), fit d’abord un procès présomptueux par lequel il désirait se faire reconnaître comme le grand démocrate. Ce procès était totalement préparé, totalement fabriqué par les militaires. Sur 30.000 disparus, on choisit 700 cas, on en jugea 270 et seules 70 personnes furent condamnées. Vous pouvez ainsi vous faire une idée des proportions de ce jugement. Strassera, celui à qui on a rendu tant d’hommages comme procureur, était un juge de la dictature qui, de but en blanc, jetait nos habeas corpus à la poubelle et nous disait: ‘Madame, ne demandez pas après votre fils parce qu’il n’est pas ici dans le pays, il est peut-être avec une autre femme’. C’était lui qui jugeait les militaires, c’est pourquoi, on a du mal à croire qu’il s’occupait de faire justice. Ils furent enfermés dans des prisons spéciales, des prisons avec des terrains de golf où leur famille venait les visiter, des chalets furent spécialement construits pour les 5 ou 6 qui restèrent condamnés. Ce fut donc une farce totale et absolue. Et à nous, ils dirent que nous ne devions pas aller sur la place parce que nous étions anti-argentines et que nous donnions une mauvaise image dans le pays. Puis, avec les Malouines, ils dirent aussi que nous étions anti-argentines, que nous ne soutenions pas la guerre. Finalement, après tous les traitements que nous, "les Mères", avons soufferts, il fut, malheureusement, démontré que nous avions raison: il n’y avait pas d’intention politique d’arrêter les assassins, parce que eux aussi, ils parlent de personnes et ce sont des personnes, ce sont des institutions, parce que les institutions sont formées de personnes et que ces personnes furent celles qui commirent toutes ces atrocités. Toutes, sur ordres de supérieurs, du plus haut au plus bas; tout qui sait ce que sont les Forces Armées sait qu’il y a un commandement mais que tous, de haut en bas, font ce que le commandement leur ordonne de faire et s’ils ne le font pas, s’ils ne veulent pas le faire, ils doivent sortir. Et d’après ce qu’on a vu, personne n’est sorti. De sorte que ce sont tous les militaires, toutes les Forces Armées, toute l’Eglise de la coupole (sauf les curés de base) qui à ce moment-là partageaient avec les militaires les décisions et les camps de concentration, [qui décidaient] du comment et du pourquoi ils devaient tuer nos enfants. C’est pour cela que nous, "les Mères", nous condamnons tout cela, toutes ces choses qui ne furent jamais abordées dans les procès. Ensuite, Menem arriva et il décréta la grâce, libérant ainsi le petit nombre de ceux qui avaient été condamnés. C’est pourquoi tout ceci est bien une farce, c’est un accord, une magouille avec les militaires pour qu’on leur donne le pouvoir..." Extrait d’un reportage auprès d’Evel Petrini (secrétaire des "Mères de la Place de Mai") fait par le journal de la CNT d’Espagne en décembre 1998. |
L’activité qui consiste à dénoncer les tortionnaires du prolétariat a toujours existé dans le Cône Sud. Au Chili ou en Uruguay, par exemple, les tortionnaires et les assassins, poursuivis sans relâche par leurs dénonciateurs, n’ont jamais eu la vie facile. Mais c’est sans aucun doute l’opération "ESCRACHE", développée pour l’instant principalement en Argentine, qui a obtenu l’impact social le plus important.
Contrairement à l’ensemble de propositions institutionnelles de la bourgeoisie de "juger les responsables" ("procès civils", "référendum", "procédure en appel", "commissions d’investigation parlementaire", "annulation juridique de telle loi", "vote vert",...), l’opération "ESCRACHE" se caractérise par la participation directe du prolétariat. Ici aussi, comme dans les autres pays, il s’agit de poursuivre et dénoncer les tortionnaires et les assassins, en recherchant plus particulièrement ceux qui, pour dissimuler leur rôle criminel dans la liquidation des militants révolutionnaires, se sont refait "une nouvelle vie".
A l’origine de l’opération "ESCRACHE", on trouve des groupes d’hommes et de femmes qui n’ont pas cru aux promesses de la justice institutionnelle, et qui se sont lancés eux-mêmes à la recherche des tortionnaires planqués, pour les dénoncer publiquement. Mais, rapidement, l’"ESCRACHE" est devenu bien plus qu’une simple dénonciation: toute une série de procédés sont maintenant utilisés pour soutenir l’action. Dans certains cas, une manifestation est organisée devant la maison même du paisible citoyen planqué, et l’on clame haut et fort ses antécédents afin que tout le quartier soit bien au courant de son passé de tortionnaire. Dans d’autres cas, on fait carrément irruption sur son lieu de travail, toujours pour le dénoncer, et on lui lance des oeufs pourris, ou encore on fait un terrible scandale dans son quartier avec tambours et cymbales. Des tracts avec des photos récentes et anciennes du sujet "escraché" sont également distribués, on badigeonne d’inscriptions les murs de sa maison... Dans la majorité des "ESCRACHES" plusieurs de ces procédés sont utilisés simultanément. Le but, est toujours le même: empêcher le sujet de continuer à vivre une cynique et paisible existence de bon citoyen. Contrairement à d’autres formes de dénonciations donc, c’est l’agitation dans les rues, les chahuts et l’incorporation du voisinage qui caractérisent l’"ESCRACHE". Il s’agit toujours d’actions qui peuvent facilement être reproduites dans d’autres lieux encore, et de façon toujours plus large.
Escracher" quelqu’un signifie le frapper, le dénoncer publiquement, le photographier. Selon le dictionnaire de lunfardo de José Gobello, "ESCRACHE" du verbe "escrachar" signifie: "Lancer quelque chose avec force, passer à tabac, frapper plusieurs fois, donner des coups de fouets à quelqu’un". Selon cet auteur, le terme provient "du Génois (scraccâ) ou du piémontais (scracè): expectorer". Au vu des diverses utilisations qu’il recouvre en Argentine, nous associons également le verbe "escrachar" au terme français "écraser" ou au terme italien "schiacciare" ou encore: crever, écraser, heurter, décourager totalement. Transformer quelqu’un en "escracho" signifie également le rendre laid, horrible, répugnant.
Gobello nous dit aussi que "Escracho" veut dire "Photographie d’une personne, particulièrement de son visage. Figure, visage -utilisé en général de manière méprisante-. Personne laide et désagréable".
Au début, les organisations qui ont lancé cette campagne l’avaient intitulée "Démasquons nos assassins" et son objectif premier était la dénonciation pure et simple des tortionnaires. Mais l’intervention décidée de certains cercles et de quelques camarades permit d’élargir les objectifs initiaux, et dès lors, le nom "ESCRACHE", que portait déjà une des commissions de "H.I.J.O.S." (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio - Fils pour l’identité et la justice contre l’oubli et le silence), fut adopté (sans doute fin 1997, début ’98).
Il est intéressant d’aborder quelques cas concrets afin de comprendre la façon dont le mouvement s’est qualitativement développé, depuis son origine. Sauf information contraire, la première victime d’un "ESCRACHE" fut Jorge Magnaco, médecin gynécologue dont on savait qu’il s’occupait des accouchements dans le centre de disparition forcée dénommé ESMA. Ce médecin joua un rôle clé dans l’enlèvement des nouveaux-nés à leur mère -des mères qui étaient ensuite portées disparues-, et dans leur livraison rapide à des militaires qui, dans la plupart des cas, les ont séquestrés jusqu’à ce jour; il s’agissait en général d’officiers ou des haut-gradés qui participaient eux-mêmes aux tortures, aux séquestrations et aux assassinats. Jusqu’au moment de son "ESCRACHE", monsieur Magnaco, à l’image de bien d’autres tortionnaires, menait une vie paisible et confortable de médecin "de prestige", son sale passé restant inconnu de ses collègues et de ses patients. C’est apparemment sur base d’une enquête télévisée que l’on parvint à déterminer qu’il travaillait à la clinique Mitre. Une délégation des organismes qui luttent contre l’impunité, commença par se rendre à cette clinique afin de révéler le passé de leur collègue aux patrons de l’institution médicale et tenter de les convaincre de le licencier. Mais pour un capitaliste, le fait d’avoir arraché des gamins à leurs mères et d’avoir fait disparaître ces dernières ne constitue pas un argument suffisant pour justifier la séparation d’un de ses bons éléments! La pétition pacifique fut donc rejetée. Commença alors une lutte de longue haleine pour ruiner la vie de ce répugnant personnage. Une série de manifestations furent organisées tant devant la clinique que devant la maison du gynécologue, on fit d’innombrables chaulages, on colla des affiches pour "brûler" le personnage, le rendre infréquentable, de sorte que, finalement, les patrons de la clinique se virent dans l’obligation de le mettre à la porte pour les raisons mêmes qui lui avaient permis de garder sa place (en dernière instance, les questions de rentabilité!).
Cette action initiale s’est avérée déterminante car dès le début, elle a permis de vérifier que seule l’action décidée et directe, et non le dialogue avec les bourgeois, pouvait réellement porter ses fruits tant en terme de dénonciation d’un tortionnaire, qu’en terme de châtiment social. Et de fait, même si ce châtiment est bien moindre que celui qu’il mérite, il s’agit néanmoins d’une punition relativement importante que de faire perdre son travail à quelqu’un, de lui imposer une diminution de ses rentrées financières et de son niveau de vie, de lui faire perdre son statut social en le "brûlant" dans son quartier et partout ailleurs. Et tout cela, sans l’intervention des bourgeois, sans attendre patiemment que la justice institutionnelle fasse quelque chose.
Cela faisait plus de 15 ans que la justice démocratique faisait des promesses qu’elle ne tenait pas: il fallait vraiment vivre dans un monde rempli d’illusions pour espérer encore quelque chose. Même ceux qui avaient cru en Alfonsin et à ses promesses de justice étaient complètement déçus. En tout cas, le résultat était clair: ce qu’on n’avait pas obtenu en plusieurs années de lutte, l’action directe d’une manifestation prolétarienne minoritaire avait réussi à l’imposer!
Les mois suivants, d’autres "ESCRACHES" et d’autres résultats suivirent. Ainsi, en décembre 1999, ce fut au tour de Julio Simón (alias "Turco") et de Juan del Cerro (alias "Colores") d’être "escrachés". Dans les deux cas, avant d’appeler à la manifestation générale dans le quartier, des groupes de camarades menèrent quelques actions préalables: mise au courant du voisinage, distribution de tracts avec photo et curriculum vitae des tortionnaires, chaulage des maisons ("ici vit un assassin")... C’est au cours même de ces actions qu’on constata à quel point, grâce à toute la stratégie légalisto-baveuse de l’Etat démocratique, les tortionnaires jouissaient de l’impunité et se sentaient à l’abri de toute sanction: dans la majorité des cas, les voisins eux-mêmes ignoraient tout de leur passé, et étaient complètement surpris d’apprendre que le citoyen modèle qu’ils voyaient passer tous les jours avec le journal ou le pain sous le bras, était en réalité un assassin, un monstrueux tortionnaire, un des hommes clé du terrorisme d’Etat. Une fois la surprise passée, de nombreux voisins passèrent eux-mêmes à l’action: certains participèrent à la manifestation, d’autres décidèrent de ne plus leur vendre de pain, à la centrale des taxis, on refusa de leur envoyer une voiture, on leur coupa les possibilités de crédit dans le quartier, etc. Nombreux sont ceux qui voulurent les virer du quartier, d’autres appelaient à se battre jusqu’à ce que ce genre de sordide personnage pourrisse en prison (13). Pour finir, de nombreux tortionnaires furent contraints de déménager pour tenter de se mettre à l’abri de nouveaux "ESCRACHES".
En vérité, bon nombre de ceux qui eurent à subir les "ESCRACHES" avaient déjà été condamnés par la justice bourgeoise, quelques années auparavant. Pour toute sanction, certains d’entre eux avaient été assignés à résidence pendant quelques mois, ou enfermés dans des prisons de luxe, et, finalement, toutes les composantes du monde politique argentin les avaient amnistiés et libérés sur base des Lois du Point final, du Devoir d’Obéissance et des grâces. Il est clair que les "ESCRACHES" se situent directement contre ces lois et contre toute les composantes du spectre politique argentin qui les ont approuvées. Dans les consignes qu’ils mettent en avant, ils s’opposent explicitement à la justice bourgeoise, à la justice formelle : "Contre la loi de Point Final", "Contre la Loi du Devoir d’Obéissance" ou, plus clairement encore, "Pour la condamnation sociale, vers la condamnation réelle".
C’est cette dernière consigne qui a réuni les militants dans l’opération "ESCRACHE" menée à l’encontre de Antonio Domingo BUSSI. Cet "ESCRACHE" constitua un véritable saut de qualité, une épreuve du feu par rapport aux autres, non seulement parce que Bussi est un haut gradé -un Général- tortionnaire et un chef de la répression, mais surtout parce qu’il est actuellement gouverneur de la province de Tucumán. Bussi n’est pas un représentant de la dite période de "dictature militaire". Ses principales médailles de terroriste d’Etat, il les a obtenues avant, en plein gouvernement d’institutions démocratiques, durant le gouvernement péroniste. Il fut le chef suprême du plan d’extermination développé par la bourgeoisie argentine sous le nom d’"Operativo Independencia". C’est en ce sens que l’on peut dire que Bussi fut un véritable démocrate, précurseur de l’ensemble de la politique militaire de terrorisme d’Etat ouvert qui, plus tard, durant ce que l’on appela d’abord "El Proceso" et ensuite "La Dictadura" (14), s’étendra à tout le pays. L’"ESCRACHE" de Bussi constitue également une véritable épreuve du feu parce qu’il va à l’encontre du courant qui voudrait rejeter la responsabilité des massacres sur la seule "dictature militaire", comme si avant et après, on n’avait pas utilisé exactement les mêmes méthodes. Aujourd’hui encore, au nom de la république démocratique, Bussi est membre du parti républicain et exerce les fonctions de Gouverneur de la province de Tucumàn. Son "ESCRACHE" fut donc très difficile à réaliser non seulement parce qu’il fallait réunir des camarades sur un terrain contrôlé de manière policière par l’adversaire, mais également à cause de la distance séparant Buenos Aires et le lieu de l’"ESCRACHE", le déplacement des camarades impliquant des coûts élevés. De plus, après avoir appris l’imminence de son "ESCRACHE", Bussi s’enfuit à Buenos Aires où il passa le week-end et fit envoyer 5.000 militaires à Tucumàn. Malgré l’impressionnant déploiement des forces de l’ordre (15) et l’impossibilité d’accéder à la maison du Gouverneur, protégée par un cordon répressif, la manifestation atteignit plusieurs objectifs importants et la place de l’"Operativo Independencia" (macabre souvenir de la répression) fut rebaptisée place "Fredy Rojas", du nom d’un militant assassiné en 1987. D’autres plaques commémoratives portant des inscriptions telles que "aux camarades disparus" et "Mémoire et Justice" furent également posées.
Ainsi donc, même dans un cas aussi compliqué que celui-ci, des résultats importants peuvent être atteints: des prolétaires se sont associés, unis, et un responsable des tortionnaires, un de leurs chefs (parce qu’il est fort probable que ce monsieur ne se soit pas sali les mains directement lui-même) a été dénoncé publiquement.
Nombreux sont les militaires qui subirent des "ESCRACHES", même
parmi les plus hauts gradés: Galtieri, Videla, Massera, Astiz, Etchecolatz,
Acosta et Suarez Mason. Au fur et à mesure de l’unification que
produisent ces actions, les objectifs initiaux sont peu à peu dépassés
et l’"ESCRACHE" devient plus puissant.
Etchecolatz, le bon citoyen"Monsieur le voisin: je ne peux être infidèle à mes valeurs de respect et de considération envers mes pairs. Je ne suis obligé de vous présenter aucun type d’excuses pour les faits qui se sont déroulés hier soir parce que jamais je n’ai participé, ni ne participe à quelque expression de violence que ce soit, mais il est de mon devoir et de mon obligation de bon citoyen et de bon voisin de vous faire part mes regrets pour les moments d’incertitude et les risques que vous avez injustement eu à supporter."Le touchant petit mot qui précède a été glissé par l’ex- commissaire général Miguel Etchecolatz (chef de la police de Buenos Aires durant la période de répression la plus intense, bras droit du Général Camps, responsable de plusieurs camps de concentration -le Pozo de Quilmes, le COT 1 Martínez, Puerto Vasco et Arana-, et responsable de la "Noche de los Lápices", un massacre de lycéens qui protestaient) sous la porte de ses voisins d’immeuble, après l’"ESCRACHE" effectué par H.I.J.O.S. Ce bon citoyen, condamné à 23 ans de prison pour assassinats et tortures réitérés, fut libéré grâce à la loi du "Devoir d’Obéissance". Il est cependant toujours inculpé pour la disparition de bébés en captivité. |
De fait, l’"ESCRACHE" est plus qu’une simple dénonciation. C’est une dénonciation qui s’accroit et s’amplifie et qui, dans la mesure où elle est assumée ouvertement par de plus en plus de monde, devient une véritable force qui anéantit, dans la pratique, l’impunité dans laquelle vivent les tortionnaires et les assassins! C’est donc une véritable condamnation sociale.
Nous l’avons dit, "escrachar" signifie "réduire à néant", "incendier", "griller",... quelqu’un. Celui qui subit un "ESCRACHE" est "brûlé" publiquement pour toujours, la sécurité dans laquelle il vit vole en éclat, la publicité des atrocités qu’il a commises le réduit à néant, la double vie qu’il s’est construite et dans laquelle il cache son passé de tortionnaire et d’assassin est ruinée.
Les "ESCRACHES" sont convoqués par différents groupes et associations liés aux disparus et à toute l’histoire de la lutte contre l’impunité, mais ce qu’il faut souligner et qui est très important, c’est qu’aux "Mères de la Place de Mai", aux "Grand-Mères de la Place de Mai" et aux différentes associations de "Parents de Détenus et Disparus pour Raisons Politiques", viennent maintenant s’ajouter toujours plus de jeunes prolétaires actifs, regroupés pour la plupart dans l’association que nous avons déjà mentionnée et qui répond au nom significatif de "H.I.J.O.S."
La force de l’opération "ESCRACHE" et la panique qu’elle suscite au sein des forces répressives est due avant tout à l’action même des protagonistes: refusant de laisser les choses aux mains des institutions bourgeoises, des tribunaux et des parlementaires, les prolétaires passent à l’action directe et assument seuls l’"ESCRACHE" des tortionnaires. Mieux encore, l’origine même de l’action s’ancre dans la dénonciation de toutes les institutions bourgeoises qui, plutôt que de faire quoi que ce soit contre les militaires assassins et tortionnaires, ont assuré leur impunité: il suffit de penser aux gouvernements qui se sont succédés depuis 1984, aux partis politiques correspondants, au pouvoir judiciaire à tous les niveaux, à l’Eglise qui fut toujours complice du terrorisme d’Etat, au parlement, à la "Loi du Point Final" et à celle du "Devoir d’Obéissance",...
De plus, l’"ESCRACHE" n’exige pas seulement la "récupération de nos frères séquestrés et nés en captivité durant la dictature" ainsi que la "prison (pour) tous les génocidaires et leurs complices", il revendique également ouvertement des consignes contre le pardon et la réconciliation, ce que, sur base de quelques "dédommagements" remis aux familles des victimes, toutes les forces bourgeoises cherchent à imposer.
Les consignes fondamentales des "ESCRACHES" restent:
La torture et la disparition physique de militants prolétariens ne relèvent ni de l’excès de certains militaires, ni de la folie de certains officiers, mais d’une politique générale de l’Etat argentin
(...) Entre vous, dans les conversations, comment faisiez-vous référence à cela? On l’appelaient "le vol". C’était normal, même si actuellement cela semble être une aberration. Comme Pernías ou Rolón l’ont dit aux sénateurs, on avait adopté la torture que l’on utilisait régulièrement pour soutirer des informations à l’ennemi; le "vol" était tout aussi habituel. Quand j’en ai reçu l’ordre, je suis descendu à la cave où se trouvaient ceux qui allaient "voler". En bas, il n’y avait plus personne. Je leur ai donc dit qu’ils allaient être transférés au sud et que, pour cette raison, on leur ferait un vaccin. On leur injecta un vaccin... je veux dire une dose pour les abrutir, un sédatif. C’est comme ça qu’on les endormait. Qui leur appliquait l’injection? Un médecin de la Marine Militaire. Ensuite on les a mis dans un camion vert de la Marine avec une bâche en toile. Nous nous sommes rendus à l’Aéroparque [aéroport national de Buenos Aires], nous sommes entrés par l’arrière. On chargeait les subversifs comme des zombis et on les embarquait dans l’avion. Qui participa? La majorité des officiers de la Marine a participé à un vol, c’était pour faire une tournante, une sorte de communion. En quoi consistait cette communion? C’était quelque chose qu’il fallait faire. Je ne sais pas ce que vivent les bourreaux quand ils doivent tuer, lâcher le couperet ou brancher les chaises électriques. Ca ne plaisait à personne de faire cela, ce n’était pas quelque chose d’agréable. Mais on le faisait et il était clair que c’était la meilleur manière de le faire, on ne discutait pas. C’était quelque chose de suprême qui se faisait pour le pays. Un acte suprême. Quand on recevait l’ordre on ne discutait plus. On l’accomplissait de manière automatique. On venait de tout le pays pour faire des tournantes. Certains y ont peut-être échappé, mais de manière anecdotique. Ce n’était pas un petit groupe, c’était toute la Marine. Quelle était la réaction des détenus quand on leur parlait du vaccin et du transfert? Ils étaient contents. Se doutaient-ils de ce dont il s’agissait? En rien. Personne n’avait conscience du fait qu’il allait mourir. Une fois que l’avion avait décollé, le médecin qui était à bord leur injectait une seconde dose, un puissant calmant. Ils restaient endormis. Quand les prisonniers dormaient que faisiez-vous? C’est très morbide. Vous faisiez des choses morbides? Il y a quatre choses qui me font du mal. Les deux vols que j’ai effectués, la personne que j’ai vu se faire torturer et le souvenir du bruit des chaînes et des fers. Je n’ai vu cela que quelque fois, mais je ne peux oublier ce bruit. Je ne veux pas parler de ça. Laissez-moi partir. Ceci n’est pas l’ESMA. Vous êtes ici de votre propre gré et vous pouvez partir quand vous le désirez. Oui, je sais. Je ne voulais pas dire cela. Il y a des détails qui sont importants, mais ils sont pour moi pénibles à raconter. J’y pense et ça me rend fou. On les déshabillait évanouis et quand le commandant de l’avion en donnait l’ordre, en fonction de où se trouvait l’avion, en haute mer, plus loin que Punta Indio, on ouvrait les portes et on les jetait nus un par un. Ceci est l’histoire réelle que personne ne peut démentir. Cela se faisait depuis des avions Skyvan de la préfecture et des avions Electra de la Marine... |
Ainsi, certains camarades estiment par exemple que l’"ESCRACHE" est une arme à double tranchant, "malheureusement réciproque", comme ils le formulent ironiquement. C’est-à-dire que les militaires tortionnaires ou les organisateurs des opérations de séquestration, responsables de la disparition de militants et de leurs enfants, ne sont pas les seuls à subir l’"ESCRACHE"; les participants eux-mêmes, surtout quand ils sont peu nombreux, sont complètement "escrachés", filmés, "grillés", repérés par les forces répressives. Il s’agit d’une réalité indéniable et malheureusement plus ou moins inévitable dans la situation actuelle. Comme ce genre d’opération n’est pas encore aussi massive qu’elle le devrait, il est effectivement relativement facile d’identifier les militants présents, ce qui implique que sur cet aspect, il faille absolument adopter un minimum de précautions et de mesures, sous peine de voir l’excès de publicité porter préjudice aux militants et même limiter les effets de l’"ESCRACHE" (17). Mais il faut être très clair sur le fait que toute avancée dans la lutte a toujours comporté ce type de risques (cf. par exemple, le fichage des historiques et vaillantes "Mères"), et que seules la généralisation et l’importance numérique croissante des actions prolétariennes elles-mêmes entraveront le travail des agents de renseignements, des journalistes et autres flics.
Un autre danger dénoncé par certains militants est de voir certaines consignes interprétées comme des exigences faites à l’Etat, et auxquelles celui-ci pourrait répondre en changeant par exemple l’une ou l’autre loi, voire en allongeant les peines de quelques militaires emprisonnés, une dynamique qui liquiderait l’action directe contenue dans le mouvement. Il faut évidemment rester attentif au fait que la fonction des démocrates, des partis politiques et des institutions de l’Etat est précisément de convertir les nécessités du prolétariat en réformes institutionnelles (18) et donc de transformer un mot d’ordre développé dans la rue en un décret ou en une loi. Ainsi, en Uruguay, toute l’énergie prolétarienne déployée à l’encontre des tortionnaires et des assassins fut très habilement canalisée par l’ensemble du spectre politique sous l’égide de la gauche (une gauche soutenue par bon nombre de groupes d’ex-guérilleros tels les "Tupamaros" légalisés) et ramenée au sein du cadre institutionnel, c’est-à-dire dans le cadre de l’Etat bourgeois. La polémique légaliste concernant les lois et référendums, les mobilisations pour les votes "verts" et autres mystifications finirent par démoraliser bon nombre de militants et par anéantir une grande partie du mouvement.
Et effectivement, c’est ce que tente aussi de faire l’Etat avec les "ESCRACHES": encadrer juridiquement le mouvement sur base des Lois du Point Final et du Devoir d’Obéissance, en affirmant que seuls les militaires responsables de séquestrations d’enfants peuvent être inculpés.
Ici, une brève explication s’impose. Du point de vue juridique, grâce aux lois susmentionnées, les militaires ont été déclarés pénalement irresponsables de toutes les atrocités commises à l’encontre de tous ceux qui luttaient. Face à cela, des collectifs en lutte contre l’impunité argumentèrent que ces lois ne pouvaient être applicables quand il s’agissait d’enfants. Ce point de vue fut accepté par les juges, mais du coup, les avocats des tortionnaires plaidèrent la prescription. Il fut alors décidé qu’il ne pouvait y avoir prescription pour les cas où il était question de bébés ou d’enfants disparus, parce qu’il s’agissait-là de séquestration et que le délai de la prescription ne peut entrer en vigueur qu’une fois le délit accompli. Or, quantité de bébés n’ont toujours pas reparus. Les militaires en question sont encore aujourd’hui condamnables pour séquestration puisqu’ils continuent à commettre leurs délits.
Par rapport à cela, même s’il faut reconnaître la force d’un argument juridique qui a permis de faire condamner quelques-uns des membres importants de la répression (Videla, Massera,...), il faut cependant insister sur le fait que tout cet imbroglio juridique n’est pas notre terrain: ce n’est pas le terrain du prolétariat, ce n’est pas le véritable terrain de la lutte contre l’impunité. C’est le terrain de nos ennemis, le terrain de la bourgeoisie, celui des institutions juridiques sur lequel, par définition, ceux qui luttent contre ces dernières ne peuvent trouver justice. Comme nous l’avons expliqué en d’autres occasions, si les gouverneurs, les juges, les parlementaires, les institutions du capital,... octroient quelques miettes au mouvement, c’est principalement pour deux raisons: d’abord parce que la force même du mouvement les oblige à faire des concessions, et d’autre part, parce que c’est sur base de ces mêmes concessions qu’ils pourront casser le mouvement. C’est-à-dire que s’ils arrêtent certains criminels (comme Videla) (19), c’est dans l’unique but de nous calmer, de nous montrer que la justice bourgeoise est utile... bref, tout comme pour le spectacle mis en place autour de Pinochet, il s’agit avant tout de désarmer le mouvement, de neutraliser le prolétariat.
On nous rétorquera que c’est grâce à la lutte que ces assassins se retrouvent en prison. Nous sommes totalement d’accord, mais nous insistons: ces incarcérations ont pour objectif non pas la continuité et le développement de la lutte (la seule chose qui intéresse le prolétariat), mais sa conclusion, sa fin. C’est la seule et unique raison qui pousse les "hommes d’ordre" à mettre en prison leurs frères de classe, à incarcérer des terroristes d’Etat essentiels au bon fonctionnement de toute démocratie, à enfermer aujourd’hui ceux-là même qu’ils encourageaient hier dans leurs opérations de répression. Par ailleurs, au vu de tous les efforts qu’ils ont déployés pour obtenir leur pardon, leur grâce, pour justifier leurs actes (sous prétexte du devoir d’obéissance), il est difficile de croire qu’ils aient soudainement décidé de les condamner.
D’autre part, si nous comprenons ceux qui se sont enfermés dans cet imbroglio juridique afin que les coupables soit punis, il est néanmoins certain que la raison fondamentale de ces inculpations n’est pas juridique (la bourgeoisie ne recourt à la loi que quand cela l’arrange), mais réside précisément dans la force du mouvement, dans sa continuité exemplaire, dans le fait qu’il a réussi à replacer le combat contre l’impunité au centre de l’actualité.
Quoi qu’il en soit, il est primordial de ne jamais perdre de vue que la justice institutionnelle, lorsqu’elle met l’un de ces monstres en prison, ne le fait jamais de sa propre initiative. Il s’agit en fait de la réponse des institutions bourgeoises au mouvement, une réponse choisie pour son efficacité à liquider le mouvement. L’action de l’Etat se base toujours sur la stratégie de la domination, de la déstructuration de toute force qui risquerait de remettre en question l’ordre bourgeois.
En fait, accepter de condamner les seuls militaires ne bénéficiant pas de la prescription, n’est-ce pas accepter la prescription pour tous les autres cas, alors que notre position est le refus pur et simple de toute prescription?
Et accepter de ne condamner que ceux qui ont participé à la séquestration d’enfants, n’est-ce pas accepter par ailleurs les lois qui innocentent tous ceux qui ont "simplement" torturé et fait disparaître plus de 30.000 personnes, alors que pour nous, il ne peut être question de pardonner un seul de ces militaires?
Et accepter que tortionnaires et assassins soient enfermés dans les prisons de luxe mises à dispositions par leurs semblables, n’est-ce pas cautionner quelque part que ce châtiment ultra-clément soit vraiment celui qu’ils méritent, alors que nous sommes tous conscients que cette simulation de peine n’est qu’une caricature de justice, une plaisanterie contre l’humanité?
Et enfin, qualifier de justice cette gigantesque farce, n’est-ce pas alimenter l’illusion d’une justice bourgeoise pouvant véritablement rendre justice? Nos ennemis ne sortent-ils pas finalement vainqueurs grâce à ce simulacre?
Le développement des "ESCRACHES" n’a pas seulement permis de continuer à démasquer et à "brûler" des tortionnaires innocentés par diverses lois et grâces, il a également ouvert la voie à l’affrontement à des institutions entières, voire à la politique bourgeoise dans son ensemble, tout en réveillant le souvenir des disparus et, mieux encore, en se revendiquant de leur lutte révolutionnaire.
C’est dans cet ordre d’idée, que "H.I.J.O.S." et d’autres regroupements ont décrété le 11 août 1998 "Journée de dénonciation de l’Eglise Complice". A cette occasion, ils ont non seulement distribué des tracts "escrachant" de hauts dignitaires de l’église officielle que l’on montrait sur des photos en train de festoyer avec les principaux militaires, mais ils ont également rendu hommage à ceux qui étaient tombés dans la lutte contre l’Etat.
La presse complice et ses propriétaires n’ont pas non plus été épargnés. Lors de la fête commémorant le centenaire du journal La Nueva Provincia de Bahia Blanca, toute la famille Massot, propriétaire dudit journal fut "escrachée". Un buffet froid avait été organisé et les 2.000 invités (Menem, sans doute averti, ne fut malheureusement pas de la partie!) eurent la bonne surprise d’entendre, comme "musique" d’ambiance, la lecture d’anciens éditoriaux dans lesquels le journal exprimait son soutien aux principaux militaires tortionnaires (citant par exemple des assassins du calibre d’Alfredo Astiz), et comme bruit de fond, les cris de protestation des "animateurs extérieurs" qui brûlaient symboliquement des exemplaires du journal.
Autre exemple encore, à l’occasion du 20ème anniversaire
du championnat du monde de football gagné par l’Argentine, "H.I.J.O.S."
publia une affiche représentant le commandant général
des Forces Navales, Emilio Massera, le président de la nation, Jorge
Rafael Videla et le commandant en chef de l’aéronautique, le brigadier
général Orlando Ramón Agosti poussant des cris de
joie. Sur cette même affiche, figurait une représentation
de la coupe "Argentine ’78" enserrant une tête de mort coiffée
d’une casquette de militaire. Le tout encadré du texte suivant:
"Alors
que le peuple fêtait le championnat du monde, eux fêtaient
le génocide."
A propos de l’égalité, de l’injustice et autres foutaises"Nous nous rebellons contre l’impunité et nous demandons justice, mais nous n’ignorons pas que la justice de la société qui consacre l’injustice n’est qu’une farce. Tout comme la politique d’extermination des militants populaires dans les années ’70, les grandes injustices qui nous émeuvent se sont faites et continuent à se faire sous l’oeil tolérant de larges secteurs sociaux. La justice à coutume de ne pas parvenir jusqu’aux responsables visibles, nous avons pu l’expérimenté nous-mêmes. Les lois du Point Final et du Devoir d’Obéissance, puis les grâces accordées aux "génocidaires", en sont la preuve. Mais même quand la justice emprisonne les assassins, elle est non seulement incapable de réparer les injustices, mais elle crée une fiction selon laquelle les injustes sont en prison et les justes dans la rue. La justice dans la société hiérarchique sert seulement à tranquilliser les consciences.L’unique manière de nous défendre des injustices est la dénonciation permanente, il faut constamment faire face à la vérité et forcer les gens à se rendre compte. Désigner les assassins, leurs collaborateurs, ceux qui ont tiré profit de leurs actions, ceux qui les ont tolérées. Permettre que les gens sachent qui est leur voisin, rompre avec l’anonymat que permet la ville. Faire en sorte que ceux qui ont permis et qui permettent les grandes injustices de notre époque soient confrontés aux conséquences de leurs actions, au regard et à la réaction de tous. Ce n’est pas avec la loi que nous combattrons les injustices, mais avec la conviction que nous sommes tous égaux et avec la volonté de défendre cette conviction. La société argentine a redécouvert un mot pour désigner cette stratégie de résistance à l’injustice. Les enfants des disparus qui se battent contre l’impunité et l’oubli l’appellent: ESCRACHE." Extrait du texte publié dans la revue A Desalambrar, sous le même titre, Numéro 10 -Casilla de Correo 18 C.P. 1871 Buenos Aires, Argentina. |
Mais ce qui est sans doute le plus important dans toutes ces manifestations de lutte, c’est que les objectifs mêmes du mouvement sont chaque fois plus larges et plus profonds, et toujours plus clairement orientés vers une lutte pour la révolution.
En effet, malgré les efforts pour confiner le mouvement dans le cadre de la lutte "pour les droits de l’homme", celui-ci revendique de plus en plus clairement non seulement le combat des enfants et des parents disparus, mais également l’objectif révolutionnaire de ce combat, ainsi que la filiation directe de la lutte actuelle avec la lutte révolutionnaire historique.
Il n’est pas nécessaire qu’une lutte se définisse comme révolutionnaire pour qu’elle le soit. Il existe de nombreux exemples de luttes dans lesquelles le prolétariat s’est donné des consignes imprécises, telles "Terre et Liberté" au Mexique, ou, plus vagues encore, "Paix et Pain" en Russie, sans que cela n’ôte quoi que ce soit à leur caractère révolutionnaire. Nous voulons souligner qu’en Argentine et dans le Cône Sud, le triomphe de la contre-révolution et le terrorisme d’Etat avaient eu un tel impact que pratiquement plus personne n’osait parler de révolution, et que, par conséquent, ceux qui continuaient à se battre restaient malheureusement le plus souvent prisonniers de revendications bourgeoises ("Droits de l’homme",...). Or, le mouvement qui réémerge aujourd’hui remet au premier plan l’affirmation selon laquelle il ne s’agit pas de quémander des droits à l’Etat et qu’il n’y a pas d’autre issue que la lutte révolutionnaire; et cela tout en revendiquant que la lutte entreprise par les enfants et les parents disparus fut avant tout -et malgré les erreurs commises- une lutte pour la révolution sociale.
Dans les déclarations publiques des "H.I.J.O.S.", des Mères, etc., on constate une prise en compte chaque fois plus claire de cette dimension: ils n’insistent plus sur l’"innocence" des parents, ils revendiquent leur action; dans la pratique ils ne se lamentent plus contre les injustices, ils revendiquent le combat de ceux qui sont morts en luttant: "mon père fut un militant révolutionnaire"; "ma fille s’est jointe à la lutte pour nous tous"; "ils ont lutté pour la révolution, parce qu’elle était et est nécessaire." (20)
La présidente historique de l’association des "Mères de la Place de Mai", Hebe Bonifani, proclame ouvertement: "Nous avons appris beaucoup de chose dans la lutte, nous avons appris à aimer la Révolution avec une intensité incroyable, parce que la révolution, ce sont nos enfants. Nous avons mis du temps à nous rendre compte qu’ils étaient la révolution, mais quand on s’en est rendu compte, notre amour a grandi et notre corps n’était pas assez grand pour le contenir. Nos enfants se trouvent à cette place, plus vivants que jamais, parce que nous qui sommes ici, nous sommes ceux qui nous battons, ceux qui ne croyons pas dans le système, ceux qui nous affrontons de toutes nos forces à la dégradation de la classe politique... Il faut se préparer avec une idéologie solide comme la pierre, qui ne bouge pas, qui nous permette d’avancer la tête haute; une idéologie pareille à celle que possédaient les nôtres, qui étaient souriants, qui vivaient, qui aimaient, luttaient, militaient et possédaient les plus beaux espoirs; ils ne sont pas arrivés à accomplir leurs rêves, nous n’y arriverons peut-être pas non plus, mais il est de votre devoir que le rêve des 30.000 [disparus] s’accomplisse."
Ceci dit, malgré l’énorme élan d’humanité qui anime les groupes de prolétaires en Argentine dans leur lutte contre ce système social en putréfaction, il est clair que le rapport de force ne penche pas en notre faveur. La défaite a été trop profonde, le nombre de prolétaires qui se reconnaissent dans cette lutte est encore trop faible, tant au niveau local qu’international. Il est fondamental pour tous ceux qui luttent aujourd’hui de ne pas sous-estimer cette réalité, de prendre très au sérieux ce problème. La généralisation de la lutte n’est pas seulement un désir, c’est une impérieuse nécessité.
En ce sens, la lutte contre l’impunité doit impérieusement se joindre à toutes les autres luttes prolétariennes, où qu’elles se développent. Ce n’est que sur cette base, en défendant qu’il s’agit d’une lutte révolutionnaire, en affirmant toujours plus clairement que l’impunité se combat en affrontant le capitalisme, que le mouvement continuera à se renforcer.
Au cours de la lutte, l’ABC du programme du prolétariat s’est vérifié: jamais nos revendications ne trouveront de solution dans le cadre institutionnel. Jamais nos ennemis -l’Etat bourgeois- ne nous donneront satisfaction. Il s’agit d’un rapport de force: seule la violence révolutionnaire pourra abolir l’impunité. Il est essentiel pour ceux qui luttent de ne pas ignorer ce fait.
Le rapport de force entre les classes, la généralisation du mouvement et des revendications prolétariennes, la nécessité de la violence révolutionnaire constituent les indispensables clés de la lutte contre l’impunité et, en dernière instance, de la lutte de toujours pour la révolution sociale, celle pour laquelle se sont battus et sont morts les 30.000 personnes dont parle Hebe Bonifani.
Il y a quelques temps, Alfredo Astiz se vantait un peu partout d’avoir tué et affirmait qu’il n’aurait aucune hésitation à tuer encore. D’autres ont même été plus loin. En juillet 1998, l’ex-Major Hogo Abete, incarcéré pour avoir participé à un putsch, déclarait depuis sa prison: "(C’est) un plan parfaitement élaboré qui, dans ses objectifs les plus bâtards, poursuit ce que la subversion a entamé avec la lutte armée et continue aujourd’hui par d’autres moyens... La destitution d’Astiz, la détention de Videla et celles qui suivront sûrement, font partie de ce plan, tout comme... les dites opérations "ESCRACHES"... Personnellement, je crois que si on applique le même critère confusioniste qui règne actuellement dans la société, le bon voisin serait tout-à-fait en droit d’"escracher" les maisons de ceux qui ne font rien pour le protéger, lui et sa propriété. Et il en irait ainsi également des militaires et de leurs familles qui pourraient "escracher" les maisons des subversifs ou de leurs parents. Et ainsi, de nouveau, face à l’absence d’autorité et le manque évident d’accord politique, les militaires recommenceraient à employer les mêmes méthodes que ceux qui les agressent. Et tout cela me rappelle que la guerre contre la subversion s’est déclenchée de manière similaire, lorsque les juges menacés se sont laissés impressionner, sont restés paralysés et ont cessé d’agir, et que, nous, les militaires nous avons été forcés de sortir au grand jour pour combattre l’impunité de ceux qui posaient des bombes, séquestraient et assassinaient de manière indiscriminée. La confusion, l’impunité et la haine nous conduiront-elles à nouveau à répéter l’histoire?"
C’est dire si les criminels savent parfaitement qu’il s’agit d’une question de force. En formulant ces menaces, ils disent explicitement à la classe qu’ils représentent qu’elle à besoin d’eux, que le système démocratique existant requiert le terrorisme étatique, que la disparition forcée de personnes, l’assassinat massif de militants a été -et sera- la seule façon de maintenir en place le répugnant système social qu’ils défendent: le capitalisme et sa démocratie. L’alternative qu’ils offrent est la suivante: ou vous acceptez toutes les conséquences du terrorisme d’Etat, ou alors nous recommençons à appliquer le terrorisme de l’Etat démocratique.
Mais comme nous l’avons dit, cela pose de très sérieux défis au mouvement contre l’impunité en particulier, et au prolétariat en général. Seule la généralisation de la lutte et son extension à tous les pays, seule l’organisation et la puissance révolutionnaire du prolétariat pourront liquider l’impunité dont jouit le terrorisme d’Etat.
Généralisons les "ESCRACHES" des tortionnaires à toute la planète! Augmentons la puissance, la force et la généralisation des "ESCRACHES"!
Mais affirmons en même temps clairement que sans la destruction de la société bourgeoise, il y aura toujours des tortionnaires, des criminels d’Etat et des militaires assassins. Il faut assumer le fait que seule la révolution sociale liquidera pour toujours le terrorisme d’Etat, et que la dictature du prolétariat est indispensable pour écraser et détruire intégralement tant l’Etat terroriste que la société qu’il représente et défend: le système capitaliste mondial.
Brandissons donc le drapeau révolutionnaire des militants prolétariens disparus et assassinés dans les années ’70, et reprenons également le flambeau des luttes menées contre l’Etat bourgeois en Argentine par nos camarades Rosigna, Severino Di Giovani et tant d’autres tombés dans ce pays en combattant pour la révolution mondiale.
Dans les passages de l’article précédent consacré au spectacle Pinochet, nous avons insisté sur l’hypocrisie des forces démocratiques qui se présentent aujourd’hui comme politiquement innocentes non seulement de ce qui s’est passé en 1973 au Chili (et dont les bourgeois et gouvernements du monde entier furent complices), mais aussi de leur activité actuelle en tant que juges, ministres, hommes politiques.
Avec cette "mémoire ouvrière" (1), nous voudrions mettre maintenant en exergue le rôle de tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, appuyèrent Allende au début des années ’70. Nous voudrions rappeler que ce dernier ne correspond en rien au portrait de victime qu’on lui a dressé ultérieurement et démontrer en quoi Pinochet ne fut possible que parce que les forces d’"opposition", la gauche bourgeoise, les trotskistes, les staliniens, etc., fournirent un incessant appui au gouvernement d’Allende, un appui tantôt ouvert, tantôt ponctuel, voire critique, mais qui justifia dans tous les cas la répression en oeuvre et permit également d’organiser minutieusement le massacre.
Pour illustrer cela, nous publions donc ici une lettre que les Cordons Industriels, et d’autres structures prolétariennes, ont adressée à Allende le 5 septembre 1973, quelques jours seulement avant le coup d’Etat de Pinochet. Ce document historique constitue une formidable dénonciation du rôle contre-révolutionnaire joué par l’Unité Populaire au Chili (et plus généralement par toutes les "unités populaires" partout dans le monde); il démontre que l’action d’un Pinochet ne peut véritablement avoir lieu que face à une classe ouvrière qui a été désorientée, désorganisée et désarmée politiquement par la gauche démocratique. Cette lettre dénonce par ailleurs les habituels galimatias sur les "généraux traîtres" auxquels nous ont habitués les partis de gauche, et permet d’ancrer les causes fondamentales de la défaite ouvrière au Chili, non pas dans la préparation de la désorganisation des ouvriers par leurs ennemis traditionnels (à quoi peut-on s’attendre d’autre de l’ennemi de classe?!), mais dans leurs propres illusions, dans leur manque total de direction et de perspective communistes. Près de trente ans nous séparent maintenant du coup d’Etat de septembre 1973 et c’est comme si ce document n’avait jamais existé: les forces démocratiques d’opposition ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour l’enterrer, pour effacer de toute mémoire un témoignage accablant sur leur rôle, un document qui dérange, qui remue le couteau dans la plaie.
Avant de commenter ce document, quelques rapides observations sur les Cordons Industriels, signataires de cette lettre adressée à Allende. Que représentaient les Cordons Industriels dont il est ici question? Les Cordons Industriels constituent une réalité double et contradictoire, exprimant, terminologiquement et donc politiquement également, ces contradictions. D’un côté, les Cordons Industriels consistent en l’ensemble des grandes entreprises industrielles (textiles, électroménager...) de Santiago, nationalisées par le gouvernement Allende, et dont ce dernier s’est abondamment servi comme vitrine pour vanter sa propre action. Mais d’un autre côté, les Cordons Industriels constituent également un niveau d’organisation en force du prolétariat semblable à ce que furent les Soviets en Russie, les Conseils en Allemagne, les Shoras en Irak... et qui eut d’autant plus d’importance dans le Chili du début des années ’70 que cette ceinture industrielle de Santiago, dont ces Cordons étaient issus, occupait une place essentielle dans l’économie chilienne.
L’appellation Cordons Industriels recouvre donc, d’une part les 98 entreprises nationalisées par Allende, et d’autre part, une force et une organisation prolétarienne qui coordonne les luttes, qui agit dans la rue, qui présente des revendications au gouvernement, et qui cherche même à imposer certains aspects de la dictature des nécessités prolétariennes contre la dictature du taux de profit.
La gauche bourgeoise cherchera systématiquement à limiter les Cordons Industriels à cette réalité sociologique des "98 entreprises". Les révolutionnaires quant à eux, insisteront sur le fait que, malgré une réalité fort contradictoire -et dont témoigne par exemple le document que nous publions-, l’organisation des prolétaires au sein de ces Cordons déborda du cadre des entreprises dont ils étaient issus, assumant un pouvoir et une centralisation toujours plus territoriale, rassemblant massivement les prolétaires de quartiers ouvriers entiers, et plus globalement tous ceux qui entre 1971 et 1973 prirent position sur les évènements politiques au Chili, en participant activement à la lutte de classe, à l’action directe contre l’ennemi bopurgeois. Il est évident que dans ce texte, lorsque nous parlons des Cordons Industriels, nous en parlons à ce niveau, même s’il est clair, encore une fois, que jamais la contradiction originelle dont il est question ici ne fut totalement surmontée.
Précisons encore que la lettre présentée ici est signée également par d’autres structures prolétariennes (Commando Provincial de Ravitaillement Direct, Front Unique des Travailleurs en conflit) et que si nous publions ce document, ce n’est pas parce que nous adhérons à son contenu, mais parce qu’il résume la tragédie de la classe ouvrière dans le Chili des années ’70, une tragédie qui se perpétuera aussi longtemps que le prolétariat ne barrera pas le chemin à tous les Allende qui, sous d’autres noms, sous d’autres visages, se cachent un peu partout dans le monde, prêts à désarmer le prolétariat s’il relevait la tête. Une situation que les auteurs de la lettre adressée à Allende ont résumé en leur temps par ces mots: "... non seulement on nous entraîne sur le chemin qui nous conduit au fascisme à une allure vertigineuse, mais on nous prive en plus des moyens de nous défendre."
Nous n’adhérons pas au contenu de ce document, disions-nous, parce qu’au delà du témoignage sur le rôle d’Allende et consorts dans le désarmement du prolétariat, les demandes exprimées dans la lettre elle-même attestent plutôt de l’incroyable paralysie qui s’était alors emparée de la classe ouvrière face à un Etat bourgeois qui, sous son visage de gauche, lui ordonnait ni plus ni moins de se replier alors même qu’il préparait le massacre "final" en frappant tous ceux qui luttaient. Ce n’est pas en méconnaissant ou en oubliant de signaler cet ensemble de faiblesses que l’on contribuera à la constitution d’une perspective révolutionnaire. Toutefois, lorsque nous critiquons les illusions et les faiblesses présentes dans ce document, ce sont nos propres illusions et nos propres faiblesses, celles de toute notre classe que nous mettons en évidence, et nous savons que la critique que nous pouvons en faire constitue la condition indispensable de leur dépassement. Loin de nous l’idée de déprécier ici cette tentative de rupture avec les illusions alliendéistes, mais il serait totalement irresponsable de publier ce document émanant de notre classe, sans souligner à quel point l’idéologie bourgeoise au sein de la classe ouvrière -y compris au sein de cette avant-garde que sont les Cordons Industriels- avait alors pris le pas sur l’instinct de classe, et allait permettre de mener des masses de prolétaires, à peine réticents, à leurs bourreaux.
Le 5 septembre 1973, lors de la rédaction de cette lettre, les prolétaires ne doutaient pourtant plus qu’ils allaient au massacre. Ils soupçonnaient bien que la répression qui avait déjà touché d’importants secteurs, se généraliserait à toutes les organisations ouvrières, qu’on était passé d’une situation où un gouvernement au drapeau socialiste "... évolue vers un gouvernement du centre, réformiste, démocratico-bourgeois qui tendrait à démobiliser les masses..." à une situation où régnait "la certitude (d’être) sur la pente qui mènera tout droit au fascisme", "à un régime fasciste de coupe plus implacable et criminelle". Mais malgré cela, malgré cette conscience de l’action contre-révolutionnaire d’un président dont on affirme anticipativement qu’il sera "responsable de mener le pays non pas à la guerre civile qui est déjà en plein développement, mais au massacre froid, planifié de la classe ouvrière", les auteurs de la lettre s’adressent à lui comme à un frère de classe: ils l’appellent CAMARADE Salvador Allende!
Voilà qui résume bien la tragédie de la classe ouvrière au Chili à cette époque: ce sont ceux-là mêmes -partis, syndicats, gouvernement- qui ont amené la classe ouvrière, pieds et poings liés, au milieu de l’arène, qu’on interpelle pour qu’ils agissent contre ceux qui s’apprêtent à lui assener le coup de grâce. Autant demander à ceux qui conduisent les condamnés au peloton d’exécution de prendre des mesures contre ceux qui vont appuyer sur la détente. Le document signale clairement que de la simple méfiance envers toutes ces forces bourgeoises, on est passé à la compréhension du "réformisme" comme étant la voie la plus sûre vers le "fascisme", mais malgré cela, ces forces continuent d’être considérées comme des forces ouvrières.
"Nous, travailleurs, nous ressentons une profonde frustration et du découragement lorsque notre Président, notre Gouvernement, nos Partis, nos organisations nous donnent cent fois l’ordre de nous replier plutôt que de nous ordonner d’avancer". "Maintenant, non seulement, nous, travailleurs, n’avons plus confiance, mais nous sommes alarmés". "Nous sommes absolument convaincus qu’historiquement le réformisme qu’on recherche au travers du dialogue avec ceux qui nous ont trahis tant de fois est le chemin le plus rapide vers le fascisme."
Malgré la conscience du chemin mortel sur lequel on engage le prolétariat, tous ces réformistes continuent d’être considérés comme "des partis prolétariens": les partis de l’Unité Populaire, le gouvernement, les syndicats sont conçus comme les partis des ouvriers et le président lui-même reste le président des travailleurs. Même la Central Unica de Trabajadores (CUT - Centrale Unique des Travailleurs) continue à être considérée comme "le plus grand organisme" de la classe ouvrière. Au Chili, tout le monde sait pourtant que la principale fonction de cette organisation a toujours été de contenir les luttes ouvrières en fonction des nécessités de valorisation du capital, et que c’est au nom des intérêts de la patrie chilienne (le cuivre chilien!) qu’elle appelait à travailler plus tout en gagnant moins. Mais malgré cela, la CUT -qui ira même jusqu’à intégrer le Cabinet Civil/Militaire où siégent les généraux de l’armée chilienne qui perpétueront le massacre-, continue à être considérée comme "el organismo máximo" de la classe ouvrière!
Le tableau est donc profondément tragique. Même ceux qui ont pour seule référence les commentaires actuels de la presse officielle comprendront en lisant ce texte à quel point le déroulement ultérieur des événements au Chili dérivent directement de la désorientation totale du prolétariat, incapable désormais de se forger sa propre voie. Il faut se resituer le contexte de l’époque. En septembre 1973, ce qu’on a devant les yeux au Chili, c’est une classe ouvrière qui reconnait déjà que "ce qui manqua... ce fut la détermination, la détermination révolutionnaire..., ce qui manqua, ce fut une avant-garde décidée et hégémonique" mais qui, face à ce manque, demande au Président de la guider. Une classe ouvrière qui n’a plus aucune confiance dans les forces populistes de la bourgeoisie mais qui, comme tant d’autres fois dans l’histoire, ne parvient pas à construire sa propre force. Une classe ouvrière qui, au plus profond de sa tragédie, d’une tragédie non pas chilienne mais internationale, n’a pas de programme propre (ou plutôt ignore totalement son programme) et exige l’application d’un programme qu’elle nomme "programme minimum", c’est-à-dire le programme bourgeois de l’Unité Populaire.
Le Chili de 1973 ne fut pas seulement témoin d’un massacre conditionné par les radotages sur "l’expérience pacifique de la construction du socialisme"; il fut également le théâtre de la réalisation intégrale de la théorie de l’appui critique, du front unique, du gouvernement ouvrier, du contrôle ouvrier... et ce, jusque dans ses ultimes conséquences: la destruction de toute organisation ouvrière. Indépendamment de l’importance relativement faible dont jouissait alors le trotskisme au Chili, indépendamment de la rupture formelle entre le MIR (Mouvement de la Gauche Revolutionnaire) et la Quatrième Internationale, l’idéologie qui barra le chemin au prolétariat et permit de retenir sur le terrain du réformisme ceux qui désiraient le quitter, était une idéologie à tout point identique à celle propre au trotskisme international. Ainsi, si au sein des Cordons Industriels personne ne croyait au passage pacifique au socialisme (à l’exception des agents de l’Etat infiltrés dans les rangs ouvriers), on pensait par contre qu’il fallait continuer à appuyer de façon critique un gouvernement considéré comme "ouvrier" par les uns, comme "populaire" par les autres. Et plus le prolétariat tentait d’échapper au contrôle que l’Etat bourgeois exerçait sur lui -comme tant d’autre fois dans l’histoire- plus le discours du centrisme se radicalisait, plus une gauche se développait au sein de chaque parti bourgeois, en invoquant en choeur "l’appui critique", "le contrôle ouvrier", etc. Dans toutes leurs variantes, les gauches socialistes, chrétiennes, celles de la MAPU, etc. se fortifiaient et convergeaient vers ces idéologies en radicalisant toutes les nuances du "soutien critique" ou du "contrôle ouvrier", positions qui, par le passé, étaient l’apanage du seul MIR. La lecture du document qui suit ne laisse aucun doute quant au fait que cette idéologie radicale de la bourgeoisie constitua une force décisive empêchant le prolétariat d’attaquer l’Etat bourgeois.
Afin que ceux qui n’ont pas vécu "l’expérience chilienne" ou qui n’en ont entendu que les versions construites pour la postérité par la bourgeoisie chilienne (social-démocrates, "communiste", trotskiste, maoïstes, Miriste, du MAPU, etc.) et répercutées par la suite dans le monde entier; afin que ces lecteurs donc, puissent saisir le mieux possible le document qui suit et les raisons qui menèrent à cette absurde "exigence" envers le sommet de l’Etat bourgeois de prendre les mesures nécessaires pour "transformer les institutions actuelles de l’Etat de façon à ce que les travailleurs et le peuple exercent réellement le pouvoir", il nous faut revenir quelque peu en arrière. C’est vrai qu’en septembre 1973, le sort de la classe ouvrière au Chili est tranché: sa faiblesse est imposante et le massacre qu’elle subira en sera la conséquence directe. Mais il n’en pas toujours été ainsi. Avant septembre 1973, la lutte du prolétariat au Chili a connu des moments déterminants durant lesquels la répression de gauche comme de droite, la répression de l’ensemble de l’Etat bourgeois se révèla totalement insuffisante, parce que la classe ouvrière traçait sa propre voie. Et c’est précisément à ce moment-là que le centrisme, avec sa classique politique contre-révolutionnaire d’"appui critique" patronnée par le MIR, et le guérillérisme en général (cf. les conseils et discours de Fidel Castro), passa réellement au premier plan et constitua l’ultime barrière de l’enclos dans lequel le prolétariat avait été conduit par le réformisme.
Ainsi, chaque fois que la réalité de la lutte de classe éclatait au grand jour, chaque fois que l’inévitable alternative terrorisme bourgeois ou destruction de l’Etat bourgeois et dictature du prolétariat émergeait socialement (la deuxième proposition supposant évidemment la liquidation en premier lieu du gouvernement d’Allende et de l’armée bourgeoise) les idéologues de l’appui critique apparaissaient sur le devant de la scène en proposant une troisième voie: organisation et armement du prolétariat, non pas pour affronter la bourgeoisie et son Etat... mais pour exiger du gouvernement qu’il respecte le programme "socialiste" (sic), pour exercer le contrôle ouvrier sur la production et la distribution puisque c’est ainsi qu’on obtient "des parts significatives de pouvoir" (sic) et pour se défendre des attaques de la bourgeoisie (pour ces messieurs, la bourgeoisie est synonyme de droite) qui tente d’empêcher que ce programme soit appliqué. L’idéologie de cette prétendue troisième voie (qui en réalité conduit inévitablement au maintien de la dictature de la bourgeoisie et à la terreur blanche) paralysera les tentatives les plus décidées de l’avant-garde ouvrière au Chili, des tentatives qui, sous le gouvernement Allende, se concentrent sur l’année 1972, et plus particulièrement à partir du 11 octobre 1972 lorsque les Cordons Industriels se développent en réponse à la situation catastrophique à laquelle le capital en crise et la répression étatique soumet la classe ouvrière, une situation encore aggravée à cette date par la grève des commerçants, des transporteurs et des membres des professions libérales impulsée par la "droite" (2).
En 1972, les luttes s’enflamment donc face une bourgeoisie qui, d’un coté, appelle à travailler plus pour la patrie chilienne et les transformations "socialistes" et, de l’autre, coupe au prolétariat ses moyens de subsistance. Comme à chaque fois que le capitalisme est en crise, la droite et la gauche s’opposent quant à leurs intérêts de fractions mais se complètent pour imposer l’augmentation du taux d’exploitation: travailler plus et manger moins. Et, comme dans toute circonstance similaire, les luttes ouvrières contre la bourgeoisie et la répression de l’Etat bourgeois s’accentuent. L’Etat chilien, avec Frei à sa tête, avec Allende ou plus tard avec Pinochet, suit cette ligne d’action inhérente à son essence (il ne peut en être autrement, que le président soit "fasciste" ou "socialiste"). L’Etat bourgeois, déguisé en "communiste", "socialiste", "alliendéiste" tente de résoudre la profonde crise que traverse l’économie chilienne par l’augmentation du taux d’exploitation, les nationalisations et le verbiage socialiste. Il n’hésite pas non plus à réprimer toute lutte ouvrière contre l’exploitation: depuis le début du "gouvernement des travailleurs", les luttes des sans-abris, des mineurs,... ont toutes été écrasées. Les partis du gouvernement, ainsi qu’Allende, dénoncent chaque lutte ouvrière comme une provocation et accusent les ouvriers réclamant des payes plus élevées d’appartenir à l’"aristocratie ouvrière" (les mineurs du cuivre, par exemple). Ils tentent de circonscrire les responsabilités à chacun des faits de répression. Les justifications abondent pour défendre les différents partis au gouvernement: "ils ne pouvaient contrôler les corps répressifs, ils ne sont pas responsables des excès des corps de gendarmerie et services de renseignements". C’est donc toujours la même histoire: le président ne savait pas, le ministre de l’intérieur non plus, le P.C. n’était pas impliqué, le P.S. ignorait que les policiers des services de renseignements torturaient, etc. etc.
Mais en cette année 1972, l’exacerbation de la lutte de classe ainsi que la répression étatique et para-étatique contrarient cette opération de camouflage de la réalité. Il apparaît alors au grand jour que tortures et assassinats d’ouvriers ne sont pas uniquement le fait de "Patrie et Liberté", du Parti National, de PROTECO (Protection de la Communauté) ou de la Démocratie Chrétienne, etc. mais aussi des partis du gouvernement. Lors de chaque intervention des forces de gendarmerie et des services de renseignements contre des groupes d’ouvriers, des dirigeants de l’Unité Populaire, du Parti "Communiste" et du Parti "Socialiste" sont identifiés. Allende continue à demander aux prolétaires de travailler plus, "de définir, produire et avancer"; tandis que, dans les bâtiments des services de renseignements, ses collaborateurs, des dirigeants tels Carlos Toro ou Eduardo Paredes (3) procèdent aux interrogatoires d’ouvriers dont ils couvrent le visage et qu’ils soumettent à l’électricité, aux coups, à la suffocation par noyade,... (peu après Pinochet élargira ces installations). Les opérations anti-ouvrières des services de renseignements et de la gendarmerie ne cesseront de s’amplifier durant l’année ’72. L’une de ces opérations, gravée dans les mémoires, fut l’attaque des campements des sans-abri de Lo Hermida (une concentration de 8 campements prolétariens). Une nuit, des tanks de la gendarmerie, des fourgons du Groupe Mobile, des patrouilleuses, des camionnettes, etc. entrèrent à Lo Hermida et attaquèrent quelques 45.000 personnes (5 campements). Ils avançaient en s’éclairant avec des feux de Bengale. Au bruit des rafales de mitraillette et à l’éclat de bombes lacrymogènes tirées dans les maisons se mélangeaient les appels à soutenir le gouvernement d’Allende lancés depuis des voitures munies de hauts-parleur. Impossible de dissimuler les résultats de cette opération: un ouvrier mort, des enfants ayant des lésions provoquées par les gaz, des centaines d’interrogatoires, etc. Les déclarations des habitants (y compris les alliendéistes) furent formelles: "En 1970 nous sommes arrivés sur ces terrains... jamais nous n’avons imaginé que ce que nous n’avions pas eu avec Frei et Alessandri, on allait l’avoir avec le camarade Allende", "Ce qui s’est passé ici, c’est un massacre. Les morts sont des camarades qui habitaient ici. Les blessés et les humiliés sont des hommes, des femmes et des enfants de nos campements, ce que la force policière a fait à Lo Hermida est un assassinat contre le peuple". "Nous, aujourd’hui, c’est avec douleur, avec peine, avec rage que nous disons que ce gouvernement s’est sali les mains avec le sang de ceux-là même qui allèrent tracer une croix sur le bulletin de vote pour donner la victoire au gouvernement d’Unité Populaire. Désormais nous n’irons plus jamais soutenir le réformisme. Nous irons risquer notre peau, nous montrerons que nous, habitants sacrifiés, offensés, morts, criblés de balles, nous avons un autre tempérament et une autre détermination". Personne ne pourra empêcher ces prolétaires d’assumer désormais les conséquences militantes des leçons qu’ils tirent lors de ces expériences. Personne ne pourra les empêcher de se préparer à un affrontement plus fondamental. Personne, sauf les tenants de l’appui critique, ultime rempart de la contre-révolution.
Le journal Punto Final ("Point Final", une revue du MIR) orchestre cette campagne. Il dénonce les faits, en rejette la faute sur le réformisme et le désigne pour ce qu’il est: contre-révolutionnaire (4). Il défend donc d’abord quelques positions ouvrières élémentaires et prend pour point de départ les nécessités du prolétariat. Mais dès qu’il s’agit d’en tirer les conclusions, il s’oppose de la façon la plus ferme à ce qui constitue l’unique porte de sortie pour le prolétariat (affronter l’ensemble de la contre-révolution tant fasciste que réformiste), et prône cette fameuse troisième voie. "Ce gouvernement a deux possibilité: être avec le peuple ou être son assassin", déclare-t-il, présentant ainsi le sommet de l’Etat bourgeois comme neutre, et ses mandataires comme étant tout à fait capables de passer du côté ouvrier "parce que l’objectif stratégique des travailleurs ne rompt pas avec un gouvernement qui, c’est sûr, peut, si on le lui propose, remporter le mérite honorable d’abréger la lutte historique de la classe ouvrière chilienne." (5) Le problème pour cette force trotskisante qui s’exprime dans Point Final se réduit donc à "châtier les coupables" et surtout à défendre le régime: "... les visites mutuelles entre La Moneda (le palais présidentiel -NDR) et Lo Hermida (le quartier ouvrier saccagé -NDR) ont ouvert une nouvelle perspective au problème. La suspension de leurs charges du Directeur et du sous-directeur des services de renseignements a également contribué à montrer que le Président Allende (sic) était ouvertau dialogue avec les habitants (de Lo Hermida -NDR) qui exigeaient des sanctions contre les responsables (sic)." (6)
Les membres du MIR et les différents groupes gauchistes s’affichent quant à eux ouvertement pro-Allende: "Nous connaissons Allende et, si nous sommes en désaccord avec plusieurs de ses points de vue, pour ne pas dire avec tous, il y a des questions fondamentales que nous lui reconnaissons. En premier lieu, la cohérence entre ce qu’il pense, dit et fait. Ensuite, son courage personnel. Enfin une trajectoire politique incompatible avec la répression du peuple (sic) . C’est pourquoi nous pensons qu’Allende fut certainement (sic) le premier surpris (sic) et peut-être le plus fortement touché (sic) par la sauvage répression qui s’est déchaînée sur ce campement (sûrement pas plus que les habitants eux-même -NDR). Le presse de droite (sic) a essayé de lui faire porter la responsabilité de ce qui s’est passé dans une tentative d’assimiler son gouvernement aux précédents régimes répressifs anti-populaires (sic)." (7)
En lisant la lettre des Cordons Industriels, il faut absolument garder en tête le déroulement de ces événements et ne pas perdre de vue le type de prises de positions qu’ils ont suscité, et que nous rappelons ici. La situation imposée par la bourgeoisie était telle que toute attaque ouvrière contre le sommet de l’Etat bourgeois était considérée comme "de droite" et faisant le jeu de l’impérialisme. Il s’agit là d’une manoeuvre classique de la bourgeoisie pour attaquer les révolutionnaires, mais ce qui fut impressionnant dans ce cas-ci c’est la généralisation de ce mythe à l’ensemble de la société chilienne: en lui était contenue la défaite du prolétariat.
Revenons au mois d’octobre 1972. La situation du prolétariat est devenue véritablement intolérable. Le manque d’approvisionnement des articles indispensables à la survie (imposé par la "droite") est effrayant. Jamais on n’a vécu une situation aussi catastrophique, jamais on n’a travaillé autant (grâce à la "gauche") pour aussi peu. Ainsi, si les luttes ouvrières se succèdent à cette période, ce n’est pas, comme l’affirme l’histoire officielle et para-officielle, grâce au progressisme du gouvernement populaire, mais bien parce que la situation est insupportable et que ni la "droite" ni la "gauche" ne sont encore parvenue à désorganiser totalement le prolétariat, à le mettre à genou afin de lui assener le coup "final". Un peu partout se développent des organismes de base à centralisation territoriale, des associations d’ouvriers en lutte, des commandos de campements, des regroupements de voisins, des centres de mères, des organismes réunissant les artisans, les étudiants, etc., autant d’organisations qui composent des Conseils de Travailleurs sous diverses dénominations telles Conseils de Coordination Communale, Commandos Communaux des Travailleurs, Cordons Industriels (8). Le prolétariat n’a qu’un seul but: liquider les responsables de cet état de fait insupportable et prendre la direction de la situation. La question du pouvoir est posée. C’est un moment crucial. Le gouvernement, considérant la conjoncture extrêmement périlleuse, y répond en formant le Cabinet Civil/Militaire auquel se réfère le document que nous publions ci-après. Le MIR (9) et toutes les forces qui soutiennent de fait cette organisation prennent alors le devant de la scène. Ils exaltent les organismes cités plus haut, impulsent les conseils de coordination. Les consignes d’armement sont plus suivies que jamais. Bref, le MIR et cie soutient que le moment est venu de défaire le "pouvoir bourgeois", se plaçant ainsi à la tête du processus mais, comme toujours, pour le contenir dans l’appui critique. Une fois de plus, on prend un ensemble de positions ouvrières pour conduire le prolétariat dans un cul-de-sac, dans l’impasse de l’appui critique aux ennemis les mieux dissimulés, afin de l’amener progressivement à défendre l’Etat bourgeois.
Le 7 novembre 1972, le journal Point Final titre en tous gros caractères: "Abattons le pouvoir bourgeois MAINTENANT", ce qui peut passer pour une consigne insurrectionnelle si l’on ignore que par "pouvoir bourgeois", le MIR et les forces qui le soutiennent entendent quelque chose de bien moindre que "l’Etat bourgeois". Plus que jamais, ils soutiendront que le gouvernement cherche à réaliser le socialisme, mais que la bourgeoisie l’en empêche, que l’armée ne s’est pas encore prononcée, qu’elle devra choisir. "Le gouvernement du Président Allende s’est engagé vis-à-vis du peuple (sic) à mener à bien un programme qui signifie, textuellement, entamer la construction du socialisme, dans notre patrie (sic). C’est précisément l’accomplissement de cet objectif que la bourgeoisie tente d’empêcher." (10) Commentant l’entrée des Généraux dans les ministères, Punto Final écrit: "Les Forces Armées, malgré leur désir de maintenir une neutralité qui ne correspond pas aux caractéristiques du processus chilien (sic), se verront obligées de choisir. Leur participation au gouvernement de l’Union Populaire donne aux officiers (sic) et aux soldats l’occasion de se joindre à l’historique mission des travailleurs... Les Forces Armées ont un rôle véritablement patriotique et démocratique à jouer aux côtés du peuple (c’est effectivement leur rôle, NDR) en appuyant les travailleurs dans leur lutte contre l’exploitation de la bourgeoisie (sic) ... Seuls les faits pourront confirmer (sic) ou mettre l’accent sur cette possibilité. Seul le côté qu’elles choisiront dans la lutte de classes (sic) permettra de connaître le sens de l’entrée des Forces Armées sur la scène politique." (11) Donc, maintenant, non seulement le gouvernement ne fait plus partie de l’Etat bourgeois, mais en plus il ne faut plus détruire l’armée puisqu’elle peut faire le choix de servir les travailleurs!
Mise en avant de besoins ouvriers comme point de départ, utilisation d’un langage quasiment "insurrectionnel" pour défendre au mieux la contre-révolution, c’est tout ce courant trotskisant d’appui "critique" qui s’imposera dans les Cordons Industriels, liquidant toute initiative classiste, toute possibilité de passage à l’offensive ouvrière. Ce courant politique international intrinsèquement contre-révolutionnaire dirigera les Cordons Industriels non pas vers l’attaque de l’Etat bourgeois mais vers l’autogestion: "Dès que ces organismes assument de tâches concrètes -en ce qui concerne l’approvisionnement en aliments, les transports, la santé, la production et l’éventuelle défense face au fascisme, ils prennent en mains une part significative du pouvoir." (12) Un mensonge réactionnaire de plus qui fut décisif également dans l’Espagne insurgée des années ‘34-’37: jamais le prolétariat ne pourra diriger la société ni même avoir des "parts de pouvoir" sans attaquer et détruire simultanément l’Etat bourgeois (ce qui est par ailleurs, l’unique possibilité de résoudre véritablement le manque de ravitaillement). Mais c’est ce mensonge de la contre-révolution -"les parts de pouvoir"- qui s’imposera et conduira les prolétaires à la désorientation et aux massacres de 1973 et des années qui suivirent. Le "contrôle ouvrier" aura ainsi sauvé la bourgeoisie d’une situation périlleuse et lui aura permis de préparer minutieusement le massacre.
Pour définir de façon générale l’action des classes sociales sous le capitalisme, on pourrait dire que pendant que la bourgeoisie s’occupe de ses entreprises et les surveille, le prolétariat quant à lui prépare sa guerre. Au Chili, à mesure que l’idéologie du contrôle ouvrier s’impose et "que des parcelles de pouvoir" sont "conquises", c’est tout le contraire qui se produit: tandis que les ouvriers sont poussés à surveiller les entreprises capitalistes (cf les "Comités de Vigilance"), la bourgeoisie mène à bien sa guerre et prépare le massacre. Au Chili, la bourgeoisie a gagné la guerre à la fin 1972 et au début de 1973, en ayant recours à la dispersion et à la désorganisation plus qu’aux balles, de sorte qu’à la fin de l’année 1973, il ne lui reste plus qu’à parachever sa victoire en passant au massacre. Comme de coutume, de nombreux défenseurs de l’Etat chilien et de l’alliendisme périrent dans ce massacre. Ce n’est guère là une exception: chaque fois que la répression anti-ouvrière se généralise, elle frappe également certaines fractions du capital. Nous n’avons aucune raison de regretter ceux qui demeurent nos ennemis, même s’ils se sont trouvés ensuite dans l’opposition. Quant à nos morts, il nous semble plus important de préparer la force de classe qui les vengera que de les pleurer. Et pour ce faire, il n’y a pas d’autre moyen que de continuer à lutter contre le capital partout dans le monde, en cherchant à générer cette direction communiste qui fit tellement défaut au Chili en 1973 et qui continue de manquer aujourd’hui dans le monde entier.
L’incroyable falsification actuelle de l’histoire autour du spectacle Pinochet, la façon dont on cherche à blanchir aujourd’hui le rôle déterminant de la gauche et des gauchistes dans la responsabilité de la défaite du prolétariat au Chili en 1973 démontre l’urgence et l’importance de la republication de documents tels celui des Cordons Industriels. Plus que jamais, nous avons énormément à apprendre de l’histoire de notre classe, et cette réappropriation est indispensable à sa victoire.
A SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE
CAMARADE ALLENDE
Voici venu le moment où la classe ouvrière organisée au sein de la Coordination Provinciale des Cordons Industriels, du Commando Provincial de Ravitaillement Direct et du Front Unique des Travailleurs en conflit, considère urgent de s’adresser à vous, alarmée par le déclenchement d’une série d’événements qui, selon nous, nous mènera non seulement à la liquidation du processus révolutionnaire chilien mais, à court terme, à un régime fasciste de coupe plus implacable et criminelle.
Auparavant, nous craignions que le processus vers le socialisme n’évolue vers un gouvernement du centre, réformiste, démocratico-bourgeois qui tendrait à démobiliser les masses ou à les mener à des actions insurrectionnelles de type anarchiques par pur instinct de conservation.
Mais désormais, après avoir analysé les derniers événements, notre crainte n’est plus celle-là; désormais, nous avons la certitude que nous sommes sur la pente qui nous mènera tout droit au fascisme.
C’est pourquoi nous allons énumérer pour vous les mesures que, en tant que représentants de la classe travailleuse, nous considérons indispensables de prendre.
En premier lieu, camarade, nous exigeons l’application du programme de l’Unité Populaire. Nous autres, en 1970, nous n’avons pas voté pour un homme, nous avons voté pour un programme.
Curieusement, le premier chapitre du programme de l’Unité Populaire s’intitule "Le Pouvoir Populaire". Nous citons, page 14 du programme:
..."les transformations révolutionnaires dont le pays a besoin ne pourront être réalisées que si le peuple prend le pouvoir entre ses mains et l’exerce réellement et effectivement"...
... "Les forces populaires et révolutionnaires ne se sont pas unies pour lutter pour la simple substitution d’un président de la République par un autre, pour remplacer un parti par un autre au gouvernement, mais pour mener à bien les changements de fond exigés par la situation nationale sur base du transfert du pouvoir des anciens groupes dominants aux travailleurs, à la paysannerie et aux secteurs progressistes des couches moyennes"..."Transformer les institutions actuelles de l’Etat de façon à ce que les travailleurs et le peuple exercent réellement le pouvoir"...
..."Le gouvernement populaire fondera essentiellement sa force et son autorité sur l’appui que lui offrira le peuple organisé"...
...page 15... "A travers une mobilisation des masses se construira, depuis les bases, la nouvelle structure du pouvoir"...
On parle d’un programme, d’une nouvelle constitution politique, d’une Chambre unique, de l’Assemblée du Peuple, d’un Tribunal Suprême avec membres désignés par l’Assemblée du Peuple,... Dans ce programme on indique qu’on rejettera l’utilisation des Forces Armées pour réprimer le peuple" (p.24)
Camarade Allende, si l’on ne vous disait pas que ces phrases sont citées du programme de l’Unité Populaire qui était un programme minimum pour la classe, dans de pareilles circonstances, vous nous diriez qu’il s’agit là du langage "ultra" des Cordons Industriels.
Mais nous demandons: où est le nouvel Etat? la nouvelle Constitution politique, la Chambre unique, l’Assemblée Populaire, les Tribunaux Suprêmes?
Trois ans se sont écoulés, camarade Allende, vous ne vous êtes pas appuyé sur les masses, et aujourd’hui, nous, les travailleurs, nous sommes méfiants.
Nous, travailleurs, nous ressentons une profonde frustration et du découragement lorsque notre Président, notre Gouvernement, nos Partis, nos organisations nous donnent cent fois l’ordre de nous replier plutôt que de nous ordonner d’avancer. Nous exigeons non seulement qu’on nous informe, mais aussi qu’on nous consulte sur les décisions qui en fin de compte sont déterminantes pour notre destin.
Nous savons que dans l’histoire des révolutions il y eut des moments pour se replier et d’autres pour avancer; mais nous savons, nous avons la certitude absolue que durant ces trois dernières années nous aurions pu gagner non seulement des batailles partielles mais également la lutte totale; nous aurions pu prendre en ces occasions des mesures qui auraient rendu le processus irrévocable, après le triomphe de l’élection des dirigeants de 1971, le peuple réclamait un plébiscite et la dissolution d’un Congrès antagonique.
En octobre, lorsque la volonté et l’organisation de la classe ouvrière maintinrent le pays en marche contre la grève patronale; lorsque, dans le feu de la lutte naquirent les Cordons Industriels et que la production, le ravitaillement, les transports furent maintenus grâce au sacrifice des travailleurs et que la bourgeoisie fut frappée d’un coup mortel, vous, vous ne nous avez pas fait confiance. Bien que personne ne puisse nier l’immense potentialité révolutionnaire démontrée par le prolétariat, vous avez donné comme issue une véritable gifle à la classe ouvrière, instaurant un Cabinet Civil/Militaire avec, comme circonstance aggravante, le fait d’y inclure deux dirigeants de la Centrale Unique des Travailleurs (CUT) qui, en acceptant d’intégrer ces Ministères firent perdre à la classe travailleuse la confiance qu’elle avait dans son plus grand organisme (organismo máximo) (13).
Organisme, qui quelque fut le caractère du gouvernement, devait se maintenir en marge de celui-ci et empêcher la moindre de ses faiblesses à l’égard des problèmes des travailleurs.
Malgré le reflux et la démobilisation que tout cela produisit, malgré l’inflation, les queues et les mille difficultés que les hommes et les femmes du prolétariat vivaient quotidiennement, lors de élections de mars ’73, ils firent preuve une fois de plus de clarté et de conscience en donnant 43% de votes militants aux candidats de l’Unité Populaire.
Ici aussi, camarade, il aurait fallu prendre les mesures que le peuple méritait, méritait et exigeait pour le protéger du désastre que nous pressentons maintenant.
Et déjà le 29 juin, lorsque les généraux et les officiers séditieux, alliés au Parti National, Frei et Patrie et Liberté se placèrent franchement en position d’illégalité, on aurait pu décapiter les séditieux et, s’appuyant sur le peuple et en donnant la responsabilité à des généraux loyaux et aux forces qui alors vous obéissaient, on aurait pu mener le processus à la victoire, on aurait pu passer à l’offensive.
Ce qui manqua alors, à chaque occasion, ce fut la détermination, la détermination révolutionnaire; ce fut la confiance dans les masses; ce fut la connaissance de leur organisation et de leur force; ce qui manqua, ce fut une avant-garde décidée et hégémonique.
Maintenant, non seulement, nous, travailleurs, n’avons plus confiance, mais nous sommes alarmés.
La droite a monté un appareil terroriste si puissant et bien organisé qu’il ne fait aucun doute qu’il est financé et dirigé par la CIA. Ils tuent des ouvriers, font sauter des oléoducs, des autobus, des chemins de fer.
Ils produisent des pannes de courant dans deux ou trois provinces, font des attentats contre nos dirigeants, contre les locaux de nos partis et des nos syndicats.
-Les punit-on, sont-il incarcérés?
-Non, camarade.
-On punit et on incarcère les dirigeants de gauche.
Les Pablo Rodriguez, les Benjamin Matta confessent ouvertement avoir participé au "tanquetazo" (14).
-Sont-ils écrasés, humiliés?
-Non, camarade.
On perquisitionne Lanera Austral de Magallanes en même temps qu’on assassine un ouvrier, et que l’on garde des travailleurs couchés sur le ventre dans la neige pendant de heures et des heures.
Les transporteurs paralysent le pays, laissant des foyers humides sans chauffage, sans aliments, sans médicaments.
-Est-ce qu’on le brime, est-ce qu’on les réprime?
-Non, camarade.
On brime les ouvriers de Corre Cerrillos, de Indugas, de Cemento Melon, des Cervecerias Unidas.
Frei, Jarpa et leurs comparses financés par ITT appellent ouvertement à la sédition.
-Est ce qu’on les écarte, est-ce qu’on porte plainte?
-Non, camarade.
On porte plainte, on demande la mise au ban de Palestro, d’Altamirano de Garretón, de ceux qui défendent les droits de la classe ouvrière.
Le 29 juin, des généraux et des officiers se sont soulevés contre le gouvernement, mitraillant pendant des heures le Palais de la Moneda, faisant 22 morts.
-Les a t’on fusillés, les a t’on torturés?
-Non, camarade.
On torture de façon inhumaine les marins et les sous-officiers qui défendent la constitution, la volonté du peuple, et vous-même, camarade Président.
Patrie et Liberté incite au coup d’Etat.
-Les emprisonne t’on, les punit-on?
-Non camarade.
Ils continuent à donner des conférences de presse, on leur donne des sauf-conduits pour qu’ils conspirent à l’étranger.
Pendant ce temps, on écrase SUMAR, où meurent les ouvriers et les habitants, et on soumet les paysans de Cautín aux châtiments les plus implacables, les promenant en hélicoptères, attachés par les pieds, au-dessus des têtes de leurs familles, jusqu’à ce qu’ils meurent.
On vous attaque vous, camarade. On attaque nos dirigeants, et à travers eux les travailleurs dans leur ensemble, de la façon la plus insolente et la plus libertine grâce aux millions dont dispose la droite pour ses moyens de communication.
-Est-ce qu’on les détruit, est-ce qu’on les réduit au silence?
-Non, camarade.
On réduit au silence et on détruit les moyens de communications de gauche, Canal 9 à la télévision, la dernière possibilité de faire entendre la voix des travailleurs.
Et le 4 septembre, troisième anniversaire du gouvernement des travailleurs, alors que nous, le peuple, étions 1.400.000 à vous saluer, à montrer notre détermination et notre conscience révolutionnaire, la FACH écrasait MADEMSA, MADECO, RITTIG lors d’une provocation des plus insolentes et inacceptables, sans qu’il y ait aucune réponse visible.
Pour toutes les raisons invoquées ici, camarade, nous, les travailleurs, sommes d’accord sur un point avec Monsieur Frei: ici, il n’y a que deux alternatives: la dictature du prolétariat ou la dictature militaire.
Bien sûr, monsieur Frei est également un peu naïf parce qu’il croit que cette dictature militaire sera seulement transitoire et le mènera en fin de compte à la présidence.
Nous sommes absolument convaincus qu’historiquement le réformisme qu’on recherche au travers du dialogue avec ceux qui nous ont trahis tant de fois est le chemin le plus rapide vers le fascisme
Et nous, les travailleurs, nous savons ce qu’est le fascisme.
Jusqu’il y a peu ce n’était qu’un mot que nous ne comprenions pas tous, et pour lequel nous devions chercher des exemples lointains, le Brésil, l’Espagne, l’Uruguay, etc.
Mais nous l’avons maintenant vécu dans notre propre chair, dans les perquisitions, dans ce qui arrive aux marins et aux sous-officiers, dans ce que souffrent les camarades de ASMAR, FAMAE, les paysans de Cautín.
Nous savons maintenant que le fascisme signifie en finir avec toutes les conquêtes obtenues par la classe ouvrière, les organisations ouvrières, les syndicats, le droit de grève, les pétitions.
Le travailleur qui réclame ses droits humains minimaux est licencié, emprisonné, torturé ou assassiné.
Nous considérons non seulement qu’on nous entraîne sur le chemin qui nous conduit au fascisme à une allure vertigineuse, mais on nous prive en plus des moyens de nous défendre.
C’est pourquoi nous exigeons de vous, camarade Président, que vous vous mettiez à la tête de cette véritable armée sans armes mais puissante quant à la conscience et la détermination, nous exigeons que les partis prolétariens mettent sur le côté leurs divergences et se transforment en véritable avant-garde de cette masse organisée mais sans direction.
Nous exigeons:
1° Face à la grève des transporteurs, la réquisition immédiate des camions, sans remboursement, par les organismes de masses et la création d’une entreprise étatique des transports pour que ces bandits n’aient plus jamais entre les mains la possibilité de paralyser le pays.
2° Face à la grève criminelle du Collège Médical, nous exigeons qu’on leur applique la Loi de la Sécurité Intérieure de l’Etat afin que la vie de nos femmes et de nos enfants ne soit jamais plus entre les mains de ces mercenaires de la santé. Tout le soutien aux médecins patriotes.
3° Face à la grève des commerçants, qu’on ne refasse pas l’erreur d’octobre où nous avons clarifié que nous n’en avions pas besoin comme corporation. Qu’on mette un terme à la possibilité pour ces trafiquants, alliés aux transporteurs, de prétendre assiéger le peuple par la faim. Que s’établissent une fois pour toutes la distribution directe, les magasins populaires, le panier populaire. Que passent dans le domaine social les industries alimentaires qui ne sont pas encore entre les mains du peuple.
4° Dans le domaine social, qu’on ne rende aucune des entreprises où existe la volonté majoritaire des travailleurs d’en garder le contrôle, et que celles-ci passent dans le domaine prédominant de l’économie. Qu’on fixe une nouvelle politique des prix. Que la production et la distribution des industries du domaine social soient dissociée. Suppression de la production de luxe pour la bourgeoisie. Qu’on exerce un véritable contrôle ouvrier dans ces entreprises.
5° Nous exigeons qu’on déroge à la Loi de Contrôle des Armes, nouvelle "loi maudite", qui n’a servi qu’à humilier les travailleurs avec les perquisitions pratiquées dans les industries et les bidonvilles, et qui fait office de répétition générale pour les secteurs séditieux des Forces Armées, en leur permettant d’étudier ainsi l’organisation et la capacité de réponse de la classe ouvrière, dans une tentative pour l’intimider et identifier ses dirigeants.
6° Face à la répression inhumaine des marins du Valparaiso et du Talcahuano, nous exigeons la liberté immédiate de ces héroïques frères de classe dont les noms sont déjà gravés dans les pages de l’histoire du Chili. Qu’on identifie et qu’on punisse les coupables.
7° Face à la torture et à la mort de nos frères paysans de Cautín, nous exigeons un jugement public et le châtiment correspondant pour les responsables.
8° Pour tous ceux qui sont impliqués dans les tentatives de faire tomber le gouvernement légitime, la peine maximale.
9° En ce qui concerne le conflit de Canal 9 à la télévision, que ce moyen de communication des travailleurs ne soit ni remis ni fermé sous aucun prétexte.
10° Nous protestons contre la destitution du camarade Jaime Faivovich, sous-secrétaire des Transports.
11° Nous demandons qu’à travers votre propre appui, s’exprime tout notre soutien à l’ambassadeur de Cuba, le camarade Mario García Incháustegui, ainsi qu’à tous les camarades cubains persécutés par la réaction la plus experte, et qu’on leur offre nos quartiers prolétariens pour y établir leur ambassade et leur résidence en remerciement à ce peuple qui a été jusqu’à se priver de sa propre ration de sucre pour nous aider dans notre lutte. Qu’on expulse l’ambassadeur nord-américain par l’intermédiaire duquel le Pentagone, la CIA et ITT fournissent des instructeurs et du financement aux séditieux.
12° Nous exigeons la défense et la protection de Carlos Altamirano, Mario Palestro, Miguel Enriquez, Oscar Garretón, persécutés par la droite et le Ministère de la Marine parce qu’ils défendent vaillamment les droits du peuple avec ou sans uniforme.
Nous vous avertissons, camarade, avec le respect et la confiance que nous avons encore, que si vous n’accomplissez pas le programme de l’Unité Populaire, si vous ne faites pas confiance aux masses, vous perdrez le seul soutien réel que vous avez comme personne et comme gouvernant et vous serez responsable d’avoir mené le pays non pas à la guerre civile qui est déjà en plein développement, mais au massacre froid, planifié de la classe ouvrière la plus consciente et la plus organisée d’Amérique latine; [nous vous avertissons] que ce gouvernement, porté au pouvoir et maintenu au prix de tant de sacrifices consentis par les travailleurs, les habitants des bidonvilles, les paysans, les étudiants, les intellectuels, les membres des professions libérales, portera la responsabilité historique d’avoir détruit et décapité, qui sait dans quel délai et à quel prix sanglant, non seulement le processus révolutionnaire chilien mais celui de tous les peuples latino-américains en lutte pour le socialisme.
Et si nous faisons cet urgent appel, camarade Président, c’est parce que nous pensons qu’il s’agit là de l’ultime possibilité d’éviter ensemble la perte par centaines de milliers de vies du meilleur de la classe ouvrière chilienne et latino-américaine.
Tout ou presque a déjà été dit à ce sujet. Depuis Errico Malatesta, jeune médecin, qui, à la fin du siècle dernier dans le sud de l’Italie, partait en guerre contre l’épidémie qui décimait la population en la déclarant être d’origine sociale et non bactérienne... en passant par Amadeo Bordiga qui, dans une série d’articles parus dans les années ’50, s’en prenait aux débordements du Pô pour les qualifier non de catastrophes naturelles, mais bien de catastrophes sociales (1).
On pourrait ajouter à la déjà trop longue liste de crimes que produit quotidiennement l’ordre capitaliste mondial, d’autres horreurs comme la réapparition de la tuberculose (2), cette vieille compagne de la misère des hommes. Car c’est bien de cela qu’il s’agit: de la généralisation de la misère, que, par euphémisme, les défenseurs du Veau d’or préfèrent masquer dans leur novlangue sous le vocable de nouvelle pauvreté (mais où donc avait-elle disparu?). Malgré ce que la Science et ses charlatans en blouse blanche prétendent, la maladie est un produit social, au même titre que les noyades dans le sud de la France, les inondations en Inde, les torrents de boue au Venezuela ou encore les bombardements en Serbie, en Tchétchénie...
L’exacerbation/accroissement des contradictions internes qui minent le capitalisme ont fait que le XXème siècle a fini comme il avait commencé, dans une orgie aspergée du sang des catastrophes, des guerres et des maladies. Aujourd’hui on peut aussi bien mourir de suicide, d’erreur médicale, de tremblement de terre, d’accident de travail, de guerre, de meurtre,... ou tout simplement de capital au quotidien: respirer l’air contaminé par le capital, manger de la nourriture polluée par le taux de profit. Jamais civilisation ne fut aussi meurtrière.
Mais en même temps jamais société de classe n’a autant justifié son existence, en s’auto-proclamant à ce point meilleur des mondes, bonheur universel, bien-être généralisé, etc.
Les tremblements de terre en Turquie, pendant l’été 1999, viennent illustrer de façon éclatante toutes ces critiques. Le maître-mot de la catastrophe permanente dans laquelle se débat quotidiennement l’humanité est: profit. Voyons comment la course au pognon a tout dirigé et a conduit en quelques secondes plus de 50.000 hommes à une mort certaine (3).
Depuis des siècles, la région est connue pour son activité sismique importante. Le capitalisme qui sait que cet endroit est dangereux et non-constructible a une fois de plus démontré son cynisme et sa monstruosité. Alors que la gigantesque basilique de Sainte-Sophie, bâtie à Istanbul il y a plus de 500 ans, a parfaitement résisté aux secousses, alors que les immeubles édifiés il y a plus de 10 ans ont encore relativement tenu le coup, les plus récents (pourvus de "tout le confort moderne", comme le vantaient les promoteurs immobiliers), se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Hasard? Malchance? Ou comme l’a évoqué sans rigoler le président de la république turc, Süleyman Demirel, "volonté de dieu"? Voire comme l’affirment les islamistes du parti REFA, "vengeance de Dieu contre la décadence des moeurs" qui caractériserait cette région?
Laissons toutes ces conneries aux cannibales de ce système anthropophage et aux moutons qui les suivent pour remonter un tout petit peu dans le temps jusqu’à la fin des années ’70 et trouver une explication rationnelle à ce nouvel amoncellement de cadavres. A cette époque, Istanbul, véritable poumon économique de la maison de commerce Turquie concentrait déjà environ deux millions d’habitants. Fin des années ’80, le supermarché URSS explose/implose et laisse la place à toute une série de nouvelles boutiques dans la région du Caucase et de la mer Caspienne: Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, Tchétchénie... de nouveaux espaces de valorisation sont ainsi dynamisés. Union sacrée, guerre avec les voisins, programmes d’austérité se succèdent dans cette région, bouleversant tout sur leur passage, aggravant (de notre point de vue) ou améliorant (du point de vue des exploiteurs) les conditions d’extraction de la plus-value, accroissant finalement le surtravail arraché à des prolétaires toujours plus terrorisés et soumis aux besoins du capital.
La Turquie n’échappe pas à ce mouvement: lieu stratégique, puisque passage obligé entre l’Europe et l’Asie, la région des détroits l’est aussi pour tout ce qui concerne le transport des marchandises, dont le pétrole du Caucase. En une décennie, le capital a implanté des centaines de grandes industries dans la région nécessitant une forêt de bras, de jambes et de têtes qu’Istanbul ne possédait pas. Nouvel "hasard" ou "volonté de Dieu", c’est au début des années ’80 sur fond de coup d’état militaire et de répression anti-ouvrière que se généralise la terrible guerre qui ravage les provinces du sud-est anatolien entre le gouvernement turc et les nationalistes kurdes du PKK. Refusant de participer à cette interminable boucherie et espérant trouver un endroit où vivre mieux, beaucoup de prolétaires de cette région ont rejoint Istanbul qui concentre officiellement aujourd’hui plus de dix millions d’habitants. Le capital a ainsi réussi en très peu de temps à déplacer une main-d’oeuvre très bon marché aux portes de l’Union Européenne, du Moyen-Orient et du Caucase. A tout cela, est venu s’ajouter un nouvel et gigantesque exode rural, touchant cette fois toutes les régions du pays qui a fait passer la population autour de cette métropole à plus de 25.000.000 d’habitants.
Des promoteurs immobiliers, vautours plus voraces les uns que les autres, se sont jetés sur ce marché juteux: la construction rapide de nombreuses cités-dortoirs pour parquer ce gigantesque afflux d’esclaves salariés. Des building-corbillards ont poussé comme des champignons dans toutes les villes entourant la dangereuse région des détroits. Les profits furent maximum: économie sur le matériel (un peu de ciment pour beaucoup de sable), achat de terrains non-constructibles donc moins chers, permis de construire accordés proportionnellement aux bakchichs reçus, plans architecturaux foireux, voire inexistants, normes antisismiques systématiquement revues à la baisse par les architectes et autres autorités compétentes, engagements d’ouvriers non-qualifiés (donc meilleur marché), cadences folles, négligences... ont constitué les éléments du cocktail mortel avec lequel tous ces faiseurs de profits ont tué. Les partis gouvernementaux en collaboration avec les banques en ont profité pour se sucrer au passage, forçant la plupart des prolétaires à devenir propriétaires de leur habitation grâce à des prêts alléchants. Beaucoup d’ouvriers, bossant comme des damnés depuis des décennies en Allemagne, Hollande, Belgique... ont vu dans l’achat de ces immondes bâtisses le couronnement de toute une vie de labeur. Ces ouvriers ont ainsi paradoxalement financé leur propre mort et celle de leur famille.
En 45 secondes l’hécatombe fut terrible. Des habitations de 7 à 8 étages ne dépassaient plus les 3 mètres de haut. Comme dans un mille-feuilles, les plaques de ciment se sont empilées les unes sur les autres n’offrant plus un seul espace de vie entre elles. Des gens paniqués sautaient de leur balcon pour échapper à la mort... qui les attendait sur le macadam. Des blessés agonisaient sans qu’on leur porte secours dans cet amoncellement de ruines. La raffinerie d’Izmit crachait ses flammes et inondait les alentours d’un nuage toxique. Et comme les secours n’arrivaient toujours pas, c’est à mains nues que la population commença à dégager les survivants. L’armée turque, présentée depuis plus de 75 ans comme le garant de l’Etat-providence et laïc, resta cantonnée dans ses casernes et n’intervint que 2 jours plus tard. Elle était occupée à enterrer d’abord les quelques militaires victimes du séisme. Notons que les bâtiments militaires ont beaucoup mieux résisté que les HLM, à l’image de la base de la NASA sise dans la région, et qui n’a pas bougé.
Durant la première semaine, rien ne sera fait pour porter sérieusement assistance aux victimes. Les hôpitaux s’étant eux aussi écroulés, c’est dans les stades que les premières ambulances conduisirent les rescapés. La bourgeoisie géra cette situation avec un mépris sans borne pour les prolétaires. Les survivants devaient faire des kilomètres, à pied, pour aller chercher de l’eau... qui se trouvait de l’autre côté de la base de la NASA. Au lieu de porter secours aux sinistrés, l’armée creusa rapidement des charniers avec ses bulldozers pour enterrer par paquets de trente les cadavres retirés des décombres. Les corps furent empilés dans les frigos des abattoirs de la ville d’Izmit en attendant d’être enterrés. Comble du cynisme, c’est au milieu de tonnes de viandes suspendues que les familles furent invitées à identifier les leurs. Hier chair à profit, aujourd’hui bête de boucherie. Voilà le sort peu enviable de l’ouvrier actuel en Turquie.
Cinquante mille morts, des conditions de sauvetage honteuses, un mépris évident des gouvernants... et peu, trop peu de réactions de la part du prolétariat. C’est à peine si quelques promoteurs furent coursés. La rage prolétarienne n’a pas pu véritablement s’exprimer. En tout cas, rien qui put rappeler la vague de lutte des années ’70 où s’étaient succédés grèves, manifestations, sabotages, occupations, actions directes en tout genre...
En l’absence évidente d’une quelconque réaction de notre classe en Turquie, une fraction de la bourgeoisie a eu beau jeu de mettre en avant un début de critique et d’opposition vis-à-vis du gouvernement, de l’armée, de la mafia. Ce sont les médias de gauche qui, semblant dénoncer le scandale, l’ont spectacularisé et donc récupéré. La fonction historique de l’opposition reste bien de canaliser notre rage et la dissoudre dans la réforme du capital. Elle dénonce la fraction rivale comme barbare, profitant de cette dynamique pour organiser l’encadrement du prolétariat, le dépossédant ainsi de sa capacité à réagir. Elle se présente du coup comme le vrai et l’unique défenseur de l’ouvrier, transformant celui-ci toujours plus puissamment en un citoyen discipliné et terrifié entre les mains sanglantes de l’Etat. Le capital sort gagnant en polarisant les prolétaires dans des intérêts contradictoires tout à fait secondaires, qui perpétuent le cadre de l’Etat bourgeois.
Une semaine après le séisme, les équipes internationales de sauvetage et les caméras étant rentrées gentiment chez elles, la bourgeoisie turque annonça très discrètement la phase numéro 2 de son plan de remise en ordre: le nettoyage. Les décombres furent évacués à coups de bulldozers, dégageant ainsi le terrain pour de nouvelles constructions génératrices de nouveaux profits. Certains bourgeois iront même encore plus loin en poussant les décombres à la mer, leur permettant ainsi de gagner sur elle de futurs terrains à bâtir. Depuis lors, les loyers ont atteint des chiffres astronomiques. Certains d’entre eux arrivant à l’équivalent d’un mois de salaire complet, alors que pendant l’hiver la majorité de la population a survécu dans des parcs ou sous des tentes... qui, dès les premières pluies, ont pris l’eau.
Dans la foulée, Ankara organisa aussi un certain "retour chez eux" de migrants originaires du Kurdistan turc. Autant profiter de la situation chaotique pour envoyer mourir un peu plus loin ces prolétaires en surplus. "Les usines étant par terre on n’a plus besoin d’eux", marmonnaient les patrons.
Depuis lors, les médias ont cessé toute critique vis-à-vis du gouvernement et de l’armée, et c’est bien sagement que tout le monde a relevé ses manches pour "rebâtir le pays sinistré". Les responsables de ces dizaines de milliers de morts et de blessés sans parler des centaines de milliers de sans-abri, traumatisés et dépossédés de tout, a enfin été trouvé par la police dans la poignée d’entrepreneurs véreux qui ont construit ces maisons-cimetières.
Le spectacle de leur procès s’annonce comme un grand moment de défoulement populaire. Ce sont eux qui paieront afin de permettre au système dans son ensemble de continuer à entasser des prolétaires dans des logements dangereux. C’est sur ces mêmes bases que, demain, la bourgeoisie pourra encore reconstruire ces saloperies qu’elle appelle maisons, appartements, villes... qui enseveliront lors d’une prochaine catastrophe naturelle des dizaines de milliers de victimes. Mais, tant que le prolétariat ne réagit pas, qu’est-ce que le capitalisme en a à foutre de tous ces cadavres, puisque son unique raison d’être est de faire du profit. Pour ses besoins, s’il est nécessaire de concentrer des centaines de millions de personnes dans des endroits aussi dangereux que la Turquie ou le Bangladesh (4), il le fera, peu importe ce qu’il en coûtera en vies humaines. Le capitalisme n’est plus à quelques millions de cadavres près. La destruction d’Istanbul est d’ailleurs annoncée, sérieusement, par les spécialistes, dans une trentaine d’années environ. Le capital pense-t-il à organiser l’éloignement des populations? Aux dernières nouvelles, non...
Le capital trouvera toujours quelque défenseur/gestionnaire pour nous dire que les catastrophes ne sont pas de sa faute, qu’elles sont naturelles, ou "envoyées par Dieu"... mais suffit-il aux prolétaires de croire aux dogmes du capital pour être sauvés? Question de croyance les cadavres, bien temporels, que charrient toutes les catastrophes naturelles? Question de croyance les maladies qui se développent actuellement? Question de croyance la viande, les oeufs et autres produits alimentaires dioxinés, hormonisés, génétiquement modifiés... qu’on nous fait avaler jour après jour?
Le capital est une catastrophe permanente pour l’humanité. Mais sa société du travail et de la soumission est transitoire. A tous les niveaux d’organisation de cette société, le profit se définit comme le but de l’activité humaine. Or, chaque instant de la sous-vie marchande nous montre, c’est-à-dire nous fait payer dans notre chair, que le capital a fait son temps, et qu’en concentrant au sein de la classe des exploités toute l’inhumanité de son système, il y concentre également toujours plus sa propre négation révolutionnaire, le prolétariat, une négation violente qui, en s’affirmant comme classe, affirme également la négation de toutes les classes et se prépare ainsi à engendrer une autre organisation de la production et de la reproduction de la vie, tournée vers la satisfaction des besoins. La communauté humaine mondiale est là, en devenir dans cette contradiction révolutionnaire, une contradiction que charrie la société de l’argent elle-même. Elle est là dans l’essoufflement de ce système-ci, dans les limites dans lesquelles il évolue: massacres, dépersonnalisation, pollution, difficulté de valorisation, etc. parce qu’en dépossédant toujours plus le prolétariat de toute parcelle d’humanité, elle détermine son existence en tant que fossoyeur du capital, accoucheur d’un nouveau monde. Le prolétariat est historiquement contraint et déterminé à se réveiller, taraudé par les misères quotidiennes, par les morts accidentelles occasionnées par l’exploitation accidentelle de nos patrons, par l’air suffocant, la bouffe insipide, l’eau polluée et les cadences qui n’arrêtent pas d’augmenter.
Malgré le caractère toujours plus catastrophique du développement capitaliste partout dans le monde, les Etats-Unis d’Amérique servent encore de repère pour tout un ensemble de crétins qui se sont taillés un costume de winner au début des années ’90 et qui, tout en gardant un oeil sur leurs derniers investissements boursiers, se persuadent de la pérennité du système en véhiculant poussivement l’image historique d’une "Amérique éternelle", tout à la fois symbole impérissable du "Nouveau Monde" et emblème d’un capitalisme qui n’en finit pas de réussir. Ce "Nouveau Monde" a beau avoir violemment englouti les rêves de millions d’immigrés partis vider les poubelles à New-York, il n’est pas un intellectuel qui à un moment ou l’autre, ne se sente obligé de ramener les clichés éculés d’une contrée où l’on peut arriver petit et pauvre, et repartir riche et énorme."L’Amérique n’est pas un pays libre. Les conditions économiques des ouvriers sont les mêmes qu’en Europe. Un esclave salarié est un esclave partout, quel que soit le pays où il est né, quel que soit le pays où il vit."A.Parsons, Correspondance, février 1884
Filtrés par le cinéma, les romans noirs et le journalisme tapageur, les USA apparaissent plus généralement bien sûr comme le pays de tous les excès, là où survivre se joue en termes de "gagne ou crève", mais c’est précisément derrière cet autre poncif que se terre confusément l’idée d’un pays, certes contradictoire et imparfait, mais où liberté et richesse ne sont pas incompatibles, et où chacun a finalement la possibilité de réussir, d’arriver.
Ces images d’Epinal ne résistent pas au moindre regard critique sur la réalité sociale nord-américaine, mais comme toutes les images, elles constituent néanmoins une force matérielle suffisante pour convaincre qu’un monde vraiment libre se cache derrière les excès de cette société. Ainsi, les images chaotiques de criminels poursuivis en hélicoptères et de gamins qui s’entre-tuent à coups de fusil dans les écoles se retrouvent pêle-mêle aux côtés des success stories hollywoodiennes et des portraits faussement rebelles qui défilent sur MTV pour naturaliser progressivement un monde fait de violence et d’injustice où l’homme est un loup pour l’homme, mais où une certaine liberté de comportement et de réussite justifierait les désagréments de la guerre de tous contre tous.
Le voile du mensonge et de l’idéologie une fois déchiré, il apparait vite que les Etats-Unis ne sont qu’une concrétisation supplémentaire d’un monde où les "libertés politiques" ne sont rien d’autre qu’un paravent pour l’esclavage salarié (cf. encadré p.46), un monde où règne non pas la liberté de conduite et d’attitude, mais bien plus essentiellement la liberté d’exploiter ou d’être exploité.
Le yuppie international n’a évidemment aucune intention d’élever sa capacité d’abstraction plus haut que le portefeuille qui lui sert de nombril et n’a donc cure de ces notions d’exploitation. Les yeux fixés sur les Etats-Unis, il véhicule comme tous ses supporters une conception de la liberté issue de la totale sujétion au "work, shopping and tv" et aux lieux communs que charrie cet asservissement, un univers fade et terne où l’individu brandit sa présomption à vivre libre en jurant qu’il ne vit que lorsqu’il travaille et qu’il n’existe que lorsqu’il consomme.
Le capitalisme imposant universellement sa dictature, cette conception de la liberté et de la réussite s’impose bien sûr également partout dans le monde, à Paris, Pékin et au Caire tout comme à Moscou, Téhéran ou Bagdad. Mais pour les laudateurs de l’argent et du clinquant, les Etats-Unis d’Amérique ont ce petit plus qui en ont fait un exemple inimitable, une figure de proue. La statue de la liberté à l’entrée de New-York, rappelle à tous ceux qui s’apprêtent à débarquer que l’on ne parlera pas ici d’exploitation, de classes sociales ou de plus-value, et que si l’on utilise le vocable "capitalisme", c’est comme synonyme de paix, richesse et développement. Le meilleur des mondes. "L’Amérique". Un monde sans marges et où tout est possible. Le pays le plus libre dans le plus libre des mondes.
Voici quelques morceaux choisis parmi les nombreux aspects que recouvrent la liberté au royaume de la démocratie...
En 1970, les Etats-Unis comptaient 200.000 détenus. En 1980, ils étaient 315.000 et en 1990, 739.000. Dix ans plus tard, fruit de la "tolérance zéro", la "décade des menottes" a fait exploser le nombre de prisonniers au royaume du libre individu. Deux millions de personnes se retrouvent aujourd’hui derrière les barreaux nord-américains pour saluer la modernité du nouveau millénaire. La population carcérale a décuplé en trente ans et compose une sorte d’énorme pays emprisonné sous les plis du drapeau étoilé. Il y a plus de prolétaires en tenue de détenu dans les prisons que de soldats sous l’uniforme dans toutes les forces armées américaines. Deux millions de prisonniers, cela constitue plus d’un quart de l’ensemble de la population carcérale mondiale officielle (1). Un quart des détenus du monde entier se trouvent aux pieds de l’immense maton que constitue la statue de la liberté.
Mais la célèbre statue américaine n’est pas qu’un gros surveillant, c’est aussi un "Big Killer", un énorme bourreau. Restons dans les chiffres pour d’autres records fort peu avenants. En 1999, une centaine de condamnés à mort ont été exécutés. Il s’agit du plus grand nombre de prisonniers exécutés depuis la fin de la guerre 1940-45. Le précédent record datait de... l’année précédente (68 exécutions en 1998). Et ces chiffres ne vont pas baisser puisque désormais, 38 Etats sur 50 font fonctionner des chambres de la mort aux Etats-Unis. Les candidats à la présidence des Etats-Unis se livrent actuellement un sordide duel autour du nombre de suppliciés qu’ils envoient à la mort. Georges W.Bush, gouverneur du Texas depuis 1995 a ainsi 112 exécutions à son actif personnel; son rival John Ellis tente de faire aussi bien en accélérant les condamnations en Floride, l’Etat dont il est le gouverneur. Ainsi, chaque année, pour l’ensemble des Etats-Unis, 300 nouvelles personnes se voient condamnées à la peine capitale. Comme les bourreaux n’en exécutent "que" une centaine par an, il y a actuellement 3.565 condamnés qui attendent dans les fameux "couloirs de la mort".
Des peines plus dures, des détentions toujours plus longues: c’est la clé de la politique de la bourgeoisie au niveau international, et les Etats-Unis en sont l’avant-garde.
Punir. Punir pour faire peur. Pousser les prolétaires à accepter de travailler à n’importe quelle condition pour éviter la prison ou la mort. Sévir pour décourager tous ceux qui, de plus en plus nombreux, tournent leurs regards vers la critique de la propriété privée. "Travailler ou crever" doit être le seul choix possible. Il s’agit donc de réprimer brutalement celui qui vole le riche, qui pille les magasins, qui survit de petits deals. Châtier durement, pour que celui qui n’a rien accepte malgré tout sa condition de prolétaire. Même si aucune possibilité de trouver du boulot ne lui est offerte et qu’il crève de faim, il faut que l’enfer vécu sur terre lui apparaisse préférable à l’emprisonnement, à la torture, à l’injection létale. Punir pour l’exemple.
Punir... et faire du profit. Car le capitalisme n’a pas de frontières et ce ne sont certes pas les murs d’une prison qui l’arrêteront.
Aux Etats-Unis, le monde de la libre entreprise a vite compris qu’un prisonnier ne vit aux dépens de l’Etat et ne constitue une charge que tant qu’il ne travaille pas. S’il travaille, il se transforme en un esclave (2) qui peut s’avérer fort rentable. Ainsi, en 1986 déjà, un certain Warren Burger, ancien juge de la Cour suprême, avait lancé un appel à transformer les prisons en "usines clôturées", demandant en gros que les prisons n’occasionnent plus de dépenses pour l’Etat, mieux, qu’elle se transforment en sources de profit. C’est désormais chose faite. La tendance va aujourd’hui vers l’exploitation croissante des emprisonnés. Pour un "salaire" d’environ 1 dollar l’heure, les détenus/esclaves sont forcés de travailler, que ce soit sous couvert de "programmes de réhabilitation" ou sous la menace de punitions sévères et de prolongement de la peine. Dans l’Oregon, la marque de blue jeans "Prison Blues" (sic!) prévoit de réaliser un chiffre d’affaire supérieur à 1,2 million de dollars par an. Dans d’autres régions (au Texas, en Louisiane, dans l’Arkansas), l’Etat fait travailler les prisonniers dans les champs, de force et sans les payer, sous la surveillance de gardes à cheval armés.
Pas de travail hors des murs de la prison? Ce n’est pas grave, il y en a à l’intérieur! C’est le sens de la remarque sarcastique d’un militant américain anti-prisons: "Comble de l’ironie, en même temps que le chômage augmente à l’extérieur, la délinquance et le nombre d’incarcérations qu’elle entraîne augmentent. Qu’est-ce qui empêche de penser que, d’ici quelques temps, on ne trouvera plus d’emplois nécessitant beaucoup de main-d’oeuvre non qualifiée ailleurs qu’en prison ou dans les pays du tiers-monde, où les gens travaillent dans les mêmes conditions. Et l’usine clôturée coïncidera avec la prison sans murs." (3) (Paul Wright, Esclaves de l’Etat, mai 1994)
Ceci dit, les apologues de la liberté et de la démocratie capitaliste se réfugieront derrière la notion d’excès pour affirmer que le nombre élevé de prisonniers, et leur utilisation comme esclaves, ne sont que le produit des défauts de la démocratie, toujours améliorable,... et que les prisons ou les condamnations, aussi encombrantes moralement soient-elles, ne sont finalement que le douloureux prix à payer pour que la majorité des gens puisse vivre en liberté, dans la sécurité et l’entente sociale.
Profitons-en donc pour parler maintenant un peu des hommes dits libres, ces habitants de la prison sans murs, pour reprendre l’image de notre dernière citation. Une métaphore très explicite du meilleur des mondes actuel qui, sous l’expression de la démocratie en tant que dictature des lois marchandes sur l’homme, parvient avec succès à nier les parois derrière lesquelles est journellement exploité le prolétariat.
Voilà bien le triomphe de la démocratie: réussir à banaliser un monde basé sur la violence faite à ceux qui travaillent, et où ceux-là même qui en sont les victimes quotidiennes n’aperçoivent même plus leurs surveillants ou leurs exploiteurs, et encore moins la réclusion dont ils sont l’objet.
Et pourtant, jamais l’environnement humain n’a été à ce point encombré de limites, de barrières, de ghettos, de grilles, de systèmes d’alarme, de caméras, de flics... Marchandise en liberté et humanité emprisonnée n’ont sans doute jamais autant rimé.
Los Angeles. Deuxième ville des Etats-Unis. Une des grandes villes du rêve américain. La côte ouest, le surf. Hollywood et Beverly Hills, l’avant-garde de ce que la société du capital propose comme futur.
Los Angeles est divisée en deux réalités sociales qui s’affrontent géographiquement dans des espaces tout autant clôturés. D’un côté, des quartiers fortifiés où paradent les riches, et où l’argent et tout ce qu’il y a de clinquant règne en maître, de l’autre des espaces de terreur tout aussi fermés où se concentrent les prolétaires les plus démunis, espaces dans lesquels les flics mènent une véritable guerre pour empêcher que les protestations qu’engendrent cette situation ne génèrent une réaction contre la propriété privée, contre les quartiers bourgeois.
Dans les deux cas, Los Angeles se présente comme une véritable forteresse, une "ville carcérale" selon l’expression de Mike Davis, qui ajoute: "on constate une tendance sans précédent à combiner l’urbanisme, l’architecture et les dispositifs policiers en une vaste entreprise de sécurité." (4)
La sécurité à Los Angeles est devenue une véritable psychose. Pour éviter la promiscuité, la bourgeoisie s’isole dans certains quartiers, se barricade dans des villas construites comme des châteaux-fort, et engage des agents de sécurité privés.
A Beverly Hills ou à Bel-Air, les maisons sont recomposées de manière à intégrer des dispositifs de sécurité ultra-sophistiqués, sur base du nouveau concept à la mode dans le secteur, la "sécurité absolue". Les architectes s’inspirent maintenant des techniques secrètes utilisées pour la construction des QG militaires ou des ambassades américaines à l’étranger, intégrant même des "pièces antiterroristes" auxquelles on accède par des panneaux coulissants et des portes dérobées. Les associations de riches propriétaires, lorsqu’ils paient pour leur sécurité, n’achètent plus seulement des agents de sécurité, mais un concept entier de sécurité incluant systèmes d’alarme, patrouilles, escortes personnelles et "réponse armée".
Le bourgeois qui veut aujourd’hui conserver sa liberté s’enterre lui-même dans de véritables silos à missiles, surveillés par une armée de sbires surarmés protégeant des pelouses parsemées de panneaux menaçant "Approchez et on tire" ("Armed Response"). Son quartier est entouré d’un véritable cordon de sécurité, avec des sortes de douanes interdisant l’accès aux non-résidents (5). Le désavantage pour la bourgeoisie est que ces barrières indiquent d’elles-mêmes l’endroit où placer les barricades lors de l’assaut à la propriété. La police et l’armée américaine l’ont bien compris qui, dès le déclenchement des émeutes de Los Angeles en 1992, ont concentré le maximum de leurs forces pour la protection de ces quartiers.
Mais la ville en liberté ne s’arrête pas aux camps retranchés des capitalistes, c’est évidemment l’ensemble du tissus urbain qui s’encaserne et s’embastille.
Tout ce qui pouvait subsister comme espace de jonction entre personnes de quartiers différents, tout ce qui pouvait susciter la rencontre, la discussion, le jeu est supprimé. Les rues n’appartiennent plus aux piétons, elles sont devenues, sous les "audaces" des urbanistes (6), de simples réseaux d’évacuation d’automobilistes surveillés un peu partout par des caméras de la police. Les parcs sont éliminés, et dans ceux qui restent, on fait la chasse au prolo sans toit qui tente encore de s’y réfugier. Les plages de Los Angeles restées célèbres pour les virées nocturnes qu’y menaient tant de gamins sur leur planche de surf sont maintenant fermées la nuit; la police y patrouille en 4 x 4 ou en hélicoptère. Substituts de cette répression achevée de toute sociabilité, les mégacomplexes commerciaux et les immenses galeries marchandes haut de gamme se sont multipliés. On y croise dans un trop plein de lumières des vendeurs de high-tech et de très riches peaux liftées venues acheter leurs bimbeloteries en or.
Dans les quartiers plus prolétariens, le style "prison" se retrouve également partout. Bien sûr, la difficulté de distinguer architecturalement écoles, hôpitaux et prisons a toujours existé; l’originalité de Haagen Development, un des plus grands réseaux de centres commerciaux de Californie du Sud, réside dans le fait d’avoir conçu, à Watts et dans d’autres quartiers "hard" de Los Angeles, des supermarchés reprenant carrément le célèbre plan panoptique que Jeremy Bentham avait proposé pour sa prison modèle au XIXè siècle. Ici, l’observatoire circulaire et central où sont installés les bureaux de la surveillance et un poste de police, contrôle tout ce qui se passe dans et autour du magasin: l’ouverture des portes aux livreurs, les caméras vidéos équipées de détecteurs de mouvements, les puissants éclairages dissuasifs... Pour couronner le tout et bien confirmer l’univers carcéral dans lequel se déplace les acheteurs, l’ensemble du centre Martin-Luther-King (c’est le nom du supermarché de Watts) est entouré de grilles en fer forgées de 2,40m de haut semblables à celles qui protègent les grandes propriétés privées dans les quartiers huppés, mais en moins chic.
Dans la même logique de liberté et de sécurité, certaines cités prolétariennes où dominent les logements sociaux ont désormais également été enfermées dans des grilles. Il en va ainsi, d’Imperial Courts, une cité adjacente au centre commercial dont nous venons de parler. Un poste de police y a été installé, assorti de contrôles d’identité obligatoire. Les flics rappellent fréquemment de quelle liberté jouissent ceux qui n’ont rien: arrestations et fouilles se multiplient auprès de ceux qui sont étrangers au secteur, et les résidents du quartier qui traînent dehors un peu trop tard sont reconduits chez eux par la police. "C’est le prix de votre sécurité", leur dit-on.
Au XIXème siècle, la bourgeoisie avait adopté les idées les plus progressistes pour maintenir le prolétariat sous contrôle: les phalanstères d’Owen, Fourier et Cabet redessinées dans le paysage industriel, concentraient les ouvriers à proximité de leur lieu de travail, limitant ainsi les dangers d’errances et d’aventures que comportait un trop long trajet entre la mine et la maison. A l’aube du IIème millénaire, c’est au nom de la sécurité que la police démocratique américaine enferme les quartiers ouvriers derrière de hautes grilles, et c’est pour rendre chacun plus libre dans son quartier qu’elle arrête, fouille, contrôle et cantonne les prolétaires dans leurs districts respectifs.
Comme on le voit, c’est l’ensemble du panorama urbain qui ressemble de plus en plus à un grand bureau de police, à une immense prison. Et cela au sens propre, parce qu’une sécurité et une répression accrue implique également plus d’espace pour, d’une part, administrer et former les policiers et, d’autre part, enfermer ceux, toujours plus nombreux, qui enfreignent les lois. Cela se traduit notamment par l’énorme boulimie d’espace dont fait preuve le LAPD, la police de Los Angeles. Ainsi, East Los Angeles, qui regroupe déjà dans un rayon de 5 kilomètres six prisons fédérales, c’est-à-dire près de 25 000 prisonniers (la plus grande concentration carcérale aux Etats-Unis), a mis sur pied un véritable projet d’urbanisme policier visant à répondre aux besoins croissants en matière carcérale. "On dirait qu’ils veulent faire de notre quartier une colonie pénitentiaire", dénonce un membre d’une association en lutte contre la construction de nouvelles prisons.
D’autre part, les services de répression liés à l’immigration se développent également dans la ville: confrontés eux aussi à une surpopulation record, ils réquisitionnent motels et appartements gérés par des entreprises privées pour servir de prisons auxiliaires et y enfermer les demandeurs d’asiles et les clandestins.
Des appartements servant de geôles côtoient désormais des quartiers habités, des tours remplies de prisonniers voisinent avec des hôtels pour touristes, des buildings anonymes au look futuriste dissimulent des prisons pour narco-trafiquants. On ne sait plus désormais si c’est la prison qui est dans la ville, ou si c’est la ville qui est en prison. Architecturalement, cela se traduit par la tentative de fondre de plus en plus l’espace carcéral dans l’espace urbain. "Ainsi, non sans ironie," note encore Mike Davis, "alors que les immeubles et les maisons ressemblent de plus en plus à des prisons ou à des forteresses, l’architecture des prisons tend à adopter une apparence esthétique." (7)
Bourgeois cloîtrés sous abri, quartiers ouvriers enfermés derrière des grilles, parcs et plages interdits au public, supermarchés "panoptiques", paysage carcéral omniprésent. "La liberté, c’est la prison", aurait pu dire Orwell. Et tout cela, sous le regard attentif du LAPD qui, plus progressiste et futuriste que ce que n’importe quel apologue du développement continu aurait jamais rêvé, vient coiffer le panorama californien de ses caméras vidéos à tous les carrefours, de ses patrouilles motorisées ou aériennes, de ses brigades anti-terroristes, de ses systèmes de communication ultrasophistiqués,...
Les hélicoptères du LAPD assurent en moyenne 19 heures de surveillance quotidienne des quartiers dits "ultrasensibles" (plus que l’armée britannique dans le ciel de Belfast). La police de Los Angeles gère également un énorme centre d’informations et de renseignements dont le commandement est installé dans un véritable bunker aménagé dans les sous-sol de l’hôtel de ville, et dont l’infrastructure est enfouie dans un site souterrain. L’étape suivante dans la garantie de "liberté et de sécurité" est le marquage électronique généralisé des biens et des personnes, une proposition de l’ancien chef de la police de Los Angeles, Ed Davis, aujourd’hui sénateur républicain de Californie (8). La devise de la police de Los Angeles? To protect and serve. Qui en aurait douté!
Mais bien plus que le nombre d’ordinateurs ou d’hélicoptères dont disposent les flics dans les villes, ce qui exprime sans doute le plus violemment l’inhumanité de ces systèmes capitalistes urbains en pleine décomposition, c’est l’acharnement avec lequel des êtres humains, tout entiers dévorés par l’imbécile "liberté" de cette dynamique de fric qui cherche sans repos à faire plus de fric, pensent, raisonnent et créent dans une logique de profit, des instruments pour emmerder l’humanité -et plus particulièrement l’humanité non rentable, excédentaire-, pour lui faire mal au sens propre, pour l’humilier.
Que peut-il bien rester comme fierté à ces types -fonctionnaires, urbanistes, politiques, fabricants, etc- qui passent leur temps à concevoir les moyens les plus sournois d’agresser notre classe, de la terroriser jusqu’aux tréfonds de son être, en s’acharnant plus particulièrement sur ceux qui n’ont plus rien, en les poursuivant, en les persécutant jusque dans les parcs publics et les souterrains, les métros?
"Dans la croisade sans merci que la ville mène contre les pauvres et les sans-abri, les espaces et les équipements publics sont traités de façon à leur rendre la vie impossible (...) Quelques tentatives de déplacement en masse des indigents ont vu le jour: certains ont ainsi été déportés dans une espèce de ferme à la limite du désert, d’autres ont été confinés dans des camps de montagne. L’opération la plus connue a consisté à transformer un vieux ferry du port en centre d’internement. Mais ces "solutions finales" ont toutefois été rejetées par des élus locaux peu enclins à accueillir cette population dans leur circonscription. Reprenant délibérément le langage de la guerre froide, la ville a alors développé l’idée d’un containment des sans-abri dans le périmètre de Skid Row, sur la partie est de la 5è rue, transformant de fait le quartier en un vaste dépôt de mendicité à ciel ouvert. Mais les effets pernicieux de cette stratégie se sont vite faits sentir. La concentration sous un espace restreint de tout le désespoir et de toute la pauvreté, combinée à l’absence de politique de logement social, a fait de Skid Row le quartier probablement le plus dangereux du monde, où les "Egorgeurs", les "Vautours de la nuit" et autres prédateurs font régner la terreur. Dès la tombée du jour, les sans-abri tentent de fuir le "Nickle" pour trouver un coin plus sûr dans un autre quartier du centre. Pour parer à ces déplacements pendulaires, la ville resserre encore un peu plus l’étau en encourageant le harcèlement policier et l’installation d’équipements dissuasifs.
L’un des plus fréquents et des plus hallucinants de ces équipements est le nouveau banc du réseau de transport en commun Rapid Transit District. Sa forme en barillet, n’offrant qu’une assise minimale, ne permet qu’une attente inconfortable et interdit toute position couchée. Ces bancs "anticlochard" (9) ont été massivement installés autour de Skid Row. Une autre invention grand-guignolesque a été l’utilisation ingénieuse du système d’arrosage installé lors de la création du Skid Row Park, au croisement de la 5è Rue et de Hell Street. Pour empêcher que les sans-abri ne viennent dormir dans le parc -comme si l’on voulait réserver son usage au trafic de drogue et à la prostitution-, un arrosage nocturne est déclenché de façon irrégulière, inondant à l’improviste les dormeurs indésirables. Le système a aussitôt été repris par des commerçants pour évincer les sans-abri des abords de leur immeuble. On a vu également les restaurants et les commerces installer des enclos sophistiqués autour de leurs poubelles. Bien que personne à Los Angeles n’ait encore proposé de mettre du cyanure dans les poubelles, comme ce fut le cas à Phoenix il y a quelques années, on a cependant pu voir un restaurant de poisson célèbre investir 12 000 dollars dans ce qui devrait être le fin du fin en matière de lutte contre la fuite des restes de table dans les cabas des affamés: une benne équipée de barreaux d’un centimètre d’épaisseur, avec cadenas en acier spécial et piques sadiques tournés vers ceux qui seraient tentés par le précieux tas de têtes de poissons moisies et de frites rances." (10)
La violence bourgeoise s’attaque sans discontinuer, et par tous les moyens, à tous ceux qui n’ont pour seule propriété que leur force de travail. Cet acharnement est aussi impitoyable qu’infini, et ce n’est pas devant le dénuement, devant la dépossession totale qu’il s’arrêtera. Au contraire, il faut terroriser plus encore ceux qui n’ont même plus la force de bosser, pour que cela serve d’exemple aux autres. Il faut persécuter l’indigent, poursuivre le sans-toit, et tous ceux qui errent lamentablement d’un coin à l’autre de la ville sans plus aucune possibilité de survivre. Et quand bien même ces prolétaires utilisent la seule force qui leur reste pour aller s’écrouler dans un parc, sous un arbre, il faut encore et toujours les harceler, inventer de nouvelles méthodes de terreur pour les réveiller la nuit, à l’improviste, en les aspergeant d’eau froide, et les chasser vers un autre nulle part.
Frapper un homme à terre! Voilà le seul courage qui reste aux exploiteurs, à tous ces bourgeois hypocrites qui ont planqué leurs désirs dans des coffres-fort, à tous ces méprisables politiciens démocrates ou républicains qui se sont honteusement réfugiés sous les jupons en pierre de la statue de la liberté pour commettre leurs crimes.
Restaurants de luxe et piques sadiques, indigence et "solutions finales". Au pays de la liberté, tous les coups sont permis. Libres de crever de faim, les sans-rien de Los Angeles jouissent également de la liberté d’être parqués dans un désert, déplacés dans la montagne ou cantonnés sur un vieux ferry; quant à ceux qu’ils dérangent, ils ont le droit de les rouer de coups. Le raffinement dont fait preuve l’Etat pour torturer les prolétaires n’a même plus ici le ridicule comme limite: des sièges pour empêcher de s’asseoir!
Des "hommes libres" enfermés dans leurs quartiers, enterrés dans leurs villas, retranchés dans d’immenses villes carcérales aux allures toujours plus orwelliennes. Des prisonniers en nombre toujours croissant, des prisonniers qu’on utilise comme esclaves. L’idéal capitaliste irradie la terre de sa véritable devise: "exploiter, surveiller et punir".
Historiquement, l’enfermement et la répression du prolétariat sont bien sûr indissociables du capitalisme, et ne datent pas d’aujourd’hui. Depuis les Workhouses européennes des siècles passés jusqu’au Ghetto de Varsovie pendant la dite Deuxième guerre mondiale, des cités ouvrières anglaises du début du siècle aux actuels camps de la bande de Gaza, partout dans le monde et à toutes les époques, l’Etat bourgeois a défendu le progrès et le développement capitaliste en concentrant avec plus ou moins d’autorité, des franges entières de prolétaires derrière des grilles, dans des camps, des hôpitaux, des HLM...
La chasse impitoyable aux prolétaires dénués de toute ressource n’a rien de bien moderne non plus. A Londres au début du siècle, il y avait 35.000 sans-abri, comme on les nomme aujourd’hui, à qui l’administration britannique interdisait de dormir la nuit sur la voie publique. Finalement, entre le passage du livre de Mike Davis que nous venons de citer et qui se penche sur le sort des "déclassés" de Los Angeles en 1996, et les récits de Jack London dans "Le peuple d’en bas" (11) décrivant les quartiers miséreux de Londres en 1902, il n’y a pas vraiment de différence. Peut-être un peu plus de raffinement dans la persécution moderne: des systèmes d’arrosage nocturnes pour compléter les matraquages... Peut-être aussi un peu plus de cynisme de la part des bourgeois actuels: "Dans les sociétés civilisées, les rues ne sont pas faites pour dormir. Il y a des chambres à coucher pour cela", déclarait le maire de New York, Rudolph Giuliani, en novembre 1999.
Rien de nouveau sous le soleil poussiéreux du capitalisme donc, mais une confirmation supplémentaire, en Amérique du Nord comme ailleurs, du rapport existant entre le spectacle capitaliste fait de réussite, de technologie, de mode et sa triviale banalité faite de misère, de contraintes et d’enfermement. Plus le capitalisme développe la liberté d’entreprendre et d’exploiter, plus se développent l’emprisonnement et la répression à l’autre pôle (12).
Aux Etats-Unis comme partout, le capitalisme se renforce en contrôlant et en incarcérant massivement. Et la "plus grande démocratie du monde", comme elle aime à se nommer, ressemble de plus en plus à une énorme prison.
Mais sans s’en rendre compte, elle contient également une tempête sociale, un ouragan qui ne demande qu’à éclater. On ne maintient pas éternellement un système en place par la répression et l’emprisonnement d’un nombre toujours plus grand d’êtres humains. Chaque jour un millier de prolétaires américains entrent en prison, et cinq cents en sortent.
"Qu’est-ce qui se passera quand, d’ici cinq ou dix ans, sortira de prison un million de jeunes détenus que la prison aura certainement endurcis et aigris?" se demande le directeur d’un Institut sur les problèmes de la justice à Washington, Jason Ziederberg.
Et qu’est-ce qui se passera quand les prolétaires "du dehors", virés par milliers des entreprises qui ne les veulent plus, entassés toujours plus nombreux dans des ghettos, contrôlés, fouillés et frappés, chercheront à organiser leur propre réponse de classe?
Qu’est-ce qui se passera quand, lassé d’entendre les politiciens nommer "liberté" la prison dans laquelle il évolue, le prolétariat reprendra son futur en main, et dépassera les questions de clans, d’ethnie, de nation, pour offrir une réponse généralisée à l’Etat bourgeois?
Plus globalement, le capital est incapable de concevoir que la subversion de son ordre n’est pas produit de quelques cerveaux bourrés d’intentions révolutionnaires, mais résulte bel et bien directement de sa propre existence, de sa propre matière en décomposition. Que des minorités, puis des groupes, puis des masses de prolétaires s’associent spontanément pour s’attaquer à la propriété privée, pour créer leurs propres fêtes dans la rue, leurs propres jeux (13), et jeter les bases de la défaite du Vieux Monde en s’organisant en conséquence, voilà quelque chose d’impossible à saisir pour la bourgeoisie. Incapable de faire le lien entre les tortures croissantes que l’Etat inflige aux exploités et la haine de la société de classe qui jette soudainement le prolétariat dans la rue, la bourgeoisie s’est plus d’une fois réveillée avec la gueule de bois.
A Los Angeles ou autre part dans le monde, un jour ou l’autre, se produira ce qui s’est produit à Watts en 1965 ou à Southcentral en 1992, à la différence près que chaque soulèvement fournit son cortège de leçons supplémentaires, et qu’associé à la décomposition toujours plus profonde du monde capitaliste, se rapproche chaque fois plus le moment où le prolétariat de Los Angeles, des Etats-Unis et d’ailleurs reliera ses colères à l’ensemble des leçons historiques de sa classe, s’organisera en parti et définira des objectifs internationalistes. Et de cette gueule de bois là, la bourgeoisie et tout son système de mort risquent de ne pas se relever.